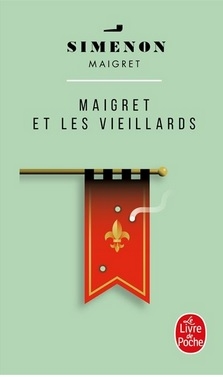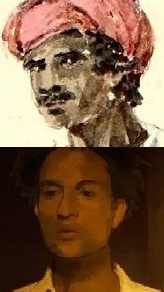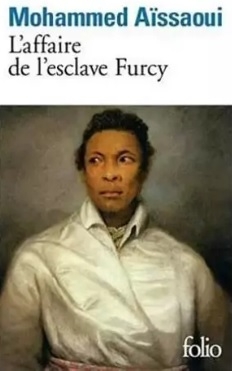jeudi, 26 février 2026
Rue Malaga
Maria Angeles (Carmen Maura, formidable) est ce qu'en France on appellerait une "pied-noir". (Voir en fin de billet.) Espagnole née dans le Maroc colonial (sans doute au début des années 1940), plus précisément à Tanger, dans le quartier traditionnel de la Kasbah, elle s'est ensuite installée dans l'appartement familial acquis dans la ville européenne.
Le début met en scène le bain de jouvence que constitue pour Maria l'atmosphère de cette ville cosmopolite (où l'on parle aussi bien l'arabe dialectal que l'espagnol), avec ses petites rues colorées, ses marchés odorants, le cri des mouettes et l'air marin, celui du détroit de Gibraltar. Une belle scène montre la septuagénaire en train de cuisiner, à partir des ingrédients qu'elle a achetés ce jour-là... Cela donne bigrement faim.
Ce petit paradis menace de s'effondrer à l'arrivée de sa fille unique (interprétée par Marta Etura, vue notamment dans Eva). Celle-ci a fait sa vie en Espagne, du côté de Madrid... et elle est la véritable propriétaire de l'appartement, qu'elle veut vendre. Le scénario a l'habileté de ne pas caricaturer les positions des deux femmes. Ainsi, on n'a pas fait de la fille une jeune pétasse égoïste. Les deux femmes sont dans une situation financière délicate. La mère a pour seul revenu la pension de réversion de son défunt époux et s'en sort parce qu'elle n'a pas de loyer à payer et qu'elle bénéficie de l'aide de certains habitants de ce quartier populaire (loin des fastes de la ville moderne, aménagée plus récemment). La fille, infirmière, ne gagne que 1700 euros par mois, avec deux enfants à charge... et un ex-mari qui ne lui facilite pas la tâche. De bonne composition, elle propose à Maria de venir vivre avec eux à Madrid. Ainsi, elle verrait plus souvent ses petits-enfants. L'autre solution serait d'emménager dans l'EHPAD espagnol local (à Tanger donc), gratuit pour les Ibériques natifs de la ville... mais Maria en vient à envisager une autre possibilité.
La seconde partie du film développe cette troisième solution, que je ne vais pas révéler, bien sûr. Sachez seulement qu'elle s'appuie, entre autres, sur les talents de cuisinière de Maria, sur l'entraide... et sur certains péchés mignons des jeunes mecs du coin. C'est à la fois inventif et savoureux.
Dans cette séquence, un homme prend de l'importance, dans le scénario comme dans la vie de Maria. Pourtant, au départ, rien ne destinait l'antiquaire à jouer un tel rôle. Cette évolution est amenée doucement, délicatement, avec humour et tendresse. La cinéaste Maryam Touzani filme ces corps âgés avec dignité.
A intervalle régulier, de l'humour est instillé dans cette histoire assez mélancolique, au fond. Quand elle s'énerve, la langue de Maria devient fourchue, piquante... pour notre plus grand plaisir. Je signale aussi certains moments comiques, lorsque l'héroïne rencontre sa dernière amie espagnole encore en vie (les autres se trouvant en Espagne... ou au cimetière). Celle-ci est une nonne, qui a fait vœu de silence... mais est assez expressive. Leurs échanges ne manquent pas de sel !
Je laisse à chacun(e) le soin de découvrir comment tout ceci se termine. Baignant dans une belle luminosité et des couleurs chatoyantes, ce film est une petite perle à ne pas manquer.
P.S.
Ma seule réserve porte sur un point de la caractérisation du personnage de Maria. Au tout début, elle nous est présentée comme faisant étant issue de l'exil de républicains espagnols, fuyant le franquisme après la guerre civile (1936-1939). Elle est donc du côté du BIEN.
Historiquement, ces républicains ont d'abord fui en France (puis en Amérique latine). Une fraction d'entre eux s'est bien retrouvée en Afrique du Nord, mais dans la région sous domination française : surtout en Algérie (où ils n'ont pas souvent été bien traités d'ailleurs), un peu en Tunisie, mais très peu au Maroc. Tanger, ville internationale, fut, à partir de 1940, occupée par les troupes franquistes. Il y a donc fort peu de chances que les parents de Maria, s'ils étaient des républicains espagnols, aient cherché à se réfugier dans cette ville.
Cet accommodement avec la réalité historique résulte sans doute de la gêne éprouvée vis-à-vis de la période coloniale. De 1912 à 1956, le Maroc fut un protectorat franco-espagnol. (Dans le film, la présence des vestiges du Théâtre Cervantès en est une trace.) Or, de nos jours, dans le monde culturel dominant, la colonisation est perçue comme n'ayant apporté que du mal (la domination politique, les mauvais traitements, l'exploitation économique, l'acculturation...). Les adultes en quête de prêt-à-penser peinent à concevoir que, de temps à autre, l'existence ait pu être agréable lors de la période coloniale, au point que des relations d'amitié sincères soient nées entre Marocains et Européens. Dans le film, Maria et son époux sont restés dans le Maroc devenu indépendant (ou l'anti-occidentalisme primaire fut moins développé qu'en Algérie, par exemple).
15:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Rue Malaga
Maria Angeles (Carmen Maura, formidable) est ce qu'en France on appellerait une "pied-noir". (Voir en fin de billet.) Espagnole née dans le Maroc colonial (sans doute au début des années 1940), plus précisément à Tanger, dans le quartier traditionnel de la Kasbah, elle s'est ensuite installée dans l'appartement familial acquis dans la ville européenne.
Le début met en scène le bain de jouvence que constitue pour Maria l'atmosphère de cette ville cosmopolite (où l'on parle aussi bien l'arabe dialectal que l'espagnol), avec ses petites rues colorées, ses marchés odorants, le cri des mouettes et l'air marin, celui du détroit de Gibraltar. Une belle scène montre la septuagénaire en train de cuisiner, à partir des ingrédients qu'elle a achetés ce jour-là... Cela donne bigrement faim.
Ce petit paradis menace de s'effondrer à l'arrivée de sa fille unique (interprétée par Marta Etura, vue notamment dans Eva). Celle-ci a fait sa vie en Espagne, du côté de Madrid... et elle est la véritable propriétaire de l'appartement, qu'elle veut vendre. Le scénario a l'habileté de ne pas caricaturer les positions des deux femmes. Ainsi, on n'a pas fait de la fille une jeune pétasse égoïste. Les deux femmes sont dans une situation financière délicate. La mère a pour seul revenu la pension de réversion de son défunt époux et s'en sort parce qu'elle n'a pas de loyer à payer et qu'elle bénéficie de l'aide de certains habitants de ce quartier populaire (loin des fastes de la ville moderne, aménagée plus récemment). La fille, infirmière, ne gagne que 1700 euros par mois, avec deux enfants à charge... et un ex-mari qui ne lui facilite pas la tâche. De bonne composition, elle propose à Maria de venir vivre avec eux à Madrid. Ainsi, elle verrait plus souvent ses petits-enfants. L'autre solution serait d'emménager dans l'EHPAD espagnol local (à Tanger donc), gratuit pour les Ibériques natifs de la ville... mais Maria en vient à envisager une autre possibilité.
La seconde partie du film développe cette troisième solution, que je ne vais pas révéler, bien sûr. Sachez seulement qu'elle s'appuie, entre autres, sur les talents de cuisinière de Maria, sur l'entraide... et sur certains péchés mignons des jeunes mecs du coin. C'est à la fois inventif et savoureux.
Dans cette séquence, un homme prend de l'importance, dans le scénario comme dans la vie de Maria. Pourtant, au départ, rien ne destinait l'antiquaire à jouer un tel rôle. Cette évolution est amenée doucement, délicatement, avec humour et tendresse. La cinéaste Maryam Touzani filme ces corps âgés avec dignité.
A intervalle régulier, de l'humour est instillé dans cette histoire assez mélancolique, au fond. Quand elle s'énerve, la langue de Maria devient fourchue, piquante... pour notre plus grand plaisir. Je signale aussi certains moments comiques, lorsque l'héroïne rencontre sa dernière amie espagnole encore en vie (les autres se trouvant en Espagne... ou au cimetière). Celle-ci est une nonne, qui a fait vœu de silence... mais est assez expressive. Leurs échanges ne manquent pas de sel !
Je laisse à chacun(e) le soin de découvrir comment tout ceci se termine. Baignant dans une belle luminosité et des couleurs chatoyantes, ce film est une petite perle à ne pas manquer.
P.S.
Ma seule réserve porte sur un point de la caractérisation du personnage de Maria. Au tout début, elle nous est présentée comme faisant étant issue de l'exil de républicains espagnols, fuyant le franquisme après la guerre civile (1936-1939). Elle est donc du côté du BIEN.
Historiquement, ces républicains ont d'abord fui en France (puis en Amérique latine). Une fraction d'entre eux s'est bien retrouvée en Afrique du Nord, mais dans la région sous domination française : surtout en Algérie (où ils n'ont pas souvent été bien traités d'ailleurs), un peu en Tunisie, mais très peu au Maroc. Tanger, ville internationale, fut, à partir de 1940, occupée par les troupes franquistes. Il y a donc fort peu de chances que les parents de Maria, s'ils étaient des républicains espagnols, aient cherché à se réfugier dans cette ville.
Cet accommodement avec la réalité historique résulte sans doute de la gêne éprouvée vis-à-vis de la période coloniale. De 1912 à 1956, le Maroc fut un protectorat franco-espagnol. (Dans le film, la présence des vestiges du Théâtre Cervantès en est une trace.) Or, de nos jours, dans le monde culturel dominant, la colonisation est perçue comme n'ayant apporté que du mal (la domination politique, les mauvais traitements, l'exploitation économique, l'acculturation...). Les adultes en quête de prêt-à-penser peinent à concevoir que, de temps à autre, l'existence ait pu être agréable lors de la période coloniale, au point que des relations d'amitié sincères soient nées entre Marocains et Européens. Dans le film, Maria et son époux sont restés dans le Maroc devenu indépendant (ou l'anti-occidentalisme primaire fut moins développé qu'en Algérie, par exemple).
15:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 25 février 2026
Les "Riton" 2025
En décembre-janvier derniers, j'ai eu la flemme... Mais l'approche des César comme des Oscars m'incite à proposer mon palmarès, moulé à la louche, roulé sous les aisselles, garanti sans paillettes ni OGM.
Riton de la délicatesse des sentiments : Touch - Nos étreintes passées (pas loin de la médaille d'or olympique)
Riton de l'animation franco-japonaise : Amélie et la métaphysique des tubes
Riton de l'animation pas du tout japonaise : Zootopie 2
Riton de l'animation irrévérencieuse : Les Bad Guys 2
Riton de la comédie irrespectueuse : La Femme la plus riche du monde
Riton du film malpensant : Eddington (pas loin du podium)
Riton du film philanthrope : Predator - Badlands
Riton du film intéressé : Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère)... principal rival de Touch
Riton du film indélicat : The Brutalist (pas loin du podium non plus)
Riton du film démembré : Novocaïne
Riton du film bien membré : Vermiglio
Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde Guerre mondiale : Berlin, été 42
Riton du film antinazi subtil : La Disparition de Josef Mengele (pas loin du podium, lui aussi)
Riton du film dénonçant une dictature : Je suis toujours là (podium, podium, quand tu nous tiens)
Riton du film post-dictatorial : Un Simple Accident
Riton de la semi-mythomanie historique : Eleanor the Great
Riton du film évoquant les conséquences d'un régime totalitaire : Voyage avec mon père
Riton de la fiction quasi documentaire : 5 septembre (encore un "film de l'année" potentiel)
Riton du documentaire fictionné : Le Garçon (un des films de l'année, injustement méconnu)
Riton de la cinéphilie : Lumière, l'aventure continue
Riton du documentaire militant : Le Chant des forêts (potentiel film de l'année)
Riton agricole : Bergers (purée, j'adore aussi !)
Riton de la complicité homme-animal : Black Dog
Riton de la plénitude solitaire : Lady Nazca (candidat sérieux au podium)
Riton de l'incomplétude multiple : Mickey 17 (dans le top 10 ?)
Riton de la multitude numérique : Tron - Arès
Riton de la politique fiction : Bugonia
Riton de la justice fiction : Je le jure
Riton de l'injustice : Julie se tait
Voilà. Pas plus que les années précédentes, je ne suis parvenu à trancher. Mon florilège compte une trentaine de films, onze me semblant au-dessus du lot. J'ai tenu à terminer par quelques longs-métrages français, ceux-ci étant peu présents dans mon palmarès... et pour cause : en général, le cinéma hexagonal ne me parle pas, ou m'ennuie, me déçoit.
Ceci dit, de mon point de vue, l'année 2026 a plutôt bien commencé pour les productions françaises, qui seront peut-être davantage distinguées l'an prochain.
11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Les "Riton" 2025
En décembre-janvier derniers, j'ai eu la flemme... Mais l'approche des César comme des Oscars m'incite à proposer mon palmarès, moulé à la louche, roulé sous les aisselles, garanti sans paillettes ni OGM.
Riton de la délicatesse des sentiments : Touch - Nos étreintes passées (pas loin de la médaille d'or olympique)
Riton de l'animation franco-japonaise : Amélie et la métaphysique des tubes
Riton de l'animation pas du tout japonaise : Zootopie 2
Riton de l'animation irrévérencieuse : Les Bad Guys 2
Riton de la comédie irrespectueuse : La Femme la plus riche du monde
Riton du film malpensant : Eddington (pas loin du podium)
Riton du film philanthrope : Predator - Badlands
Riton du film intéressé : Comment devenir riche (grâce à sa grand-mère)... principal rival de Touch
Riton du film indélicat : The Brutalist (pas loin du podium non plus)
Riton du film démembré : Novocaïne
Riton du film bien membré : Vermiglio
Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde Guerre mondiale : Berlin, été 42
Riton du film antinazi subtil : La Disparition de Josef Mengele (pas loin du podium, lui aussi)
Riton du film dénonçant une dictature : Je suis toujours là (podium, podium, quand tu nous tiens)
Riton du film post-dictatorial : Un Simple Accident
Riton de la semi-mythomanie historique : Eleanor the Great
Riton du film évoquant les conséquences d'un régime totalitaire : Voyage avec mon père
Riton de la fiction quasi documentaire : 5 septembre (encore un "film de l'année" potentiel)
Riton du documentaire fictionné : Le Garçon (un des films de l'année, injustement méconnu)
Riton de la cinéphilie : Lumière, l'aventure continue
Riton du documentaire militant : Le Chant des forêts (potentiel film de l'année)
Riton agricole : Bergers (purée, j'adore aussi !)
Riton de la complicité homme-animal : Black Dog
Riton de la plénitude solitaire : Lady Nazca (candidat sérieux au podium)
Riton de l'incomplétude multiple : Mickey 17 (dans le top 10 ?)
Riton de la multitude numérique : Tron - Arès
Riton de la politique fiction : Bugonia
Riton de la justice fiction : Je le jure
Riton de l'injustice : Julie se tait
Voilà. Pas plus que les années précédentes, je ne suis parvenu à trancher. Mon florilège compte une trentaine de films, onze me semblant au-dessus du lot. J'ai tenu à terminer par quelques longs-métrages français, ceux-ci étant peu présents dans mon palmarès... et pour cause : en général, le cinéma hexagonal ne me parle pas, ou m'ennuie, me déçoit.
Ceci dit, de mon point de vue, l'année 2026 a plutôt bien commencé pour les productions françaises, qui seront peut-être davantage distinguées l'an prochain.
11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 24 février 2026
Aucun autre choix
L'introduction de ce long-métrage nous présente le bonheur factice d'une famille de la bourgeoisie sud-coréenne. Le père, cadre supérieur dans l'industrie du papier, gagne très bien sa vie et entrevoit même une possibilité de promotion. Son épouse a interrompu son activité professionnelle pour s'occuper des enfants (et de son corps). Le fils aîné semble commencer sa crise d'adolescence, mais doucement, tandis que la cadette se révèle surdouée en musique, une carrière internationale s'offrant peut-être à elle (grâce à des cours onéreux).
A cette entame ironique succède hélas une fausse comédie macabre, selon moi complètement ratée pendant au moins une heure. On nous montre les conséquences successives du licenciement du père : la perte de l'estime de soi, la fragilisation du couple, les dérapages du fils et l'enfermement progressif de la fille. En sous-texte, le scénario dénonce la mondialisation : plusieurs entreprises sud-coréennes du secteur du papier passent sous domination d'un groupe étranger, états-unien ou chinois. A chaque fois, cela débouche sur des licenciements et la dégradation des conditions de travail, le stade ultime étant atteint à la fin de l'histoire...
Entre temps, on nous montre des cadres en concurrence les uns avec les autres, le père de famille songeant à éliminer ses rivaux, au propre comme au figuré. J'ai trouvé intéressante la mise en scène de la découverte, par le héros, des points communs qu'il a avec ses potentielles victimes : des types pas plus méchants que lui, passionnés par le secteur du papier et soumis aux mêmes pressions.
C'est cet aspect quasi sociologique qui m'a retenu de quitter la salle, alors qu'à l'écran, le grotesque succédait aux maladresses. C'est vraiment mal joué et/ou mal dirigé. On n'y croit pas une seconde.
Grosse déception pour moi, qui ai tant aimé certains des films précédents de Park Chan-Wook : Old Boy, Mademoiselle et Decision to leave.
20:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, flm, films
Aucun autre choix
L'introduction de ce long-métrage nous présente le bonheur factice d'une famille de la bourgeoisie sud-coréenne. Le père, cadre supérieur dans l'industrie du papier, gagne très bien sa vie et entrevoit même une possibilité de promotion. Son épouse a interrompu son activité professionnelle pour s'occuper des enfants (et de son corps). Le fils aîné semble commencer sa crise d'adolescence, mais doucement, tandis que la cadette se révèle surdouée en musique, une carrière internationale s'offrant peut-être à elle (grâce à des cours onéreux).
A cette entame ironique succède hélas une fausse comédie macabre, selon moi complètement ratée pendant au moins une heure. On nous montre les conséquences successives du licenciement du père : la perte de l'estime de soi, la fragilisation du couple, les dérapages du fils et l'enfermement progressif de la fille. En sous-texte, le scénario dénonce la mondialisation : plusieurs entreprises sud-coréennes du secteur du papier passent sous domination d'un groupe étranger, états-unien ou chinois. A chaque fois, cela débouche sur des licenciements et la dégradation des conditions de travail, le stade ultime étant atteint à la fin de l'histoire...
Entre temps, on nous montre des cadres en concurrence les uns avec les autres, le père de famille songeant à éliminer ses rivaux, au propre comme au figuré. J'ai trouvé intéressante la mise en scène de la découverte, par le héros, des points communs qu'il a avec ses potentielles victimes : des types pas plus méchants que lui, passionnés par le secteur du papier et soumis aux mêmes pressions.
C'est cet aspect quasi sociologique qui m'a retenu de quitter la salle, alors qu'à l'écran, le grotesque succédait aux maladresses. C'est vraiment mal joué et/ou mal dirigé. On n'y croit pas une seconde.
Grosse déception pour moi, qui ai tant aimé certains des films précédents de Park Chan-Wook : Old Boy, Mademoiselle et Decision to leave.
20:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, flm, films
lundi, 23 février 2026
Cold Storage
StudioCanal a sorti Vanessa Redgrave et Liam Neeson de l'EHPAD pour produire cette comédie horrifique, dans laquelle une mystérieuse substance venue de l'espace (un champignon vert particulièrement agressif... et résilient) menace d'éradiquer l'espèce humaine.
La séquence inaugurale se déroule dans le passé, dans le Bush australien. On nous offre un avant-goût du carnage qui va suivre.
Quand on retrouve ce bon vieux Liam (officier à la retraite d'une agence gouvernementale), une quinzaine d'années plus tard, il a des problèmes de dos et ne semble plus capable d'escalader une modeste clôture privée... mais il est prêt à reprendre du service, pour sauver le monde.
A ce moment-là, les scénaristes se sont dits qu'il fallait viser au-delà du public (semi-)grabataire (voire décédé) qui avait suivi la carrière cinématographique de Liam Neeson. On lui flanque donc une bande de djeunses dans les pattes. Ce sont d'abord les employés d'un centre de stockage, situé aux Etats-Unis... et implanté pile à l'endroit où, jadis, une agence gouvernementale ultra-secrète (mais peu précautionneuse) a entreposé des trucs louches, avant de dégager et de vendre le tout.
Je pense que les deux jeunes employés (chargés sans doute de fédérer le public présent dans la salle, beaucoup moins âgé que moi) sont incarnés par des acteurs connus à la télévision ou sur une plate-forme. Quoi qu'il en soit, ils forment un joli duo de trous du cul, qui va évidemment faire ce que personne de normalement constitué ne ferait dans la même situation : percer une paroi de placoplâtre sur leur lieu de travail, descendre au deuxième sous-sol pour rechercher l'origine d'un signal sonore sans prévenir qui que ce soit, ouvrir une entrée secrète (à moitié rouillée) pour aller encore plus bas, s'y rendre... et même entrer (sans protections) dans une salle que tout indique comme extrêmement dangereuse...
Du coup, on a envie qu'il arrive quelques bricoles à ces djeunses... ainsi qu'à leurs "visiteurs" inattendus : un gros blaireau (l'ex de la jeune meuf) et une bande de loubards (en quête d'un coup facile). Si l'on ajoute que l'armée états-unienne finit par débarquer sur les lieux, je crois qu'on peut affirmer qu'il s'agit du centre de stockage le plus fréquenté de la planète. (Ah, j'oubliais : Vanessa incarne une veuve inconsolable, qui pique un roupillon dans l'un des casiers de stockage... un flingue à portée de main.)
La manière dont la majorité des "visiteurs" décède est assez réjouissante à voir, entre vomissures abondantes, éclatements divers et pourrissement accéléré. Je signale aux âmes sensibles qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage, le générique de fin précisant qu'aucun animal n'a été utilisé... tout court. On se rassure donc pour le charmant matou, les cerfs élégants et les séduisants rats : ce sont des créatures numériques.
Je crois que c'est mon premier "plaisir coupable" de l'année 2026.
16:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Cold Storage
StudioCanal a sorti Vanessa Redgrave et Liam Neeson de l'EHPAD pour produire cette comédie horrifique, dans laquelle une mystérieuse substance venue de l'espace (un champignon vert particulièrement agressif... et résilient) menace d'éradiquer l'espèce humaine.
La séquence inaugurale se déroule dans le passé, dans le Bush australien. On nous offre un avant-goût du carnage qui va suivre.
Quand on retrouve ce bon vieux Liam (officier à la retraite d'une agence gouvernementale), une quinzaine d'années plus tard, il a des problèmes de dos et ne semble plus capable d'escalader une modeste clôture privée... mais il est prêt à reprendre du service, pour sauver le monde.
A ce moment-là, les scénaristes se sont dits qu'il fallait viser au-delà du public (semi-)grabataire (voire décédé) qui avait suivi la carrière cinématographique de Liam Neeson. On lui flanque donc une bande de djeunses dans les pattes. Ce sont d'abord les employés d'un centre de stockage, situé aux Etats-Unis... et implanté pile à l'endroit où, jadis, une agence gouvernementale ultra-secrète (mais peu précautionneuse) a entreposé des trucs louches, avant de dégager et de vendre le tout.
Je pense que les deux jeunes employés (chargés sans doute de fédérer le public présent dans la salle, beaucoup moins âgé que moi) sont incarnés par des acteurs connus à la télévision ou sur une plate-forme. Quoi qu'il en soit, ils forment un joli duo de trous du cul, qui va évidemment faire ce que personne de normalement constitué ne ferait dans la même situation : percer une paroi de placoplâtre sur leur lieu de travail, descendre au deuxième sous-sol pour rechercher l'origine d'un signal sonore sans prévenir qui que ce soit, ouvrir une entrée secrète (à moitié rouillée) pour aller encore plus bas, s'y rendre... et même entrer (sans protections) dans une salle que tout indique comme extrêmement dangereuse...
Du coup, on a envie qu'il arrive quelques bricoles à ces djeunses... ainsi qu'à leurs "visiteurs" inattendus : un gros blaireau (l'ex de la jeune meuf) et une bande de loubards (en quête d'un coup facile). Si l'on ajoute que l'armée états-unienne finit par débarquer sur les lieux, je crois qu'on peut affirmer qu'il s'agit du centre de stockage le plus fréquenté de la planète. (Ah, j'oubliais : Vanessa incarne une veuve inconsolable, qui pique un roupillon dans l'un des casiers de stockage... un flingue à portée de main.)
La manière dont la majorité des "visiteurs" décède est assez réjouissante à voir, entre vomissures abondantes, éclatements divers et pourrissement accéléré. Je signale aux âmes sensibles qu'aucun animal n'a été maltraité durant le tournage, le générique de fin précisant qu'aucun animal n'a été utilisé... tout court. On se rassure donc pour le charmant matou, les cerfs élégants et les séduisants rats : ce sont des créatures numériques.
Je crois que c'est mon premier "plaisir coupable" de l'année 2026.
16:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 22 février 2026
Maigret et le mort amoureux
Sous ce titre, Pascal Bonitzer adapte l'un des romans de Georges Simenon : Maigret et les vieillards (dont je recommande la lecture).
Dans celui-ci, le commissaire s'inquiète de ne quasiment croiser, dans cette affaire, que des personnes très âgées (mortes comme vivantes) : le défunt, sa gouvernante, sa "femme de cœur", le mari de celle-ci, le notaire... et même le neveu, qui fait plus vieux que son âge.
On retrouve un peu de cette ironie dans le film de Bonitzer, principalement dans les dialogues, que j'ai trouvé bien écrits, et qui nous valent quelques échanges savoureux. Ils sont bien servis par une galerie d'interprètes talentueux : Denis Podalydès (qui réussit son incursion dans l'univers de Simenon), Anne Alvaro, Dominique Reymond (déjà remarquable dans La Cache, l'an dernier), Micha Lescot, Manuel Guillot, Julia Faure (présente dans une seule séquence, marquante)...
Le roman ayant déjà fait l'objet de plusieurs adaptations (dont une avec Jean Richard et une avec Bruno Crémer), Bonitzer fait le choix (pertinent, à mon avis) de décaler l'intrigue à une époque où existent déjà internet et de petits téléphones portables. Le début des années 2000 remplace donc celui des années 1960, sans smartphone, mais dans un Paris contemporain.
Tout cela est fort agréable, mais, au niveau de la mise en scène, c'est assez banal. On nous propose une succession d'entretiens, sous la forme de vignettes plus ou moins humoristiques, montrant la progression (laborieuse) de l'enquête. Nous avons donc droit à :
Maigret au Quai d'Orsay
Maigret dans son bureau
Maigret chez la victime
Maigret à son domicile
Maigret chez le procureur
Maigret au restaurant
Maigret chez le neveu
Maigret chez le notaire
Maigret chez l'amoureuse
Maigret et la gomme magique
Maigret en salle d'interrogatoire
C'est ce côté répétitif, peu inventif, qui peut lasser, même si le film ne dure qu'1h20. Cerise sur le gâteau, pour celles et ceux qui connaissent le roman : la fin a été changée.
08:44 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, roman, littérature
Maigret et le mort amoureux
Sous ce titre, Pascal Bonitzer adapte l'un des romans de Georges Simenon : Maigret et les vieillards (dont je recommande la lecture).
Dans celui-ci, le commissaire s'inquiète de ne quasiment croiser, dans cette affaire, que des personnes très âgées (mortes comme vivantes) : le défunt, sa gouvernante, sa "femme de cœur", le mari de celle-ci, le notaire... et même le neveu, qui fait plus vieux que son âge.
On retrouve un peu de cette ironie dans le film de Bonitzer, principalement dans les dialogues, que j'ai trouvé bien écrits, et qui nous valent quelques échanges savoureux. Ils sont bien servis par une galerie d'interprètes talentueux : Denis Podalydès (qui réussit son incursion dans l'univers de Simenon), Anne Alvaro, Dominique Reymond (déjà remarquable dans La Cache, l'an dernier), Micha Lescot, Manuel Guillot, Julia Faure (présente dans une seule séquence, marquante)...
Le roman ayant déjà fait l'objet de plusieurs adaptations (dont une avec Jean Richard et une avec Bruno Crémer), Bonitzer fait le choix (pertinent, à mon avis) de décaler l'intrigue à une époque où existent déjà internet et de petits téléphones portables. Le début des années 2000 remplace donc celui des années 1960, sans smartphone, mais dans un Paris contemporain.
Tout cela est fort agréable, mais, au niveau de la mise en scène, c'est assez banal. On nous propose une succession d'entretiens, sous la forme de vignettes plus ou moins humoristiques, montrant la progression (laborieuse) de l'enquête. Nous avons donc droit à :
Maigret au Quai d'Orsay
Maigret dans son bureau
Maigret chez la victime
Maigret à son domicile
Maigret chez le procureur
Maigret au restaurant
Maigret chez le neveu
Maigret chez le notaire
Maigret chez l'amoureuse
Maigret et la gomme magique
Maigret en salle d'interrogatoire
C'est ce côté répétitif, peu inventif, qui peut lasser, même si le film ne dure qu'1h20. Cerise sur le gâteau, pour celles et ceux qui connaissent le roman : la fin a été changée.
08:44 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, livre, livres, roman, littérature
samedi, 21 février 2026
Marty Supreme
Le titre de ce faux biopic (concentré sur une année de la vie présumée du pongiste Marty Reisman) fait allusion à la marque de balles de ping pong que le héros tente de lancer, grâce à l'argent apporté par une connaissance, un gosse de riches tombé dans ses filets.
Ainsi, Timothée Chalamet sort de sa zone de confort pour interpréter un type pas très sympathique (égocentrique, menteur, arrogant, voleur et magouilleur... entre autres), mais qui vit une histoire somme toute très américaine : d'origine modeste, il va vaincre l'adversité pour réaliser son rêve : devenir champion de tennis de table... et gagner sa vie avec.
Il y a donc des passages assez convenus dans l'intrigue, qui n'est pas sans rappeler celle de deux des Rocky : le premier pour l'ascension d'un outsider sous-estimé, le quatrième pour la lutte du pot de terre contre le pot de fer, l'antagoniste soviétique étant cette fois-ci remplacé par un adversaire japonais.
Ceci dit, les rares échanges sportifs qui sont présentés à l'écran sont très correctement mis en scène. On sait que Chalamet s'est longuement entraîné pour être crédible dans le rôle. Son principal concurrent est un authentique pongiste. S'ajoutent à cela d'abondants effets spéciaux (voir le générique de fin). Je note toutefois que, lors de l'ultime combat, particulièrement âpre, si le front de Marty se garnit de perles de sueur, sa chemise demeure impeccable... (Cette remarque est faite par celui qui fut, dans un lointain passé, un médiocre pongiste amateur.)
C'est malgré tout un bon spectacle, d'autant que Josh Safdie ne se montre pas maladroit dans le cœur du film : la mise en scène des heurs et malheurs du héros (et de celles et ceux qu'il embarque), entre réussites improbables et fiascos monumentaux. Parmi les moments mémorables, je note une scène de baignoire (dans un hôtel miteux), les aventures avec un chien nommé Moïse (Moses dans la version originale) et une monumentale fessée, administrée dans des circonstances que je me garderai de divulguer.
Sur le fond, le scénario essaie de contenter tout le monde. Les États-Unis des années 1950 sont décrits comme un pays d'inégalités gigantesques, où les riches exploitent les pauvres. (Ça, c'est pour la gauche.) D'un autre côté, c'est aussi le pays des opportunités, où un p'tit gars talentueux et opiniâtre peut espérer (s'il ne respecte pas trop les règles) faire son trou. Comme, en plus, le Marty est un patriote, il y a de quoi contenter la droite. (J'ai aussi relevé le fait qu'on nous conte l'histoire d'un juif pauvre exploité par de riches protestants, une audace louable en ces temps d'antisémitisme rampant.)
En revanche, du côté des personnages féminins, c'est assez stéréotypé. La mère du héros, sa maîtresse comme sa compagne (interprétée par Odessa A'zion, vue récemment dans Until Dawn) n'agissent qu'en relation avec Marty. Tout tourne autour de lui. Le film ne passe donc sans doute pas le test de Bechdel-Wallace... mais, comme le personnage principal est interprété par Timothée Chalamet (et pas par Gerard Butler, Liam Neeson ou Bruce Willis), c'est cool et l'on s'extasie sans peine. Il me semble que les scénaristes (et peut-être l'un des coproducteurs, un certain... T. Chalamet) ont ressenti de la gêne, puisque la conclusion du film replace le héros dans le "droit chemin".
21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Marty Supreme
Le titre de ce faux biopic (concentré sur une année de la vie présumée du pongiste Marty Reisman) fait allusion à la marque de balles de ping pong que le héros tente de lancer, grâce à l'argent apporté par une connaissance, un gosse de riches tombé dans ses filets.
Ainsi, Timothée Chalamet sort de sa zone de confort pour interpréter un type pas très sympathique (égocentrique, menteur, arrogant, voleur et magouilleur... entre autres), mais qui vit une histoire somme toute très américaine : d'origine modeste, il va vaincre l'adversité pour réaliser son rêve : devenir champion de tennis de table... et gagner sa vie avec.
Il y a donc des passages assez convenus dans l'intrigue, qui n'est pas sans rappeler celle de deux des Rocky : le premier pour l'ascension d'un outsider sous-estimé, le quatrième pour la lutte du pot de terre contre le pot de fer, l'antagoniste soviétique étant cette fois-ci remplacé par un adversaire japonais.
Ceci dit, les rares échanges sportifs qui sont présentés à l'écran sont très correctement mis en scène. On sait que Chalamet s'est longuement entraîné pour être crédible dans le rôle. Son principal concurrent est un authentique pongiste. S'ajoutent à cela d'abondants effets spéciaux (voir le générique de fin). Je note toutefois que, lors de l'ultime combat, particulièrement âpre, si le front de Marty se garnit de perles de sueur, sa chemise demeure impeccable... (Cette remarque est faite par celui qui fut, dans un lointain passé, un médiocre pongiste amateur.)
C'est malgré tout un bon spectacle, d'autant que Josh Safdie ne se montre pas maladroit dans le cœur du film : la mise en scène des heurs et malheurs du héros (et de celles et ceux qu'il embarque), entre réussites improbables et fiascos monumentaux. Parmi les moments mémorables, je note une scène de baignoire (dans un hôtel miteux), les aventures avec un chien nommé Moïse (Moses dans la version originale) et une monumentale fessée, administrée dans des circonstances que je me garderai de divulguer.
Sur le fond, le scénario essaie de contenter tout le monde. Les États-Unis des années 1950 sont décrits comme un pays d'inégalités gigantesques, où les riches exploitent les pauvres. (Ça, c'est pour la gauche.) D'un autre côté, c'est aussi le pays des opportunités, où un p'tit gars talentueux et opiniâtre peut espérer (s'il ne respecte pas trop les règles) faire son trou. Comme, en plus, le Marty est un patriote, il y a de quoi contenter la droite. (J'ai aussi relevé le fait qu'on nous conte l'histoire d'un juif pauvre exploité par de riches protestants, une audace louable en ces temps d'antisémitisme rampant.)
En revanche, du côté des personnages féminins, c'est assez stéréotypé. La mère du héros, sa maîtresse comme sa compagne (interprétée par Odessa A'zion, vue récemment dans Until Dawn) n'agissent qu'en relation avec Marty. Tout tourne autour de lui. Le film ne passe donc sans doute pas le test de Bechdel-Wallace... mais, comme le personnage principal est interprété par Timothée Chalamet (et pas par Gerard Butler, Liam Neeson ou Bruce Willis), c'est cool et l'on s'extasie sans peine. Il me semble que les scénaristes (et peut-être l'un des coproducteurs, un certain... T. Chalamet) ont ressenti de la gêne, puisque la conclusion du film replace le héros dans le "droit chemin".
21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 14 février 2026
Le Gâteau du président
Dans l'Irak dirigé d'une main de fer par le dictateur Saddam Hussein, la coutume veut qu'on offre des présents le jour de son anniversaire (le 28 avril). Dans chaque école primaire, plusieurs élèves sont mis à contribution. Cette fois-ci, le sort désigne la petite Lamia pour préparer le "gâteau du président", qui sera dégusté en son nom par... l'instituteur. Au cas où cette gastronomique tradition ne serait pas dignement respectée, l'enseignant menace de dénoncer les parents des enfants au gouvernement. (On savait tenir les gamins à l'école, en ce temps-là !)
Pour Lamia, la confection de cette simple pâtisserie relève du parcours du combattant. Orpheline, sans doute de confession chiite, elle a été recueillie par sa grand-mère, qui vit dans une sorte de cabane en roseaux, le long d'un cours d'eau qui pourrait être le Chatt al-Arab. Cela donne de forts jolis plans aquatiques, les ruraux de la région se déplaçant de préférence sur de petites embarcations.
La suite est un périple urbain, celui de la gamine, pour se procurer, de manière plus ou moins légale, les ingrédients nécessaires à la confection dudit gâteau. (On pense immédiatement à Une Enfance allemande, sorti il y a un peu moins de deux mois.) Dans sa recherche, elle est aidée par Saeed, son unique ami, un as de la débrouille qu'il met en général au service de son père handicapé. Complète ce duo un... coq, étrangement docile, qui joue le rôle d'animal de compagnie de l'héroïne.
Bien entendu, ces pérégrinations (parfois peu réalistes) ont pour but de nous faire découvrir différents aspects de l'Irak urbain à la fin du règne de Saddam Hussein. Entre sanctions occidentales, bombardements et persécutions du régime, la population de base peine à joindre les deux bouts. Le plus souvent, c'est un peu chacun pour soi. Dans ce cadre, les efforts déployés par les gamins apparaissent presque pathétiques. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de misérabilisme dans la manière de les filmer... mais la présence à l'écran de Baneen Ahmad Nayyef emporte l'adhésion. Cette jeune actrice est formidable de justesse et d'émotion. A plusieurs reprises, on a furieusement envie de se lever pour lui donner un coup de main, ou la prendre dans ses bras, pour la consoler.
Une autre qualité du film est l'introduction de pointes comiques dans une intrigue le plus souvent sombre. Cela m'a rappelé les comédies italiennes d'après-guerre, qui montraient un pays appauvri, dans lequel les citoyens ordinaires essayaient de survivre comme ils pouvaient, sans perdre leur sens de l'humour.
Du coup, en dépit de quelques invraisemblances et maladresses, ce film est une petite pépite à ne pas rater (même s'il a été quelque peu survendu par la critique).
21:08 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Le Gâteau du président
Dans l'Irak dirigé d'une main de fer par le dictateur Saddam Hussein, la coutume veut qu'on offre des présents le jour de son anniversaire (le 28 avril). Dans chaque école primaire, plusieurs élèves sont mis à contribution. Cette fois-ci, le sort désigne la petite Lamia pour préparer le "gâteau du président", qui sera dégusté en son nom par... l'instituteur. Au cas où cette gastronomique tradition ne serait pas dignement respectée, l'enseignant menace de dénoncer les parents des enfants au gouvernement. (On savait tenir les gamins à l'école, en ce temps-là !)
Pour Lamia, la confection de cette simple pâtisserie relève du parcours du combattant. Orpheline, sans doute de confession chiite, elle a été recueillie par sa grand-mère, qui vit dans une sorte de cabane en roseaux, le long d'un cours d'eau qui pourrait être le Chatt al-Arab. Cela donne de forts jolis plans aquatiques, les ruraux de la région se déplaçant de préférence sur de petites embarcations.
La suite est un périple urbain, celui de la gamine, pour se procurer, de manière plus ou moins légale, les ingrédients nécessaires à la confection dudit gâteau. (On pense immédiatement à Une Enfance allemande, sorti il y a un peu moins de deux mois.) Dans sa recherche, elle est aidée par Saeed, son unique ami, un as de la débrouille qu'il met en général au service de son père handicapé. Complète ce duo un... coq, étrangement docile, qui joue le rôle d'animal de compagnie de l'héroïne.
Bien entendu, ces pérégrinations (parfois peu réalistes) ont pour but de nous faire découvrir différents aspects de l'Irak urbain à la fin du règne de Saddam Hussein. Entre sanctions occidentales, bombardements et persécutions du régime, la population de base peine à joindre les deux bouts. Le plus souvent, c'est un peu chacun pour soi. Dans ce cadre, les efforts déployés par les gamins apparaissent presque pathétiques. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de misérabilisme dans la manière de les filmer... mais la présence à l'écran de Baneen Ahmad Nayyef emporte l'adhésion. Cette jeune actrice est formidable de justesse et d'émotion. A plusieurs reprises, on a furieusement envie de se lever pour lui donner un coup de main, ou la prendre dans ses bras, pour la consoler.
Une autre qualité du film est l'introduction de pointes comiques dans une intrigue le plus souvent sombre. Cela m'a rappelé les comédies italiennes d'après-guerre, qui montraient un pays appauvri, dans lequel les citoyens ordinaires essayaient de survivre comme ils pouvaient, sans perdre leur sens de l'humour.
Du coup, en dépit de quelques invraisemblances et maladresses, ce film est une petite pépite à ne pas rater (même s'il a été quelque peu survendu par la critique).
21:08 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 12 février 2026
Le Mage du Kremlin
Le nouveau film d'Olivier Assayas s'inspire d'un roman primé et de l'histoire de la Russie de ces trente-quarante dernières années. Il ne s'agit donc pas d'une biographie de Vladimir Poutine, même si son parcours politique est décrypté à l'aune du regard d'une "éminence grise", celle-ci n'ayant au départ aucun lien avec la politique.
La première partie (du film comme du livre, d'ailleurs) se déroule donc sans Poutine, mais elle permet de comprendre les circonstances qui ont permis son accession au pouvoir et le renforcement de son contrôle sur la société russe. C'est sans doute ici qu'Assayas dispose du plus de liberté cinématographique. Ce n'est pas pour moi la partie la plus convaincante, mais elle permet de resituer l'émergence de Poutine dans un contexte de chaos.
Quand celui-ci débarque à l'écran, sous les traits de Jude Law, c'est un choc. A l'origine, je rechignais à aller voir ce film, parce que je pensais que le choix de cet acteur (fort estimable au demeurant) n'était pas le bon. Je dois reconnaître que je me suis trompé. Law fait un Poutine très convaincant, ne tombant pas trop dans le mimétisme tout en restant crédible. Chapeau.
La suite est des plus passionnantes. Ayant été spectateur de ces événements, consultant divers journaux pour tenter de comprendre ce qui se passait en Russie, j'ai retrouvé l'ambiance de l'époque, de la décrépitude de Boris Eltsine aux premières exécutions d'opposants, en passant par la guerre en Tchétchénie et la tragédie du Koursk.
La distribution est bonne, qu'elle concerne les personnages réels (outre Poutine, Boris Berezovsky et Igor Setchine) que les personnages fictifs : celui du "mage" (certes inspiré de Vladislav Sourkov, mais à l'évidence résultat d'un mélange plus subtil), de sa compagne (dans la peau de laquelle j'ai eu du mal à reconnaître Alicia Vikander !) ou de l'interlocuteur états-unien. Plus ambigu est le statut de Dimitri Sidorov, décalque évident de Mikhail Khodorkovsky... et qui dans le roman se prénomme bien Mikhail. Pourquoi diable avoir modifié son identité pour le film ? Serait-ce pour épargner cet ancien oligarque, dont le passé sulfureux semble avoir été effacé de la mémoire collective depuis qu'il a subi les foudres du Kremlin ? C'est dommage, parce que son ambiguïté à lui aurait pu contribuer à mieux mettre en évidence celle du "Tsar".
Les commentateurs officiels ont souvent regretté la trop grande place laissée par le film aux arguments de Poutine, qu'ils sortent de sa bouche ou de celle de son conseiller officieux. Certes, le propos aurait pu être plus grinçant à leur égard, mais je trouve qu'Assayas et Carrère réussissent dans leur entreprise de rendre plus intelligibles les motivations de Poutine et de ceux qui le soutiennent.
A cela s'ajoute une interprétation tout en sobriété du "Mage", par Paul Dano, un excellent choix à double titre, puisque celui qui longtemps fit figure d'acteur de deuxième rang incarne un personnage qui semble de prime abord secondaire, avant que l'importance de son action n'apparaisse au grand jour. Je trouve cette mise en abyme très pertinente, les aspects moins reluisants du "héros" ressortant lors de ses rencontres avec la "femme de sa vie".
C'est donc un film exigeant, plutôt destiné à celles et ceux que la politique internationale intéresse, mais il m'a tenu en haleine du début à la fin.
21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Le Mage du Kremlin
Le nouveau film d'Olivier Assayas s'inspire d'un roman primé et de l'histoire de la Russie de ces trente-quarante dernières années. Il ne s'agit donc pas d'une biographie de Vladimir Poutine, même si son parcours politique est décrypté à l'aune du regard d'une "éminence grise", celle-ci n'ayant au départ aucun lien avec la politique.
La première partie (du film comme du livre, d'ailleurs) se déroule donc sans Poutine, mais elle permet de comprendre les circonstances qui ont permis son accession au pouvoir et le renforcement de son contrôle sur la société russe. C'est sans doute ici qu'Assayas dispose du plus de liberté cinématographique. Ce n'est pas pour moi la partie la plus convaincante, mais elle permet de resituer l'émergence de Poutine dans un contexte de chaos.
Quand celui-ci débarque à l'écran, sous les traits de Jude Law, c'est un choc. A l'origine, je rechignais à aller voir ce film, parce que je pensais que le choix de cet acteur (fort estimable au demeurant) n'était pas le bon. Je dois reconnaître que je me suis trompé. Law fait un Poutine très convaincant, ne tombant pas trop dans le mimétisme tout en restant crédible. Chapeau.
La suite est des plus passionnantes. Ayant été spectateur de ces événements, consultant divers journaux pour tenter de comprendre ce qui se passait en Russie, j'ai retrouvé l'ambiance de l'époque, de la décrépitude de Boris Eltsine aux premières exécutions d'opposants, en passant par la guerre en Tchétchénie et la tragédie du Koursk.
La distribution est bonne, qu'elle concerne les personnages réels (outre Poutine, Boris Berezovsky et Igor Setchine) que les personnages fictifs : celui du "mage" (certes inspiré de Vladislav Sourkov, mais à l'évidence résultat d'un mélange plus subtil), de sa compagne (dans la peau de laquelle j'ai eu du mal à reconnaître Alicia Vikander !) ou de l'interlocuteur états-unien. Plus ambigu est le statut de Dimitri Sidorov, décalque évident de Mikhail Khodorkovsky... et qui dans le roman se prénomme bien Mikhail. Pourquoi diable avoir modifié son identité pour le film ? Serait-ce pour épargner cet ancien oligarque, dont le passé sulfureux semble avoir été effacé de la mémoire collective depuis qu'il a subi les foudres du Kremlin ? C'est dommage, parce que son ambiguïté à lui aurait pu contribuer à mieux mettre en évidence celle du "Tsar".
Les commentateurs officiels ont souvent regretté la trop grande place laissée par le film aux arguments de Poutine, qu'ils sortent de sa bouche ou de celle de son conseiller officieux. Certes, le propos aurait pu être plus grinçant à leur égard, mais je trouve qu'Assayas et Carrère réussissent dans leur entreprise de rendre plus intelligibles les motivations de Poutine et de ceux qui le soutiennent.
A cela s'ajoute une interprétation tout en sobriété du "Mage", par Paul Dano, un excellent choix à double titre, puisque celui qui longtemps fit figure d'acteur de deuxième rang incarne un personnage qui semble de prime abord secondaire, avant que l'importance de son action n'apparaisse au grand jour. Je trouve cette mise en abyme très pertinente, les aspects moins reluisants du "héros" ressortant lors de ses rencontres avec la "femme de sa vie".
C'est donc un film exigeant, plutôt destiné à celles et ceux que la politique internationale intéresse, mais il m'a tenu en haleine du début à la fin.
21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 08 février 2026
Marsupilami
Je ne suis nostalgique ni de la bande dessinée de Franquin (à laquelle je n'avais pas "accroché"', quand j'étais gamin) ni du film d'Alain Chabat (que je crois n'avoir jamais vu). J'étais plus intéressé par la nouvelle œuvre de "la bande à Lacheau". Il y a trois ans, Philippe et ses potes m'avaient fait passer un excellent moment avec Alibi.com 2.
Le début nous fait découvrir les deux principaux invités de cette fiction : Jean Reno (en chef de bande sans scrupule) et Jamel Debbouze (en raison des références au premier film). Ces deux lascars, dont les personnages vont subir quelques avanies, sont entourés de seconds rôles familiers, interprétés par Elodie Fontan (en épouse mécontente), Tarek Boudali (en chanteur has been), Julien Arruti (toujours aussi bon dans les rôles d'abruti... sérieux, il mérite un César !), Reem Kherici (en réalisatrice de télé-réalité bidonnée), Didier Bourdon (pour une brève apparition... ô combien marquante), sans oublier Vincent Desagnat (en mec bourré... qui peut le croire ?).
J'ai failli oublier un autre nouveau venu : Alban Ivanov, qui interprète un douanier aux méthodes "rugueuses", à la limite de la légalité. A un moment du film, ce personnage voit son comportement fortement modifié en raison d'une substance dont il est aspergé... et cela devient hilarant...
... et c'est aussi une référence à Zootopie, le film de Lacheau regorgeant de clins d’œil (souvent parodiques), à Titanic, Top Gun, E.T., Dragon Ball... et même Kingsman, dans une scène de bagarre qui mêle techniques japonaises et britanniques. Je pense qu'au-delà de la commande qui lui a été faite (la mise en images animées d'une icône de la BD franco-belge), le cinéaste a voulu nous livrer une sorte de Hot Shots ! à la française.
Lacheau a donc bien mis sa patte à ce film de commande, notamment à travers les rafales de gags potaches, le plus souvent visuels. Cela commence par la crise du couple principal (incarné par le duo Lacheau-Fontan) : les petites mesquineries réciproques des ex rappelleront sans doute quelques souvenirs à celles et ceux qui ont connu une rupture difficile...
L'action culmine sur le paquebot, où se retrouvent presque tous les protagonistes. Les quiproquos s'ajoutent aux situations gênantes, avec moult cascades. A un moment, tout part en sucette à bord du navire... et les spectateurs exultent ! (La salle était bondée, transgénérationnelle et a ri de bon cœur tout au long du film.)
Les auteurs en ont toutefois gardé sous la pédale pour la dernière partie, avec notamment une folle course-poursuite, qui apprendra à certain(e)s qu'avoir du cul n'est pas toujours synonyme de chance !
Tous ces gags pas franchement subtils (mais efficacement mis en scène) rendent l'aspect familial de l'histoire (la séparation du couple et les angoisses du gamin) supportable. J'ai même envie d'y retourner pour savourer à nouveau certains moments de pur délire, qui passent hélas trop rapidement à l'écran.
P.S.
Soyez notamment attentifs aux détails, par exemple à l'identité du spécialiste d'économie du journal télévisé...
19:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Marsupilami
Je ne suis nostalgique ni de la bande dessinée de Franquin (à laquelle je n'avais pas "accroché"', quand j'étais gamin) ni du film d'Alain Chabat (que je crois n'avoir jamais vu). J'étais plus intéressé par la nouvelle œuvre de "la bande à Lacheau". Il y a trois ans, Philippe et ses potes m'avaient fait passer un excellent moment avec Alibi.com 2.
Le début nous fait découvrir les deux principaux invités de cette fiction : Jean Reno (en chef de bande sans scrupule) et Jamel Debbouze (en raison des références au premier film). Ces deux lascars, dont les personnages vont subir quelques avanies, sont entourés de seconds rôles familiers, interprétés par Elodie Fontan (en épouse mécontente), Tarek Boudali (en chanteur has been), Julien Arruti (toujours aussi bon dans les rôles d'abruti... sérieux, il mérite un César !), Reem Kherici (en réalisatrice de télé-réalité bidonnée), Didier Bourdon (pour une brève apparition... ô combien marquante), sans oublier Vincent Desagnat (en mec bourré... qui peut le croire ?).
J'ai failli oublier un autre nouveau venu : Alban Ivanov, qui interprète un douanier aux méthodes "rugueuses", à la limite de la légalité. A un moment du film, ce personnage voit son comportement fortement modifié en raison d'une substance dont il est aspergé... et cela devient hilarant...
... et c'est aussi une référence à Zootopie, le film de Lacheau regorgeant de clins d’œil (souvent parodiques), à Titanic, Top Gun, E.T., Dragon Ball... et même Kingsman, dans une scène de bagarre qui mêle techniques japonaises et britanniques. Je pense qu'au-delà de la commande qui lui a été faite (la mise en images animées d'une icône de la BD franco-belge), le cinéaste a voulu nous livrer une sorte de Hot Shots ! à la française.
Lacheau a donc bien mis sa patte à ce film de commande, notamment à travers les rafales de gags potaches, le plus souvent visuels. Cela commence par la crise du couple principal (incarné par le duo Lacheau-Fontan) : les petites mesquineries réciproques des ex rappelleront sans doute quelques souvenirs à celles et ceux qui ont connu une rupture difficile...
L'action culmine sur le paquebot, où se retrouvent presque tous les protagonistes. Les quiproquos s'ajoutent aux situations gênantes, avec moult cascades. A un moment, tout part en sucette à bord du navire... et les spectateurs exultent ! (La salle était bondée, transgénérationnelle et a ri de bon cœur tout au long du film.)
Les auteurs en ont toutefois gardé sous la pédale pour la dernière partie, avec notamment une folle course-poursuite, qui apprendra à certain(e)s qu'avoir du cul n'est pas toujours synonyme de chance !
Tous ces gags pas franchement subtils (mais efficacement mis en scène) rendent l'aspect familial de l'histoire (la séparation du couple et les angoisses du gamin) supportable. J'ai même envie d'y retourner pour savourer à nouveau certains moments de pur délire, qui passent hélas trop rapidement à l'écran.
P.S.
Soyez notamment attentifs aux détails, par exemple à l'identité du spécialiste d'économie du journal télévisé...
19:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 07 février 2026
Grand Ciel
C'est le nom d'un "quartier intelligent" en cours d'aménagement. Ultra-moderne, agréable à vivre, respectueux de l'environnement, il promet le bonheur à celles et ceux qui auront assez de thunes le privilège de s'y installer.
Son symbole est une tour en construction, devant atteindre une vingtaine d'étages. C'est sur ce chantier en voie d'achèvement que travaillent des personnes qui n'ont pas vocation à y résider. Ce sont majoritairement des immigrés, légaux ou illégaux, auxquels s'adjoignent quelques "Français de souche" comme Vincent (Damien Bonnard, très bien), un bosseur, du genre taiseux, ne cherchant pas à faire de vague.
Le problème est que, depuis quelques temps, certains événements étranges se produisent sur le chantier, en particulier au sixième sous-sol. On y entend parfois des bruits mystérieux et la poussière y est inhabituellement abondante. Des malfaçons apparaissent sur certaines dalles de béton, pourtant récentes... et des ouvriers disparaissent.
Le talent d'Akihiro Hata est de mêler la critique sociale au fantastique. On se demande si ces mystères ne sont pas tout simplement liés aux combines des patrons, qui rognent sur les coûts et donc fournissent des matériaux de mauvaise qualité... et s'arrangent pour que les accidents du travail soient passés sous silence.
Fait inhabituel dans le cinéma français, la réalisation met en valeur le travail manuel, ici celui d'employés du BTP. La tour en chantier, les algécos et le sous-sol sont très bien utilisés pour suggérer l'exploitation, le danger ou le malaise. Quand une poignée d'ouvriers descend au sixième sous-sol, on pense à des films sur l'extraction minière.
Leur vie personnelle n'est pas oubliée, entre transport en bus, logement en HLM (ou mobile home, voire foyer) et courses dans une grande surface.
Les seconds rôles sont bien campés, avec notamment Samir Guesmi, Mouna Soualem (autre "fille de..."), Tudor Istodor, Ahmed Laoui ou encore Denis Eyriey. Ce n'est qu'à la toute fin que l'on comprend ce qu'est vraiment cette poussière supplémentaire, quasi surnaturelle.
Ce petit film, mine de rien, dit beaucoup de choses. Il est dommage qu'il ne bénéficie pas d'une plus large diffusion.
15:58 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Grand Ciel
C'est le nom d'un "quartier intelligent" en cours d'aménagement. Ultra-moderne, agréable à vivre, respectueux de l'environnement, il promet le bonheur à celles et ceux qui auront assez de thunes le privilège de s'y installer.
Son symbole est une tour en construction, devant atteindre une vingtaine d'étages. C'est sur ce chantier en voie d'achèvement que travaillent des personnes qui n'ont pas vocation à y résider. Ce sont majoritairement des immigrés, légaux ou illégaux, auxquels s'adjoignent quelques "Français de souche" comme Vincent (Damien Bonnard, très bien), un bosseur, du genre taiseux, ne cherchant pas à faire de vague.
Le problème est que, depuis quelques temps, certains événements étranges se produisent sur le chantier, en particulier au sixième sous-sol. On y entend parfois des bruits mystérieux et la poussière y est inhabituellement abondante. Des malfaçons apparaissent sur certaines dalles de béton, pourtant récentes... et des ouvriers disparaissent.
Le talent d'Akihiro Hata est de mêler la critique sociale au fantastique. On se demande si ces mystères ne sont pas tout simplement liés aux combines des patrons, qui rognent sur les coûts et donc fournissent des matériaux de mauvaise qualité... et s'arrangent pour que les accidents du travail soient passés sous silence.
Fait inhabituel dans le cinéma français, la réalisation met en valeur le travail manuel, ici celui d'employés du BTP. La tour en chantier, les algécos et le sous-sol sont très bien utilisés pour suggérer l'exploitation, le danger ou le malaise. Quand une poignée d'ouvriers descend au sixième sous-sol, on pense à des films sur l'extraction minière.
Leur vie personnelle n'est pas oubliée, entre transport en bus, logement en HLM (ou mobile home, voire foyer) et courses dans une grande surface.
Les seconds rôles sont bien campés, avec notamment Samir Guesmi, Mouna Soualem (autre "fille de..."), Tudor Istodor, Ahmed Laoui ou encore Denis Eyriey. Ce n'est qu'à la toute fin que l'on comprend ce qu'est vraiment cette poussière supplémentaire, quasi surnaturelle.
Ce petit film, mine de rien, dit beaucoup de choses. Il est dommage qu'il ne bénéficie pas d'une plus large diffusion.
15:58 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Reconnu coupable
Dans ce thriller d'anticipation, la ville de Los Angeles a adopté une procédure judiciaire révolutionnaire en matière criminelle, puisque l'enquête, le procès et l'exécution des peines sont sous la responsabilité de Maddox, une intelligence artificielle. (Les juristes pointilleux noteront la disparition des avocats de la défense et de la possibilité de faire appel.)
Le policier Chris Raven a contribué à la mise en place de ce programme... mais le voilà désormais sur la sellette, plus précisément sur la chaise de l'accusé, puisqu'on lui reproche d'avoir assassiné son épouse, dont il était sur le point de divorcer. Problème pour lui : il ne se souvient plus de ce qu'il a fait la veille, en raison d'une cuite monumentale, dont d'ailleurs il peine à se remettre au début de l'histoire. (Au passage, c'est la confirmation que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé... notamment celle des conjoints.) Au vu des éléments réunis lors de l'enquête préliminaire, l'IA l'a déclaré présumé coupable (à 96,7 %). L'accusé a 1h30 pour, sinon prouver son innocence, du moins instiller un doute raisonnable, capable de faire suffisamment baisser son taux de culpabilité pour lui éviter l'exécution.
Le suspens est bien mis en scène, mais c'est surtout la manière dont l'accusé est autorisé à mener sa contre-enquête qui est épatante. Bien que rivé sur son siège, il a accès à tous les éléments du dossier (vidéos, rapports, interrogatoires, géolocalisations, preuves matérielles recueillies...) ainsi qu'à tous les contenus numériques (publics... et privés) enregistrés (conformément à la nouvelle loi) sur le cloud de la ville, afin de prévenir le crime. Il y a donc un peu de Minority Report (de Spielberg) dans ce film (les précogs étant remplacés par une IA, plus déductive que prédictive). L'ambiance rappelle aussi un peu la série 24 heures chrono, l'intrigue se déroulant quasiment en temps réel.
Un autre atout du film est l'incarnation de l'IA par Rebecca Ferguson (au charme de laquelle je ne suis pas insensible). Son côté beauté froide peu empathique convient parfaitement au rôle. L'un des enjeux de l'intrigue est d'ailleurs la possibilité d'évolution de l'IA, dont le fonctionnement apparaît de prime abord assez mécanique, mais qui, si elle a été bien entraînée, doit être capable de se remettre en question. Elle a aussi pour fonction d'aider honnêtement l'accusé dans ses tentatives de prouver son innocence. Un lien d'ordre humain pourrait-il naître des interactions entre Chris et Maddox ? Suspens...
J'ai passé un bon moment. L'habillage numérique, les scènes d'action et les multiples rebondissements entretiennent l'intérêt, jusqu'à la fin.
08:35 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Reconnu coupable
Dans ce thriller d'anticipation, la ville de Los Angeles a adopté une procédure judiciaire révolutionnaire en matière criminelle, puisque l'enquête, le procès et l'exécution des peines sont sous la responsabilité de Maddox, une intelligence artificielle. (Les juristes pointilleux noteront la disparition des avocats de la défense et de la possibilité de faire appel.)
Le policier Chris Raven a contribué à la mise en place de ce programme... mais le voilà désormais sur la sellette, plus précisément sur la chaise de l'accusé, puisqu'on lui reproche d'avoir assassiné son épouse, dont il était sur le point de divorcer. Problème pour lui : il ne se souvient plus de ce qu'il a fait la veille, en raison d'une cuite monumentale, dont d'ailleurs il peine à se remettre au début de l'histoire. (Au passage, c'est la confirmation que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé... notamment celle des conjoints.) Au vu des éléments réunis lors de l'enquête préliminaire, l'IA l'a déclaré présumé coupable (à 96,7 %). L'accusé a 1h30 pour, sinon prouver son innocence, du moins instiller un doute raisonnable, capable de faire suffisamment baisser son taux de culpabilité pour lui éviter l'exécution.
Le suspens est bien mis en scène, mais c'est surtout la manière dont l'accusé est autorisé à mener sa contre-enquête qui est épatante. Bien que rivé sur son siège, il a accès à tous les éléments du dossier (vidéos, rapports, interrogatoires, géolocalisations, preuves matérielles recueillies...) ainsi qu'à tous les contenus numériques (publics... et privés) enregistrés (conformément à la nouvelle loi) sur le cloud de la ville, afin de prévenir le crime. Il y a donc un peu de Minority Report (de Spielberg) dans ce film (les précogs étant remplacés par une IA, plus déductive que prédictive). L'ambiance rappelle aussi un peu la série 24 heures chrono, l'intrigue se déroulant quasiment en temps réel.
Un autre atout du film est l'incarnation de l'IA par Rebecca Ferguson (au charme de laquelle je ne suis pas insensible). Son côté beauté froide peu empathique convient parfaitement au rôle. L'un des enjeux de l'intrigue est d'ailleurs la possibilité d'évolution de l'IA, dont le fonctionnement apparaît de prime abord assez mécanique, mais qui, si elle a été bien entraînée, doit être capable de se remettre en question. Elle a aussi pour fonction d'aider honnêtement l'accusé dans ses tentatives de prouver son innocence. Un lien d'ordre humain pourrait-il naître des interactions entre Chris et Maddox ? Suspens...
J'ai passé un bon moment. L'habillage numérique, les scènes d'action et les multiples rebondissements entretiennent l'intérêt, jusqu'à la fin.
08:35 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
vendredi, 06 février 2026
Nuremberg
Ce n'est pas la première fois que le procès des principaux dirigeants nazis capturés par les Alliés fait l'objet d'une fiction (télévisuelle ou cinématographique). L'originalité de celle-ci est de présenter l'intrigue sous l'angle de la relation entre Hermann Göring et l'un des deux psychiatres états-uniens chargés de suivre les détenus.
Au départ, je nourrissais quelques appréhensions concernant l'interprétation de Russell Crowe en Göring. En fait, je l'ai trouvé très bien, à la fois sobre et ambigu dans son jeu. La déception est venue de là où je ne l'attendais pas : Rami Malek surjoue horriblement en psychiatre humaniste et sûr de sa science, dont on comprend immédiatement qu'il va se faire manipuler.
Heureusement, les personnages secondaires sont mieux campés, à commencer par le procureur Jackson (par Michael Shannon), mais aussi son homologue britannique Maxwell-Fyfe (par Richard E. Grant), le colonel Andrus (par John Slattery) et le sergent Triest (par Leo Woodall), ce dernier réservant de belles surprises, bien intégrées à l'histoire.
L'aspect filmique est donc réussi... plus que l'aspect historique. Je veux bien que, pour créer une intéressante dramaturgie, scénaristes comme réalisateurs soient amenés à prendre des libertés avec la réalité des faits, mais je commence à en avoir marre de constater les énormes déformations opérées dans des œuvres destinées à un grand public, et présentées par leurs auteurs comme fiables sur le plan historique.
Ainsi, je trouve que la genèse comme les enjeux du procès ne sont pas bien restitués. Le film donne l'impression que tout commence en 1945, alors que c'est dès 1942 que les Alliés ont songé à traduire en justice les dirigeants nazis. D'autre part, obtenir les aveux des accusés n'était pas une priorité pour tout le monde, puisque les preuves réunies étaient accablantes. A ce sujet, le colossal travail de documentation réalisé en amont n'est quasiment pas montré. Enfin, parmi les chefs d'accusation, les auteurs du film ont choisi d'insister sur celui qui a sans doute été le moins évoqué durant le procès : les crimes contre l'humanité. En effet, les Américains voulaient mettre en avant les notions de complot et de crime contre la paix, l'ensemble des Alliés étant d'accord pour pointer d'abord les crimes de guerre, dont ont été notamment victimes les civils des pays envahis par l'armée allemande ainsi que les prisonniers de guerre. (Les Soviétiques ont été les plus nombreux à mourir dans d'atroces souffrances et les Britanniques ont mis l'accent sur l'exécution de certains de leurs soldats.)
Le sort des juifs a bien été évoqué durant le procès, mais assez brièvement. C'est une déformation du XXIe siècle que de lui accorder une place centrale dans l'accusation. D'ailleurs, celle-ci n'avait pas retenu la toute récente notion de génocide.
Il y donc du trop-dit... et des non-dits, concernant principalement l'allié soviétique. On ne voit quasiment pas intervenir le procureur nommé par Staline, alors qu'il a pourtant ardemment participé au contre-interrogatoire de Göring. De plus, les crimes du régime communiste ne sont (vaguement) abordés qu'une seule fois, dans la bouche du second d'Hitler. Pourtant, de 1928 à 1945, des millions de personnes sont mortes sous la botte de Staline et de ses affidés, ce qui posait tout de même un sacré problème moral, auquel peut-être une vague allusion est faite, à un moment, dans l'une des interventions de Jackson.
Le film n'en demeure pas moins intéressant, bien conçu sur la forme et disant des choses importantes, mais avec tellement d'approximations...
P.S.
Avant de voir ce film, je connaissais le rôle des médecins dans le procès à travers l'action du psychologue Gustave Gilbert, présenté de manière particulièrement caricaturale dans le film. On le fait passer pour le grand incompétent, en comparaison du héros incarné par Malek. Une rivalité a bien opposé les deux hommes, mais Gilbert (qui parlait allemand) a lui aussi mené de nombreux entretiens avec les prisonniers. Il avait gagné la confiance de nombre d'entre eux (tant qu'il ne leur avait pas révélé qu'il était juif). C'est lui qui avait conseillé à l'accusation de miser sur l'orgueil de Göring... Dans le film, il est interprété par Colin Hanks (fils de...), vu récemment dans Nobody 2.
22:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Nuremberg
Ce n'est pas la première fois que le procès des principaux dirigeants nazis capturés par les Alliés fait l'objet d'une fiction (télévisuelle ou cinématographique). L'originalité de celle-ci est de présenter l'intrigue sous l'angle de la relation entre Hermann Göring et l'un des deux psychiatres états-uniens chargés de suivre les détenus.
Au départ, je nourrissais quelques appréhensions concernant l'interprétation de Russell Crowe en Göring. En fait, je l'ai trouvé très bien, à la fois sobre et ambigu dans son jeu. La déception est venue de là où je ne l'attendais pas : Rami Malek surjoue horriblement en psychiatre humaniste et sûr de sa science, dont on comprend immédiatement qu'il va se faire manipuler.
Heureusement, les personnages secondaires sont mieux campés, à commencer par le procureur Jackson (par Michael Shannon), mais aussi son homologue britannique Maxwell-Fyfe (par Richard E. Grant), le colonel Andrus (par John Slattery) et le sergent Triest (par Leo Woodall), ce dernier réservant de belles surprises, bien intégrées à l'histoire.
L'aspect filmique est donc réussi... plus que l'aspect historique. Je veux bien que, pour créer une intéressante dramaturgie, scénaristes comme réalisateurs soient amenés à prendre des libertés avec la réalité des faits, mais je commence à en avoir marre de constater les énormes déformations opérées dans des œuvres destinées à un grand public, et présentées par leurs auteurs comme fiables sur le plan historique.
Ainsi, je trouve que la genèse comme les enjeux du procès ne sont pas bien restitués. Le film donne l'impression que tout commence en 1945, alors que c'est dès 1942 que les Alliés ont songé à traduire en justice les dirigeants nazis. D'autre part, obtenir les aveux des accusés n'était pas une priorité pour tout le monde, puisque les preuves réunies étaient accablantes. A ce sujet, le colossal travail de documentation réalisé en amont n'est quasiment pas montré. Enfin, parmi les chefs d'accusation, les auteurs du film ont choisi d'insister sur celui qui a sans doute été le moins évoqué durant le procès : les crimes contre l'humanité. En effet, les Américains voulaient mettre en avant les notions de complot et de crime contre la paix, l'ensemble des Alliés étant d'accord pour pointer d'abord les crimes de guerre, dont ont été notamment victimes les civils des pays envahis par l'armée allemande ainsi que les prisonniers de guerre. (Les Soviétiques ont été les plus nombreux à mourir dans d'atroces souffrances et les Britanniques ont mis l'accent sur l'exécution de certains de leurs soldats.)
Le sort des juifs a bien été évoqué durant le procès, mais assez brièvement. C'est une déformation du XXIe siècle que de lui accorder une place centrale dans l'accusation. D'ailleurs, celle-ci n'avait pas retenu la toute récente notion de génocide.
Il y donc du trop-dit... et des non-dits, concernant principalement l'allié soviétique. On ne voit quasiment pas intervenir le procureur nommé par Staline, alors qu'il a pourtant ardemment participé au contre-interrogatoire de Göring. De plus, les crimes du régime communiste ne sont (vaguement) abordés qu'une seule fois, dans la bouche du second d'Hitler. Pourtant, de 1928 à 1945, des millions de personnes sont mortes sous la botte de Staline et de ses affidés, ce qui posait tout de même un sacré problème moral, auquel peut-être une vague allusion est faite, à un moment, dans l'une des interventions de Jackson.
Le film n'en demeure pas moins intéressant, bien conçu sur la forme et disant des choses importantes, mais avec tellement d'approximations...
P.S.
Avant de voir ce film, je connaissais le rôle des médecins dans le procès à travers l'action du psychologue Gustave Gilbert, présenté de manière particulièrement caricaturale dans le film. On le fait passer pour le grand incompétent, en comparaison du héros incarné par Malek. Une rivalité a bien opposé les deux hommes, mais Gilbert (qui parlait allemand) a lui aussi mené de nombreux entretiens avec les prisonniers. Il avait gagné la confiance de nombre d'entre eux (tant qu'il ne leur avait pas révélé qu'il était juif). C'est lui qui avait conseillé à l'accusation de miser sur l'orgueil de Göring... Dans le film, il est interprété par Colin Hanks (fils de...), vu récemment dans Nobody 2.
22:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 31 janvier 2026
Primate
Ce petit film d'horreur a pour principal antagoniste un chimpanzé domestique, devenu enragé. On le découvre dans ses œuvres dès la première séquence, chargée de nous "mettre l'eau à la bouche"... avant que l'histoire ne fasse un bond en arrière.
C'est un procédé classique de ce genre de films, tout comme la présence, dans le groupe de protagonistes, d'une brochette d'individus peu sympathiques, que l'on découvre dans la séquence suivante (dans un avion). Ces jeunes adultes (des deux sexes) semblent assez superficiels, immatures. Les scénaristes sont malins : on a rapidement envie qu'il leur arrive quelques bricoles.
Grâce à Ben (le chimpanzé), ce sera chose faite, avec une cruauté à faire pâlir d'envie un requin psychopathe. Mais, en attendant ce déferlement de violence simiesque, on peut profiter de la visite d'une baraque époustouflante, située dans les îles Hawaï, dotée d'une somptueuse piscine à flanc de falaise. Comme, en plus, il fait chaud, c'est l'occasion pour les jeunes héros de porter des petites tenues. (Trop malin, le scénar !)
Évidemment, il faut s'attendre à ce que plusieurs personnages fassent ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ce genre de situation (sauf bien sûr si l'on à envie de finir entre les pattes de Ben). A un moment, on a même un duo de jeunes hommes, un brin éméchés, qui décident de faire "deux groupes de un". (Jean-Marie Bigard, sors de ce corps de scénariste !)
J'oubliais de vous dire que l'un des protagonistes est sourd-muet. Certains échanges s'effectuent donc grâce à la langue des signes... ce qui permet aussi de communiquer avec le singe (enfin, tant qu'il a encore toute sa tête). Le côté "inclusif" du film est renforcé par une amitié très particulière entre deux jeunes femmes, l'une des deux apparaissant clairement comme bisexuelle. Cela suffira-t-il à la faire échapper aux griffes du chimpanzé ? Le suspens est insoutenable...
20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Primate
Ce petit film d'horreur a pour principal antagoniste un chimpanzé domestique, devenu enragé. On le découvre dans ses œuvres dès la première séquence, chargée de nous "mettre l'eau à la bouche"... avant que l'histoire ne fasse un bond en arrière.
C'est un procédé classique de ce genre de films, tout comme la présence, dans le groupe de protagonistes, d'une brochette d'individus peu sympathiques, que l'on découvre dans la séquence suivante (dans un avion). Ces jeunes adultes (des deux sexes) semblent assez superficiels, immatures. Les scénaristes sont malins : on a rapidement envie qu'il leur arrive quelques bricoles.
Grâce à Ben (le chimpanzé), ce sera chose faite, avec une cruauté à faire pâlir d'envie un requin psychopathe. Mais, en attendant ce déferlement de violence simiesque, on peut profiter de la visite d'une baraque époustouflante, située dans les îles Hawaï, dotée d'une somptueuse piscine à flanc de falaise. Comme, en plus, il fait chaud, c'est l'occasion pour les jeunes héros de porter des petites tenues. (Trop malin, le scénar !)
Évidemment, il faut s'attendre à ce que plusieurs personnages fassent ce qu'il ne faut absolument pas faire dans ce genre de situation (sauf bien sûr si l'on à envie de finir entre les pattes de Ben). A un moment, on a même un duo de jeunes hommes, un brin éméchés, qui décident de faire "deux groupes de un". (Jean-Marie Bigard, sors de ce corps de scénariste !)
J'oubliais de vous dire que l'un des protagonistes est sourd-muet. Certains échanges s'effectuent donc grâce à la langue des signes... ce qui permet aussi de communiquer avec le singe (enfin, tant qu'il a encore toute sa tête). Le côté "inclusif" du film est renforcé par une amitié très particulière entre deux jeunes femmes, l'une des deux apparaissant clairement comme bisexuelle. Cela suffira-t-il à la faire échapper aux griffes du chimpanzé ? Le suspens est insoutenable...
20:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Furcy, né libre
Onze ans après Qu'Allah bénisse la France, le rappeur Abd Al Malik est de retour derrière la caméra, avec un film "engagé", consacré à un personnage réel de notre histoire, Furcy Madeleine, en général présenté comme esclave réunionnais, mais qui, en réalité, était né libre... sans le savoir. Sur un sujet fort, le réalisateur a construit une œuvre divisée grosso modo en trois parties, qu'on peut se contenter d'analyser sur un plan strictement cinématographique, mais dont je pense qu'il faut aussi présenter les faiblesses historiques.
La première partie évoque la période 1816-1817 quand, après avoir découvert l'affranchissement ancien de sa mère, Furcy décide de se faire rendre justice. Les méchants de l'histoire sont en général bien campés : Vincent Macaigne incarne une petite ordure de colon esclavagiste et Micha Lescot nous ravit en avocat fielleux et méprisant. Du côté des gentils, Makita Samba est sobre dans le rôle principal, tandis que Romain Duris et Frédéric Pierrot sont chargés d'incarner les juristes humanistes. Ils le font avec conviction... et, parfois, avec maladresse. Les scènes sont souvent très courtes. Je pense que le montage a eu pour but de masquer certaines faiblesses.
La deuxième partie est consacrée au (long) séjour de Furcy sur l'Île Maurice (ex-Île de France), d'abord comme esclave, puis comme employé de commerce. Cette partie contient un peu plus de cinéma, avec les scènes de case et de plantation. On nous y montre la volonté de briser un homme, pour qui survivre, c'est résister. Makita Samba est toujours aussi sobre et digne, un peu comme jadis Alfred Dreyfus à Cayenne. Il supporte ce qu'il subit, dans l'espoir que ses droits finissent par être reconnus. J'ai aussi apprécié le fait que, pour les esclaves (mais pas que), l'émancipation passe par la lecture et l'écriture.
Je n'ai pas été choqué par la comparaison visuelle qui est faite (par allusion) entre l'entrée de la file d'esclaves sur la propriété esclavagiste et l'arrivée des déportés de jadis dans les camps nazis. Dans les deux cas, on est face à un crime contre l'humanité et il est question de travail forcé. (Mais, les esclaves ne sont pas victimes d'extermination, ce qui constitue la limite de la comparaison.)
A travers la séquence mauricienne, on a l'impression qu'Abd Al Malik a voulu faire son 12 Years a Slave... en moins bien. Le moment qui voit le héros s'investir dans la confiserie est toutefois correctement mis en scène, même s'il comporte des zones d'ombre et des déformations (dont je parlerai plus loin).
La troisième partie se joue en France métropolitaine. C'est le retour du film de procès. On y entend de belles plaidoiries, de belles déclarations de principes, mais c'est gâché par la volonté de faire de l'avocat de Furcy (l'ancien procureur du début, interprété par Romain Duris) un homme malade, à la toux aussi aléatoire qu'envahissante, sauf quand il nous livre sa grande tirade, curieusement pas interrompue par le moindre soubresaut. (Au passage, je signale que ledit ex-procureur, reconverti en avocat, était absent du procès en Cassation... Peut-être a-t-on estimé qu'il était regrettable de se passer des services de Romain Duris pour cet épisode capital de l'intrigue.)
Le film se conclut sur l'évocation, par des incrustations, des suites judiciaires (l'obtention de réparations) et de la fin de la vie de Furcy. Là encore, on ne nous donne que des informations incomplètes, ce qui m'amène à évoquer les faiblesses historiques du film, qui ne sont pas petites.
Le premier problème est posé par le choix du comédien principal, non pas en raison de son talent (je trouve qu'il fait plutôt bien le job), mais à cause de son apparence physique. Le véritable Furcy n'était pas africain, mais né d'une mère indienne (ce qui figure d'ailleurs dans les dialogues) et d'un père colon français de Bourbon. Dans les textes de l'époque (par exemple le testament de la tante de l'esclavagiste Lory), il est qualifié de "Malabar", pas de "Cafre" (terme utilisé pour désigner les personnes originaires de l'Afrique intertropicale). Il ne devait donc pas ressembler à ceci :
... mais plutôt à cela :
(Ces deux tentatives de représentation figurent dans une exposition datant de 2019, dont on peut télécharger la version numérique ici. Les auteurs du film auraient dû la consulter et s'en inspirer.)
A ce problème d'incarnation s'ajoutent les choix opérés à propos de la représentation des femmes. Dans le film, Furcy entretient une liaison amoureuse avec une femme blanche (bien incarnée par Ana Girardot). Dans la réalité, Furcy a eu des relations avec des femmes "libres de couleur", sur l'île Bourbon comme sur l'île Maurice. Il a même eu des enfants avec. Cela aurait pu constituer un versant intéressant de l'intrigue, que les scénaristes ont préféré remplacer par une relation interethnique (pourquoi pas après tout). Peut-être aussi s'agissait-il d'ajouter un nom connu à la distribution (pourtant déjà riche). On ressent toutefois un certain malaise quand, dans la troisième partie de l'histoire, cette petite amie blanche suggère au héros de se soumettre... On se demande ce qui peut bien justifier cette insertion totalement fictive, tout comme une autre, un peu avant : quand Furcy débarque sur l'île Maurice, il est presque immédiatement maltraité par une parente de Lory, une femme blanche, à cheval, qui le frappe. Or, d'après l'essai biographique qui a été consacré à Furcy (voir ci-dessous), c'est le frère aîné de Lory qui le moleste.
(Vous noterez que l'éditeur de la version de poche n'a pas été très inspiré dans le choix de l'illustration de couverture (qui est censée représenter... Othello, personnage de Shakespeare). J'ajoute que, très souvent, j'ai lu et entendu, à propos de ce livre, qu'il était un roman, ce qui n'est pas le cas. C'est au moins l'indice que ces personnes ne l'ont pas lu.)
Mais le personnage féminin le plus maltraité du film (au sens propre comme au sens figuré) est sans conteste Constance, la sœur de Furcy. Elle aussi est dotée d'une apparence qui n'a pas grand chose à voir avec la réalité. (Issue du même métissage que son frère, elle était jadis décrite comme ayant la peau claire et pouvant passer pour une Européenne de l'époque.) Surtout, dans le film, bien que rebelle, elle est essentiellement présentée comme une victime, un personnage secondaire, alors qu'elle savait lire et était à l'origine de la procédure juridique en faveur de son frère, qu'elle a tout fait pour sortir de l'esclavage. Enfin cerise sur le gâteau, la séquence de "pressions" exercées sur elle chez les planteurs blancs est en grande partie inventée. Certes, certains esclavagistes de Bourbon l'ont menacée pour qu'elle change sa version des faits, mais dans tout ce que j'ai lu, il n'est pas question du viol suggéré par le film, un viol qui aurait été perpétré par Brabant, le sbire noir de Lory... qui, en réalité, avait déjà quitté son service à l'époque. (Il avait acheté son affranchissement.) Il a bien rencontré Constance, mais, dans la rue, et cela s'est limité à une discussion... Je précise que je tire la plupart de ces détails du livre de Mohammed Aïssaoui, qui est pourtant présenté par la production comme ayant inspiré le film !
Je ne vais pas m'éterniser, mais je tiens à terminer par un dernier élément, que je juge très important, et que les auteurs du film ont pris soin de passer sous silence. Une fois sa liberté obtenue à Maurice, Furcy est devenu commerçant indépendant (pas simple employé, comme montré dans le film). Il s'est enrichi et a même acheté... deux esclaves ! Du coup, son combat semble quelque peu perdre sa vocation universaliste, pour devenir celui d'un homme talentueux, soucieux d'obtenir la place qu'il estime mériter dans une société inégalitaire qu'il ne souhaite pas chambouler.
17:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Furcy, né libre
Onze ans après Qu'Allah bénisse la France, le rappeur Abd Al Malik est de retour derrière la caméra, avec un film "engagé", consacré à un personnage réel de notre histoire, Furcy Madeleine, en général présenté comme esclave réunionnais, mais qui, en réalité, était né libre... sans le savoir. Sur un sujet fort, le réalisateur a construit une œuvre divisée grosso modo en trois parties, qu'on peut se contenter d'analyser sur un plan strictement cinématographique, mais dont je pense qu'il faut aussi présenter les faiblesses historiques.
La première partie évoque la période 1816-1817 quand, après avoir découvert l'affranchissement ancien de sa mère, Furcy décide de se faire rendre justice. Les méchants de l'histoire sont en général bien campés : Vincent Macaigne incarne une petite ordure de colon esclavagiste et Micha Lescot nous ravit en avocat fielleux et méprisant. Du côté des gentils, Makita Samba est sobre dans le rôle principal, tandis que Romain Duris et Frédéric Pierrot sont chargés d'incarner les juristes humanistes. Ils le font avec conviction... et, parfois, avec maladresse. Les scènes sont souvent très courtes. Je pense que le montage a eu pour but de masquer certaines faiblesses.
La deuxième partie est consacrée au (long) séjour de Furcy sur l'Île Maurice (ex-Île de France), d'abord comme esclave, puis comme employé de commerce. Cette partie contient un peu plus de cinéma, avec les scènes de case et de plantation. On nous y montre la volonté de briser un homme, pour qui survivre, c'est résister. Makita Samba est toujours aussi sobre et digne, un peu comme jadis Alfred Dreyfus à Cayenne. Il supporte ce qu'il subit, dans l'espoir que ses droits finissent par être reconnus. J'ai aussi apprécié le fait que, pour les esclaves (mais pas que), l'émancipation passe par la lecture et l'écriture.
Je n'ai pas été choqué par la comparaison visuelle qui est faite (par allusion) entre l'entrée de la file d'esclaves sur la propriété esclavagiste et l'arrivée des déportés de jadis dans les camps nazis. Dans les deux cas, on est face à un crime contre l'humanité et il est question de travail forcé. (Mais, les esclaves ne sont pas victimes d'extermination, ce qui constitue la limite de la comparaison.)
A travers la séquence mauricienne, on a l'impression qu'Abd Al Malik a voulu faire son 12 Years a Slave... en moins bien. Le moment qui voit le héros s'investir dans la confiserie est toutefois correctement mis en scène, même s'il comporte des zones d'ombre et des déformations (dont je parlerai plus loin).
La troisième partie se joue en France métropolitaine. C'est le retour du film de procès. On y entend de belles plaidoiries, de belles déclarations de principes, mais c'est gâché par la volonté de faire de l'avocat de Furcy (l'ancien procureur du début, interprété par Romain Duris) un homme malade, à la toux aussi aléatoire qu'envahissante, sauf quand il nous livre sa grande tirade, curieusement pas interrompue par le moindre soubresaut. (Au passage, je signale que ledit ex-procureur, reconverti en avocat, était absent du procès en Cassation... Peut-être a-t-on estimé qu'il était regrettable de se passer des services de Romain Duris pour cet épisode capital de l'intrigue.)
Le film se conclut sur l'évocation, par des incrustations, des suites judiciaires (l'obtention de réparations) et de la fin de la vie de Furcy. Là encore, on ne nous donne que des informations incomplètes, ce qui m'amène à évoquer les faiblesses historiques du film, qui ne sont pas petites.
Le premier problème est posé par le choix du comédien principal, non pas en raison de son talent (je trouve qu'il fait plutôt bien le job), mais à cause de son apparence physique. Le véritable Furcy n'était pas africain, mais né d'une mère indienne (ce qui figure d'ailleurs dans les dialogues) et d'un père colon français de Bourbon. Dans les textes de l'époque (par exemple le testament de la tante de l'esclavagiste Lory), il est qualifié de "Malabar", pas de "Cafre" (terme utilisé pour désigner les personnes originaires de l'Afrique intertropicale). Il ne devait donc pas ressembler à ceci :
... mais plutôt à cela :
(Ces deux tentatives de représentation figurent dans une exposition datant de 2019, dont on peut télécharger la version numérique ici. Les auteurs du film auraient dû la consulter et s'en inspirer.)
A ce problème d'incarnation s'ajoutent les choix opérés à propos de la représentation des femmes. Dans le film, Furcy entretient une liaison amoureuse avec une femme blanche (bien incarnée par Ana Girardot). Dans la réalité, Furcy a eu des relations avec des femmes "libres de couleur", sur l'île Bourbon comme sur l'île Maurice. Il a même eu des enfants avec. Cela aurait pu constituer un versant intéressant de l'intrigue, que les scénaristes ont préféré remplacer par une relation interethnique (pourquoi pas après tout). Peut-être aussi s'agissait-il d'ajouter un nom connu à la distribution (pourtant déjà riche). On ressent toutefois un certain malaise quand, dans la troisième partie de l'histoire, cette petite amie blanche suggère au héros de se soumettre... On se demande ce qui peut bien justifier cette insertion totalement fictive, tout comme une autre, un peu avant : quand Furcy débarque sur l'île Maurice, il est presque immédiatement maltraité par une parente de Lory, une femme blanche, à cheval, qui le frappe. Or, d'après l'essai biographique qui a été consacré à Furcy (voir ci-dessous), c'est le frère aîné de Lory qui le moleste.
(Vous noterez que l'éditeur de la version de poche n'a pas été très inspiré dans le choix de l'illustration de couverture (qui est censée représenter... Othello, personnage de Shakespeare). J'ajoute que, très souvent, j'ai lu et entendu, à propos de ce livre, qu'il était un roman, ce qui n'est pas le cas. C'est au moins l'indice que ces personnes ne l'ont pas lu.)
Mais le personnage féminin le plus maltraité du film (au sens propre comme au sens figuré) est sans conteste Constance, la sœur de Furcy. Elle aussi est dotée d'une apparence qui n'a pas grand chose à voir avec la réalité. (Issue du même métissage que son frère, elle était jadis décrite comme ayant la peau claire et pouvant passer pour une Européenne de l'époque.) Surtout, dans le film, bien que rebelle, elle est essentiellement présentée comme une victime, un personnage secondaire, alors qu'elle savait lire et était à l'origine de la procédure juridique en faveur de son frère, qu'elle a tout fait pour sortir de l'esclavage. Enfin cerise sur le gâteau, la séquence de "pressions" exercées sur elle chez les planteurs blancs est en grande partie inventée. Certes, certains esclavagistes de Bourbon l'ont menacée pour qu'elle change sa version des faits, mais dans tout ce que j'ai lu, il n'est pas question du viol suggéré par le film, un viol qui aurait été perpétré par Brabant, le sbire noir de Lory... qui, en réalité, avait déjà quitté son service à l'époque. (Il avait acheté son affranchissement.) Il a bien rencontré Constance, mais, dans la rue, et cela s'est limité à une discussion... Je précise que je tire la plupart de ces détails du livre de Mohammed Aïssaoui, qui est pourtant présenté par la production comme ayant inspiré le film !
Je ne vais pas m'éterniser, mais je tiens à terminer par un dernier élément, que je juge très important, et que les auteurs du film ont pris soin de passer sous silence. Une fois sa liberté obtenue à Maurice, Furcy est devenu commerçant indépendant (pas simple employé, comme montré dans le film). Il s'est enrichi et a même acheté... deux esclaves ! Du coup, son combat semble quelque peu perdre sa vocation universaliste, pour devenir celui d'un homme talentueux, soucieux d'obtenir la place qu'il estime mériter dans une société inégalitaire qu'il ne souhaite pas chambouler.
17:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mercredi, 28 janvier 2026
Gourou
Quelques mois à peine après la sortie de Dalloway, voici une nouvelle œuvre de Yann Gozlan sur nos écrans. Ce sont aussi des retrouvailles avec Pierre Niney (qui coproduit le film), auréolé de sa prestation dans Le Comte de Monte-Cristo.
Ici, le nouvel Alain Delon du cinéma français interprète un coach en développement personnel prospère, qui organise de grandes réunions cathartiques (payantes), au cours desquelles il ambitionne de redonner du sens à la vie de ses "clients". Dans le rôle du gourou qui ne dit pas son nom, Niney a une présence folle. Sa performance justifie à elle seule la vision du film, de surcroît habilement mis en scène et doté d'une excellente musique d'accompagnement.
J'ai été cueilli par la première scène "messianique", qui voit le coach "prendre en mains" un pauvre type qui le voit comme un demi-dieu. Le pauvre type en question est très bien interprété par Anthony Bajon (rappelez-vous : Teddy). Les interactions entre ces deux personnages nous réservent quelques surprises.
Un autre moment fort est celui au cours duquel Matt Vasseur démasque (sans le dire ouvertement) une infiltrée, en pleine "cérémonie".
Cette manière de procéder, de la part du héros, m'a rappelé les télévangélistes (américains) de ma jeunesse, que je regardais jadis sur RTL. C'est fou comme les styles sont ressemblants, la grande différence résidant dans le caractère laïc du travail du gourou, celui-ci se permettant toutefois de préciser, au cours d'un entretien, que lui et Jésus font un peu le même boulot...
La réalisation est suffisamment subtile pour ménager quelques incertitudes : dans quelle mesure le héros croit-il à ce qu'il dit ? quelle est la nature exacte de la relation toxique qu'il entretient avec son frère ?
Ma principale déception vient de la fin de l'histoire. Soit Gozlan n'a pas su comment conclure, soit il a maladroitement brouillé les pistes pour que l'on ne devine pas à l'avance comment tout cela allait se terminer... soit, entre plusieurs fins possibles, on n'a pas choisi la meilleure.
Le film n'en demeure pas moins fort, prenant, s'appuyant d'abord sur le talent d'un acteur solaire, bien épaulé par une brigade de seconds rôles efficaces.
21:23 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Gourou
Quelques mois à peine après la sortie de Dalloway, voici une nouvelle œuvre de Yann Gozlan sur nos écrans. Ce sont aussi des retrouvailles avec Pierre Niney (qui coproduit le film), auréolé de sa prestation dans Le Comte de Monte-Cristo.
Ici, le nouvel Alain Delon du cinéma français interprète un coach en développement personnel prospère, qui organise de grandes réunions cathartiques (payantes), au cours desquelles il ambitionne de redonner du sens à la vie de ses "clients". Dans le rôle du gourou qui ne dit pas son nom, Niney a une présence folle. Sa performance justifie à elle seule la vision du film, de surcroît habilement mis en scène et doté d'une excellente musique d'accompagnement.
J'ai été cueilli par la première scène "messianique", qui voit le coach "prendre en mains" un pauvre type qui le voit comme un demi-dieu. Le pauvre type en question est très bien interprété par Anthony Bajon (rappelez-vous : Teddy). Les interactions entre ces deux personnages nous réservent quelques surprises.
Un autre moment fort est celui au cours duquel Matt Vasseur démasque (sans le dire ouvertement) une infiltrée, en pleine "cérémonie".
Cette manière de procéder, de la part du héros, m'a rappelé les télévangélistes (américains) de ma jeunesse, que je regardais jadis sur RTL. C'est fou comme les styles sont ressemblants, la grande différence résidant dans le caractère laïc du travail du gourou, celui-ci se permettant toutefois de préciser, au cours d'un entretien, que lui et Jésus font un peu le même boulot...
La réalisation est suffisamment subtile pour ménager quelques incertitudes : dans quelle mesure le héros croit-il à ce qu'il dit ? quelle est la nature exacte de la relation toxique qu'il entretient avec son frère ?
Ma principale déception vient de la fin de l'histoire. Soit Gozlan n'a pas su comment conclure, soit il a maladroitement brouillé les pistes pour que l'on ne devine pas à l'avance comment tout cela allait se terminer... soit, entre plusieurs fins possibles, on n'a pas choisi la meilleure.
Le film n'en demeure pas moins fort, prenant, s'appuyant d'abord sur le talent d'un acteur solaire, bien épaulé par une brigade de seconds rôles efficaces.
21:23 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société