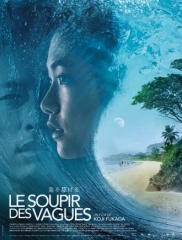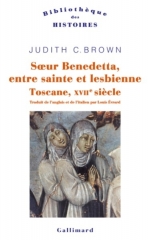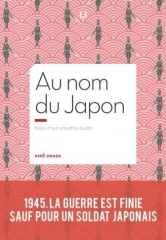vendredi, 13 août 2021
Rouge
À la lecture de ce titre, les "vieux" cinéphiles auront tendance à penser à un film de Krzysztof Kieslowski datant de plus de vingt ans. Il n'en est rien, puisque le long-métrage auquel est consacré ce billet vient juste de sortir, même s'il fait partie de la promotion (maudite) de Cannes 2020 (le festival qui n'a pas eu lieu). La majorité de la sélection a débarqué dans nos salles ces derniers mois. Rétrospectivement, on se rend compte d'ailleurs que c'était une promotion de qualité, puisqu'elle comptait des œuvres comme Teddy, Des Hommes, Les Deux Alfred, Nadia, Butterfly et L'Oubli que nous serons.
Rouge bénéficie d'une bonne critique presse, qui le compare souvent à Dark Waters. On est donc tenté de penser qu'il s'agit d'un "film-dossier", d'autant qu'il s'appuie sur un scandale bien réel, celui des "boues rouges de Gardanne". Mais, plus qu'un pamphlet sociétal, Rouge est d'abord selon moi un film psychologique, qui s'apparente au drame familial.
L'intrigue tourne autour de deux personnages principaux, Slimane, ouvrier-syndicaliste (sans doute CGT) de l'usine d'aluminium Arkalu (un décalque d'Alteo) et Nour, sa fille, infirmière qui vient de quitter l'hôpital pour intégrer l'entreprise où son père travaille depuis près de trente ans. Dans cette boîte, elle va avoir pour collègues les amis de la famille, mais aussi son futur beau-frère.
Outre l'ambiance de travail, le réalisateur (Farid Bentoumi) réussit à mettre en scène le conflit d'allégeance qui tenaille Nour (Zita Hanrot, formidable) : soit elle reste la fille à son père (Sami Bouajila, tout aussi excellent) et elle renie une partie de sa vocation d'infirmière, soit elle demeure fidèle à son engagement professionnel (sauver des vies) et, dans ce cas, elle entre en conflit avec ceux qu'elle aime.
Le résultat, qui pourrait être platement manichéen, est d'une remarquable subtilité. Même le personnage du patron de l'usine (interprété par Olivier Gourmet, une fois de plus impeccable) a droit à une vision nuancée. On découvre un monde ouvrier divisé, d'abord entre titulaires et intérimaires, ensuite entre "Français de souche" racistes (ou pas), Français d'origine immigrée et étrangers. Qu'est-ce qui maintient l'unité ? L'envie de garder son boulot.
Les seconds rôles sont au poil et contribuent à nuancer le tableau, de la journaliste écolo (Céline Sallette) à la sœur de Nour (Alka Balbir), en passant par les anciens ouvriers basculés au service restauration, les cadres de la boîte, le député du coin et des militants écologistes plus ou moins regardants sur les méthodes.
Dans le même temps, Slimane prépare le mariage de sa fille aînée. J'ajoute qu'à l'usine tout le monde redoute la venue d'une inspection, dont l'avis est indispensable pour obtenir le droit de rejeter à nouveau des déchets en mer. Dans le dernier tiers de l'histoire, l'ambiance de thriller prend le dessus... et c'est prenant.
Je conseille de se jeter sans délai sur ce film, parce qu'il risque de disparaître rapidement de nos écrans. Ce n'est pas le genre d'histoire que les Français ont envie de voir au cinéma en ce moment. C'est pourtant l'un des plus beaux films sortis ces dernières semaines.
P.S.
L'avenir de l'usine Alteo (la vraie) n'est toujours pas assuré. Des améliorations ont été apportées au processus de fabrication d'aluminium, mais l'entreprise est en difficulté, en quête de repreneur.
16:13 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Rouge
À la lecture de ce titre, les "vieux" cinéphiles auront tendance à penser à un film de Krzysztof Kieslowski datant de plus de vingt ans. Il n'en est rien, puisque le long-métrage auquel est consacré ce billet vient juste de sortir, même s'il fait partie de la promotion (maudite) de Cannes 2020 (le festival qui n'a pas eu lieu). La majorité de la sélection a débarqué dans nos salles ces derniers mois. Rétrospectivement, on se rend compte d'ailleurs que c'était une promotion de qualité, puisqu'elle comptait des œuvres comme Teddy, Des Hommes, Les Deux Alfred, Nadia, Butterfly et L'Oubli que nous serons.
Rouge bénéficie d'une bonne critique presse, qui le compare souvent à Dark Waters. On est donc tenté de penser qu'il s'agit d'un "film-dossier", d'autant qu'il s'appuie sur un scandale bien réel, celui des "boues rouges de Gardanne". Mais, plus qu'un pamphlet sociétal, Rouge est d'abord selon moi un film psychologique, qui s'apparente au drame familial.
L'intrigue tourne autour de deux personnages principaux, Slimane, ouvrier-syndicaliste (sans doute CGT) de l'usine d'aluminium Arkalu (un décalque d'Alteo) et Nour, sa fille, infirmière qui vient de quitter l'hôpital pour intégrer l'entreprise où son père travaille depuis près de trente ans. Dans cette boîte, elle va avoir pour collègues les amis de la famille, mais aussi son futur beau-frère.
Outre l'ambiance de travail, le réalisateur (Farid Bentoumi) réussit à mettre en scène le conflit d'allégeance qui tenaille Nour (Zita Hanrot, formidable) : soit elle reste la fille à son père (Sami Bouajila, tout aussi excellent) et elle renie une partie de sa vocation d'infirmière, soit elle demeure fidèle à son engagement professionnel (sauver des vies) et, dans ce cas, elle entre en conflit avec ceux qu'elle aime.
Le résultat, qui pourrait être platement manichéen, est d'une remarquable subtilité. Même le personnage du patron de l'usine (interprété par Olivier Gourmet, une fois de plus impeccable) a droit à une vision nuancée. On découvre un monde ouvrier divisé, d'abord entre titulaires et intérimaires, ensuite entre "Français de souche" racistes (ou pas), Français d'origine immigrée et étrangers. Qu'est-ce qui maintient l'unité ? L'envie de garder son boulot.
Les seconds rôles sont au poil et contribuent à nuancer le tableau, de la journaliste écolo (Céline Sallette) à la sœur de Nour (Alka Balbir), en passant par les anciens ouvriers basculés au service restauration, les cadres de la boîte, le député du coin et des militants écologistes plus ou moins regardants sur les méthodes.
Dans le même temps, Slimane prépare le mariage de sa fille aînée. J'ajoute qu'à l'usine tout le monde redoute la venue d'une inspection, dont l'avis est indispensable pour obtenir le droit de rejeter à nouveau des déchets en mer. Dans le dernier tiers de l'histoire, l'ambiance de thriller prend le dessus... et c'est prenant.
Je conseille de se jeter sans délai sur ce film, parce qu'il risque de disparaître rapidement de nos écrans. Ce n'est pas le genre d'histoire que les Français ont envie de voir au cinéma en ce moment. C'est pourtant l'un des plus beaux films sortis ces dernières semaines.
P.S.
L'avenir de l'usine Alteo (la vraie) n'est toujours pas assuré. Des améliorations ont été apportées au processus de fabrication d'aluminium, mais l'entreprise est en difficulté, en quête de repreneur.
16:13 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
mardi, 10 août 2021
C'est quoi ce papy ?!
Deux ans après le succès du médiocre C'est quoi cette mamie ?! (un million deux cent mille entrées tout de même), Gabriel Julien-Laferrière revient avec la suite (le troisième volet d'un triptyque, en fait). Les petits-enfants ont plus ou moins grandi, les parents pas vraiment changé... et la grand-mère pète toujours le feu ! Chantal Ladesou bénéficie des meilleurs saillies écrites par les dialoguistes, qui ont néanmoins réservé quelques perles à un nouveau venu, le grand-père (présumé), interprété par Patrick Chesnais.
C'est en raison de sa présence au générique (et grâce à une bande-annonce percutante) que je me suis lancé dans cette aventure. La première partie joue sur l'amnésie de l'héroïne, suite à un accident survenu au cours d'une de ces bamboches qu'affectionne Aurore. J'ai été agréablement surpris par tout ce qu'il se passe à l'hôpital... où elle est censée se reposer... (Notons que cet institut s'appelle "Julien-Laferrière-Mounier", des noms des deux scénaristes !)
L'intérêt pour l'histoire vient aussi de l'évolution des personnages des petits-enfants. Dans le lot, on a une ribambelle de têtes à claques, entre la féministe extrémiste, le végan, le noir homosexuel intersectionnel, la bonne sœur, le flic "bogosse" et le youtubeur fumeur de joints. Les scénaristes aiment visiblement leurs jeunes personnages... toutefois pas au point de totalement les épargner. Ainsi, le défenseur de la nature doit accepter de voyager en véhicule polluant, la féministe de "sécher" une manif', le policier d'enfreindre la loi, le Noir de jouer au "petit nègre", la bonne sœur de "s'ouvrir" au monde séculier (je n'en dis pas plus)... Ma préférée reste Clara (Violette Guillon, fille de... avec du talent), pas la plus âgée mais la cheville ouvrière de la tribu de petits-enfants, qui s'est donné pour mission de faire recouvrer la mémoire à Aurore.
Pour cela, ils comptent sur ses retrouvailles avec ce qu'ils présument être son amour de jeunesse, un certain Gégé. Caché au fin fond des Cévennes, cet éleveur de moutons n'est pas submergé de joie quand débarque la petite troupe. Plus attendue, cette partie est savoureuse pour la confrontation entre le vieil anar et les jeunes bobos, qui ont sans doute des valeurs en commun, mais avec deux générations d'écart. (Je laisse à chacun.e le plaisir de découvrir quels animaux de la ferme ont été nommés Lénine, Staline, Mao, Méluche et... Sarko !)
En revanche, je trouve le côté sentimental (la renaissance de l'amour entre les deux "aînés") complètement raté. Là, on sent que Chesnais se fait un peu chier. Il est un autre aspect de l'histoire qui m'a semblé très maladroit : la grossesse de Juliette (la féministe). Au début du film, on distingue à peine son petit bidon, alors qu'elle est censée être enceinte de huit mois. En quelques jours, on la voit prendre des seins et du ventre de manière impressionnante ! (Cela m'a rappelé un passage du récent Old, qui, lui, est étiqueté film fantastique...) La séquence de l'accouchement (dans une grange, en présence d'un âne...) accumule les clichés, sans le second degré d'OSS 117, hélas. Mais, comme les deux vieux cons tiennent bien la barre, l'ensemble n'est pas déplaisant, loin de là.
14:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
C'est quoi ce papy ?!
Deux ans après le succès du médiocre C'est quoi cette mamie ?! (un million deux cent mille entrées tout de même), Gabriel Julien-Laferrière revient avec la suite (le troisième volet d'un triptyque, en fait). Les petits-enfants ont plus ou moins grandi, les parents pas vraiment changé... et la grand-mère pète toujours le feu ! Chantal Ladesou bénéficie des meilleurs saillies écrites par les dialoguistes, qui ont néanmoins réservé quelques perles à un nouveau venu, le grand-père (présumé), interprété par Patrick Chesnais.
C'est en raison de sa présence au générique (et grâce à une bande-annonce percutante) que je me suis lancé dans cette aventure. La première partie joue sur l'amnésie de l'héroïne, suite à un accident survenu au cours d'une de ces bamboches qu'affectionne Aurore. J'ai été agréablement surpris par tout ce qu'il se passe à l'hôpital... où elle est censée se reposer... (Notons que cet institut s'appelle "Julien-Laferrière-Mounier", des noms des deux scénaristes !)
L'intérêt pour l'histoire vient aussi de l'évolution des personnages des petits-enfants. Dans le lot, on a une ribambelle de têtes à claques, entre la féministe extrémiste, le végan, le noir homosexuel intersectionnel, la bonne sœur, le flic "bogosse" et le youtubeur fumeur de joints. Les scénaristes aiment visiblement leurs jeunes personnages... toutefois pas au point de totalement les épargner. Ainsi, le défenseur de la nature doit accepter de voyager en véhicule polluant, la féministe de "sécher" une manif', le policier d'enfreindre la loi, le Noir de jouer au "petit nègre", la bonne sœur de "s'ouvrir" au monde séculier (je n'en dis pas plus)... Ma préférée reste Clara (Violette Guillon, fille de... avec du talent), pas la plus âgée mais la cheville ouvrière de la tribu de petits-enfants, qui s'est donné pour mission de faire recouvrer la mémoire à Aurore.
Pour cela, ils comptent sur ses retrouvailles avec ce qu'ils présument être son amour de jeunesse, un certain Gégé. Caché au fin fond des Cévennes, cet éleveur de moutons n'est pas submergé de joie quand débarque la petite troupe. Plus attendue, cette partie est savoureuse pour la confrontation entre le vieil anar et les jeunes bobos, qui ont sans doute des valeurs en commun, mais avec deux générations d'écart. (Je laisse à chacun.e le plaisir de découvrir quels animaux de la ferme ont été nommés Lénine, Staline, Mao, Méluche et... Sarko !)
En revanche, je trouve le côté sentimental (la renaissance de l'amour entre les deux "aînés") complètement raté. Là, on sent que Chesnais se fait un peu chier. Il est un autre aspect de l'histoire qui m'a semblé très maladroit : la grossesse de Juliette (la féministe). Au début du film, on distingue à peine son petit bidon, alors qu'elle est censée être enceinte de huit mois. En quelques jours, on la voit prendre des seins et du ventre de manière impressionnante ! (Cela m'a rappelé un passage du récent Old, qui, lui, est étiqueté film fantastique...) La séquence de l'accouchement (dans une grange, en présence d'un âne...) accumule les clichés, sans le second degré d'OSS 117, hélas. Mais, comme les deux vieux cons tiennent bien la barre, l'ensemble n'est pas déplaisant, loin de là.
14:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 09 août 2021
Ice Road
Sic transit gloria mundi... Il fut un temps où la sortie d'un film avec Liam Neeson était un événement et occupait une impressionnante combinaison de salles. Le problème est que, depuis au moins dix ans, l'ancienne gloire irlandaise enchaîne les films d'action potables et les navets, le public ayant de plus en plus de mal à s'y retrouver. Ajoutez à cela les conséquences de la pandémie de covid (en particulier la sortie en rafales des films stockés depuis des mois dans les cartons des distributeurs) et vous comprendrez pourquoi, à part dans les métropoles, il est très difficile d'avoir accès à ce long-métrage.
Pourtant, le sujet est porteur. Le scénario s'appuie sur une réalité : le transport de marchandises, au Canada, sur des "routes de glace" (des pistes aménagées notamment sur des lacs gelés). Cela a même donné naissance, au début du XXIe siècle, à une émission de télé-réalité, "Le Convoi de l'extrême", qui a peut-être inspiré ce film.
C'est principalement une histoire de burnes. Le début nous fait découvrir le travail de mineurs couillus, dans le Grand Nord canadien. Certains de ces valeureux prolétaires vont se retrouver piégés au fond de la mine, après un "coup de grisou". Le matériel nécessaire à leur sauvetage se trouve à des centaines de kilomètres de là et, vu sa taille, il ne peut être livré que par camion. Le problème est qu'on est au début du printemps et qu'à cette époque de l'année, beaucoup de chauffeurs routiers sont en vacances. Surtout, les routes de glace sont de moins en moins sûres.
Pour ce convoi à risque, le patron couillu de la boîte de transport (Laurence Fishburne le bien nommé) a du mal à trouver du personnel compétent... et volontaire. Il sélectionne deux frères, Mike et Gurty, le premier parce qu'il en a une énorme paire (il est bien entendu interprété par Liam Neeson), le second (vétéran d'Irak atteint de stress post-traumatique) parce qu'il est un mécanicien de génie. Complètent l'équipe un cadre de la compagnie minière et... une délinquante, aux ovaires solidement arrimés. (Est-il nécessaire de préciser qu'Amber Midthunder est belle comme un camion ?) Comme, en plus, elle est issue d'une tribu indienne, on se dit que les quotas de minorités sont respectés.
À partir du moment où les trois camions sont lancés sur la piste glacée, c'est prenant. Les péripéties, mécaniques comme climatiques, sont mises en scène avec un indéniable savoir-faire... parce que péripéties il y a. Vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu, d'abord parce que la préparation d'un transport aussi risqué à la dernière minute ne peut être optimale... mais aussi parce que de curieux "incidents" vont se produire sur le parcours. Un complot est à l'œuvre, que nos vaillants conducteurs vont devoir déjouer.
Je ne vais pas survendre ce film : certaines péripéties sont un peu téléphonées et les corps à corps ne sont pas très bien chorégraphiés. (Ceci dit, les fans de Liam Neeson verront avec plaisir ce quasi-septuagénaire venir à bout d'un mercenaire surentraîné qui a trente ans de moins que lui...) Mais, dans une salle obscure, sur grand écran, la chaleur estivale revenant, c'est rafraîchissant.
12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Ice Road
Sic transit gloria mundi... Il fut un temps où la sortie d'un film avec Liam Neeson était un événement et occupait une impressionnante combinaison de salles. Le problème est que, depuis au moins dix ans, l'ancienne gloire irlandaise enchaîne les films d'action potables et les navets, le public ayant de plus en plus de mal à s'y retrouver. Ajoutez à cela les conséquences de la pandémie de covid (en particulier la sortie en rafales des films stockés depuis des mois dans les cartons des distributeurs) et vous comprendrez pourquoi, à part dans les métropoles, il est très difficile d'avoir accès à ce long-métrage.
Pourtant, le sujet est porteur. Le scénario s'appuie sur une réalité : le transport de marchandises, au Canada, sur des "routes de glace" (des pistes aménagées notamment sur des lacs gelés). Cela a même donné naissance, au début du XXIe siècle, à une émission de télé-réalité, "Le Convoi de l'extrême", qui a peut-être inspiré ce film.
C'est principalement une histoire de burnes. Le début nous fait découvrir le travail de mineurs couillus, dans le Grand Nord canadien. Certains de ces valeureux prolétaires vont se retrouver piégés au fond de la mine, après un "coup de grisou". Le matériel nécessaire à leur sauvetage se trouve à des centaines de kilomètres de là et, vu sa taille, il ne peut être livré que par camion. Le problème est qu'on est au début du printemps et qu'à cette époque de l'année, beaucoup de chauffeurs routiers sont en vacances. Surtout, les routes de glace sont de moins en moins sûres.
Pour ce convoi à risque, le patron couillu de la boîte de transport (Laurence Fishburne le bien nommé) a du mal à trouver du personnel compétent... et volontaire. Il sélectionne deux frères, Mike et Gurty, le premier parce qu'il en a une énorme paire (il est bien entendu interprété par Liam Neeson), le second (vétéran d'Irak atteint de stress post-traumatique) parce qu'il est un mécanicien de génie. Complètent l'équipe un cadre de la compagnie minière et... une délinquante, aux ovaires solidement arrimés. (Est-il nécessaire de préciser qu'Amber Midthunder est belle comme un camion ?) Comme, en plus, elle est issue d'une tribu indienne, on se dit que les quotas de minorités sont respectés.
À partir du moment où les trois camions sont lancés sur la piste glacée, c'est prenant. Les péripéties, mécaniques comme climatiques, sont mises en scène avec un indéniable savoir-faire... parce que péripéties il y a. Vous vous doutez bien que rien ne va se passer comme prévu, d'abord parce que la préparation d'un transport aussi risqué à la dernière minute ne peut être optimale... mais aussi parce que de curieux "incidents" vont se produire sur le parcours. Un complot est à l'œuvre, que nos vaillants conducteurs vont devoir déjouer.
Je ne vais pas survendre ce film : certaines péripéties sont un peu téléphonées et les corps à corps ne sont pas très bien chorégraphiés. (Ceci dit, les fans de Liam Neeson verront avec plaisir ce quasi-septuagénaire venir à bout d'un mercenaire surentraîné qui a trente ans de moins que lui...) Mais, dans une salle obscure, sur grand écran, la chaleur estivale revenant, c'est rafraîchissant.
12:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 08 août 2021
Profession du père
C'est l'histoire d'un homme, André Choulans, marié, père de famille provincial, frustré dans sa vie professionnelle, aigri par la politique française et qui a tendance à voir des complots partout. Eh non, il ne s'agit pas d'un de ces manifestants antivax... puisque l'intrigue débute en 1961, au moment du putsch des généraux en Algérie.
Le film repose beaucoup sur le talent de Benoît Poelvoorde, qu'on a déjà vu dans des rôles de perdant magnifique. Ici, le père de famille en apparence débonnaire va petit à petit dévoiler un côté psychopathe de plus en plus inquiétant.
Son fils, Émile (incarné jeune par le surprenant Jules Lefebvre) ne sait pas trop comment renseigner la ligne "profession du père", le jour de la rentrée des classes (au collège). Doit-il écrire "chanteur" ? (Son père prétend avoir fait partie des membres fondateurs des Compagnons de la chanson.) Doit-il écrire "agent secret" ? (Le meilleur ami de son père, Ted, serait membre de la CIA.) Doit-il écrire "joueur de football" ? "professeur de judo" ? "parachutiste" ?... Son père ne cesse de lui raconter des histoires, au propre comme au figuré. Comment démêler le vrai du faux, dans ce magma auquel la mère (Audrey Dana, très bien) a renoncé à apporter un minimum de cohérence ?
La première partie du film met en scène le "bourrage de crâne" familial, sous les yeux d'une épouse qui reconnaît de moins en moins l'homme charmant qu'elle a jadis épousé. Rappelons que nous sommes au début de la Ve République, à Lyon, dans un ménage de "Français moyens". À la maison, c'est l'homme qui commande, au besoin par la force... même (surtout ?) si c'est sur les épaules de madame que repose le foyer.
La deuxième partie de l'intrigue renforce l'intérêt du film : le gamin se met à son tour à inventer des histoires. On a bien compris qu'il ne croit pas à tout ce que lui raconte son père mais, comme lui, il développe une propension à la mythomanie pour rendre son quotidien plus supportable. Il s'imagine membre actif de "l'organisation" (l'O.A.S.). Je ne vais pas en dire plus, mais sachez que cela va très loin, surtout à partir du moment où débarque au collège un jeune pied-noir (Tom Levy, lui aussi très bien), dont Émile cherche à devenir l'ami.
Au-delà du contexte de la Guerre d'Algérie (le film adapte un roman de Sorj Chalandon, en partie autobiographique), c'est une réflexion sur l'influence qu'ont les parents sur leurs enfants et comment leurs délires peuvent en faire des individus névrosés, voire dangereux. Je trouve que c'est d'une étonnante actualité.
P.S.
Les spectateurs aveyronnais doivent être particulièrement attentifs à la première scène de repas familial, au début de l'histoire. On y voit André Choulans déplier un célèbre couteau de poche (avec tire-bouchon)...
11:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Profession du père
C'est l'histoire d'un homme, André Choulans, marié, père de famille provincial, frustré dans sa vie professionnelle, aigri par la politique française et qui a tendance à voir des complots partout. Eh non, il ne s'agit pas d'un de ces manifestants antivax... puisque l'intrigue débute en 1961, au moment du putsch des généraux en Algérie.
Le film repose beaucoup sur le talent de Benoît Poelvoorde, qu'on a déjà vu dans des rôles de perdant magnifique. Ici, le père de famille en apparence débonnaire va petit à petit dévoiler un côté psychopathe de plus en plus inquiétant.
Son fils, Émile (incarné jeune par le surprenant Jules Lefebvre) ne sait pas trop comment renseigner la ligne "profession du père", le jour de la rentrée des classes (au collège). Doit-il écrire "chanteur" ? (Son père prétend avoir fait partie des membres fondateurs des Compagnons de la chanson.) Doit-il écrire "agent secret" ? (Le meilleur ami de son père, Ted, serait membre de la CIA.) Doit-il écrire "joueur de football" ? "professeur de judo" ? "parachutiste" ?... Son père ne cesse de lui raconter des histoires, au propre comme au figuré. Comment démêler le vrai du faux, dans ce magma auquel la mère (Audrey Dana, très bien) a renoncé à apporter un minimum de cohérence ?
La première partie du film met en scène le "bourrage de crâne" familial, sous les yeux d'une épouse qui reconnaît de moins en moins l'homme charmant qu'elle a jadis épousé. Rappelons que nous sommes au début de la Ve République, à Lyon, dans un ménage de "Français moyens". À la maison, c'est l'homme qui commande, au besoin par la force... même (surtout ?) si c'est sur les épaules de madame que repose le foyer.
La deuxième partie de l'intrigue renforce l'intérêt du film : le gamin se met à son tour à inventer des histoires. On a bien compris qu'il ne croit pas à tout ce que lui raconte son père mais, comme lui, il développe une propension à la mythomanie pour rendre son quotidien plus supportable. Il s'imagine membre actif de "l'organisation" (l'O.A.S.). Je ne vais pas en dire plus, mais sachez que cela va très loin, surtout à partir du moment où débarque au collège un jeune pied-noir (Tom Levy, lui aussi très bien), dont Émile cherche à devenir l'ami.
Au-delà du contexte de la Guerre d'Algérie (le film adapte un roman de Sorj Chalandon, en partie autobiographique), c'est une réflexion sur l'influence qu'ont les parents sur leurs enfants et comment leurs délires peuvent en faire des individus névrosés, voire dangereux. Je trouve que c'est d'une étonnante actualité.
P.S.
Les spectateurs aveyronnais doivent être particulièrement attentifs à la première scène de repas familial, au début de l'histoire. On y voit André Choulans déplier un célèbre couteau de poche (avec tire-bouchon)...
11:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 06 août 2021
Nadia, Butterfly
Tourné en 2019 pour sortir en 2020, au moment des Jeux de Tokyo (durant lesquels est censée se dérouler l'action), ce film a subi le même sort que les compétitions olympiques : le report. Son arrivée dans les salles obscures françaises est opportune à plusieurs titres, d'autant qu'il aborde un sujet qui a récemment fait l'actualité (à propos de la joueuse de tennis Noami Osaka et de la gymnaste Simone Biles) : la difficulté d'être une sportive professionnelle et la charge mentale qui pèse sur les jeunes femmes. (Les Frenchies auront tendance à faire le lien avec le cas Laure Manaudou.)
Cette fiction à caractère documentaire revêt donc plusieurs intérêts. Notons que les quatre actrices principales sont nageuses de formation. Dans l'intrigue, elles constituent une équipe de relais canadien, où l'on trouve "l'ancienne" (qui approche la trentaine !) en fin de carrière, deux nageuses confirmées plus jeunes et le grand espoir national (encore mineure). Trois sont québécoises, la quatrième anglophone stricte.
L'héroïne est Nadia, spécialiste du papillon (d'où le titre). À 23 ans, elle est un pilier de l'équipe nationale et l'une des meilleures spécialistes mondiales de sa discipline. On la suit tout d'abord à l'entraînement, avec de superbes plans de piscine. Un regard extérieur aurait tendance à la voir comme une machine : la jeune femme aux larges épaules et aux cuisses musculeuses enchaîne les longueurs avec une apparente impassibilité. En réalité, cela bouillonne dans sa tête : elle a décidé d'arrêter la natation et de reprendre ses études après les Jeux. Cela suscite beaucoup d'incompréhension dans son entourage où, curieusement, on note l'absence totale des membres de sa famille (même en communication à distance).
La compétition, à Tokyo, est filmée de manière classique. Notons que le scénariste avait quasiment prévu l'exact podium du relais (dont la finale s'est déroulée le 1er août dernier) ! En alternance, on nous montre les à-côtés de la vie des sportifs du village, entre soirées, obligations médiatiques et découverte du Japon. La scène qui voit Nadia tenter de gagner une peluche (de la mascotte olympique) à un jeu de capture est symbolique de ce que vit la jeune femme, qui peine à obtenir ce qu'elle veut... pour finalement changer d'avis. Elle ne sait plus trop où elle en est.
Les Jeux sont aussi l'occasion de faire des rencontres... du moins quand sa part de compétition est achevée. Deux des membres du relais vont s'offrir une soirée déjantée, avec maquillage, godasses de "poulette", musique, alcool fort et mecs dispos. Cette séquence devrait rayonner de bonheur... mais le mal-être n'est pas loin.
Nadia, qui a consacré la majeure partie de son temps à la natation depuis l'âge de dix ans, a l'impression d'être passée à côté de sa jeunesse. La période des Jeux est celle des choix, non sans regrets, contre lesquels elle tente de se prémunir à l'aide de son smartphone. (Soyez attentifs à ce qu'elle fait avec.)
J'ai trouvé cette histoire très touchante, avec des interprètes authentiques et une caméra près des corps, mais sans impudeur.
Nadia, Butterfly
Tourné en 2019 pour sortir en 2020, au moment des Jeux de Tokyo (durant lesquels est censée se dérouler l'action), ce film a subi le même sort que les compétitions olympiques : le report. Son arrivée dans les salles obscures françaises est opportune à plusieurs titres, d'autant qu'il aborde un sujet qui a récemment fait l'actualité (à propos de la joueuse de tennis Noami Osaka et de la gymnaste Simone Biles) : la difficulté d'être une sportive professionnelle et la charge mentale qui pèse sur les jeunes femmes. (Les Frenchies auront tendance à faire le lien avec le cas Laure Manaudou.)
Cette fiction à caractère documentaire revêt donc plusieurs intérêts. Notons que les quatre actrices principales sont nageuses de formation. Dans l'intrigue, elles constituent une équipe de relais canadien, où l'on trouve "l'ancienne" (qui approche la trentaine !) en fin de carrière, deux nageuses confirmées plus jeunes et le grand espoir national (encore mineure). Trois sont québécoises, la quatrième anglophone stricte.
L'héroïne est Nadia, spécialiste du papillon (d'où le titre). À 23 ans, elle est un pilier de l'équipe nationale et l'une des meilleures spécialistes mondiales de sa discipline. On la suit tout d'abord à l'entraînement, avec de superbes plans de piscine. Un regard extérieur aurait tendance à la voir comme une machine : la jeune femme aux larges épaules et aux cuisses musculeuses enchaîne les longueurs avec une apparente impassibilité. En réalité, cela bouillonne dans sa tête : elle a décidé d'arrêter la natation et de reprendre ses études après les Jeux. Cela suscite beaucoup d'incompréhension dans son entourage où, curieusement, on note l'absence totale des membres de sa famille (même en communication à distance).
La compétition, à Tokyo, est filmée de manière classique. Notons que le scénariste avait quasiment prévu l'exact podium du relais (dont la finale s'est déroulée le 1er août dernier) ! En alternance, on nous montre les à-côtés de la vie des sportifs du village, entre soirées, obligations médiatiques et découverte du Japon. La scène qui voit Nadia tenter de gagner une peluche (de la mascotte olympique) à un jeu de capture est symbolique de ce que vit la jeune femme, qui peine à obtenir ce qu'elle veut... pour finalement changer d'avis. Elle ne sait plus trop où elle en est.
Les Jeux sont aussi l'occasion de faire des rencontres... du moins quand sa part de compétition est achevée. Deux des membres du relais vont s'offrir une soirée déjantée, avec maquillage, godasses de "poulette", musique, alcool fort et mecs dispos. Cette séquence devrait rayonner de bonheur... mais le mal-être n'est pas loin.
Nadia, qui a consacré la majeure partie de son temps à la natation depuis l'âge de dix ans, a l'impression d'être passée à côté de sa jeunesse. La période des Jeux est celle des choix, non sans regrets, contre lesquels elle tente de se prémunir à l'aide de son smartphone. (Soyez attentifs à ce qu'elle fait avec.)
J'ai trouvé cette histoire très touchante, avec des interprètes authentiques et une caméra près des corps, mais sans impudeur.
Le Soupir des vagues
Sous ce titre ressort en France un film du Japonais Koji Fukada. Depuis deux-trois ans, ses œuvres arrivent sur nos écrans, un peu dans le désordre. Leur qualité est d'ailleurs inégale. Si j'avais apprécié L'Infirmière, l'an dernier, j'ai globalement été déçu cette année par Hospitalité (son premier long métrage, moins maîtrisé que les suivants), qui nous a été un peu survendu par la critique.
Il y a deux ans, au mois de juin, le cinéma CGR de Rodez avait programmé plusieurs films japonais (parfois en avant-première), sur deux semaines. C'est à cette occasion que j'avais pu voir L'Homme qui venait de la mer... qui ressort donc sous un nouveau titre. Je ne vais pas réécrire le billet. Pour lire ma recension, il suffit de cliquer sur le lien précédent. Ce film mérite vraiment le détour.
00:35 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Le Soupir des vagues
Sous ce titre ressort en France un film du Japonais Koji Fukada. Depuis deux-trois ans, ses œuvres arrivent sur nos écrans, un peu dans le désordre. Leur qualité est d'ailleurs inégale. Si j'avais apprécié L'Infirmière, l'an dernier, j'ai globalement été déçu cette année par Hospitalité (son premier long métrage, moins maîtrisé que les suivants), qui nous a été un peu survendu par la critique.
Il y a deux ans, au mois de juin, le cinéma CGR de Rodez avait programmé plusieurs films japonais (parfois en avant-première), sur deux semaines. C'est à cette occasion que j'avais pu voir L'Homme qui venait de la mer... qui ressort donc sous un nouveau titre. Je ne vais pas réécrire le billet. Pour lire ma recension, il suffit de cliquer sur le lien précédent. Ce film mérite vraiment le détour.
00:35 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 05 août 2021
Benedetta
J'ai rechigné à aller voir ce film, tant le battage fait autour de certains aspects (supposés) provocateurs m'a paru artificiel. Et puis, récemment, j'ai profité d'un déplacement pour m'offrir la séance, dans un cinéma qui le programme depuis sa sortie à Cannes. À ma grande surprise, la salle fut aux trois quarts pleine, avec comme public un océan de tempes argentées (plutôt féminines), dans lequel s'étaient noyés un étudiant et quelques actifs en goguette.
Commençons par l'aspect technique : c'est bien filmé, avec de bons décors. Le contexte de l'Italie du Nord du début du XVIIe siècle (à peine sortie du Moyen-Âge...) est assez bien planté, quoique de manière sommaire.
Les scènes les plus intéressantes sont (pour moi) celles qui se déroulent à l'intérieur du couvent. Plus que le confinement, c'est la promiscuité qui a été mise en scène, avec ces pseudo-cellules monastiques qui ne sont séparées que par un rideau pas tout à fait opaque. Le mystère et le désir qui accompagnent cette fausse étanchéité sont quasiment palpables.
À cela s'ajoute la prestation des acteurs. J'ai été davantage convaincu par les deux principales interprètes féminines (Virginie Éfira et Daphne Patakia) que par les deux "anciens" (Lambert Wilson, juste correct dans le rôle du nonce, Charlotte Rampling très à la peine). Heureusement, une pléiade de seconds rôles bien campés (notamment par Olivier Rabourdin et Louise Chevillotte) donne de la consistance à la distribution.
Reste le propos global. Bien que Verhoeven s'en défende, il a construit une œuvre anticléricale, provocatrice (un peu tape-à-l'oeil) et dans l'air du temps pro-LGBT. Cela ne me dérange guère, à ceci près qu'il a déformé l'histoire (réelle) de cette religieuse homosexuelle (bisexuelle sans doute) pour la faire cadrer avec ses idées.
Contrairement à ce que j'ai parfois lu et entendu, le livre dont s'est inspiré Paul Verhoeven n'est pas un roman. C'est une étude universitaire rigoureuse, parue il y a plus de trente ans et que les éditions Gallimard ont fort opportunément décidé de republier (pas en collection de poche, toutefois... il n'y a pas de petit profit). De plus, le film n'est pas la simple adaptation du livre. Il y a eu réécriture de l'histoire, au profit d'un scénario en partie fictif... et ce n'est a priori pas forcément un mal.
L'ouvrage de l'universitaire états-unienne mérite le détour pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il présente beaucoup mieux le contexte, évoquant notamment la place de la "déviance" sexuelle dans la société de l'époque... ainsi qu'au sein de l'Église. Le livre est beaucoup plus intéressant que le film par l'analyse détaillée qu'il fait des enquêtes ecclésiastiques. La hiérarchie toscane s'est demandée si Benedetta n'avait pas rêvé, puis si ses visions relevaient de l'extase ou du ravissement... et surtout si ce n'était pas Satan qui était derrière.
À la lecture de l'étude, on comprend mieux quels étaient les enjeux de pouvoir, entre les autorités locales et régionales, entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres. Durant 90 % de l'ouvrage, l'historienne se garde de prendre position, se contentant de rendre compréhensibles par un public du XXe siècle (époque de la première publication) les mentalités de l'époque. Ce n'est qu'à la toute fin qu'elle semble trancher au niveau de la réalité des visions et de la relation nouée entre Benedetta et sa "protégée". Le livre n'est pas toujours facile à lire, mais il est passionnant. Il contient en outre de précieuses annexes traduites.
19:26 Publié dans Cinéma, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Benedetta
J'ai rechigné à aller voir ce film, tant le battage fait autour de certains aspects (supposés) provocateurs m'a paru artificiel. Et puis, récemment, j'ai profité d'un déplacement pour m'offrir la séance, dans un cinéma qui le programme depuis sa sortie à Cannes. À ma grande surprise, la salle fut aux trois quarts pleine, avec comme public un océan de tempes argentées (plutôt féminines), dans lequel s'étaient noyés un étudiant et quelques actifs en goguette.
Commençons par l'aspect technique : c'est bien filmé, avec de bons décors. Le contexte de l'Italie du Nord du début du XVIIe siècle (à peine sortie du Moyen-Âge...) est assez bien planté, quoique de manière sommaire.
Les scènes les plus intéressantes sont (pour moi) celles qui se déroulent à l'intérieur du couvent. Plus que le confinement, c'est la promiscuité qui a été mise en scène, avec ces pseudo-cellules monastiques qui ne sont séparées que par un rideau pas tout à fait opaque. Le mystère et le désir qui accompagnent cette fausse étanchéité sont quasiment palpables.
À cela s'ajoute la prestation des acteurs. J'ai été davantage convaincu par les deux principales interprètes féminines (Virginie Éfira et Daphne Patakia) que par les deux "anciens" (Lambert Wilson, juste correct dans le rôle du nonce, Charlotte Rampling très à la peine). Heureusement, une pléiade de seconds rôles bien campés (notamment par Olivier Rabourdin et Louise Chevillotte) donne de la consistance à la distribution.
Reste le propos global. Bien que Verhoeven s'en défende, il a construit une œuvre anticléricale, provocatrice (un peu tape-à-l'oeil) et dans l'air du temps pro-LGBT. Cela ne me dérange guère, à ceci près qu'il a déformé l'histoire (réelle) de cette religieuse homosexuelle (bisexuelle sans doute) pour la faire cadrer avec ses idées.
Contrairement à ce que j'ai parfois lu et entendu, le livre dont s'est inspiré Paul Verhoeven n'est pas un roman. C'est une étude universitaire rigoureuse, parue il y a plus de trente ans et que les éditions Gallimard ont fort opportunément décidé de republier (pas en collection de poche, toutefois... il n'y a pas de petit profit). De plus, le film n'est pas la simple adaptation du livre. Il y a eu réécriture de l'histoire, au profit d'un scénario en partie fictif... et ce n'est a priori pas forcément un mal.
L'ouvrage de l'universitaire états-unienne mérite le détour pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il présente beaucoup mieux le contexte, évoquant notamment la place de la "déviance" sexuelle dans la société de l'époque... ainsi qu'au sein de l'Église. Le livre est beaucoup plus intéressant que le film par l'analyse détaillée qu'il fait des enquêtes ecclésiastiques. La hiérarchie toscane s'est demandée si Benedetta n'avait pas rêvé, puis si ses visions relevaient de l'extase ou du ravissement... et surtout si ce n'était pas Satan qui était derrière.
À la lecture de l'étude, on comprend mieux quels étaient les enjeux de pouvoir, entre les autorités locales et régionales, entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres. Durant 90 % de l'ouvrage, l'historienne se garde de prendre position, se contentant de rendre compréhensibles par un public du XXe siècle (époque de la première publication) les mentalités de l'époque. Ce n'est qu'à la toute fin qu'elle semble trancher au niveau de la réalité des visions et de la relation nouée entre Benedetta et sa "protégée". Le livre n'est pas toujours facile à lire, mais il est passionnant. Il contient en outre de précieuses annexes traduites.
19:26 Publié dans Cinéma, Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 03 août 2021
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
Cela fait plus de douze ans que les cinéphiles attendent la suite des aventures d'Hubert Bonisseur de la Bath, que l'on avait laissé du côté de Rio, en galante compagnie. Je connais des fans qui redoutaient le changement de réalisateur. Mais, comme le scénario et les dialogues sont restés de la main de Jean-François Halin, le passage de témoin s'est fait sans heurt.
Nicolas Bedos a gardé les éléments identitaires des précédents films : le pastiche/hommage à des films de genre et la mise en scène d'une franchouillardise qu'on est censé prendre au second (troisième ? quatrième ?) degré. Le générique de début est d'ailleurs un montage de plans faisant référence à plusieurs James Bond. C'est assez joliment réalisé... et Jean Dujardin est toujours aussi bon.
Le vieillissement de son personnage fait partie des réussites du film. On le sent moins svelte qu'auparavant... et moins "vigoureux" au lit. (Je recommande vivement toutes les scènes de chambre à coucher !) On le voit porter des lunettes de lecture et se mettre à l'informatique. Surtout, l'arrivée à ses côtés de l'agent "1001" (Pierre Niney, très bien) contribue à le ringardiser. L'association de ces deux tempéraments, issus de deux générations différentes, est une autre réussite du film.
Les dialogues sont souvent savoureux. Halin a pris plaisir à placer dans la bouche du héros des répliques qui, soit sont d'une consternante beaufitude, soit sont à double-sens. Même quand il essaie de passer pour un type bien, le héros finit par sortir des énormités. Mais c'est un bon agent de terrain. Sa mission en Afrique noire subsaharienne est riche en péripéties, parfois spectaculaires, comme l'intrusion des deux espions français dans la cache des trafiquants d'armes.
Culturellement, l'histoire baigne dans la fin des années 1970 et le début des années 1980 (avec notamment le célèbre générique de la Gaumont, en introduction). Cela aura comme un petit goût de madeleine de Proust pour les spectateurs entre deux âges. Toutefois, en fil rouge sous-jacent, ce sont plutôt des questionnements contemporains que l'on trouve. Le duo Bedos-Halin s'amuse du "politiquement correct" à la française et de ses dérives... tout en dénonçant (gentiment) la "Françafrique".
Pour un film de divertissement grand public, ce n'est déjà pas si mal.
P.S.
La toute fin laisse présager une suite, sous la forme d'une dernière référence cinématographique, cette fois-ci à La Revanche des Sith !
23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
OSS 117 : alerte rouge en Afrique noire
Cela fait plus de douze ans que les cinéphiles attendent la suite des aventures d'Hubert Bonisseur de la Bath, que l'on avait laissé du côté de Rio, en galante compagnie. Je connais des fans qui redoutaient le changement de réalisateur. Mais, comme le scénario et les dialogues sont restés de la main de Jean-François Halin, le passage de témoin s'est fait sans heurt.
Nicolas Bedos a gardé les éléments identitaires des précédents films : le pastiche/hommage à des films de genre et la mise en scène d'une franchouillardise qu'on est censé prendre au second (troisième ? quatrième ?) degré. Le générique de début est d'ailleurs un montage de plans faisant référence à plusieurs James Bond. C'est assez joliment réalisé... et Jean Dujardin est toujours aussi bon.
Le vieillissement de son personnage fait partie des réussites du film. On le sent moins svelte qu'auparavant... et moins "vigoureux" au lit. (Je recommande vivement toutes les scènes de chambre à coucher !) On le voit porter des lunettes de lecture et se mettre à l'informatique. Surtout, l'arrivée à ses côtés de l'agent "1001" (Pierre Niney, très bien) contribue à le ringardiser. L'association de ces deux tempéraments, issus de deux générations différentes, est une autre réussite du film.
Les dialogues sont souvent savoureux. Halin a pris plaisir à placer dans la bouche du héros des répliques qui, soit sont d'une consternante beaufitude, soit sont à double-sens. Même quand il essaie de passer pour un type bien, le héros finit par sortir des énormités. Mais c'est un bon agent de terrain. Sa mission en Afrique noire subsaharienne est riche en péripéties, parfois spectaculaires, comme l'intrusion des deux espions français dans la cache des trafiquants d'armes.
Culturellement, l'histoire baigne dans la fin des années 1970 et le début des années 1980 (avec notamment le célèbre générique de la Gaumont, en introduction). Cela aura comme un petit goût de madeleine de Proust pour les spectateurs entre deux âges. Toutefois, en fil rouge sous-jacent, ce sont plutôt des questionnements contemporains que l'on trouve. Le duo Bedos-Halin s'amuse du "politiquement correct" à la française et de ses dérives... tout en dénonçant (gentiment) la "Françafrique".
Pour un film de divertissement grand public, ce n'est déjà pas si mal.
P.S.
La toute fin laisse présager une suite, sous la forme d'une dernière référence cinématographique, cette fois-ci à La Revanche des Sith !
23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 02 août 2021
Jungle Cruise
Et c'est parti pour un nouveau blockbuster de l'été !... avec encore une production Disney, au moins ma troisième de la saison, après le surprenant Cruella et et le bastonnant Black Widow.
C'est un film d'aventures, bourré d'effets spéciaux, inspiré paraît-il d'une attraction d'un des parcs d'attractions de la Mickey Company. Les spectateurs pas trop mous du bulbe remarqueront aussi des ressemblances avec Pirates des Caraïbes (les conquistadors espagnols remplaçant les écumeurs des mers) et avec Indiana Jones (le vilain prince allemand semblant être un précurseur des nazis opposés à l'homme au fouet). Les plus âgés se souviendront d'autres œuvres de fiction (cinématographiques ou télévisuelles) ayant pour cadre une forêt tropicale.
Attention toutefois : il n'est pas question ici de présenter les peuples indigènes comme de redoutables sauvages... même si le film s'amuse à jouer avec les clichés (le cannibalisme et la réduction des têtes). On a aussi modernisé la caractérisation des personnages, avec la présence (parmi les protagonistes) d'un homosexuel et une romance interraciale. Ceci dit, ces éléments ont été insérés avec une relative finesse.
Ainsi, l'histoire d'amour entre le baroudeur très musclé et l'entreprenante exploratrice britannique met du temps à émerger... et c'est tant mieux. Dans ces deux rôles, Dwayne Johnson et Emily Blunt (délicieux accent britannique en V.O.) font merveille.
En 1916, une petite expédition s'enfonce dans la forêt amazonienne, à la recherche d'un arbre miraculeux. Les Britanniques sont poursuivis par de méchants Allemands (leur chef étant une caricature vivante). Ils doivent aussi échapper à de dangereux fantômes, qui hantent la forêt... mais seulement à proximité du fleuve. Celui-ci recèle bien d'autres menaces, dont doivent se méfier de riches touristes de passage, limite inconscients.
Aux manettes se trouve Jaume Collet-Serra, qui a déjà prouvé qu'il sait mettre en scène un film d'action (récemment dans The Passenger). On ne s'ennuie pas une seconde, avec quelques séquences particulièrement spectaculaires, comme la première poursuite avec le sous-marin et le périple dans une grotte mystérieuse. L'humour (familial) est très présent, notamment à travers les chamailleries entre les deux héros. À ce sujet, à titre exceptionnel, j'aurais tendance à recommander plutôt la VF, si l'on n'a pas une bonne maîtrise de l'anglais : Frank Wolff / Dwayne Johnson ne cesse de balancer des calembours plus ou moins réussis, au grand désespoir de son entourage. D'après ce que j'ai vu des traductions, ils m'ont l'air plus savoureux en français qu'en anglais !
J'ai passé un très bon moment.
23:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Jungle Cruise
Et c'est parti pour un nouveau blockbuster de l'été !... avec encore une production Disney, au moins ma troisième de la saison, après le surprenant Cruella et et le bastonnant Black Widow.
C'est un film d'aventures, bourré d'effets spéciaux, inspiré paraît-il d'une attraction d'un des parcs d'attractions de la Mickey Company. Les spectateurs pas trop mous du bulbe remarqueront aussi des ressemblances avec Pirates des Caraïbes (les conquistadors espagnols remplaçant les écumeurs des mers) et avec Indiana Jones (le vilain prince allemand semblant être un précurseur des nazis opposés à l'homme au fouet). Les plus âgés se souviendront d'autres œuvres de fiction (cinématographiques ou télévisuelles) ayant pour cadre une forêt tropicale.
Attention toutefois : il n'est pas question ici de présenter les peuples indigènes comme de redoutables sauvages... même si le film s'amuse à jouer avec les clichés (le cannibalisme et la réduction des têtes). On a aussi modernisé la caractérisation des personnages, avec la présence (parmi les protagonistes) d'un homosexuel et une romance interraciale. Ceci dit, ces éléments ont été insérés avec une relative finesse.
Ainsi, l'histoire d'amour entre le baroudeur très musclé et l'entreprenante exploratrice britannique met du temps à émerger... et c'est tant mieux. Dans ces deux rôles, Dwayne Johnson et Emily Blunt (délicieux accent britannique en V.O.) font merveille.
En 1916, une petite expédition s'enfonce dans la forêt amazonienne, à la recherche d'un arbre miraculeux. Les Britanniques sont poursuivis par de méchants Allemands (leur chef étant une caricature vivante). Ils doivent aussi échapper à de dangereux fantômes, qui hantent la forêt... mais seulement à proximité du fleuve. Celui-ci recèle bien d'autres menaces, dont doivent se méfier de riches touristes de passage, limite inconscients.
Aux manettes se trouve Jaume Collet-Serra, qui a déjà prouvé qu'il sait mettre en scène un film d'action (récemment dans The Passenger). On ne s'ennuie pas une seconde, avec quelques séquences particulièrement spectaculaires, comme la première poursuite avec le sous-marin et le périple dans une grotte mystérieuse. L'humour (familial) est très présent, notamment à travers les chamailleries entre les deux héros. À ce sujet, à titre exceptionnel, j'aurais tendance à recommander plutôt la VF, si l'on n'a pas une bonne maîtrise de l'anglais : Frank Wolff / Dwayne Johnson ne cesse de balancer des calembours plus ou moins réussis, au grand désespoir de son entourage. D'après ce que j'ai vu des traductions, ils m'ont l'air plus savoureux en français qu'en anglais !
J'ai passé un très bon moment.
23:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Les Sorcières de l'Orient
Entre 1960 et 1982, le Japon fut une nation majeure du volley-ball féminin, avec deux titres olympiques, trois de championnes du monde et cinq places de finaliste, toutes compétition confondues.
Ce documentaire, tourné par le Français Julien Faraut, rend hommage à la première génération de volleyeuses championnes, celle des années 1960, surnommée par les Soviétiques "les sorcières de l'Orient". Le film entremêle les séquences tournées au XXIe siècle, des extraits de manga (apparemment de la série Les Attaquantes, même si j'ai parfois eu l'impression de revoir Jeanne et Serge) et des images d'époque (actualités, reportage sur les joueuses et extraits de matchs).
Pour qui a déjà pratiqué le volley-ball, il est évident que les adaptations animées manquent de réalisme (contrairement aux versions papier, paraît-il). Toutefois, le choix des extraits est pertinent, parce que ceux-ci font écho à ce qu'on peut voir dans les images d'archives ou celles tournées très récemment. Le montage a été judicieux.
Le documentaire est particulièrement évocateur lorsqu'il s'appuie sur les films tournés dans les années 1960, auxquels sont juxtaposés les témoignages de celles qui sont désormais souvent grands-mères (quand elles sont encore en vie). La plus jeune devait avoir, au moment du tournage, autour de 75 ans ! Deux d'entre elles font encore beaucoup d'efforts pour rester en forme, l'une continuant à promouvoir son sport de prédilection auprès des jeunes générations.
À ce sujet, le contraste entre les années 1960 et notre époque est flagrant au niveau de l'entraînement (même si les groupes filmés n'évoluent pas au même niveau). À celles et ceux qui l'ignoreraient, le documentaire montre quels sacrifices il faut être prêt(e) à faire pour jouer au très haut niveau. On a d'ailleurs eu tendance à estimer que le charismatique entraîneur des Japonaises avait quasiment fait œuvre de maltraitance auprès des joueuses. C'était oublier un peu vite les conditions dans lesquelles ces jeunes femmes vivaient, à l'époque. La majorité avait perdu son père très jeune (surtout à cause de la Seconde Guerre mondiale). Presque toutes ont découvert le volley-ball au lycée et ont continué une fois devenues actives. C'étaient des ouvrières du textile. Je pense qu'on peut considérer que, vu la place des femmes au Japon à cette époque et vu leur situation professionnelle, s'engager dans la compétition sportive de haut niveau a été perçu comme une forme d'ascension sociale et d'épanouissement personnel. (On pourrait comparer cela à l'épopée des Verts au football, en France, dans les années 1960-1970.) L'emploi du temps des joueuses n'en était pas moins effrayant ! Quoi qu'il en soit, l'équipe est devenue très populaire, parce qu'elle a contribué au regain de fierté nationale d'un pays qui cherchait à retrouver le lustre passé (celui d'avant 1945).
Sur le plan cinématographique, ce n'est pas particulièrement emballant. La réalisation est très classique. Mais quel sujet !
Les Sorcières de l'Orient
Entre 1960 et 1982, le Japon fut une nation majeure du volley-ball féminin, avec deux titres olympiques, trois de championnes du monde et cinq places de finaliste, toutes compétition confondues.
Ce documentaire, tourné par le Français Julien Faraut, rend hommage à la première génération de volleyeuses championnes, celle des années 1960, surnommée par les Soviétiques "les sorcières de l'Orient". Le film entremêle les séquences tournées au XXIe siècle, des extraits de manga (apparemment de la série Les Attaquantes, même si j'ai parfois eu l'impression de revoir Jeanne et Serge) et des images d'époque (actualités, reportage sur les joueuses et extraits de matchs).
Pour qui a déjà pratiqué le volley-ball, il est évident que les adaptations animées manquent de réalisme (contrairement aux versions papier, paraît-il). Toutefois, le choix des extraits est pertinent, parce que ceux-ci font écho à ce qu'on peut voir dans les images d'archives ou celles tournées très récemment. Le montage a été judicieux.
Le documentaire est particulièrement évocateur lorsqu'il s'appuie sur les films tournés dans les années 1960, auxquels sont juxtaposés les témoignages de celles qui sont désormais souvent grands-mères (quand elles sont encore en vie). La plus jeune devait avoir, au moment du tournage, autour de 75 ans ! Deux d'entre elles font encore beaucoup d'efforts pour rester en forme, l'une continuant à promouvoir son sport de prédilection auprès des jeunes générations.
À ce sujet, le contraste entre les années 1960 et notre époque est flagrant au niveau de l'entraînement (même si les groupes filmés n'évoluent pas au même niveau). À celles et ceux qui l'ignoreraient, le documentaire montre quels sacrifices il faut être prêt(e) à faire pour jouer au très haut niveau. On a d'ailleurs eu tendance à estimer que le charismatique entraîneur des Japonaises avait quasiment fait œuvre de maltraitance auprès des joueuses. C'était oublier un peu vite les conditions dans lesquelles ces jeunes femmes vivaient, à l'époque. La majorité avait perdu son père très jeune (surtout à cause de la Seconde Guerre mondiale). Presque toutes ont découvert le volley-ball au lycée et ont continué une fois devenues actives. C'étaient des ouvrières du textile. Je pense qu'on peut considérer que, vu la place des femmes au Japon à cette époque et vu leur situation professionnelle, s'engager dans la compétition sportive de haut niveau a été perçu comme une forme d'ascension sociale et d'épanouissement personnel. (On pourrait comparer cela à l'épopée des Verts au football, en France, dans les années 1960-1970.) L'emploi du temps des joueuses n'en était pas moins effrayant ! Quoi qu'il en soit, l'équipe est devenue très populaire, parce qu'elle a contribué au regain de fierté nationale d'un pays qui cherchait à retrouver le lustre passé (celui d'avant 1945).
Sur le plan cinématographique, ce n'est pas particulièrement emballant. La réalisation est très classique. Mais quel sujet !
samedi, 31 juillet 2021
C'est la vie
- M'sieur l'producteur ! M'sieur l'producteur !
- Oui Julien ?
- J'voudrais faire une comédie sociétale, avec plein d'acteurs connus à la tél...
- ... J't'arrête tout de suite, bonhomme, on en a déjà plein des comme ça !
- ... Oui, mais celle-là, elle sera pas chère !
- Je t'écoute.
- Imaginez cinq femmes sur le point d'accoucher. Elles ont des âges différents et sont issues de milieux hétérog... euh très variés !
- Oui ? Et ?...
- Ben, on aurait une pédégère quadragénaire, maîtresse femme soutenue par un mari dévoué et qui arrive à jongler entre toutes ses obligations !
- Pas mal, ça. C'est bien de briser le plafond de verre au cinéma ! Continue, mon garçon !
- Il y aurait aussi un couple recomposé, la femme attendant son deuxième enfant, sous le regard d'une mère très envahissante...
- C'est pas un peu trop cliché, ça ?
- Oui, mais, j'ai ajouté un truc : le jour où sa compagne accouche, le mari apprend le décès de son propre père ! C'est pas génial ?
- Mouais... Faut voir comment c'est joué. Quoi d'autre ?
- L'une des femmes arrive seule à la maternité. L'enfant a été conçu avec un type trouvé sur une appli de rencontre. C'est trop moderne !
- Mouais... On espère que les spectateurs oublieront que, lors de ce genre de rencontre, les adultes responsables sont censés avoir des capotes sous la main...
- Pensez donc ! Le public est prêt à croire n'importe quoi ! Y en a même qui défilent contre la vaccination !
- T'as raison, bonhomme. Certains de nos compatriotes sont de grosses truffes.
- Ah, pis j'ai mis de la diversité aussi : un couple lesbien, dont l'un des membres est "d'ascendance africaine" !
- Bien joué ! C'est toujours mieux avoir les assoc' de son côté. Et puis tu connais le petit monde du cinéma...
- Pour l'émotion, j'ai prévu une naissance prématurée, les parents étant séparés par une grande distance. Ce sera le fil rouge de l'histoire : le père parviendra-t-il à assister à la naissance de son premier enfant ? Suspens...
- Aaaah, ça j'aime ! N'oublie pas de souligner ces "moments d'émotion" à coups de musique d'ascenseur. Ça coûte que dalle et ça tire toujours des larmes dans les chaumières !... Finalement, tu m'as l'air d'avoir bien préparé ton affaire. Que te manque-t-il ?
- Six millions !
- Tu les as !
21:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
C'est la vie
- M'sieur l'producteur ! M'sieur l'producteur !
- Oui Julien ?
- J'voudrais faire une comédie sociétale, avec plein d'acteurs connus à la tél...
- ... J't'arrête tout de suite, bonhomme, on en a déjà plein des comme ça !
- ... Oui, mais celle-là, elle sera pas chère !
- Je t'écoute.
- Imaginez cinq femmes sur le point d'accoucher. Elles ont des âges différents et sont issues de milieux hétérog... euh très variés !
- Oui ? Et ?...
- Ben, on aurait une pédégère quadragénaire, maîtresse femme soutenue par un mari dévoué et qui arrive à jongler entre toutes ses obligations !
- Pas mal, ça. C'est bien de briser le plafond de verre au cinéma ! Continue, mon garçon !
- Il y aurait aussi un couple recomposé, la femme attendant son deuxième enfant, sous le regard d'une mère très envahissante...
- C'est pas un peu trop cliché, ça ?
- Oui, mais, j'ai ajouté un truc : le jour où sa compagne accouche, le mari apprend le décès de son propre père ! C'est pas génial ?
- Mouais... Faut voir comment c'est joué. Quoi d'autre ?
- L'une des femmes arrive seule à la maternité. L'enfant a été conçu avec un type trouvé sur une appli de rencontre. C'est trop moderne !
- Mouais... On espère que les spectateurs oublieront que, lors de ce genre de rencontre, les adultes responsables sont censés avoir des capotes sous la main...
- Pensez donc ! Le public est prêt à croire n'importe quoi ! Y en a même qui défilent contre la vaccination !
- T'as raison, bonhomme. Certains de nos compatriotes sont de grosses truffes.
- Ah, pis j'ai mis de la diversité aussi : un couple lesbien, dont l'un des membres est "d'ascendance africaine" !
- Bien joué ! C'est toujours mieux avoir les assoc' de son côté. Et puis tu connais le petit monde du cinéma...
- Pour l'émotion, j'ai prévu une naissance prématurée, les parents étant séparés par une grande distance. Ce sera le fil rouge de l'histoire : le père parviendra-t-il à assister à la naissance de son premier enfant ? Suspens...
- Aaaah, ça j'aime ! N'oublie pas de souligner ces "moments d'émotion" à coups de musique d'ascenseur. Ça coûte que dalle et ça tire toujours des larmes dans les chaumières !... Finalement, tu m'as l'air d'avoir bien préparé ton affaire. Que te manque-t-il ?
- Six millions !
- Tu les as !
21:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 30 juillet 2021
The Suicide Squad
En ajoutant l'article défini, la Warner retente le coup avec son équipe d'anti-super-héros, cinq ans plus tard. De la distribution principale d'origine ne restent que Viola Davis (en directrice d'agence sans scrupule), Joel Kinnaman (en boy-scout bodybuildé), Jai Courtney (un délinquant adepte du boomerang) et, surtout, Margot Robbie, de nouveau dans la peau d'Harley Quinn, un an après Birds of Prey.
L'histoire débute dans une prison, dans une cour de promenade, où l'on découvre l'un des personnages "à haut potentiel". J'aime beaucoup la manière dont cette scène est réalisée : ce n'est pas parce que la prod' a dépensé des dizaines de millions en effets spéciaux qu'il ne faut pas travailler la mise en scène ! Et puis... cela se conclut de manière "politiquement incorrecte". À un moment, on comprend que le personnage a une idée en tête. Les scénaristes ont-ils osé ? se demande-t-on. Oui !
C'est à l'image du film, à la photographie chiadée et au ton mal élevé. Ainsi, une délicate petite brune évoque la possibilité d'introduire des rats dans l'anus d'un scientifique, tandis qu'Harley Quinn n'hésite pas à révéler la cause de son retard : un passage par les toilettes, pour la grosse commission... Amis de la délicatesse, bonjour ! Comme les messieurs ne sont pas en reste (l'un d'entre eux se baladant le soir en slip kangourou), c'est assez fendard.
Tout en recyclant les codes du film de super-héros, celui-ci se positionne comme un anti-Marvel (ce qui ne manque pas de sel, quand on sait que le réalisateur, James Gunn, est celui des Gardiens de la galaxie). Ainsi, c'est un Noir et non un Blanc qui va diriger l'équipe, dans laquelle on distingue une sorte de Captain America (le mal nommé Peace maker)... mais en nettement moins sympathique. Il est incarné par John Cena, dont les gros muscles sont aussi à l'affiche de Fast & Furious 9.
De son côté, au vu de la sorte d'armure qu'il porte, l'ancien tueur à gages Bloodsport (Idris Elba, chargé de remplacer Will Smith, qui n'a pas rempilé) pourrait être un succédané d'Iron Man. Complètent le groupe un homme-requin aussi balèze qu'Hulk (mais anthropophage) et un type indéfinissable, qui balance... des pastilles !
Attention toutefois : le début est trompeur. Les spectateurs sont (presque) mis dans la position des habitants d'une île. Dans un premier temps, on nous immerge dans un arc narratif... que l'on finit par voir sous un autre angle, un peu à l'image de ce qui est présenté dans Deadpool 2 (le plus DC des Marvel).
Le scénario est narquois à un point tel que je ne peux pas raconter en détail. Sachez néanmoins que, lorsque l'équipe finale est constituée, elle engage son premier véritable combat contre un adversaire sur lequel elle se trompe grandement. C'est savoureux, après coup !
L'humour est souvent présent, en particulier quand Harley Quinn est à l'écran. J'ai adoré la parodie de romance entre la garce blonde et le nouveau dictateur... ainsi que sa conclusion. Il vaut mieux ne pas contrarier l'ex-patineuse, qui a des valeurs ! Quant à son évasion, c'est est une véritable symphonie sanguinaire...
Les amateurs de crânes éclatés, de membres arrachés et de giclées de sauce tomate sont servis par les péripéties de l'intrigue. La petite armée d'un dictateur centre-américain fournit une pelletée de victimes convenables. (Au passage, le scénario, s'il ridiculise les combattants latinos, dénonce la politique étrangère états-unienne.) Cependant, au sein d'une tour fortifiée, se trouve un ennemi autrement plus dangereux : une créature extra-terrestre, jusque-là prisonnière, mais qui, bien entendu, va parvenir à se libérer.
Le combat final est mi-héroïque mi-parodique, les membres du commando affrontant une créature aussi gigantesque que ridicule... mais bigrement redoutable. (Je pense que la séquence du combat, en zone urbaine, est un décalque ironique d'un des Avengers, alors que les avatars de la créature sont une référence à Alien.) Cette dernière partie est assez prévisible (en particulier concernant le rôle joué par Harley Quinn), mais on passe toujours un bon moment.
P.S.
La musique, plutôt rock'n'roll, est sympa !
P.S. II
Deux scènes supplémentaires encadrent le générique de fin. Chacune voit le retour à la vie d'un des personnages présumés décédés...
00:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
The Suicide Squad
En ajoutant l'article défini, la Warner retente le coup avec son équipe d'anti-super-héros, cinq ans plus tard. De la distribution principale d'origine ne restent que Viola Davis (en directrice d'agence sans scrupule), Joel Kinnaman (en boy-scout bodybuildé), Jai Courtney (un délinquant adepte du boomerang) et, surtout, Margot Robbie, de nouveau dans la peau d'Harley Quinn, un an après Birds of Prey.
L'histoire débute dans une prison, dans une cour de promenade, où l'on découvre l'un des personnages "à haut potentiel". J'aime beaucoup la manière dont cette scène est réalisée : ce n'est pas parce que la prod' a dépensé des dizaines de millions en effets spéciaux qu'il ne faut pas travailler la mise en scène ! Et puis... cela se conclut de manière "politiquement incorrecte". À un moment, on comprend que le personnage a une idée en tête. Les scénaristes ont-ils osé ? se demande-t-on. Oui !
C'est à l'image du film, à la photographie chiadée et au ton mal élevé. Ainsi, une délicate petite brune évoque la possibilité d'introduire des rats dans l'anus d'un scientifique, tandis qu'Harley Quinn n'hésite pas à révéler la cause de son retard : un passage par les toilettes, pour la grosse commission... Amis de la délicatesse, bonjour ! Comme les messieurs ne sont pas en reste (l'un d'entre eux se baladant le soir en slip kangourou), c'est assez fendard.
Tout en recyclant les codes du film de super-héros, celui-ci se positionne comme un anti-Marvel (ce qui ne manque pas de sel, quand on sait que le réalisateur, James Gunn, est celui des Gardiens de la galaxie). Ainsi, c'est un Noir et non un Blanc qui va diriger l'équipe, dans laquelle on distingue une sorte de Captain America (le mal nommé Peace maker)... mais en nettement moins sympathique. Il est incarné par John Cena, dont les gros muscles sont aussi à l'affiche de Fast & Furious 9.
De son côté, au vu de la sorte d'armure qu'il porte, l'ancien tueur à gages Bloodsport (Idris Elba, chargé de remplacer Will Smith, qui n'a pas rempilé) pourrait être un succédané d'Iron Man. Complètent le groupe un homme-requin aussi balèze qu'Hulk (mais anthropophage) et un type indéfinissable, qui balance... des pastilles !
Attention toutefois : le début est trompeur. Les spectateurs sont (presque) mis dans la position des habitants d'une île. Dans un premier temps, on nous immerge dans un arc narratif... que l'on finit par voir sous un autre angle, un peu à l'image de ce qui est présenté dans Deadpool 2 (le plus DC des Marvel).
Le scénario est narquois à un point tel que je ne peux pas raconter en détail. Sachez néanmoins que, lorsque l'équipe finale est constituée, elle engage son premier véritable combat contre un adversaire sur lequel elle se trompe grandement. C'est savoureux, après coup !
L'humour est souvent présent, en particulier quand Harley Quinn est à l'écran. J'ai adoré la parodie de romance entre la garce blonde et le nouveau dictateur... ainsi que sa conclusion. Il vaut mieux ne pas contrarier l'ex-patineuse, qui a des valeurs ! Quant à son évasion, c'est est une véritable symphonie sanguinaire...
Les amateurs de crânes éclatés, de membres arrachés et de giclées de sauce tomate sont servis par les péripéties de l'intrigue. La petite armée d'un dictateur centre-américain fournit une pelletée de victimes convenables. (Au passage, le scénario, s'il ridiculise les combattants latinos, dénonce la politique étrangère états-unienne.) Cependant, au sein d'une tour fortifiée, se trouve un ennemi autrement plus dangereux : une créature extra-terrestre, jusque-là prisonnière, mais qui, bien entendu, va parvenir à se libérer.
Le combat final est mi-héroïque mi-parodique, les membres du commando affrontant une créature aussi gigantesque que ridicule... mais bigrement redoutable. (Je pense que la séquence du combat, en zone urbaine, est un décalque ironique d'un des Avengers, alors que les avatars de la créature sont une référence à Alien.) Cette dernière partie est assez prévisible (en particulier concernant le rôle joué par Harley Quinn), mais on passe toujours un bon moment.
P.S.
La musique, plutôt rock'n'roll, est sympa !
P.S. II
Deux scènes supplémentaires encadrent le générique de fin. Chacune voit le retour à la vie d'un des personnages présumés décédés...
00:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 29 juillet 2021
Spirale : l'héritage de Saw
Le plus important est dans le sous-titre : ce film-ci se place dans la continuité de la (lucrative) série Saw qui, jadis, avait (un peu) renouvelé le genre horrifique. J'ai tenté le coup pour voir où les scénaristes en étaient. (Je m'étais arrêté à Saw IV.)
Un nouveau tueur en série s'en prend cette fois-ci spécifiquement à des policiers. Le choix cornélien auquel il confronte ceux-ci est toujours aussi tordu que dans les précédents films. Je dois reconnaître que les dispositifs de torture sont bien conçus et efficacement mis en scène (par Darren Lynn Bousman, qui avait déjà tourné trois des précédents volets)... mais c'est à peu près tout.
Le scénario est hyper-classique. Le montage n'est pas très réussi : l'insertion des retours en arrière arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Comme les scénaristes n'ont pas su/voulu correctement raccrocher l'intrigue de Spirale à celle des précédents films, ils ont été obligés de recourir à ces acrobaties.
De surcroît, quand on est un minimum dégourdi et qu'on a déjà vu des films / épisodes de série dans le même genre, on comprend assez rapidement qui est derrière ce qui ressemble à une vengeance. Du coup, les policiers apparaissent vraiment pas très futés, tombant facilement dans les pièges tendus par l'assassin.
J'ajoute que, pour attirer un public particulier, les auteurs ont mâtiné leur histoire d'un côté Black Lives Matter. Il est question de corruption et de violence policières... dont les responsables sont aussi bien blancs que noirs, soit dit en passant (le "bon" flic étant afroaméricain).
Je ne sais pas trop ce que Samuel L. Jackson est venu faire là-dedans. (N'a-t-il pas été assez payé pour Hitman & Bodyguard 2 ?) Bref, ce sera vite oublié.
15:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Spirale : l'héritage de Saw
Le plus important est dans le sous-titre : ce film-ci se place dans la continuité de la (lucrative) série Saw qui, jadis, avait (un peu) renouvelé le genre horrifique. J'ai tenté le coup pour voir où les scénaristes en étaient. (Je m'étais arrêté à Saw IV.)
Un nouveau tueur en série s'en prend cette fois-ci spécifiquement à des policiers. Le choix cornélien auquel il confronte ceux-ci est toujours aussi tordu que dans les précédents films. Je dois reconnaître que les dispositifs de torture sont bien conçus et efficacement mis en scène (par Darren Lynn Bousman, qui avait déjà tourné trois des précédents volets)... mais c'est à peu près tout.
Le scénario est hyper-classique. Le montage n'est pas très réussi : l'insertion des retours en arrière arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Comme les scénaristes n'ont pas su/voulu correctement raccrocher l'intrigue de Spirale à celle des précédents films, ils ont été obligés de recourir à ces acrobaties.
De surcroît, quand on est un minimum dégourdi et qu'on a déjà vu des films / épisodes de série dans le même genre, on comprend assez rapidement qui est derrière ce qui ressemble à une vengeance. Du coup, les policiers apparaissent vraiment pas très futés, tombant facilement dans les pièges tendus par l'assassin.
J'ajoute que, pour attirer un public particulier, les auteurs ont mâtiné leur histoire d'un côté Black Lives Matter. Il est question de corruption et de violence policières... dont les responsables sont aussi bien blancs que noirs, soit dit en passant (le "bon" flic étant afroaméricain).
Je ne sais pas trop ce que Samuel L. Jackson est venu faire là-dedans. (N'a-t-il pas été assez payé pour Hitman & Bodyguard 2 ?) Bref, ce sera vite oublié.
15:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
La Loi de Téhéran
Voici venu le désormais traditionnel polar étranger de l'été, une catégorie qui, ces dernières années, a vu la sortie en France de La Isla minima, Que Dios nos perdone, Lands of Murders ou encore Le Caire confidentiel. C'est avec celui-ci que la parenté est la plus forte, puisque l'action se déroule au Moyen-Orient (en Iran au lieu de l'Égypte) et que l'enquête policière est prétexte à dresser un portrait socio-politique du pays.
Intitulé "Six et demi" dans la version originale, le film se concentre sur la lutte contre le trafic de crack, une drogue qui fait des ravages en Iran, avec 6,5 millions de consommateurs ! Dès le départ, on est plongé dans le travail de la police, avec l'interpellation d'un revendeur, incluant une course-poursuite dans les rues tortueuses de la capitale. Lui succèdent des séquences mises en scène avec le même brio. J'ai été particulièrement impressionné par le coup de filet organisé dans un bidonville, entre carcasses de voiture et grands cylindres de béton (avec immeubles en construction à l'arrière-plan). À cette séquence succèdent d'autres moments parfaitement maîtrisés : la garde à vue de masse, au commissariat, puis les scènes de cellule, avec le rôle stratégique du "coin toilettes". Très vite s'impose à nos oreilles la "jactance" de Samad, le chef de groupe, un policier intègre, tenace, qui n'hésite pas à bousculer les prévenus. Il est interprété par Payman Maadi, que les spectateurs français ont vu dans Une Séparation.
Face à lui se trouve le chef du réseau de trafiquants. Dans la première partie de l'histoire, une aura de mystère enveloppe ce personnage (à droite ci-dessus), avant que son côté "caïd" ne prenne le dessus. Dans la dernière partie, le réalisateur essaie de développer un propos plus sociologique, montrant ce personnage sous un jour nouveau.
Saeed Roustayi est un inconnu pour moi, mais ce réalisateur semble bourré de qualités. Il a réussi aussi bien les scènes d'intervention de la police que celles d'interrogatoire, s'appuyant sur des seconds rôles très bien campés. Outre les policiers et les délinquants, je signale deux personnages féminins, celui de l'épouse d'un petit trafiquant (au cours d'une scène de perquisition qui se termine de manière surprenante) et celui de l'ancienne petite amie du caïd, interprétée par la ravissante Parinaz Izadyar. Mais je pourrais aussi parler du fils d'un consommateur de drogue ou du juge qui interroge, avec équanimité, criminels présumés, témoins et policiers.
Sur le fond, le scénario a dû jouer avec la censure iranienne. Ici ou là, il suggère que, pour que le trafic ait pu prendre une telle ampleur, il faut que les délinquants aient bénéficié de protections, parfois haut placées. Du côté des consommateurs, discrètement, il pointe la misère sociale présente en Iran. Mais les spectateurs attentifs remarqueront aussi que les trafiquants et consommateurs de crack sont très souvent occidentalisés, tandis que les valeureux policiers portent une barbe "islamiquement correcte" (pour les messieurs) ou un strict tchador (pour les dames). Je conseille aussi d'être attentif aux chaussures des personnes arrêtées.
La dernière demi-heure réserve quelques surprises. Ce n'est pas la partie la plus réussie du film, selon moi, mais le reste est tellement prenant que je ne peux que recommander ce long-métrage.
12:49 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
La Loi de Téhéran
Voici venu le désormais traditionnel polar étranger de l'été, une catégorie qui, ces dernières années, a vu la sortie en France de La Isla minima, Que Dios nos perdone, Lands of Murders ou encore Le Caire confidentiel. C'est avec celui-ci que la parenté est la plus forte, puisque l'action se déroule au Moyen-Orient (en Iran au lieu de l'Égypte) et que l'enquête policière est prétexte à dresser un portrait socio-politique du pays.
Intitulé "Six et demi" dans la version originale, le film se concentre sur la lutte contre le trafic de crack, une drogue qui fait des ravages en Iran, avec 6,5 millions de consommateurs ! Dès le départ, on est plongé dans le travail de la police, avec l'interpellation d'un revendeur, incluant une course-poursuite dans les rues tortueuses de la capitale. Lui succèdent des séquences mises en scène avec le même brio. J'ai été particulièrement impressionné par le coup de filet organisé dans un bidonville, entre carcasses de voiture et grands cylindres de béton (avec immeubles en construction à l'arrière-plan). À cette séquence succèdent d'autres moments parfaitement maîtrisés : la garde à vue de masse, au commissariat, puis les scènes de cellule, avec le rôle stratégique du "coin toilettes". Très vite s'impose à nos oreilles la "jactance" de Samad, le chef de groupe, un policier intègre, tenace, qui n'hésite pas à bousculer les prévenus. Il est interprété par Payman Maadi, que les spectateurs français ont vu dans Une Séparation.
Face à lui se trouve le chef du réseau de trafiquants. Dans la première partie de l'histoire, une aura de mystère enveloppe ce personnage (à droite ci-dessus), avant que son côté "caïd" ne prenne le dessus. Dans la dernière partie, le réalisateur essaie de développer un propos plus sociologique, montrant ce personnage sous un jour nouveau.
Saeed Roustayi est un inconnu pour moi, mais ce réalisateur semble bourré de qualités. Il a réussi aussi bien les scènes d'intervention de la police que celles d'interrogatoire, s'appuyant sur des seconds rôles très bien campés. Outre les policiers et les délinquants, je signale deux personnages féminins, celui de l'épouse d'un petit trafiquant (au cours d'une scène de perquisition qui se termine de manière surprenante) et celui de l'ancienne petite amie du caïd, interprétée par la ravissante Parinaz Izadyar. Mais je pourrais aussi parler du fils d'un consommateur de drogue ou du juge qui interroge, avec équanimité, criminels présumés, témoins et policiers.
Sur le fond, le scénario a dû jouer avec la censure iranienne. Ici ou là, il suggère que, pour que le trafic ait pu prendre une telle ampleur, il faut que les délinquants aient bénéficié de protections, parfois haut placées. Du côté des consommateurs, discrètement, il pointe la misère sociale présente en Iran. Mais les spectateurs attentifs remarqueront aussi que les trafiquants et consommateurs de crack sont très souvent occidentalisés, tandis que les valeureux policiers portent une barbe "islamiquement correcte" (pour les messieurs) ou un strict tchador (pour les dames). Je conseille aussi d'être attentif aux chaussures des personnes arrêtées.
La dernière demi-heure réserve quelques surprises. Ce n'est pas la partie la plus réussie du film, selon moi, mais le reste est tellement prenant que je ne peux que recommander ce long-métrage.
12:49 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 26 juillet 2021
Onoda - 10 000 nuits dans la jungle
Présenté au dernier Festival de Cannes, dans la sélection "Un certain regard", ce film franco-japonais raconte l'histoire extraordinaire d'Hiroo Onoda, un soldat nippon envoyé en 1944 sur une petite île des Philippines, Lubang (à peine plus grande que la commune de Paris).
Sa mission est d'y organiser une guérilla susceptible de contrecarrer la progression des troupes américaines, qui se rapprochent dangereusement du Japon. L'une des séquences du début montre d'ailleurs le débarquement nocturne de "l'ennemi" et les ravages que l'armée d'Oncle Sam fait dans le camp japonais, pas très bien préparé à l'affronter.
Ce n'est pas l'un des moindres intérêts de cette fiction à caractère documentaire. Même si l'on y croise des soldats et officiers imprégnés de la mentalité de samouraï, prêts à tous les sacrifices au nom du Japon, on s'aperçoit que beaucoup d'autres ne sont pas de cette trempe, soit qu'ils soient lassés de la guerre, soit qu'ils jugent ces efforts inutiles, soit qu'ils aient tout simplement la trouille.
On retrouve (en partie) ces nuances au sein du quatuor de survivants, réfugié dans la jungle philippine, d'où le dernier, Hiroo Onoda, n'est sorti qu'en... 1974. (Il est décédé en 2014.) Celui-ci semble tout d'un bloc : patriote, obéissant, tenace... et même buté. Ses deux adjoints, Shimada et Kozuka, ont un peu plus d'expérience, de vécu. Le premier, ancien charbonnier, sait comment vivre dans les bois. Complète la bande le plus jeune, Akatsu, sans doute récemment incorporé... et pas vraiment adapté à la vie militaire.
Curieusement, ce film en apparence authentiquement japonais a été réalisé par... un Français, Arthur Harari, remarqué il y a quelques années grâce à un excellent polar, Diamant noir. Il est parvenu à faire de la jungle tropicale un véritable personnage du film. La chance des quatre hommes est qu'elle fournit de quoi se sustenter, s'habiller... et même se loger. Ici, le film se fait documentaire, montrant comment les hommes parviennent à se nourrir, à construire une cabane ou à tresser des semelles de chaussures.
Cependant, si l'environnement est source de vie, il représente aussi parfois une gêne considérable. On y croise de nombreuses petites bêtes invasives et, surtout, le climat n'est pas propice à une vie saine : les soldats subissent l'alternance de deux longues saisons : la sèche (très chaude) et l'humide, pénible pour les organismes, mais protectrice pour les fugitifs.
Pendant la saison des pluies, les paysans de l'île ne s'aventurent pas dans la forêt. Les patrouilles des forces de l'ordre se font rares. Dans un premier temps, les quatre soldats tentent d'échapper aux troupes américaines. Quelques années plus tard (les Philippines étant devenues indépendantes en 1947, ce que les protagonistes ignorent), ce sont d'autres uniformes qui patrouillent dans l'île. Des Japonais finissent même par y revenir... mais des civils, ce qui perturbe fortement les soldats, persuadés que la guerre continue.
C'est l'autre grand intérêt de cette histoire : montrer comment ces hommes (trois sur les quatre, en fait) se sont convaincus que le Japon ne pouvait pas s'être rendu aux États-Unis et donc que leur mission continuait. Onoda est incontestablement le plus buté, refusant de voir l'évidence, même quand des journaux japonais sont laissés à leur intention ou quand, après avoir récupéré un poste de radio, ils parviennent à capter des émissions de leur pays. (Le rejet des -supposés- "médias officiels" et l'adhésion aux "vérités alternatives" ne datent pas d'aujourd'hui !) Cet aveuglement culmine dans une scène sidérante, au cours de laquelle Onoda, en s'appuyant sur un planisphère rudimentaire, tente d'expliquer à Kozuka la "nouvelle" géopolitique mondiale, totalement farfelue. Ici, le film fait écho à notre époque, où l'aveuglement idéologique (ou tout simplement la bêtise) fait croire tellement d'âneries à des gilets jaunes, antivax, complotistes divers.
À la description minutieuse d'une auto-aliénation collective, le film ajoute la naissance d'un compagnonnage forcé, à quatre, puis trois, puis deux... Les tensions alternent avec les moments de camaraderie, voire de fraternité. Les deux derniers, Onoda et Kozuka, grisonnants et complices, finissent quasiment par former un vieux couple. C'est l'occasion d'évoquer la sexualité, très peu présente dans cette histoire de quatre hommes jeunes (âgés de 20-25 ans au début) confinés dans la jungle. Dans la première partie, un plan suggère la pratique du plaisir solitaire. Dans le dernier tiers de l'histoire, on se demande si, à certaines occasions, ces hommes n'ont pas abusé de Philippines. Globalement, les relations ne sont pas bonnes entre les soldats et la population locale, qui n'a pas gardé de bons souvenirs de la domination impériale japonaise. De plus, la propension des fugitifs à pratiquer des "réquisitions" (un euphémisme pour "vols") chez les paysans du coin, tout comme leurs activités de sabotage, leur ont valu beaucoup d'inimitié.
Pourtant, quand Onoda finit par regagner le monde réel, il a droit à une cérémonie d'honneur. Les temps ont changé et, au bout de trente ans, la ressentiment a laissé la place à de la curiosité et de la pitié. Le plus marquant est la rencontre entre Onoda et... un touriste japonais. Se font alors face le Japon traditionnel (militariste, nationaliste, plutôt renfermé) et le moderne (pacifique, technophile et ouvert sur le monde).
Concernant le film, je vais m'arrêter là, mais vous avez sans doute compris que j'ai été envoûté par cette histoire d'une grande richesse sur le plan historique mais aussi sur celui de la nature humaine. En complément, je suggère la lecture d'Au nom du Japon, l'autobiographie d'Onoda :
Publiée dès 1974 au Japon, elle n'est sortie en France que l'an dernier. Je ne sais pas si c'est lié à la rédaction d'origine ou à la qualité de la traduction (effectuée par Sébastien Raizer, un écrivain français vivant à Kyoto), mais cela se lit comme un roman. Le livre fourmille de détails qu'il n'était pas possible d'intégrer au film. On y découvre la "vie d'avant" d'Onoda et la relation particulière qu'il entretient avec son frère aîné. La vie quotidienne des soldats (dans la jungle) y est aussi décrite plus longuement, certains événements représentés une seule fois à l'écran figurant à plusieurs reprises. On peut même s'amuser au "jeu des 7 différences" (entre le livre et le film).
14:18 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Onoda - 10 000 nuits dans la jungle
Présenté au dernier Festival de Cannes, dans la sélection "Un certain regard", ce film franco-japonais raconte l'histoire extraordinaire d'Hiroo Onoda, un soldat nippon envoyé en 1944 sur une petite île des Philippines, Lubang (à peine plus grande que la commune de Paris).
Sa mission est d'y organiser une guérilla susceptible de contrecarrer la progression des troupes américaines, qui se rapprochent dangereusement du Japon. L'une des séquences du début montre d'ailleurs le débarquement nocturne de "l'ennemi" et les ravages que l'armée d'Oncle Sam fait dans le camp japonais, pas très bien préparé à l'affronter.
Ce n'est pas l'un des moindres intérêts de cette fiction à caractère documentaire. Même si l'on y croise des soldats et officiers imprégnés de la mentalité de samouraï, prêts à tous les sacrifices au nom du Japon, on s'aperçoit que beaucoup d'autres ne sont pas de cette trempe, soit qu'ils soient lassés de la guerre, soit qu'ils jugent ces efforts inutiles, soit qu'ils aient tout simplement la trouille.
On retrouve (en partie) ces nuances au sein du quatuor de survivants, réfugié dans la jungle philippine, d'où le dernier, Hiroo Onoda, n'est sorti qu'en... 1974. (Il est décédé en 2014.) Celui-ci semble tout d'un bloc : patriote, obéissant, tenace... et même buté. Ses deux adjoints, Shimada et Kozuka, ont un peu plus d'expérience, de vécu. Le premier, ancien charbonnier, sait comment vivre dans les bois. Complète la bande le plus jeune, Akatsu, sans doute récemment incorporé... et pas vraiment adapté à la vie militaire.
Curieusement, ce film en apparence authentiquement japonais a été réalisé par... un Français, Arthur Harari, remarqué il y a quelques années grâce à un excellent polar, Diamant noir. Il est parvenu à faire de la jungle tropicale un véritable personnage du film. La chance des quatre hommes est qu'elle fournit de quoi se sustenter, s'habiller... et même se loger. Ici, le film se fait documentaire, montrant comment les hommes parviennent à se nourrir, à construire une cabane ou à tresser des semelles de chaussures.
Cependant, si l'environnement est source de vie, il représente aussi parfois une gêne considérable. On y croise de nombreuses petites bêtes invasives et, surtout, le climat n'est pas propice à une vie saine : les soldats subissent l'alternance de deux longues saisons : la sèche (très chaude) et l'humide, pénible pour les organismes, mais protectrice pour les fugitifs.
Pendant la saison des pluies, les paysans de l'île ne s'aventurent pas dans la forêt. Les patrouilles des forces de l'ordre se font rares. Dans un premier temps, les quatre soldats tentent d'échapper aux troupes américaines. Quelques années plus tard (les Philippines étant devenues indépendantes en 1947, ce que les protagonistes ignorent), ce sont d'autres uniformes qui patrouillent dans l'île. Des Japonais finissent même par y revenir... mais des civils, ce qui perturbe fortement les soldats, persuadés que la guerre continue.
C'est l'autre grand intérêt de cette histoire : montrer comment ces hommes (trois sur les quatre, en fait) se sont convaincus que le Japon ne pouvait pas s'être rendu aux États-Unis et donc que leur mission continuait. Onoda est incontestablement le plus buté, refusant de voir l'évidence, même quand des journaux japonais sont laissés à leur intention ou quand, après avoir récupéré un poste de radio, ils parviennent à capter des émissions de leur pays. (Le rejet des -supposés- "médias officiels" et l'adhésion aux "vérités alternatives" ne datent pas d'aujourd'hui !) Cet aveuglement culmine dans une scène sidérante, au cours de laquelle Onoda, en s'appuyant sur un planisphère rudimentaire, tente d'expliquer à Kozuka la "nouvelle" géopolitique mondiale, totalement farfelue. Ici, le film fait écho à notre époque, où l'aveuglement idéologique (ou tout simplement la bêtise) fait croire tellement d'âneries à des gilets jaunes, antivax, complotistes divers.
À la description minutieuse d'une auto-aliénation collective, le film ajoute la naissance d'un compagnonnage forcé, à quatre, puis trois, puis deux... Les tensions alternent avec les moments de camaraderie, voire de fraternité. Les deux derniers, Onoda et Kozuka, grisonnants et complices, finissent quasiment par former un vieux couple. C'est l'occasion d'évoquer la sexualité, très peu présente dans cette histoire de quatre hommes jeunes (âgés de 20-25 ans au début) confinés dans la jungle. Dans la première partie, un plan suggère la pratique du plaisir solitaire. Dans le dernier tiers de l'histoire, on se demande si, à certaines occasions, ces hommes n'ont pas abusé de Philippines. Globalement, les relations ne sont pas bonnes entre les soldats et la population locale, qui n'a pas gardé de bons souvenirs de la domination impériale japonaise. De plus, la propension des fugitifs à pratiquer des "réquisitions" (un euphémisme pour "vols") chez les paysans du coin, tout comme leurs activités de sabotage, leur ont valu beaucoup d'inimitié.
Pourtant, quand Onoda finit par regagner le monde réel, il a droit à une cérémonie d'honneur. Les temps ont changé et, au bout de trente ans, la ressentiment a laissé la place à de la curiosité et de la pitié. Le plus marquant est la rencontre entre Onoda et... un touriste japonais. Se font alors face le Japon traditionnel (militariste, nationaliste, plutôt renfermé) et le moderne (pacifique, technophile et ouvert sur le monde).
Concernant le film, je vais m'arrêter là, mais vous avez sans doute compris que j'ai été envoûté par cette histoire d'une grande richesse sur le plan historique mais aussi sur celui de la nature humaine. En complément, je suggère la lecture d'Au nom du Japon, l'autobiographie d'Onoda :
Publiée dès 1974 au Japon, elle n'est sortie en France que l'an dernier. Je ne sais pas si c'est lié à la rédaction d'origine ou à la qualité de la traduction (effectuée par Sébastien Raizer, un écrivain français vivant à Kyoto), mais cela se lit comme un roman. Le livre fourmille de détails qu'il n'était pas possible d'intégrer au film. On y découvre la "vie d'avant" d'Onoda et la relation particulière qu'il entretient avec son frère aîné. La vie quotidienne des soldats (dans la jungle) y est aussi décrite plus longuement, certains événements représentés une seule fois à l'écran figurant à plusieurs reprises. On peut même s'amuser au "jeu des 7 différences" (entre le livre et le film).
14:18 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire