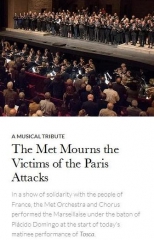mercredi, 30 octobre 2024
Monsieur Aznavour
Et c'est parti pour un biopic à la française, consacré à celui qu'on a parfois considéré comme "le Sinatra français". L'hommage est rendu par deux personnes qu'on pourrait penser plus proches des "musiques urbaines" que de la variété traditionnelle : Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Ce serait méconnaître les points communs entre le crooner français et certains rappeurs contemporains : une ascendance immigrée, une jeunesse modeste voire pauvre, des débuts artistiques critiqués, une forte envie de reconnaissance et un certain goût pour les achats dispendieux, voire clinquants. Concernant Grand Corps Malade, il faudrait ajouter l'amour de la langue française et un talent indéniable pour la manier.
Pour incarner celui qui fut une star internationale, Tahar Rahim a cherché le plus possible à se faire oublier derrière le personnage. On peut admirer les efforts... tout en constatant que cela se voit trop. Quasiment à chaque scène, on a l'impression que l'acteur nous dit : « Admirez ma performance. » Du coup, cet aspect-là m'a laissé plutôt froid, d'autant plus que, durant la première heure, Tahar Rahim se fait voler la vedette par... elle
Marie-Julie Baup (vue ces dernières années dans Délicieux et L'Esprit de famille) étincelle en Édith Piaf... et la production s'en est peut-être rendu compte, puisque ce personnage est totalement passé sous silence à partir du moment où Aznavour tente de prendre seul son envol.
C'est pourtant cette première heure qui m'a le plus intéressé. Grâce à des retours en arrière, on revit l'enfance pauvre (mais pleine de chaleur humaine) de la famille (arménienne) Aznavourian. On suit plus tard le jeune Charles pendant l'Occupation, pendant qu'un autre génocide est à l’œuvre. Ce n'est pas toujours très bien joué, la mise en scène est parfois plan-plan mais, grosso modo, jusqu'à l'épisode québécois (inclus), il se passe quelque chose.
Après, le film s'enlise. Pourtant, il est servi par les chansons les plus connues de l'artiste, mais le déroulé de sa vie, pourtant riche en péripéties, manque de saveur. Rahim cabotine toujours autant et, autour de lui, l'ambiance a comme un air de déjà-vu.
Du coup, on sent bien les 2h15. Pour moi, l'émotion a du mal à passer, sauf quand les succès d'Aznavour sont intégrés à l'intrigue.
P.S.
J'ai au moins appris un truc pendant la vision de ce film : la reprise (en sample) du titre Parce que tu crois par un certain... Dr Dre. D'autres artistes a priori éloignés de l'univers d'Aznavour se sont inspirés de ses chansons, comme on a pu l'entendre récemment sur France Inter.
21:53 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson
dimanche, 26 juin 2022
Elvis (dans la peau)
CRITIQUE FAVORABLE
La tâche confiée à Baz Luhrmann était ardue : ressusciter la carrière et la vie privée de l'une des icônes de l'Amérique, mettre le tout en scène de manière à la fois crédible et attractive. Il y avait matière à grand film.... encore fallait-il trouver l'interprète. Quasi inconnu du grand public, Austin Butler réalise une performance extraordinaire, de l'ordre de celle de Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Sans être un sosie d'Elvis Presley, il incarne le chanteur et son appétit de vivre... certains diraient même sa "fureur de vivre", puisque l'acteur James Dean semble avoir été une référence pour Elvis, dont le rêve était de briller sur grand écran.
En attendant la concrétisation de ses espoirs cinématographiques, le jeune homme commence à se faire connaître dans de petits concerts, comme première partie d'une vedette de la country. C'est l'une des influences que le musicien conservera tout au long de sa vie... mais ce n'est sans doute pas la plus importante. La première partie du film montre quel poids a eu la musique afro-américaine dans la genèse de l'artiste. Il a côtoyé (entre autres) BB King, Big Mama Thornton et Little Richard. On découvre un Elvis opposé à la ségrégation, parce qu'elle va contre ses fréquentations et son mode de vie.
Cette première partie est vraiment excellente. Colorée, variée au niveau de la mise en scène, elle est à la fois riche (sur le fond) et entraînante (sur la forme). Les culs-pincés de la blanche Amérique y sont tournés en dérision. Rien ne semble pouvoir arrêter "Elvis le Pelvis", dont le déhanché fait pâmer les dames et donne des ailes aux messieurs.
Un autre grand mérite de ce film est de mettre en valeur le rôle du deus ex machina de la carrière de l'artiste, le trouble colonel Parker, vrai manager, mais pas plus Parker que colonel. Tom Hanks est lui aussi formidable dans ce rôle, incarnant avec talent un personnage mêlant cupidité, roublardise et bonhomie.
Une fois la vedette lancée vers les sommets, le film se fait plus classique et plus prévisible... jusqu'à la chute, qui suscite l'émotion.
Baz Luhrmann signe une grande réussite, à voir absolument en salle !
CRITIQUE DÉFAVORABLE
Depuis le succès (mérité) de Bohemian Rhapsody et (dans une moindre mesure) de Rocketman (dont Baz Luhrmann avait refusé de prendre en charge la réalisation), Hollywood sent que les films de super-héros et ceux d'animation ne sont plus les seules machines à cash du Septième Art. Le tout est de trouver la vedette qui a vendu beaucoup de disques et un(e) interprète capable d'endosser le rôle.
C'est chose faite avec Austin Butler, un comédien vu plutôt auparavant dans des séries (même s'il a été aperçu dans Once upon a time... in Hollywood). Le jeune homme réussit à rendre vie à l'Elvis débutant, des concerts de country bas-de-gamme aux premiers gros succès enregistrés chez RCA. Il est beaucoup moins convaincant en "vieil" Elvis (quadragénaire, ceci dit). On a beau lui faire porter les mêmes fringues et les mêmes lunettes que l'ex-idole des jeunes, l'évolution de l'habillage peine à masquer le fait que l'acteur reste svelte tout au long de l'histoire, alors qu'Elvis était devenu empâté et bouffi à la fin. C'est sans doute pourquoi les ultimes images du King sont extraites de vidéos d'archives (le concert durant lequel il peine à tenir debout ou assis), et non pas une dernière incarnation par Butler.
En revanche, on perçoit bien le vieillissement progressif de l'autre personnage principal, le colonel Parker, un redoutable filou qui, s'il a contribué à lancer la carrière d'Elvis, a bien vécu sur la bête... Dans le rôle, Tom Hanks est formidable, même si, au bout d'un moment, le fait de voir jouer cet excellent acteur avec d'imposantes prothèses devient agaçant.
Le film est tout à la gloire d'Elvis. Le scénario gomme (sans les effacer, heureusement) les aspérités du parcours. Ainsi, on ne nous présente que brièvement les infidélités du chanteur-vedette à l'amour de sa vie, la ravissante Priscilla. Tel que c'est montré dans le film, on a l'impression que le King "faute" soit parce qu'il est sous l'emprise de drogues, parce qu'il se sent seul en tournée, soit parce que c'est le seul moyen de se redonner l'envie de vivre... Comme tout mari/compagnon infidèle, il est assez pathétique quand il dit que, malgré tout, Priscilla est la seule qu'il aime...
Le film est aussi assez discret sur le déclin artistique d'Elvis. La carrière cinématographique du King (dans les années 1960) coïncide avec une baisse des ventes musicales (et des recettes des concerts). Elvis Presley commençait à être considéré comme ringard, les nouvelles vedettes s'appelant Beatles et Rolling Stones.
Sur le plan formel, le film mêle les styles. Baz Luhrmann (auteur entre autres d'Australia) va parfois jusqu'à saturer l'écran pour suggérer l'explosion de vie et de désir que représente l'émergence du rock façon Elvis. Si le résultat est parfois entraînant, il faut quand même dire que le réalisateur en fait des tonnes.
Quoi qu'il en soit, c'est un film, certes inégal, mais à voir en salle, sur un très grand écran, avec du bon son.
samedi, 26 juin 2021
Billie
J'ai enfin pu voir ce documentaire consacré à la chanteuse afro-américaine, film qui complète de manière intéressante le biopic Billie Holiday, une affaire d'État sorti il y a peu.
L'avantage du documentaire est de nous donner à voir et à entendre la vraie Billie (ainsi que les autres protagonistes de sa vie), avec sa voix à nulle autre pareille. La comparaison des deux films confirme l'appréciation de la performance d'Andra Day : elle a magnifié Bille Holiday... et atténué, par sa beauté, la déchéance physique de sa fin de vie.
Le documentaire en dit un peu plus sur son enfance et sa jeunesse. Il propose une version légèrement différente des ennuis de la chanteuse avec les autorités fédérales, concernant l'infiltration d'un Afro-américain dans son entourage et la cause de son arrestation : l'un de ses producteurs aurait voulu ainsi la protéger, en la forçant à suivre une cure de désintoxication. Plus loin dans le film, par contre, on perçoit l'envie de se débarrasser d'une gêneuse, dont la seule existence est une offense à la ségrégation.
Une autre particularité du documentaire est sa double focale : sur Billie Holiday bien sûr, mais aussi sur Linda Lipnack Kuehl, une journaliste qui projetait d'écrire un livre sur la chanteuse et qui est morte (dans des conditions mystérieuses) avant d'avoir pu achever son projet. Son travail préparatoire avait été effectué à partir de cassettes audio, qui ont été retrouvées. Ces enregistrements d'entretiens se sont révélés précieux. On en entend d'ailleurs plusieurs extraits dans le film.
La mise en parallèle de ces vies ne manque pas d'intérêt. La journaliste (blanche, juive) ne venait pas du tout du même milieu Lady Day. Mais le destin brisé de cette artiste talentueuse lui parlait. C'était d'abord une femme victime des hommes (producteurs, compagnons, époux...), dans une relation de dépendance dont elle ne semblait pas vouloir sortir. À son sujet, le documentaire évoque une forme de masochisme, ajoutant de la complexité à son histoire.
Sans être aussi flamboyant que le biopic, le documentaire mérite le détour.
13:03 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, musique, chanson, états-unis
lundi, 07 juin 2021
Billie Holiday
Sous-titré "une affaire d'État", ce biopic est consacré à celle qui est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz et de blues. Il a été réalisé par Lee Daniels, auquel on doit aussi Le Majordome. On pouvait donc redouter que ce long-métrage ne prenne la forme d'un hommage consensuel à une femme qui fut tout sauf conventionnelle.
Il faut immédiatement parler de l'actrice, Andra Day, véritablement habitée par le rôle. Elle livre une performance exceptionnelle (oscarisable)... et elle chante ! Oui, elle s'est appropriée les titres de "Lady Day". Franchement, elle n'a pas la même voix, mais son ton rauque passe à merveille.
La biographie se concentre sur les années quarante et cinquante (en gros, les seize-dix-sept dernières années de la vie de Billie). Que nous montre-t-on ? Une femme talentueuse, charismatique, grande consommatrice d'alcool, de drogues... et d'hommes (musclés). Le film a pour but de nous faire comprendre que ce comportement auto-destructeur vient des traumatismes vécus dans son enfance : le viol (à peine effleuré), la pauvreté, le racisme, l'abandon. La musique et le chant ont été les portes de sortie de Billie. C'est particulièrement bien montré dans une séquence onirique de la seconde partie, consécutive à une injection d'héroïne.
Pour le reste, c'est assez conventionnel et chic : les décors (en partie numériques) sont soignés, les tenues parfois incroyables... et quel boulot des coiffeurs !
Si le biopic se concentre sur les années 1940-1950, c'est aussi pour mieux insister sur l'imbrication entre la musique et la cause noire. Pourtant, la plupart des titres chantés par Billie Holiday sont anodins : on y célèbre la fête, on y parle d'amour. Mais il en est un qui a déchaîné la colère des Blancs racistes : Strange Fruit (le lien mène à la version interprétée par la vraie Billie, plus belle encore que celle qu'on entend dans le film). Le paradoxe est que cette chanson, pas du tout représentative du répertoire de Billie Holiday, a figé son image de chanteuse engagée.
La dernière partie de l'histoire n'est pas très originale : elle évoque la déchéance de la vedette, celle-ci toujours diablement bien interprétée. Du coup, même si le film est un peu long (environ 2h10), même si l'imagerie est un peu trop léchée, je le recommande, en raison de la force du destin qui le traverse.
23:25 Publié dans Cinéma, Histoire, Musique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, musique, chanson, etats-unis, états-unis, etats unis
mardi, 22 octobre 2019
Le Regard de Charles
Ce regard est celui de Charles Aznavour. On connaissait l'acteur convenable et le chanteur talentueux. On découvre le vidéaste amateur, à qui Edith Piaf avait offert une caméra portative. L'auteur-compositeur-interprète a tourné des dizaines d'heures de petits films, pendant ses moments de loisir (notamment en famille), mais aussi à l'occasion de ses tournées, qui constituent le principal matériau de ce film.
Ce documentaire d'1h20 est le résultat du montage d'images qui s'étalent des années 1950 au tout début des années 1970. En fond sonore, on entend la musique, parfois les chansons d'Aznavour. Un commentaire a été créé à parti de déclarations de l'artiste. Il est lu par Romain Duris, dont la voix grave et posée se révèle un excellent substitut à la parole d'Aznavour. C'est fou ce que les déclarations d'Aznavour se marient bien avec les images qu'il a tournées !
Il y en a pour tous les goûts. Les fans du chanteur le réécouteront avec plaisir, aussi bien avec des titres célèbres qu'avec des chansons méconnues du grand public. Les adeptes d'anecdotes "pipoles" en apprendront peut-être sur sa vie privée, assez chaotique : l'artiste a d'abord donné la priorité à sa carrière même si, sur le tard (après 40 ans), il a accordé davantage de temps et d'attention au cocon familial. La mort de son fils, à l'âge de 24 ans, a peut-être pesé. A contrario, le jeune artiste paraît totalement détaché des responsabilités familiales quand il s'embarque pour le Canada, où son contrat d'une semaine va se prolonger un mois, une année... On découvre aussi des images rares, celles d'un Aznavour en "jam session". On sent l'amoureux de la musique et du rythme.
Quand il ne se faisait pas filmer, Aznavour prenait la caméra pour montrer son entourage, ses épouses, ses enfants (en particulier l'une de ses filles, qu'il filme de manière attendrissante). On le voit aussi aux côtés de vedettes de l'époque, françaises comme étrangères.
Pour moi, les images les plus intéressantes sont celles qui montrent un pays où il s'est produit, il y a 50-60 ans. Hong Kong et Macao ont bien changé depuis ! Que dire aussi des prises de vue d'Afrique du Nord ou des Etats-Unis (New York et Las Vegas en particulier) ! Elles ont une authentique valeur historique, si bien qu'au bout d'1h20, on regrette que le film s'achève déjà.
dimanche, 07 juillet 2019
Yesterday
La chanson de Paul McCartney donne son titre à cette comédie romantique, à la fois musicale et fantastique. C'est une sorte d'uchronie. A la suite d'un accident de la route, un soir de coupure générale d'électricité, Jack Malik (Himesh Patel, très bien) se réveille dans un monde où les Beatles n'ont pas existé (pas plus qu'Oasis et Harry Potter, d'ailleurs). C'est aussi un monde sans Coca Cola ni cigarettes... sympa, a priori !
Le début de l'histoire (avant l'accident) nous présente un auteur-compositeur-interprète raté. Jack a quitté l'enseignement pour se lancer dans une carrière d'artiste, vivotant grâce à un travail alimentaire (manutentionnaire chez un grossiste). Seule son amie d'enfance Ellie (restée elle enseignante) croit encore en lui. Dès le début, on sent qu'entre eux il y a plus que de l'amitié. C'est l'un des points faibles de cette intrigue pourtant bien menée : une grande partie des événements sont téléphonés. Mais, comme la dulcinée du héros est interprétée par la délicieuse Lily James (vue récemment dans Baby Driver et Le Cercle littéraire de Guernesey), cela passe.
Le ton de la comédie prend le dessus quand, sorti de l'hôpital, le héros découvre qu'il vit désormais dans une sorte de monde parallèle, où presque tout est semblable à celui dont il vient, à l'exception de quelques "détails" comme la formation et le succès de son groupe favori.
C'est particulièrement réussi quand Jack commence à interpréter en public les chansons des Beatles dont il se souvient. Dans les bars où il se produit, les clients pensent surtout à boire, manger et discuter entre eux. Dans sa propre famille, il n'arrive pas au bout de Let it Be, ses parents étant visiblement plus intéressés par la conversation de l'ami de passage où le fait de se servir une bière.
Quand le succès commence à poindre à l'horizon, le ton tourne à la satire. La cible est l'industrie musicale américaine. Elle est principalement incarnée par l'excellente Kate McKinnon, dont nous avons déjà pu apprécier la puissance comique dans S.O.S. Fantômes et l'inoubliable L'Espion qui m'a larguée. J'ai aussi en mémoire la réunion de toute l'équipe de production américaine (qui -les sourires en plus- ressemble furieusement à un rassemblement de cadres communistes de feue l'URSS), une réjouissante caricature dans laquelle le boss rejette comme titre de l'album de Jack tous ceux choisis jadis par les Beatles !
La dernière demi-heure prend le virage de l'émotion. Le héros y fait deux rencontres capitales. La première lui permet de se sentir moins seul. (Je n'en dirai pas plus.) La seconde (que l'on sent venir) lui remet la tête à l'endroit, faisant bifurquer l'intrigue vers une conclusion hyper consensuelle et morale. La séquence du concert ne m'a pas plu du tout, alors qu'elle était censée émouvoir. C'est très protestant anglo-saxon. Mais, bon, l'éloge de la simplicité du bonheur ordinaire me convient très bien, alors je suis sorti de là plutôt content.
P.S.
Dans le film, la carrière de Jack est lancée grâce à une supposée grosse vedette, Ed Sheeran, qui, d'après le générique, joue son propre rôle... et qui, pour moi, est un illustre inconnu !
P.S. II
Les amateurs de mini-séries britanniques reconnaîtront au moins deux visages connus (dans les seconds rôles), celui de Sanjeev Bhaskar (Unforgotten) et celui de Sarah Lancashire (Happy Valley).
11:09 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson
dimanche, 09 juin 2019
Rocketman
Je suis britannique, d'origine modeste (sans être pauvre). Très tôt, on m'a découvert des dons artistiques. J'ai rapidement voulu changer d'identité pour faire carrière et j'ai longtemps été un homosexuel honteux. Je suis... eh, non ! Pas Freddy Mercury ! Pourtant, les ressemblances entre les deux parcours sont frappantes. Il est d'autant plus étonnant que moins de sept mois après la sortie de Bohemian Rhapsody, cet autre demi-biopic nous soit proposé.
C'est un demi-biopic parce que l'histoire s'arrête au moment où Elton John devient sobre. Les 25-30 dernières années en sont donc exclues. La forme prise par le film est aussi déroutante : c'est une "comédie" musicale, dont le passage le plus entraînant se trouve dans la première partie, lorsqu'il est question de la soirée de folie que passe le jeune adulte. La musique claque, les chorégraphies sont au poil et c'est filmé avec une touche d'inventivité.
Le problème est que, si l'on excepte la séquence au Troubadour, c'est, pour moi, le seul moment du film où l'aspect comédie musicale tient la route. Il est vrai qu'à la base, je n'aime pas trop le genre. Mais, franchement, dans le reste du film, ça "bande mou". Les chansons d'Elton sont réinterprétées par l'acteur principal (Taron Egerton, très bon dans le rôle) ou d'autres personnages. Déjà, dans la bouche d'Elton, la plupart de ses titres ne me branchaient pas, alors dans la bouche d'autres, moins doués... De surcroît, les chansons ne sont pas insérées dans l'ordre chronologique de leur composition, ce qui enlève une partie de sa force au caractère biographique du film.
J'ai quand même bien aimé les scènes de création artistique, au piano. Le jeune Reginald semble doté de l'oreille absolue, si bien qu'il aurait pu envisager une carrière classique. Il est fort bien interprété par deux garçons (à deux âges différents), le premier se révélant (si l'on se fie aux photographies montrées à la fin du film) le quasi-sosie du jeune artiste.
Il n'y a non plus rien à reprocher à l'interprétation. De Taron Egerton à Richard Madden (doté d'un curieux accent dans la version originale... parce que son personnage est d'origine écossaise !), en passant par Bryce Dallas Howard (méconnaissable dans le rôle de la mère indigne), on peut dire que le boulot est bien fait. Mais l'ensemble manque souvent de rythme et, paradoxalement, de folie. Le film souffre de la comparaison avec Bohemian Rhapsody, réalisé il est vrai par Bryan Singer.
11:23 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson
samedi, 08 juin 2019
Amazing Grace
Ce documentaire réalisé par le jeune Sydney Pollack n'avait jamais pu sortir en salles, faute de montage adéquat. Tourné en 1972 dans une église baptiste de Los Angeles, il montre les préparatifs, les à-côtés et le déroulement de deux mini-concerts de gospel donnés par Aretha Franklin.
Jusque dans les années 1980 je ne savais pas grand chose de celle-ci. J'avais quelques "tubes" en tête, comme Respect et Think. J'ai découvert la personne à l'occasion de duos, l'un avec Eurythmics (Sisters are doin' it for themselves), l'autre avec George Michael (I knew you were waiting).
Le titre du film est à double sens. Cette "grâce exceptionnelle" est, de prime abord, le talent d'Aretha Franklin, au timbre de voix unique. Mais c'est aussi un célèbre cantique (chez les Anglo-Saxons). Comme les concerts sont filmés dans une église, on doit tenir compte de la signification religieuse : cette grâce est divine, c'est un don qui distingue la chanteuse de la masse... et qu'elle utilise ici pour faire la promotion de l'église tenue par un pasteur qu'elle connaît depuis l'enfance. Dans le même temps, elle enregistre un disque de gospel, qui s'est d'ailleurs très bien vendu... Ou comment concilier le spirituel et le temporel.
Le réalisateur met en valeur l'interprète, dont la qualité du chant est stupéfiante. (Rappelons que le son est en prise directe, sur bandes magnétiques !) On voit que la jeune femme se donne à fond. Rapidement, des gouttes de transpiration apparaissent sur son visage (alors qu'elle ne fait que chanter et -parfois- jouer du piano, sans danser). Plusieurs gros plans bénéficient d'un effet quasi miraculeux : le visage d'Aretha est baigné de gouttes de sueur et du reflet des lumières sur les petits éclats de verre dont est piquetée sa robe blanche (le premier soir).
Mais le spectacle est aussi dans la salle. Lors du premier concert, elle est à moitié remplie, presque exclusivement garnie de spectateurs noirs (avec des coupes "afro" à la pelle). Ce sont des fidèles de l'église, parmi lesquels ont dû se glisser quelques incroyants amateurs de musique soul. Ils savent qu'ils sont filmés et enregistrés. Du coup, beaucoup sont venus sur leur trente-et-un et certains n'ont pas un comportement très naturel devant la caméra. Mais il ne faut pas croire que l'agitation que le concert provoque soit factice. C'est ainsi que le culte se passait et nombre de fidèles vivent à travers la musique religieuse une véritable expérience spirituelle.
Le second soir, la salle est pleine à craquer... et plus multi-ethnique. Dans l'assistance, on remarque la présence de Mick Jagger (14 ans avant la reprise de Jumpin' Jack Flash), d'abord tout au fond, puis beaucoup plus près de la scène. Le discours prononcé par le père d'Aretha (un pasteur, comme son hôte) est émouvant.
Au-delà de la musique, au-delà de la voix, au-delà de la religion, ce documentaire présente un intérêt historique. Il nous replonge au début des années 1970, peu de temps après la fin officielle de la ségrégation (à laquelle il est plusieurs fois fait allusion), quelques années aussi après les violentes émeutes de Watts, quartier dans lequel est situé le bâtiment qui sert de salle de concert. On réalise que les églises protestantes ont constitué un moyen d'ascension sociale pour certaines familles afro-américaines et le cadre idéal pour l'émergence de talents vocaux (Aretha annonçant nombre de "divas" contemporaines, comme Whitney Houston). Plus prosaïquement, on se dit aussi que la mode vestimentaire a (heureusement) beaucoup changé...
L'ensemble, hétéroclite, forme, pour moi, un beau documentaire musical, de surcroît pas très long (1h25).
18:02 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson
dimanche, 21 avril 2019
Whitney (en V.O.D.)
J'ai raté ce documentaire à sa sortie en salles. Je l'ai regretté par la suite : les critiques sont plutôt bonnes et je me suis rendu compte un peu tard que le réalisateur est Kevin MacDonald. On lui doit notamment Un Jour en septembre, Mon Meilleur ennemi, Jeux de pouvoir et surtout Le Dernier Roi d'Ecosse.
Bien que durant deux heures, le film ne s'attarde que très peu sur les premières années de Whitney Houston. Bien qu'étant née dans un ghetto noir (à Newark, dans la partie du New Jersey qui tient lieu de banlieue new-yorkaise), elle a plutôt vécu une enfance de classe moyenne (noire), entre une mère choriste (pour Aretha Franklin et Elvis Presley, entre autres) et un père fonctionnaire municipal pas très honnête. Dans la famille élargie, on chante souvent (les soeurs Warwick, Dionne et Dee Dee, sont des cousines) et l'on se rend régulièrement au temple.
A l'image de bien des actuelles vedettes de R'N'B, la future diva a fait ses premières armes vocales dans un contexte religieux. L'adolescente n'a pas tardé à être repérée. Les enregistrements qui montrent ses débuts font bien comprendre que, dès cette époque, l'artiste avait une voix hors du commun.
Arrivent les années 1980, les années Reagan-Bush (père), celles d'une Amérique conquérante, avide de fric facile et de paillettes. Du point de vue de la musique pop, ce furent les années Whitney Houston - Michael Jackson, deux artistes populaires, doués et qui n'ont pas su gérer richesse et célébrité. Whitney devient la vache à lait de la famille et subit des pressions contradictoires : sa mère voit sa carrière comme une revanche sur ses propres échecs, alors que le père voudrait prendre le contrôle de la machine à fric. Quant aux aux frères, cousins et amis, ils initient la chanteuse à diverses drogues...
Whitney découvre aussi qu'elle ne peut plus avoir de véritable vie privée. Le problème est qu'elle n'a pas été souvent sincèrement aimée. Le documentaire apprendra à celles et ceux qui l'ignoraient qu'elle était bisexuelle (et que sa compagne fut sans doute son plus grand amour, finalement écarté par les proches, un brin homophobes certes, mais qui redoutaient surtout son influence). Son mariage avec un rappeur de seconde zone fut un échec qui dura, pour le plus grand malheur de l'artiste : elle sombra dans la drogue et la dépression.
Cependant, la révélation la plus fracassante nous est réservée pour la dernière demi-heure : la source des névroses de la chanteuse serait des abus sexuels subis dans son enfance (par une personne proche). Cela expliquerait son malaise quant à son identité sexuelle et son acharnement à ne pas laisser sa petite fille à la maison, quand elle partait en tournée. La gamine n'en a pas moins souffert : privée de camarades de son âge, elle a navigué dans les eaux troubles de l'entourage de sa mère.
Même quand, comme moi, on n'est pas fan de la chanteuse, on peut apprécier ce documentaire assez riche, qui parle de la condition de femme, de mère, de chanteuse et d'amoureuse dans les années 1980-1990-2000.
dimanche, 11 novembre 2018
Bohemian Rhapsody
Voici donc le demi-biopic de Freddie Mercury et de Queen. Bien que durant 2h15, le film ne décrit ni l'enfance ni l'adolescence de celui qui s'appelait Farrokh Bulsara et l'intrigue s'interrompt sur un point d'orgue, la formidable séquence du concert de Wembley, laissant de côté les dernières années du chanteur.
Je pense que c'est un bon choix. Il y avait tant de choses à dire et à montrer que, d'un point de vue cinématographique, il était plus pertinent de se concentrer sur la naissance du groupe, jusqu'à ce qui est parfois considéré comme son apogée (même si Mercury n'est plus tout à fait à son meilleur niveau lors du concert).
Ce choix a aussi l'avantage de ne pas trop faire vieillir les personnages, qui sont donc toujours interprétés par les mêmes acteurs. J'ai un peu tout lu et entendu à propos de Rami Malek (qui s'est fait connaître en tant qu'Elliot dans Mr Robot). D'accord, ce n'est pas un sosie de Freddy Mercury. OK, sa prothèse dentaire est parfois gênante. Mais le comédien nous livre une sacrée performance. Il incarne véritablement l'artiste. (Au niveau du chant, il s'est évidemment contenté du play-back sur les pistes enregistrées de Mercury, une doublure-voix ayant été sollicitée pour certaines scènes.)
Pour les seconds rôles, on a visiblement recherché des acteurs et des actrices ressemblant déjà physiquement à leurs personnages. L'alchimie fonctionne : on sent qu'ils forment un groupe, avec sa complicité, ses engueulades et ses non-dits. Bien que n'étant pas un grand fan de leur musique, j'ai quand même beaucoup aimé les scènes montrant leur travail d'artistes, en particulier toute la séquence aboutissant à la naissance du titre Bohemian Rhapsody. Il manque toutefois la genèse du clip vidéo, qui était novateur pour l'époque.
La mise en scène elle-même ne se veut pas un plat filmage de la grandeur et de la décadence d'un artiste populaire d'origine modeste. J'ai déjà évoqué la séquence du Live Aid (dont une partie du matériau sert d'introduction au film). On sent la patte de Bryan Singer, qui s'est creusé la tête pour, d'une œuvre essentiellement musicale, faire une œuvre visuelle. Il y a aussi instillé de l'humour et de l'émotion (surtout vers la fin).
C'est clairement un film qui vise le grand public. Il me semble qu'on a gommé certaines aspérités dans la vie personnelle de Mercury, ainsi que dans ses relations avec les membres du groupe. Mais, en gros, quand ce n'est pas montré, c'est suggéré.
Il y a quand même quelques facilités et quelques maladresses. La première rencontre entre trois des quatre futurs membres du groupe ne m'a pas convaincu, tout comme la séquence de rupture entre le héros et son conseiller-protecteur-amant-homme-à-tout-faire Paul (qui débute par la visite de son ancienne compagne). Il y a aussi la tendance (agaçante) à filmer les visages des personnages secondaires, émus ou en admiration devant le héros. Enfin, je doute que l'évolution des dons (pendant le concert) soit aussi caricaturale que ce qui est montré. Mais, franchement, vu la qualité de l'ensemble, on peut se montrer indulgent pour les petits défauts du film.
PS
J'ai lu et entendu que Singer avait reconstitué l'intégralité de la prestation de Queen au Live Aid. Ce n'est pas exact, me semble-t-il. On ne voit pas Mercury jouer à la guitare sur Crazy little thing called love et le morceau (très moralisateur) Is this the world we created, interprété en fin de concert, est absent.
PS II
Les chats sont très mignons... mais, curieusement, on ne voit jamais Malek/Mercury les caresser, alors qu'il les adorait. L'acteur serait-il allergique ?... Apparemment oui !
13:07 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson
mercredi, 28 juin 2017
L'affaire Fualdès à la Une
2017 marque le bicentenaire de l'assassinat de l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès, qui fut à l'origine d'une sorte de bourrasque médiatique d'ampleur nationale, la première en France pour un fait divers. Depuis trente ans, à intervalle régulier, des publications évoquent le sujet. Plus rarement, la radio s'est penchée sur l'affaire. Récemment, à deux reprises, c'est Jacques Pradel, sur RTL, qui a donné un coup de projecteur sur l'un des plus retentissants meurtres du XIXe siècle, tout d'abord en mars 2015, puis, de nouveau, le 15 juin dernier, avec pour invité l'historien Jacques Miquel.
Celui-ci a contribué à la création de l'exposition actuellement visible au musée Fenaille jusqu'au 31 décembre 2017 (et dont je parlerai bientôt). Aujourd'hui mercredi, il était cette fois-ci l'invité de La Marche de l'histoire, sur France Inter.
Dans un format aussi court, il était impossible de tout dire. Ceux qui connaissent déjà l'affaire resteront sans doute un peu sur leur faim... mais je pense que c'est le but : susciter la curiosité, pour donner envie de se rendre au musée Fenaille, pour en savoir plus. L'émission aura au moins été l'occasion de faire entendre (partiellement) une version de la Complainte de Fualdès.
22:31 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique aveyronnaise, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, histoire, culture, médias, occitanie, musique, chanson
dimanche, 25 juin 2017
La dernière de Philippe Meyer
Heureux habitants de l'Aveyron et des autres départements français, ça n'est pas pour me vanter, mais, ce matin, j'ai écouté France Culture.
Dans le huis clos de vos salles de bains, il me semble vous entendre dire : "Mais, blogueur inconséquent, pourquoi diable écourter une grasse matinée aussi méritée que nécessaire, en ces temps troublés d'oppressante canicule et d'abstentionnisme triomphant ?"
Peut-être, chers lecteurs, n'êtes-vous pas sans ignorer que, ce dimanche, était diffusée, pour la dernière fois en direct, l'émission L'Esprit public, animée par un mammifère omnivore nommé Philippe Meyer. Dans les contrées rouergates, il arrive que l'on s'intéresse à l'activité dudit mammifère. Certaines mauvaises langues iront jusqu'à affirmer que c'est parce que l'homo sociologus meyerus est ce qu'on appelle parfois un "Aveyronnais de Paris"... né dans le Palatinat, sous un échevinat auguste, celui de M. Ebinger.
C'est au tournant des années 1980-1990 que je suis entré en contact (radiophonique) avec celui qui allait devenir le plus célèbre (et unique) chroniqueur matutinal de France. Aujourd'hui encore, j'ai peine à décrire l'impatience qui tenaillait l'étudiant d'alors, de retour précipité de la douche pour ne rater aucune miette des élucubrations de Philippe. Plus tard, c'est au volant de son rutilant véhicule d'occasion que le jeune actif a savouré les pointes et les piques du plus habile bretteur des ondes. C'était une autre époque, avant que ne fût inventée la baladodiffusion. Déjà, le progrès faisait rage.
Il m'est même arrivé de contribuer à la bonne tenue d'une émission présentée par Philippe Meyer, toujours sur le service public de radiophonie. A l'orée du XXIe siècle, l'animateur a sollicité ses auditeurs sachant auditer, afin qu'ils lui proposassent des définitions aussi rigoureuses qu'imaginaires de termes que les dictionnaires de langue française traitaient de manière trop traditionnelle.
Prévoyant peut-être que son futur sur France Inter risquait de manquer d'avenir, l'ancien chroniqueur matutinal s'est mué en animateur politique, sur France Culture, le Temple de la connaissance élitiste accessible aux masses. Si "L'Esprit public" ressemblait parfois un peu trop à une conversation de salon entre hommes (et femmes) de bonne compagnie, l'émission avait l'immense mérite de laisser des personnes intelligentes développer des argumentations élaborées sur des sujets complexes, une entreprise ô combien ambitieuse en ces temps où le gazouillis numérique le dispute aux éructations télévisuelles.
Hélas, trois fois hélas ! De nos jours, les radios publiques sont dirigées par des phénix qui ont souvent fait la preuve de leur incompétence dans d'autres institutions. Il était donc logique que les programmes qui font appel à l'intelligence (surtout s'ils sont des succès d'audience) deviennent la cible des gestionnaires qui, du futur, veulent faire table rase. L'an dernier, c'est "La prochaine fois, je vous le chanterai" qui a subi les foudres des Torquemada de la Maison ronde. Le 28 mai dernier, Philippe Meyer a annoncé l'arrêt programmé de "L'Esprit public", suite à un courrier dont chacun jugera de la délicatesse.
Ce dimanche, l'animateur-journaliste-sociologue-toutologue, un peu ému, a conclu en chanson, s'inspirant de Roland de Lassus, un compositeur de la Renaissance.
Je vous souhaite le bonjour ! Nous vivons une époque moderne.
14:02 Publié dans Politique, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : musique, chanson, médias, presse, journalisme, politique
samedi, 14 novembre 2015
Une "Marseillaise" new-yorkaise
Je l'ai entendue (pas en entier) sur France Inter, à la fin de l'émission de ce soir, dans laquelle les auditeurs étaient amenés à réagir. Je suis ensuite parti à la recherche de la version intégrale. Je suis d'abord tombé sur un autre extrait, sur le site de BFMTV. Puis, j'ai eu l'idée d'aller sur le site du Metropolitan Opera de New York, où j'ai vu ceci :
De là, on peut accéder à l'interprétation des chanteurs et de l'orchestre... jusqu'aux applaudissements finaux. A ce moment-là, tendez bien l'oreille : on entend plusieurs "Vive la France !"
Thank you, New York !
22:10 Publié dans Musique, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, politique, france, actualité, médias, journalisme, attentats
lundi, 30 décembre 2013
Twenty Feet from Stardom
"A six mètres de la célébrité", c'est-à-dire tout près, mais plutôt dans l'ombre, évoluent depuis des dizaines d'années des femmes (et parfois des hommes), dont les voix n'ont pas grand chose à envier à celle des vedettes. Ces personnes sont les choristes. Ce documentaire leur est consacré.
Blanches et lisses à l'origine, ces assistantes sont devenues majoritairement noires... et plus pétulantes. Leur point commun est d'avoir découvert le chant au temple. De manière générale, la musique populaire noire-américaine doit beaucoup à la manière dont le culte protestant est rendu outre-Atlantique.
La trame du film est linéaire. On part de la création des groupes de choristes noires à leurs tentatives de carrière solo, en passant par le fonctionnement de l'industrie du disque et les interactions avec les mouvements politiques des années 1960-1970.
Parmi les vétéranes, il y a celle qui a servi la soupe à Ray Charles (qui avait ses "raelettes"). Dans le film, on nous propose l'intégralité d'une célèbre chanson (What'd I say), avec les choristes au premier plan (sur le côté toutefois), dans un jeu érotique (au niveau des gémissements) avec le pianiste, qui se trouve au centre. (Au passage, ceux qui ne connaissaient le musicien que très âgé et rabougri pourront le découvrir jeune et en pleine santé, très proche de l'interprétation de Jamie Foxx dans Ray.)
L'une des plus talentueuses était Darlene Wright, qui dut changer son nom en "Love". Elle raconte comment elle n'a parfois même pas été créditée pour les voix qu'elle avait assurées sur des disques du groupe The Crystals. Le producteur Phil Spector ne semble pas avoir éprouvé un grand respect pour ces petites mains du spectacle chanté, sans lesquelles bien des artistes n'auraient pas eu autant de succès.
D'autres, comme Claudia Lennear, Lisa Fischer et Merry Clayton, ont travaillé pour les Rolling Stones, David Bowie, Joe Cocker, Sting... En général, elles ont commencé jeunes (autour de 18 ans)... et elles étaient très jolies ! Le contraste est saisissant, puisque l'on voit ce qu'elles sont devenues, 30, 40 ou 50 ans plus tard...
Elles n'ont de plus pas été gâtées par la vie. Si elles se contentaient de rester choristes, au bout d'un moment, on leur faisait comprendre qu'il fallait laisser la place à de plus jeunes. Et presque toutes celles qui se sont lancées dans une carrière solo ont échoué. Le film n'ose pas trop s'attarder sur le sujet mais, s'il est incontestable que ces femmes possèdent des voix en or, cela ne suffit pas pour faire carrière. Sans auteur ni compositeur, le rossignol chante à vide. Et il y a ce petit "supplément d'âme", qui fait qu'une chanteuse techniquement moins bonne fait passer beaucoup plus de choses.
Toutefois, bien que le film ne dure qu'une heure et demie, j'ai trouvé cela assez long. C'est le défaut des documentaires, en général. Et pourtant, ici, on a pris soin d'alterner images d'archives, entretiens récents (plus ou moins intéressants) et séquences chantées. Cela reste un film plaisant à voir... et à entendre.
22:23 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, musique, chanson
lundi, 23 décembre 2013
La Morinade, fin
Ce dimanche 22 décembre a été diffusé le dernier numéro de l'émission "La Morinade", enregistré le mardi précédent. Le paradoxe est que cette émission est la plus populaire du Mouv', station de radio à l'audience (très) confidentielle. Créée à la rentrée 2011, "La Morinade" est depuis des mois en tête des téléchargements, comme en témoigne encore un communiqué de novembre de Médiamétrie :
Si ce n'est pas le manque de succès qui explique l'arrêt de l'émission, c'est peut-être son contenu. Intéressons-nous à celui de dimanche dernier. Comme à l'accoutumée, après les présentations d'usage, c'est la chroniqueuse Anne Ma qui a dressé le portrait de l'invité, Richard Lornac :
Evoluant sans cesse entre second et troisième degré, Anne Ma, fille d'un CRS de la région PACA, évoque avec crudité sa condition de serial célibataire, abusée dans son enfance par son pépé René et éduquée à coups de matraque par un père raciste. On la retrouve à plusieurs reprises dans l'émission, presque toujours sur ce registre dérangeant... mais follement drôle !
Lui a succédé celui qui est devenu la vedette de l'émission, le père Albert, incarné par Albert Algoud, un ancien de la bande à Canal qui était réapparu sur France Inter, donnant la réplique à Daniel Morin dans certaines de ses chroniques au "Fou du roi" (animé par Stéphane Bern), par exemple celle du 28 septembre 2010 :
Les attaques répétées contre l'Eglise catholique et la promotion du masochisme à une heure de grande écoute avaient eu raison de la participation du père Albert... qui avait donc débarqué sur Le Mouv' à la rentrée suivante. Ce dimanche, le saint homme a été le seul à se réjouir de la disparition de l'émission.
Autre intervention qui avait de quoi choquer les oreilles sensibles, celle de Jacky le Nordiste (incarné par Daniel Morin en personne). Dans "La Morinade", il s'est spécialisé dans la drague lourde, humiliante... avec l'accent :
Lui et sa soeur Jacquette (alias Anne Ma) sont issus d'une famille de zoophiles hyperviolents. Le pseudo-journal diffusé lors de chaque émission se faisait régulièrement l'écho des aventures de ces deux infréquentables Chtimis. Pour la dernière, ils nous ont offert un duo d'anthologie :
(C'est bien entendu un hommage à Francis Cabrel, à travers sa chanson Je l'aime à mourir.)
Même les musiciens invités ont été priés d'oeuvrer dans le sens des chroniqueurs. Ainsi, dimanche dernier, Teddy Savic a offert au public (en deuxième morceau) une reprise de l'un des hymnes de "La Morinade", L'Handicapé.
Je regretterai aussi les mini-fictions de Fred Martin (le fils de Jacques). La dernière retrace les origines mythiques de l'émission et la manière dont l'équipe s'est constituée :
Dans les dialogues ont été insérées des répliques qui pourraient expliquer les récents changements subis par l'émission, notamment la disparition de certains chroniqueurs, comme Jean-Mama le réac (voir plus bas) et l'inénarrable Jean-Kévin (au centre sur l'image ci-dessus), doté d'une sensuelle voix prépubère et d'un énorme "goumi" de 4 centimètres (en érection) !
Fred Martin, c'est aussi l'auteur des prévisions météo, en forme de charade... et le créateur de fausses publicités, de qualité inégale. Les calembours étaient plus ou moins réussis. J'aime bien celles du 23 janvier 2012.
Autre pilier multitalent de l'émission, Albert Algoud s'était mis à incarner un chanteur ringard, Jean-Pierre Aznavour, dont les textes mettaient en valeur des slogans publicitaires de manière emphatique... ou faisaient référence à Emile Louis :
Mais l'un des moments les plus attendus de l'émission était incontestablement le décrochage en faveur d'une petite radio locale, Radio Caca :
Albert Algoud y interprétait plusieurs personnages, au premier rang desquels le Maréchal Ganache, dernier maréchal de France survivant des guerres coloniales, hélas frappé d'incontinence fécale.
C'est aussi dans la dernière partie de l'émission que l'on a revu le chroniqueur (franchement) de droite Jean-Mama le réac, qui avait disparu des ondes à la rentrée 2013, lorsque l'émission était devenue hebdomadaire. Il en était pourtant un fidèle "compagnon de route", même si, pour gagner sa croûte, il officiait ailleurs. Les auditeurs attentifs de France Info auront reconnu la voix de Jean-Mathieu Pernin, qui a parcouru la France rurale pour la station d'information et qui, aujourd'hui, tient une chronique sur le monde du spectacle. (Cette année, il a par exemple parlé de GiedRé.)
En guise de conclusion, Thomas Croisière, l'enfant terrible de "La Morinade", a proposé un dernier radi-oké, truffé de calembours, construit à partir d'une chanson de Patrick Bruel.
Voilà, c'est fini. On éradique la seule émission d'humour féroce, à ne pas mettre entre toutes les oreilles certes, mais qui réunissait une brochette inédite de talents.
Cette suppression est liée à la réorganisation de la grille du Mouv', décidée par Joël Ronez, le directeur nommé en août dernier. Le problème est que, pour relancer l'audience, on supprime l'émission la plus populaire. A mon avis, on a profité de la nécessaire refonte des programmes pour se débarrasser d'humoristes considérés comme des gêneurs. La gauche caviar n'aime décidément pas la gaudriole...
15:56 Publié dans Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : médias, humour, actualité, chanson, chanson française
mercredi, 08 mai 2013
Purée d'homonymie !
Hier soir, après le boulot, j'ai eu une belle surprise en écoutant La Morinade. L'une des rubriques est celle de la "très très bonne musique" proposée par Daniel Morin lui-même. (Elle est parfois introduite par un jingle évoquant un lieu emblématique de l'Aveyron.) L'animateur nous y propose des extraits qu'il juge particulièrement puissants... Voici donc ce que j'ai entendu dans l'émission de mardi 7 mai :
Le morceau de musique en question existe bel et bien. Il s'agit du rap arabe, d'un individu qui s'appelle Henri Golan (sans le "t", attention, hein !). C'est évidemment un pseudonyme, celui du Belge Willy Dehaibe, qui a mis un terme à sa carrière d'humoriste en 2010.
09:17 Publié dans Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chanson, musique, médias
jeudi, 12 juillet 2012
"Nique ta mère"... en Chine
Cet été, France Inter propose, en fin d'après-midi (approximativement de 17h à 18h), une émission très intéressante : "Le monde sur un plateau". Je n'ai pas forcément l'occasion de l'écouter en direct. Heureusement, le site de la radio est très bien fichu, permettant de télécharger ou de réécouter un programme longtemps après sa diffusion.
Trois pays vont successivement faire l'objet de reportages : la Chine, les Etats-Unis et la Russie. Actuellement, il est question de "l'empire du milieu". J'ai récemment écouté l'émission du 4 juillet, consacrée à internet. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre ceci :
C'est l'illustration de l'un des moyens utilisés pour contourner la censure. A l'image des chansonniers français, friands de calembours (plus ou moins graveleux), certains internautes jouent sur l'homophonie ou le double sens de certains mots. Le procédé a donné naissance à des vidéos (certaines parodiant les documentaires animaliers), dont le héros est Caonima, littéralement "cheval de l'herbe et de boue" (une sorte d'alpaga), dont le nom chinois signifie aussi "nique ta mère" !
Dessins animés mis à part, il y a un petit côté South Park dans cette production irrévérencieuse.
14:09 Publié dans Chine, Politique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, chanson, société, journalisme, humour
mercredi, 02 novembre 2011
Une chanson de circonstance
Aujourd'hui 2 novembre nous rendons hommage aux morts... chacun à notre manière. (Il y a même de fortes chances que cet hommage ait été rendu hier 1er novembre, jour de tous les saints, qui a l'avantage d'être férié.)
L'auteure-compositrice-interprète GiedRé, qui a sorti un épatant CdVd l'été dernier, a marqué le coup à sa manière... très particulière.
Sur Youtube (et sur son profil Facebook) a été récemment mis en ligne un nouveau titre : Le ver de terre.
Bonne écoute...
13:14 Publié dans Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chanson, musique, poésie, société, vidéo
vendredi, 03 décembre 2010
"Tripote-moi la bite avec les doigts"
Non, non, rassurez-vous, je ne suis pas en train de lancer un appel désespéré ! Je viens juste de regarder quelques extraits du coffret Groland dont j'ai causé il y a peu. Du coup, je rigole comme un con devant mon écran. Je découvre parfois des séquences inédites, mais, le plus souvent, je revois avec plaisir des moments truculents.
Parmi ceux-ci, il y a une parodie d'Elton John, qui se termine en chanson paillarde.
En creusant un peu, je suis tombé sur la version complète de la chanson, interprétée (en live, avec ses tripes) par Mano Solo.
Pour une interpétation plus classique, on peur se tourner vers Dodone.
22:54 Publié dans Musique, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, musique, chanson, internet, médias
dimanche, 12 septembre 2010
De Pierre Perret à Nicolas Sarkozy
D'habitude, je n'aime pas les attaques sur le physique des gens. Je me suis même déjà pris le chou avec des collègues au sujet de Sarkozy quand les attaques ciblaient uniquement sa taille.
Mais là, franchement, la parodie que je vous propose d'écouter est vraiment bien fichue. Comme vous vous en doutez sûrement après avoir vu le titre, c'est la chanson Le Zizi qui a été détournée. L'interprète est censée être Carla Bruni... Y a eu un gros boulot sur les rimes, moi j'vous l'dis !
00:31 Publié dans Musique, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, sarkozy, musique, chanson
dimanche, 30 mai 2010
Le concours eurovision de la chanson (2010)
Cela faisait des années que je n'avais pas regardé ni même suivi ce concours réputé ringard, truqué et apôtre de la médiocrité. J'ai fait exception ce soir. A cette occasion, j'ai découvert que l'on pouvait suivre en direct la compétition, sur internet. (Une caméra permettait même d'avoir une vision des coulisses.) Gros avantage de la chose : on échappait aux commentaires de Stéphane Bern et Cyril Hanouna.
Je me suis donc aperçu que tous les pays ne participent pas à la finale : il y a des demis auparavant... et tous les pays n'y sont pas représentés, puisque, par exemple, l'Italie a cessé de participer... un fort bel exemple à suivre, et je vais dire pourquoi.
D'abord ce concours a perdu son charme ethnographique, puisque 80 % des candidats chantent en anglais, sur des rythmes stéréotypés. (Quelques exceptions sont à relever : on a pu entendre du grec, du serbe, de l'hébreu, du portugais et du français, mais les chansons n'étaient pas de très bonne qualité.) C'est assez consternant de voir ces Britney Spears, Abba, Worlds Apart, Ace of Base, Peter et Sloane de deuxième catégorie. Qui plus est, la musique est préenregistrée, seuls les chanteurs étant en direct. Du coup, les musiciens miment... mal en général ! Et que dire des danseurs, accompagnateurs désormais quasi obligés et caricaturaux (des mecs bodybuildés à l'air très con et des pétasses plus ou moins refaites). Je ne parlerai pas des jeux de scène idiots, comme des ailes qui se déploient dans le dos de chanteuses ou des interprètes qui émergent de cubes en plastique... Ah, j'ai failli oublier : à cause d'un imbécile qui s'est glissé sur la scène, on a dû se taper deux fois la chanson espagnole, qui est vraiment à chier.
Quant aux coups de projecteurs donnés sur les différents pays, ils sont réduits à leur plus simple expression : on voit des petits groupes se comporter comme des cons finis, brandissant maladroitement des drapeaux dont ils ne connaissent sans doute pas la signification. A la fin, on leur a demandé à tous de se trémousser en cadence sur du r'n'b (ce qui m'a permis d'apprendre que le groupe Madcon est norvégien). La vision de ces foules malléables ne me laisse rien augurer de bon pour les démocraties européennes, décidément bien soumises aux médias de masse.
Vient ensuite la longue litanie des votes nationaux. Auparavant, on a laissé le temps aux pigeons de dépenser un peu d'argent par téléphone, sans forcément savoir que le choix du jury "compétent" pèse autant que tous les appels.
Et quand chaque pays annonce ses résultats, on découvre qu'ils suivent davantage la géopolitique ou les affinités civilisationnelles qu'autre chose. Donc, les Européens du centre et de l'Est votent les uns pour les autres (notamment dans les Balkans), tout comme les Scandinaves, les pays de l'ex-U.R.S.S. et d'Europe du Sud (avec les copinages Espagne-Portugal et Grèce-Chypre, de grands classiques). Ne négligeons pas non plus le poids des communautés émigrées (les Turcs d'Allemagne et de France par exemple). On n'oublie pas d'accorder quelques voix à chaque fois aux gros financeurs du concours, on s'arrange pour qu'aucun pays ne reparte avec 0 point et le tour est joué !
C'est sans doute le meilleur moment de la soirée. J'aime observer les tics de comportement de chaque personne annonçant les votes de son pays. Le choix de l'homme ou de la femme est souvent lui-même porteur de sens. Ainsi, la France, déjà représentée par un chanteur de couleur, a fait annoncer ses votes par une ravissante métis. Qui osera dire après cela que nous vivons dans un pays gangréné par le racisme ? La Norvège avait donné l'exemple, avec une présentation paritaire (un homme, une femme... on est en Scandinavie !) et multiculturelle, puisqu'aux côtés d'un horrible blondinet officiait une ravissante Noire. De son côté, la Turquie avait l'image d'une jolie décolorée, le pays étant représenté par un groupe de djeunses qui proposait de la pop occidentale (pas plus mauvaise que ce que l'on entend sur les radios FM)... si après tous ces efforts on ne comprend pas que la Turquie veut à tout prix entrer dans l'Union européenne, c'est à désespérer !
Résultat ? L'Allemagne gagne, avec une chanson qui, si elle sera vite oubliée, est pour moi l'une des moins pires... et l'interprète est très mignonne, ce qui n'a pas dû la désavantager. (On peut la voir entièrement nue dans l'extrait d'un nanard qui circule sur le net.) Derrière on trouve une brochette de grosses merdes : les chansons roumaine (de la sous-pop italienne), belge (de la bogossitude creuse, en anglais, pour ne fâcher ni les francophones ni les fachos néerlandophones), danoise (un énième duo... on a entendu ça mille fois, en mieux), arménienne (interprétée par un véritable petit canon... mais je m'égare). La France termine douzième avec un titre vraiment très très moyen (du zouk au rabais)... Au moins, on n'aura pas à financer l'organisation de ce truc ! Toutes les daubes n'ont pas été bien classées : dans les derniers de la finale on trouve les interprètes biélorusses, moldaves et britannique... ce qui n'est pas immérité !
Je suis quand même allé faire un tour sur le site de France 3, histoire de jeter un oeil aux éliminés des demi-finales. Ben c'est mauvais. J'ai par ailleurs remarqué qu'ils sont proportionnellement plus nombreux à chanter dans leur langue nationale. Les oreilles européennes seraient-elles formatées à l'anglais ?
01:56 Publié dans Musique, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, europe, actualité
mardi, 11 mai 2010
Bienvenue à Paris
Je viens de découvrir ça en zappant sur NRJ. Il s'agit d'une parodie du "tube" d'Alicia Keys et Jay Z, "Empire state of mind", par l'équipe de MIKL. (Ouais, je sais, son émission, c'est pas du haut niveau, il passe des auditeurs qui racontent parfois vraiment n'importe quoi, à côté, les mecs de Skyrock c'est limite France Culture...)
A la base, le "tube" ricain est un hymne à New York, chanté par un joli brin de femme (qui a de la voix) et un gros blaireau en bonnet avec lunettes de soleil (mais il paraît qu'il fait dans l'humanitaire). Attention, le clip est vraiment naze, malgré les images léchées de la métropole by night.
La parodie française s'intitule donc "Bienvenue à Paris". C'est du quinzième degré, tout le monde en prend pour son grade. Cela m'a rappelé les meilleures heures du Festival Roblès. J'ai aussi trouvé une version illustrée de la chanson, l'internaute ayant tenté de superposer les paroles à des images... Amusez-vous à compter les fautes de français !
01:05 Publié dans Musique, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, chanson, paris, humour