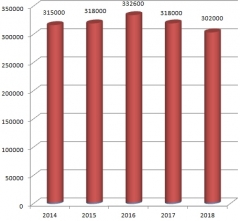lundi, 18 février 2019
Vice
Le titre du nouveau film d'Adam McKay (auquel on doit The Big Short) est à double sens : c'est la contraction de "vice-président", la fonction occupée par Richard Cheney sous George W. Bush, entre 2001 et 2009... et c'est un adjectif, qui peut être traduit par "vicieux" en français. C'est dire que ce biopic ne prend pas le chemin du regard distancié. C'est un mélange de documentaire et de fiction, à charge.
L'histoire entremêle deux trames chronologiques. On découvre le jeune Cheney au début des années 1960, étudiant alcoolique. Dans le même temps, on nous présente le rôle décisif tenu par le vice-président, à partir des attentats islamistes du 11 septembre 2001. Les retours en arrière sont chargés de montrer comment un type très ordinaire va devenir l'homme le plus puissant du pays (selon l'auteur), tandis que la trame principale met en exergue son action contemporaine, éminemment néfaste.
Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette histoire que les deux futurs acolytes (Bush Jr et Cheney) soient des alcooliques repentis, le premier parce qu'il a rencontré Dieu, le second parce qu'il a voulu garder son épouse. Celle-ci est incarnée par Amy Adams et c'est sans doute le personnage le plus romanesque de ce film, celui d'une femme intelligente, lucide, patriote et conservatrice, qui a mis sur orbite son balourd de mari, lequel a beaucoup appris au contact de chacals de la politique, finissant par tirer les ficelles, à Washington.
Je n'ai par contre pas été très emballé par la prestation de Christian Bale. Pourtant, sur le plan physique, il finit par ressembler étrangement au vrai Cheney. Mais on sent trop la présence des prothèses et la grimace du visage est vraiment forcée. Si l'on cherche le meilleur comédien, on peut se tourner vers Steve Carell, qui interprète Donald Rumsfeld, une autre enflure républicaine, qui fut le mentor de Cheney, avant de découvrir que l'élève avait dépassé le maître.
L'avidité et le cynisme de la faune républicaine (qui a fait ses premiers pas sous Richard Nixon) est très bien rendue par le film, tout comme la tentative de faire du président (et de son colistier) le chef d'un exécutif fort. Mais les diverses influences qui s'exerçaient sur les dirigeants de la droite ne sont qu'esquissées. Ainsi, même si l'on comprend que Cheney n'était pas un religieux (préférant rester proche de sa fille homosexuelle que gagner l'électorat ultra-conservateur), l'imprégnation chrétienne de George W. Bush est totalement absente du film ! Un comble quand on sait que le président faisait débuter nombre de réunions par... une prière. De la même manière, on ne comprend pas l'une des motivations de ceux qui ont voulu remodeler le Moyen-Orient : y implanter des démocraties pro-américaines stables. Les néo-conservateurs sont réduits à un groupe de complotistes hauts placés, certains très sensibles aux intérêts pétroliers. Là encore, on perçoit les lacunes du scénario, qui ne nous fait pas comprendre comment un étudiant médiocre a pu devenir PDG d'une firme comme Halliburton.
Le film tente d'expliquer une grande part de la vie politique américaine par la vie privée des principaux acteurs (la vie familiale et les réseaux d'amitié). C'est ce que l'on pourrait appeler du "gauchisme pipole". L'auteur semble en être conscient, puisque, juste après le début du générique de fin, il a inséré une scène assez drôle, où plusieurs personnages commentent le film qui vient de s'achever.
J'ai aussi été gêné par l'alternance de scènes de fiction et d'extraits de documents d'actualité, sans que la distinction soit bien établie entre les deux. J'ai par contre apprécié que l'histoire nous soit racontée du point de vue d'un jeune père de famille, ancien soldat de l'US Army envoyé au Moyen-Orient et qui va jouer un rôle déterminant dans la vie du vice-président... d'une manière que je me garderai bien de révéler.
Cela vous donne une idée du caractère hétéroclite de ce film. C'est une assez bonne dénonciation d'une équipe politique qui a foutu le bordel au Moyen-Orient, mais cela manque de rigueur.
21:36 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 17 février 2019
Ralph 2.0
Le titre est trompeur, puisque le véritable personnage principal de ce film d'animation n'est pas ce balourd de Ralph, mais sa meilleure amie, l'adorable petite puce prénommée Vanellope, gamine intrépide au grand coeur :
J'en profite pour conseiller de choisir plutôt la version française du film, dans laquelle ce personnage est particulièrement bien doublé, par Dorothée Pousséo, dont la voix paraîtra sans doute familière à bien des spectateurs.
L'histoire s'adresse à la fois aux enfants et aux parents. Les deux héros font des bêtises, certaines plus grosses que d'autres. Ils vont tenter de se racheter, quitte à mettre leur amitié en péril. Les voilà embarqués pour le monde d'internet... et de Disney, dont les produits sont ostensiblement mis en valeur par le film.
On se consolera avec les clins d'oeil et les (rares) traits d'autodérision. Certaines séquences méritent quand même le détour, comme la course-poursuite après le vol de voiture ou encore la rencontre (très attendue depuis la sortie de la bande-annonce) entre Vanellope et toutes les princesses de l'univers Disney. C'est effectivement réussi, d'autant que la gamine va convaincre lesdites princesses de changer d'apparence ! On retrouve d'ailleurs avec plaisir cette brochette de miss un peu plus tard dans l'intrigue : elles vont donner un coup de main décisif aux héros.
Entre temps, les deux amis vont découvrir le fonctionnement des différents services vedettes de la Toile (eux aussi outrageusement mis en valeur), pour leur plus grand plaisir... et parfois à leur détriment. Très réussie visuellement est la scène qui montre Ralph face à un mur d'écrans géants, où s'affichent les commentaires des usagers des réseaux sociaux. Il y a donc bien une petite morale derrière cette histoire, mais une morale toute gentillette, qui se garde d'émettre des critiques acerbes.
On pourrait aussi s'amuser à relever les allusions cinématographiques, la plus évidente (en fin d'histoire) étant celle à King Kong. C'est du travail bien fait, parfois impressionnant sur le plan visuel. Je me suis toutefois ennuyé à plusieurs reprises : c'est d'un intérêt très inégal... et je regrette le manque de recul des auteurs vis-à-vis de l'omniprésence des écrans dans le monde contemporain.
PS
Aux parents je déconseille d'emmener de très jeunes enfants, qui, dans la salle où je me trouvais, ont perdu le fil de l'histoire (peut-être perturbés par l'avalanche de mots inconnus et de situations compliquées pour eux).
00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Ralph 2.0
Le titre est trompeur, puisque le véritable personnage principal de ce film d'animation n'est pas ce balourd de Ralph, mais sa meilleure amie, l'adorable petite puce prénommée Vanellope, gamine intrépide au grand coeur :
J'en profite pour conseiller de choisir plutôt la version française du film, dans laquelle ce personnage est particulièrement bien doublé, par Dorothée Pousséo, dont la voix paraîtra sans doute familière à bien des spectateurs.
L'histoire s'adresse à la fois aux enfants et aux parents. Les deux héros font des bêtises, certaines plus grosses que d'autres. Ils vont tenter de se racheter, quitte à mettre leur amitié en péril. Les voilà embarqués pour le monde d'internet... et de Disney, dont les produits sont ostensiblement mis en valeur par le film.
On se consolera avec les clins d'oeil et les (rares) traits d'autodérision. Certaines séquences méritent quand même le détour, comme la course-poursuite après le vol de voiture ou encore la rencontre (très attendue depuis la sortie de la bande-annonce) entre Vanellope et toutes les princesses de l'univers Disney. C'est effectivement réussi, d'autant que la gamine va convaincre lesdites princesses de changer d'apparence ! On retrouve d'ailleurs avec plaisir cette brochette de miss un peu plus tard dans l'intrigue : elles vont donner un coup de main décisif aux héros.
Entre temps, les deux amis vont découvrir le fonctionnement des différents services vedettes de la Toile (eux aussi outrageusement mis en valeur), pour leur plus grand plaisir... et parfois à leur détriment. Très réussie visuellement est la scène qui montre Ralph face à un mur d'écrans géants, où s'affichent les commentaires des usagers des réseaux sociaux. Il y a donc bien une petite morale derrière cette histoire, mais une morale toute gentillette, qui se garde d'émettre des critiques acerbes.
On pourrait aussi s'amuser à relever les allusions cinématographiques, la plus évidente (en fin d'histoire) étant celle à King Kong. C'est du travail bien fait, parfois impressionnant sur le plan visuel. Je me suis toutefois ennuyé à plusieurs reprises : c'est d'un intérêt très inégal... et je regrette le manque de recul des auteurs vis-à-vis de l'omniprésence des écrans dans le monde contemporain.
PS
Aux parents je déconseille d'emmener de très jeunes enfants, qui, dans la salle où je me trouvais, ont perdu le fil de l'histoire (peut-être perturbés par l'avalanche de mots inconnus et de situations compliquées pour eux).
00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 15 février 2019
La Favorite
Le film aurait dû s'intituler "Les Favorites", vu qu'il y est question (entre autres choses) de la rivalité de deux femmes pour décrocher/conserver la place de conseillère privilégiée de la reine Anne de Grande-Bretagne. Les deux intrigantes, la duchesse de Malborough (ancêtre de Winston Churchill !) et sa cousine Abigail, ont bien existé, tout comme la souveraine, bien entendu.
Tout tourne autour des trois femmes, campées par d'excellentes actrices (toutes trois nommées aux Oscar). La reine a les traits d'Olivia Colman, jadis abonnée aux seconds rôles, et que le grand public a réellement découverte grâce à la série Broadchurch. Ici, elle incarne une vieille enfant gâtée, goinfre, malpropre et cyclothymique, que la mort successive de tous ses enfants a sans doute rendue à moitié dingue :
La favorite en titre est Lady Sarah, une brune intelligente, opiniâtre, un brin cassante... et diablement excitante : elle a les traits, le corps et la diction de la délicieuse Rachel Weisz. (C'est évidemment à savourer en version originale sous-titrée.) Alors qu'elle n'est que le troisième choix de la production, elle étincelle dans le rôle, qu'on croirait écrit pour elle :
Sa rivale est sa propre cousine Abigail, dont la famille est ruinée... et qui a subi quelques avanies dans sa jeune existence. La ridicule oie blanche va petit à petit se muer en redoutable rapace de la cour. Elle est brillamment interprétée par Emma Stone, qui confirme tout le bien qu'on pensait déjà d'elle :
Chaque personnage (et donc chaque actrice) a ses moments de bravoure. La reine surprend par ses brusques changements d'humeur, Olivia Colman réussissant à nous faire saisir les tourments qui la hantent. Lady Sarah est sublime d'intensité, discrète et efficace dans les coulisses du Parlement, arrogante dans les salons, dangereuse une arme à la main. Quant à Abigail, elle se révèle particulièrement douée pour la sournoiserie. Elle joue de sa faiblesse présumée pour manipuler femmes et hommes. J'ai particulièrement aimé les scènes de couple (en formation) avec Samuel Masham (Joe Alwyn). C'est que l'héroïne tient remarquablement bien le manche !
Voilà qui m'amène à une autre grande réussite de cette œuvre : le dépoussiérage du film de costumes. Oh, certes, on touche du doigt la magnificence, le clinquant de la décoration, la délicatesse des étoffes prestigieuses. Mais, fort heureusement, on ne nous cache pas les aspects triviaux de l'existence. Le langage est aussi parfois très cru, ce qui donne encore plus de couleur à cette histoire, tournée avec une lumière naturelle. De jour, cela ne se remarque guère. Mais, pour les scènes se déroulant le soir ou la nuit, l'éclairage aux chandelles donne des résultats de toute beauté. Par contre, je n'ai pas apprécié les effets déformants donnés à certains plans. Ils n'apportent rien à l'histoire, d'autant que la mise en scène est la plupart du temps brillante. On a la confirmation (pour ceux qui en doutaient) que Yorgos Lanthimos (auquel on doit The Lobster) est l'un des plus talentueux réalisateurs de sa génération.
Je termine par une grosse réserve scénaristique.
J'ai gardé pour la fin ce bémol à mon enthousiasme. Attention donc si vous n'avez pas encore vu le film. Dans les lignes qui suivent, je vais révéler des éléments clés de l'intrigue.
Si le fond de l'histoire tourne autour du pouvoir et de la place des femmes dans la haute société britannique du début du XVIIIe siècle, un autre versant important traite de l'amour homosexuel, celui qui lie la reine Anne à Lady Sarah et celui que la reine croit voir naître avec Abigail. Si, sur un plan dramatique, cet aspect donne plus de force à l'intrigue, sur le plan historique, je n'ai rien trouvé qui puisse accréditer cette rumeur. Concernant les relations entre Anne et ses favorites, les historiens parlent de forte amitié, jamais de sexe. Alors ? Pudibonderie ? Autocensure ?... ou invention des scénaristes ?
21:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
La Favorite
Le film aurait dû s'intituler "Les Favorites", vu qu'il y est question (entre autres choses) de la rivalité de deux femmes pour décrocher/conserver la place de conseillère privilégiée de la reine Anne de Grande-Bretagne. Les deux intrigantes, la duchesse de Malborough (ancêtre de Winston Churchill !) et sa cousine Abigail, ont bien existé, tout comme la souveraine, bien entendu.
Tout tourne autour des trois femmes, campées par d'excellentes actrices (toutes trois nommées aux Oscar). La reine a les traits d'Olivia Colman, jadis abonnée aux seconds rôles, et que le grand public a réellement découverte grâce à la série Broadchurch. Ici, elle incarne une vieille enfant gâtée, goinfre, malpropre et cyclothymique, que la mort successive de tous ses enfants a sans doute rendue à moitié dingue :
La favorite en titre est Lady Sarah, une brune intelligente, opiniâtre, un brin cassante... et diablement excitante : elle a les traits, le corps et la diction de la délicieuse Rachel Weisz. (C'est évidemment à savourer en version originale sous-titrée.) Alors qu'elle n'est que le troisième choix de la production, elle étincelle dans le rôle, qu'on croirait écrit pour elle :
Sa rivale est sa propre cousine Abigail, dont la famille est ruinée... et qui a subi quelques avanies dans sa jeune existence. La ridicule oie blanche va petit à petit se muer en redoutable rapace de la cour. Elle est brillamment interprétée par Emma Stone, qui confirme tout le bien qu'on pensait déjà d'elle :
Chaque personnage (et donc chaque actrice) a ses moments de bravoure. La reine surprend par ses brusques changements d'humeur, Olivia Colman réussissant à nous faire saisir les tourments qui la hantent. Lady Sarah est sublime d'intensité, discrète et efficace dans les coulisses du Parlement, arrogante dans les salons, dangereuse une arme à la main. Quant à Abigail, elle se révèle particulièrement douée pour la sournoiserie. Elle joue de sa faiblesse présumée pour manipuler femmes et hommes. J'ai particulièrement aimé les scènes de couple (en formation) avec Samuel Masham (Joe Alwyn). C'est que l'héroïne tient remarquablement bien le manche !
Voilà qui m'amène à une autre grande réussite de cette œuvre : le dépoussiérage du film de costumes. Oh, certes, on touche du doigt la magnificence, le clinquant de la décoration, la délicatesse des étoffes prestigieuses. Mais, fort heureusement, on ne nous cache pas les aspects triviaux de l'existence. Le langage est aussi parfois très cru, ce qui donne encore plus de couleur à cette histoire, tournée avec une lumière naturelle. De jour, cela ne se remarque guère. Mais, pour les scènes se déroulant le soir ou la nuit, l'éclairage aux chandelles donne des résultats de toute beauté. Par contre, je n'ai pas apprécié les effets déformants donnés à certains plans. Ils n'apportent rien à l'histoire, d'autant que la mise en scène est la plupart du temps brillante. On a la confirmation (pour ceux qui en doutaient) que Yorgos Lanthimos (auquel on doit The Lobster) est l'un des plus talentueux réalisateurs de sa génération.
Je termine par une grosse réserve scénaristique.
J'ai gardé pour la fin ce bémol à mon enthousiasme. Attention donc si vous n'avez pas encore vu le film. Dans les lignes qui suivent, je vais révéler des éléments clés de l'intrigue.
Si le fond de l'histoire tourne autour du pouvoir et de la place des femmes dans la haute société britannique du début du XVIIIe siècle, un autre versant important traite de l'amour homosexuel, celui qui lie la reine Anne à Lady Sarah et celui que la reine croit voir naître avec Abigail. Si, sur un plan dramatique, cet aspect donne plus de force à l'intrigue, sur le plan historique, je n'ai rien trouvé qui puisse accréditer cette rumeur. Concernant les relations entre Anne et ses favorites, les historiens parlent de forte amitié, jamais de sexe. Alors ? Pudibonderie ? Autocensure ?... ou invention des scénaristes ?
21:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 14 février 2019
Les Invisibles
C'est peut-être le film qui, actuellement, bénéficie du meilleur bouche-à-oreille autour de moi (avec Green Book, chez les cinéphiles purs et durs). J'ai fini par me laisser tenter, d'autant que le réalisateur Louis-Julien Petit m'avait déjà agréablement surpris avec Discount, il y a quatre ans.
On en retrouve d'ailleurs l'une des actrices principales, Corinne Masiero, assez sobre ici (contrairement à ce qu'elle a récemment montré dans Capitaine Marleau, où elle part trop en vrille). Elle est accompagnée par Noémie Lvovsky, Brigitte Sy (qu'on peut actuellement voir sur France 2, dans la -surprenante- série Zone blanche) et Fatsah Bouyahmed (rappelez-vous : La Vache !).
Le rôle principal est tenu par Andrey Lamy, une habituée des comédies faciles (dernièrement CoeXister et Ma Reum). Ici, elle incarne une sorte de Mère Teresa laïque, dont la vie est vouée à l'aide aux plus démunis, plus particulièrement les femmes sans domicile fixe. Elle nous livre une composition pleine de force et d'émotion.
Autour des comédiennes professionnelles gravitent des débutantes, recrutées pour leur expérience de la vie dans la rue. Majoritairement âgées, souvent un peu grosses, rarement jolies, parfois "sans-dents", ces femmes sans éclat apparent donnent une couleur formidable au film, par leur présence physique et leur naturel face à la caméra. Se détache évidemment Chantal, une adorable mamie, véritable as de mécanique... et qui a fait de la prison pour avoir descendu le mari qui la battait.
C'est peut-être la seule faiblesse du film, qui évite (la plupart du temps) de tomber dans le "politiquement correct" : les femmes de la rue sur lesquelles un coup de projecteur est donné ont toutes un talent caché. Une parle italien, une autre était comptable, une autre psychologue... Malheureusement, la réinsertion de ce genre de public ne repose pas toujours sur des bases aussi solides. On trouve aussi dans la rue des personnes qui n'ont jamais reçu la moindre formation et qui sont encore plus difficiles à gérer que les cas extrêmes montrés dans le film. Mais ce choix favorise l'identification par les spectateurs, à l'image de ce qui s'était passé jadis avec Une Epoque formidable.
J'ai apprécié qu'on ne nous présente pas les personnages comme des anges. Les SDF ont en général un caractère bien trempé et les travailleuses sociales ont leurs propres problèmes. L'aide à autrui peut être vue comme un moyen de donner un sens à une vie décevante. Cela risque aussi (comme avec l'héroïne) de les couper de toute vie sociale "normale", tant elles sont investies dans leur travail.
Pendant 1h40, on sourit, on rit, on est ému, inquiet, dans l'attente d'une fin qui ne sera ni sirupeuse ni dramatique, mais porteuse d'espoir. C'est vraiment un film à voir.
21:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Les Invisibles
C'est peut-être le film qui, actuellement, bénéficie du meilleur bouche-à-oreille autour de moi (avec Green Book, chez les cinéphiles purs et durs). J'ai fini par me laisser tenter, d'autant que le réalisateur Louis-Julien Petit m'avait déjà agréablement surpris avec Discount, il y a quatre ans.
On en retrouve d'ailleurs l'une des actrices principales, Corinne Masiero, assez sobre ici (contrairement à ce qu'elle a récemment montré dans Capitaine Marleau, où elle part trop en vrille). Elle est accompagnée par Noémie Lvovsky, Brigitte Sy (qu'on peut actuellement voir sur France 2, dans la -surprenante- série Zone blanche) et Fatsah Bouyahmed (rappelez-vous : La Vache !).
Le rôle principal est tenu par Andrey Lamy, une habituée des comédies faciles (dernièrement CoeXister et Ma Reum). Ici, elle incarne une sorte de Mère Teresa laïque, dont la vie est vouée à l'aide aux plus démunis, plus particulièrement les femmes sans domicile fixe. Elle nous livre une composition pleine de force et d'émotion.
Autour des comédiennes professionnelles gravitent des débutantes, recrutées pour leur expérience de la vie dans la rue. Majoritairement âgées, souvent un peu grosses, rarement jolies, parfois "sans-dents", ces femmes sans éclat apparent donnent une couleur formidable au film, par leur présence physique et leur naturel face à la caméra. Se détache évidemment Chantal, une adorable mamie, véritable as de mécanique... et qui a fait de la prison pour avoir descendu le mari qui la battait.
C'est peut-être la seule faiblesse du film, qui évite (la plupart du temps) de tomber dans le "politiquement correct" : les femmes de la rue sur lesquelles un coup de projecteur est donné ont toutes un talent caché. Une parle italien, une autre était comptable, une autre psychologue... Malheureusement, la réinsertion de ce genre de public ne repose pas toujours sur des bases aussi solides. On trouve aussi dans la rue des personnes qui n'ont jamais reçu la moindre formation et qui sont encore plus difficiles à gérer que les cas extrêmes montrés dans le film. Mais ce choix favorise l'identification par les spectateurs, à l'image de ce qui s'était passé jadis avec Une Epoque formidable.
J'ai apprécié qu'on ne nous présente pas les personnages comme des anges. Les SDF ont en général un caractère bien trempé et les travailleuses sociales ont leurs propres problèmes. L'aide à autrui peut être vue comme un moyen de donner un sens à une vie décevante. Cela risque aussi (comme avec l'héroïne) de les couper de toute vie sociale "normale", tant elles sont investies dans leur travail.
Pendant 1h40, on sourit, on rit, on est ému, inquiet, dans l'attente d'une fin qui ne sera ni sirupeuse ni dramatique, mais porteuse d'espoir. C'est vraiment un film à voir.
21:15 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
mercredi, 13 février 2019
Alita : Battle Angel
Alléché par les bonnes fées (J. Cameron et R. Rodriguez) qui se sont penchées sur ce film, j'ai tenté ma chance, à l'occasion d'une séance en version originale sous-titrée. (A Rodez, on n'en bénéficie pas qu'en art-et-essai. Récemment, de grosses productions comme Glass et Creed II nous ont été proposées aussi bien en version doublée qu'en VO.)
L'héroïne, inspirée d'un manga, est fidèle aux nouveaux canons du film d'action non machiste, de Ghost in the shell à Divergente. Elle est mince et sportive, tenace voire impitoyable, tout en étant capable d'éprouver de profonds sentiments.
Dans le rôle-titre Rosa Salazar (dont on a semble-t-il considérablement rajeuni les traits) s'en sort très bien. Elle est crédible dans les scènes d'action et fait bien ressentir ce qu'éprouve son personnage. (A titre d'anecdote, je précise qu'elle a un petit rôle dans Divergente 2.) On s'habitue très vite à ses grands yeux, qui contribuent à rendre son visage plus expressif. Le procédé rappelle les tableaux de Margaret Keane, à laquelle Tim Burton a naguère consacré le film Big Eyes (dans lequel jouait déjà un certain Christopher Waltz).
La relation (de type père-fille) qui se tisse entre Alita et le docteur Dyson (Christopher Waltz, plutôt bon) est assez touchante, bien que pas assez approfondie à mon goût. C'est d'ailleurs le principal défaut de ce film, très réussi sur le plan formel : il survole beaucoup de choses, en réutilisant de surcroît quelques vieilles recettes.
Ainsi, on du mal à croire à la relation amoureuse qui naît au premier regard entre la cyborg ressuscitée et le séduisant trafiquant, genre aventurier rebelle pour filles de bourges en goguette. J'ai quand même apprécié l'évolution de ce personnage masculin, qui devient plus altruiste... mais on est loin du Han Solo de Star Wars.
L'héroïne va devoir affronter une impressionnante galerie de méchants, plus ou moins redoutables. N'hésitons pas à le dire (et à l'écrire) : les scènes de combat, qu'elles se déroulent dans les rues, sous terre ou dans un stade, sont brillantes. Si l'on ajoute à cela un habillage visuel scintillant, on peut considérer ce truc comme un divertissement convenable, un peu prévisible certes, mais pas sans charme.
PS
Une suite est prévue.
23:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Alita : Battle Angel
Alléché par les bonnes fées (J. Cameron et R. Rodriguez) qui se sont penchées sur ce film, j'ai tenté ma chance, à l'occasion d'une séance en version originale sous-titrée. (A Rodez, on n'en bénéficie pas qu'en art-et-essai. Récemment, de grosses productions comme Glass et Creed II nous ont été proposées aussi bien en version doublée qu'en VO.)
L'héroïne, inspirée d'un manga, est fidèle aux nouveaux canons du film d'action non machiste, de Ghost in the shell à Divergente. Elle est mince et sportive, tenace voire impitoyable, tout en étant capable d'éprouver de profonds sentiments.
Dans le rôle-titre Rosa Salazar (dont on a semble-t-il considérablement rajeuni les traits) s'en sort très bien. Elle est crédible dans les scènes d'action et fait bien ressentir ce qu'éprouve son personnage. (A titre d'anecdote, je précise qu'elle a un petit rôle dans Divergente 2.) On s'habitue très vite à ses grands yeux, qui contribuent à rendre son visage plus expressif. Le procédé rappelle les tableaux de Margaret Keane, à laquelle Tim Burton a naguère consacré le film Big Eyes (dans lequel jouait déjà un certain Christopher Waltz).
La relation (de type père-fille) qui se tisse entre Alita et le docteur Dyson (Christopher Waltz, plutôt bon) est assez touchante, bien que pas assez approfondie à mon goût. C'est d'ailleurs le principal défaut de ce film, très réussi sur le plan formel : il survole beaucoup de choses, en réutilisant de surcroît quelques vieilles recettes.
Ainsi, on du mal à croire à la relation amoureuse qui naît au premier regard entre la cyborg ressuscitée et le séduisant trafiquant, genre aventurier rebelle pour filles de bourges en goguette. J'ai quand même apprécié l'évolution de ce personnage masculin, qui devient plus altruiste... mais on est loin du Han Solo de Star Wars.
L'héroïne va devoir affronter une impressionnante galerie de méchants, plus ou moins redoutables. N'hésitons pas à le dire (et à l'écrire) : les scènes de combat, qu'elles se déroulent dans les rues, sous terre ou dans un stade, sont brillantes. Si l'on ajoute à cela un habillage visuel scintillant, on peut considérer ce truc comme un divertissement convenable, un peu prévisible certes, mais pas sans charme.
PS
Une suite est prévue.
23:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 10 février 2019
Green Book
Ce "livre vert" est un guide de voyage créé aux Etats-Unis pendant la période de ségrégation et destiné aux Afro-américains désireux d'éviter les désagréments d'hôteliers et restaurateurs indélicats racistes. (Aux curieux, je signale que la version de 1949 est disponible en ligne.) Il n'a donc rien à voir avec le livre vert de feu Mouammar Kadhafi, le risque de confusion (aux yeux du public francophone cultivé) expliquant sans doute que le film soit sorti avec son titre original.
Cette histoire "inspirée de faits réels" met en scène plusieurs communautés. On découvre d'abord le milieu italo-américain, dans lequel évolue Tony Lip, un homme de main des mafieux new-yorkais, qui a certes le coup de poing facile, mais qu'on nous présente comme un brave type. Dans le rôle, Viggo Mortensen est stupéfiant de vérité.
Il va se retrouver face à Don Shirley, un pianiste noir virtuose, élitiste et guindé, formidablement incarné par Mahershala Ali (vu récemment dans Free State of Jones et Les Figures de l'ombre). Entre les deux héros, c'est un peu le choc des cultures, le paradoxe étant que c'est l'homme noir qui est raffiné, le Blanc étant un rustaud... mais un rustaud qui connaît le culture populaire black. La première partie met plutôt en scène les différences (non "raciales") entre les deux personnages, notamment pendant les trajets en voiture. L'une des scènes marquantes est celle qui fait intervenir du poulet frit... Tony/Viggo s'y révèle insupportablement goinfre.
On attend bien sûr le moment où, ayant quitté les Etats (officiellement) non ségrégationnistes, les héros vont débarquer dans le "Deep South", où il est inconcevable qu'un "nègre" commande un Blanc. Fini les hôtels chics pour le pianiste, qui va davantage côtoyer les Afro-américains moyens, en général pauvres. Le contraste avec les salles de spectacle et les grandes demeures où il se produit est saisissant. Là, tout n'est que luxe, calme et volupté... blanches.
A partir de là, c'est un peu balisé : le pianiste noir subit les marques de racisme, son chauffeur blanc, pas très "Black Friendly" de prime abord, s'attache à lui et lui sauve la mise à plusieurs reprises. De son côté, Shirley se décoince un peu... et file un coup de main à son employé quand il peine à écrire à son épouse. On se dirige vers une fin assez prévisible, mais belle quand même, l'apogée se situant (pour moi) dans le petit bar noir, lors d'une séquence de toute beauté.
Au niveau de la réalisation, c'est très classique. N'attendez pas de recherche particulière au niveau de la mise en scène. Mais c'est du travail soigné, avec de beaux décors et des éclairages superbes. Les dialogues (que j'ai pu savourer en V.O. à Rodez) sont très bien écrits avec, cerise sur le gâteau, beaucoup de traits d'humour (où l'on retrouve la patte de Peter Farrely).
17:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films
Green Book
Ce "livre vert" est un guide de voyage créé aux Etats-Unis pendant la période de ségrégation et destiné aux Afro-américains désireux d'éviter les désagréments d'hôteliers et restaurateurs indélicats racistes. (Aux curieux, je signale que la version de 1949 est disponible en ligne.) Il n'a donc rien à voir avec le livre vert de feu Mouammar Kadhafi, le risque de confusion (aux yeux du public francophone cultivé) expliquant sans doute que le film soit sorti avec son titre original.
Cette histoire "inspirée de faits réels" met en scène plusieurs communautés. On découvre d'abord le milieu italo-américain, dans lequel évolue Tony Lip, un homme de main des mafieux new-yorkais, qui a certes le coup de poing facile, mais qu'on nous présente comme un brave type. Dans le rôle, Viggo Mortensen est stupéfiant de vérité.
Il va se retrouver face à Don Shirley, un pianiste noir virtuose, élitiste et guindé, formidablement incarné par Mahershala Ali (vu récemment dans Free State of Jones et Les Figures de l'ombre). Entre les deux héros, c'est un peu le choc des cultures, le paradoxe étant que c'est l'homme noir qui est raffiné, le Blanc étant un rustaud... mais un rustaud qui connaît le culture populaire black. La première partie met plutôt en scène les différences (non "raciales") entre les deux personnages, notamment pendant les trajets en voiture. L'une des scènes marquantes est celle qui fait intervenir du poulet frit... Tony/Viggo s'y révèle insupportablement goinfre.
On attend bien sûr le moment où, ayant quitté les Etats (officiellement) non ségrégationnistes, les héros vont débarquer dans le "Deep South", où il est inconcevable qu'un "nègre" commande un Blanc. Fini les hôtels chics pour le pianiste, qui va davantage côtoyer les Afro-américains moyens, en général pauvres. Le contraste avec les salles de spectacle et les grandes demeures où il se produit est saisissant. Là, tout n'est que luxe, calme et volupté... blanches.
A partir de là, c'est un peu balisé : le pianiste noir subit les marques de racisme, son chauffeur blanc, pas très "Black Friendly" de prime abord, s'attache à lui et lui sauve la mise à plusieurs reprises. De son côté, Shirley se décoince un peu... et file un coup de main à son employé quand il peine à écrire à son épouse. On se dirige vers une fin assez prévisible, mais belle quand même, l'apogée se situant (pour moi) dans le petit bar noir, lors d'une séquence de toute beauté.
Au niveau de la réalisation, c'est très classique. N'attendez pas de recherche particulière au niveau de la mise en scène. Mais c'est du travail soigné, avec de beaux décors et des éclairages superbes. Les dialogues (que j'ai pu savourer en V.O. à Rodez) sont très bien écrits avec, cerise sur le gâteau, beaucoup de traits d'humour (où l'on retrouve la patte de Peter Farrely).
17:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films
samedi, 09 février 2019
L'Intervention
Ce film de guerre assez austère relate les circonstances dans lesquelles s'est illustrée une unité spéciale de la gendarmerie, ancêtre du GIGN. L'action se déroule en 1976, alors que la majorité de l'Afrique est décolonisée... mais pas le Territoire français des Afars et des Issas, stratégiquement placé à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. On est en pleine Guerre froide. Le bloc communiste se porte bien et même progresse en Afrique.
L'ambiance des seventies est bien restituée par la musique d'accompagnement et la pratique de l'écran partagé (au début). Certains apprécieront aussi les tenues vestimentaires et les coupes de cheveux...
Les héros sont une bande de gendarmes atypiques, du genre doués mais francs-tireurs. On sent les références aux films américains. Cette unité spéciale est envoyée sur une base de la Légion, alors qu'un bus scolaire a été détourné par des indépendantistes djiboutiens. La prise d'otage est filmée de manière spectaculaire.
C'est alors qu'intervient un autre personnage important, celui de l'institutrice des enfants. Elle est incarnée par Olga Kurylenko, qu'on a coiffée et habillée comme un clone de Sophie Marceau. La belle et courageuse enseignante rejoint les enfants, mais se place sous la menace des preneurs d'otages, qui ne sont toutefois pas tous présentés comme des brutes sanguinaires.
La tension remonte dès que les commandos de gendarmerie se mettent en place, à l'insu des Djiboutiens. C'est très bien foutu, alors que quelques maladresses, au début, m'avaient fait craindre le pire. Les acteurs sont bons. On sent peser la chaleur et les odeurs moites (y compris celles de pets...). Ces hommes courageux et intelligents vont tenter de réaliser un exploit, alors que presque tout semble se liguer contre eux, y compris le général de la Légion et la conseillère Afrique de l'Elysée, personnages en lesquels on retrouve de vieilles connaissances : Vincent Perez et Josiane Balasko, pour mon plus grand plaisir.
Même si elle est un brin hollywoodienne sur la fin, cette histoire se suit avec grand plaisir.
00:57 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films
L'Intervention
Ce film de guerre assez austère relate les circonstances dans lesquelles s'est illustrée une unité spéciale de la gendarmerie, ancêtre du GIGN. L'action se déroule en 1976, alors que la majorité de l'Afrique est décolonisée... mais pas le Territoire français des Afars et des Issas, stratégiquement placé à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb. On est en pleine Guerre froide. Le bloc communiste se porte bien et même progresse en Afrique.
L'ambiance des seventies est bien restituée par la musique d'accompagnement et la pratique de l'écran partagé (au début). Certains apprécieront aussi les tenues vestimentaires et les coupes de cheveux...
Les héros sont une bande de gendarmes atypiques, du genre doués mais francs-tireurs. On sent les références aux films américains. Cette unité spéciale est envoyée sur une base de la Légion, alors qu'un bus scolaire a été détourné par des indépendantistes djiboutiens. La prise d'otage est filmée de manière spectaculaire.
C'est alors qu'intervient un autre personnage important, celui de l'institutrice des enfants. Elle est incarnée par Olga Kurylenko, qu'on a coiffée et habillée comme un clone de Sophie Marceau. La belle et courageuse enseignante rejoint les enfants, mais se place sous la menace des preneurs d'otages, qui ne sont toutefois pas tous présentés comme des brutes sanguinaires.
La tension remonte dès que les commandos de gendarmerie se mettent en place, à l'insu des Djiboutiens. C'est très bien foutu, alors que quelques maladresses, au début, m'avaient fait craindre le pire. Les acteurs sont bons. On sent peser la chaleur et les odeurs moites (y compris celles de pets...). Ces hommes courageux et intelligents vont tenter de réaliser un exploit, alors que presque tout semble se liguer contre eux, y compris le général de la Légion et la conseillère Afrique de l'Elysée, personnages en lesquels on retrouve de vieilles connaissances : Vincent Perez et Josiane Balasko, pour mon plus grand plaisir.
Même si elle est un brin hollywoodienne sur la fin, cette histoire se suit avec grand plaisir.
00:57 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, cinéma, cinema, film, films
mercredi, 06 février 2019
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?
Presque cinq ans après la sortie du premier volet des aventures de la famille Verneuil (qui fut un énorme carton au box-office), nous retrouvons quasiment tous les personnages... avec quasiment les mêmes défauts. Le premier dîner familial est d'ailleurs une répétition de l'un des repas du film précédent, durant lequel Claude, le patriarche gaulliste (incarné avec gourmandise par Christian Clavier), débite ses plaisanteries "politiquement incorrectes", au désespoir de ses gendres et de ses filles (toutes remarquablement interprétées, soit dit en passant).
C'est drôle, mais l'on courait le risque de se manger le même film. Fort heureusement, les scénaristes ont introduit des péripéties inédites. Les couples fille/gendre envisagent tous de partir s'installer à l'étranger (en Chine, en Israël, en Inde et en Algérie !), avec leur progéniture, privant papy et mamie Verneuil de leurs petits-enfants. Si les raisons qui les conduisent à ce choix radical ne sont pas très bien amenées, les conséquences sont par contre assez cocassement mises en scène.
C'est le personnage de la grand-mère (Chantal Lauby, formidable) qui sort du lot. Elle tombe en dépression et se met à la marche nordique... de jour comme de nuit. On la découvre aussi accro à son smartphone et très branchée réseaux sociaux... avec plus ou moins de réussite.
Mis devant le fait accompli, Marie et Claude mettent au point un plan machiavélique pour tenter de convaincre les gendres de revenir sur leur décision. Pour moi, c'est la meilleure partie du film. Dans le même temps, le couple de grands bourgeois va accueillir sur sa propriété un réfugié afghan, source de quelques quiproquos savoureux. De son côté, la belle-famille ivoirienne va subir un véritable traumatisme moral, dont je me garderai bien de révéler la teneur... (On retrouve avec bonheur Pascal Nzonzi.)
Voilà. C'est hyper-balisé, fait pour séduire à la fois les spectateurs qui ont des préjugés et ceux qui les rejettent. On se dirige vers une fin consensuelle, qui prône le "vivre ensemble". Le film, qui se voulait plutôt grinçant à la base, se garde en réalité de franchir les lignes rouges, à commencer par le dénigrement des homosexuels, qui ne sont la cible d'aucune plaisanterie douteuse. Si cette comédie est incontestablement rythmée, elle est surtout très sage.
21:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?
Presque cinq ans après la sortie du premier volet des aventures de la famille Verneuil (qui fut un énorme carton au box-office), nous retrouvons quasiment tous les personnages... avec quasiment les mêmes défauts. Le premier dîner familial est d'ailleurs une répétition de l'un des repas du film précédent, durant lequel Claude, le patriarche gaulliste (incarné avec gourmandise par Christian Clavier), débite ses plaisanteries "politiquement incorrectes", au désespoir de ses gendres et de ses filles (toutes remarquablement interprétées, soit dit en passant).
C'est drôle, mais l'on courait le risque de se manger le même film. Fort heureusement, les scénaristes ont introduit des péripéties inédites. Les couples fille/gendre envisagent tous de partir s'installer à l'étranger (en Chine, en Israël, en Inde et en Algérie !), avec leur progéniture, privant papy et mamie Verneuil de leurs petits-enfants. Si les raisons qui les conduisent à ce choix radical ne sont pas très bien amenées, les conséquences sont par contre assez cocassement mises en scène.
C'est le personnage de la grand-mère (Chantal Lauby, formidable) qui sort du lot. Elle tombe en dépression et se met à la marche nordique... de jour comme de nuit. On la découvre aussi accro à son smartphone et très branchée réseaux sociaux... avec plus ou moins de réussite.
Mis devant le fait accompli, Marie et Claude mettent au point un plan machiavélique pour tenter de convaincre les gendres de revenir sur leur décision. Pour moi, c'est la meilleure partie du film. Dans le même temps, le couple de grands bourgeois va accueillir sur sa propriété un réfugié afghan, source de quelques quiproquos savoureux. De son côté, la belle-famille ivoirienne va subir un véritable traumatisme moral, dont je me garderai bien de révéler la teneur... (On retrouve avec bonheur Pascal Nzonzi.)
Voilà. C'est hyper-balisé, fait pour séduire à la fois les spectateurs qui ont des préjugés et ceux qui les rejettent. On se dirige vers une fin consensuelle, qui prône le "vivre ensemble". Le film, qui se voulait plutôt grinçant à la base, se garde en réalité de franchir les lignes rouges, à commencer par le dénigrement des homosexuels, qui ne sont la cible d'aucune plaisanterie douteuse. Si cette comédie est incontestablement rythmée, elle est surtout très sage.
21:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 03 février 2019
La Mule
Un an après le très médiocre 15h17 pour Paris, Clint Eastwood revient, derrière et devant la caméra, pour mettre en scène une histoire vraie, celle d'un papy employé par un cartel de la drogue mexicain. Le scénario en décale toutefois l'histoire : le héros Earl (Clint, eastwoodien jusqu'au bout des ongles) est un vétéran de la guerre de Corée (et pas de la Seconde guerre mondiale) et l'action se déroule à cheval sur 2005 et 2017, pas dans les années 1980.
C'est d'abord un portrait de l'Amérique modeste besogneuse... et blanche. L'ancien combattant Earl ne semble avoir bénéficié d'aucune aide et, devenu horticulteur, il subit la concurrence du commerce en ligne. Lui qui, à 88 ans, n'a jamais récolté la moindre amende au volant, va plonger dans l'illégalité, d'abord pour survivre, puis pour répandre un peu de bonheur autour de lui.
Plusieurs détails disséminés ici et là indiquent le milieu (blanc conservateur et patriote) dans lequel a baigné Earl durant sa jeunesse et la première partie de sa vie active : les Noirs sont des Negroes, les homosexuelles des "gouines" (dykes)... et j'aurais peine à me souvenir de tous les termes péjoratifs employés à propos des Latinos. Néanmoins, ce petit Blanc élevé dans les préjugés interrompt sa route pour venir en aide à un couple de Noirs et, bien qu'interloqué par le groupe de bikeuses homos, il leur indique comment réparer leur bécane. Il finit même par nouer des liens d'amitié avec certaines des petites frappes du gang de trafiquants. C'est d'ailleurs l'une des qualités du film que de nuancer l'appréciation des personnages et des groupes. On n'est pas dans le manichéisme d'American Sniper, par exemple.
Pratiquement tout le monde joue bien... avec quelques baisses de tension de la part de Clint. On nous dit qu'il est en bien meilleure forme que le personnage qu'il incarne, mais, à deux-trois reprises, il m'a semblé jouer un peu approximativement. J'ai vu le film en version originale sous-titrée (et dans une grande salle... ALLELUIA !) ; j'ai donc pu percevoir les inflexions de sa voix, pas toujours bien audible. Les face-à-face avec l'agent de la DEA (Bradley Cooper) sont par contre très réussis, tout comme les dernières scènes familiales. (Il me semble toutefois y avoir aperçu un faux raccord, dans un plan tourné dans la chambre où repose l'ex-femme d'Earl : quand il y entre, la première fois, un équipement semble fixé sur le corps de la malade... dont il n'y a aucune trace dans les plans suivants.)
Au niveau technique, c'est globalement du bon boulot. Eastwood filme très bien l'intérieur, celui des garages, des bars et des restaurants. Les scènes de transport font respirer l'intrigue : elles montrent le fourgon d'Earl traversant des paysages parfois superbes et elles baignent dans une musique nostalgique et entraînante... qui séduit même le duo de nervis chargé d'accompagner le héros lorsque le chargement est particulièrement important.
Comme souvent chez Clint, le sous-texte est fourni. On sent l'homme un peu perturbé par le monde tel qu'il est devenu, avec ses contemporains obnubilé par internet, plus attentifs à leur téléphone portable qu'à leurs proches. A travers Earl, il est possible que ce soit Eastwood qui s'exprime, notamment lorsqu'il est question de l'importance de la famille. (La fille d'Earl est interprétée par une certaine Alison Eastwood !) Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de cela. Le film nous montre quand même un vieil homme qui a peur de finir sa vie seul, d'où son attachement à ses relations sociales (le club d"horticulteurs jadis, le bar de vétérans depuis toujours). Et si cet ex-mari fait de belles déclarations à son épouse, il n'en batifole pas moins avec des prostituées quand ses poches se remplissent d'argent (et profite des "hôtesses" de la villa du chef du Cartel).
Ce n'est pas aussi fort que Gran Torino, mais c'est un bon Eastwood, nourri de la pâte humaine qu'il sait si bien malaxer.
12:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
La Mule
Un an après le très médiocre 15h17 pour Paris, Clint Eastwood revient, derrière et devant la caméra, pour mettre en scène une histoire vraie, celle d'un papy employé par un cartel de la drogue mexicain. Le scénario en décale toutefois l'histoire : le héros Earl (Clint, eastwoodien jusqu'au bout des ongles) est un vétéran de la guerre de Corée (et pas de la Seconde guerre mondiale) et l'action se déroule à cheval sur 2005 et 2017, pas dans les années 1980.
C'est d'abord un portrait de l'Amérique modeste besogneuse... et blanche. L'ancien combattant Earl ne semble avoir bénéficié d'aucune aide et, devenu horticulteur, il subit la concurrence du commerce en ligne. Lui qui, à 88 ans, n'a jamais récolté la moindre amende au volant, va plonger dans l'illégalité, d'abord pour survivre, puis pour répandre un peu de bonheur autour de lui.
Plusieurs détails disséminés ici et là indiquent le milieu (blanc conservateur et patriote) dans lequel a baigné Earl durant sa jeunesse et la première partie de sa vie active : les Noirs sont des Negroes, les homosexuelles des "gouines" (dykes)... et j'aurais peine à me souvenir de tous les termes péjoratifs employés à propos des Latinos. Néanmoins, ce petit Blanc élevé dans les préjugés interrompt sa route pour venir en aide à un couple de Noirs et, bien qu'interloqué par le groupe de bikeuses homos, il leur indique comment réparer leur bécane. Il finit même par nouer des liens d'amitié avec certaines des petites frappes du gang de trafiquants. C'est d'ailleurs l'une des qualités du film que de nuancer l'appréciation des personnages et des groupes. On n'est pas dans le manichéisme d'American Sniper, par exemple.
Pratiquement tout le monde joue bien... avec quelques baisses de tension de la part de Clint. On nous dit qu'il est en bien meilleure forme que le personnage qu'il incarne, mais, à deux-trois reprises, il m'a semblé jouer un peu approximativement. J'ai vu le film en version originale sous-titrée (et dans une grande salle... ALLELUIA !) ; j'ai donc pu percevoir les inflexions de sa voix, pas toujours bien audible. Les face-à-face avec l'agent de la DEA (Bradley Cooper) sont par contre très réussis, tout comme les dernières scènes familiales. (Il me semble toutefois y avoir aperçu un faux raccord, dans un plan tourné dans la chambre où repose l'ex-femme d'Earl : quand il y entre, la première fois, un équipement semble fixé sur le corps de la malade... dont il n'y a aucune trace dans les plans suivants.)
Au niveau technique, c'est globalement du bon boulot. Eastwood filme très bien l'intérieur, celui des garages, des bars et des restaurants. Les scènes de transport font respirer l'intrigue : elles montrent le fourgon d'Earl traversant des paysages parfois superbes et elles baignent dans une musique nostalgique et entraînante... qui séduit même le duo de nervis chargé d'accompagner le héros lorsque le chargement est particulièrement important.
Comme souvent chez Clint, le sous-texte est fourni. On sent l'homme un peu perturbé par le monde tel qu'il est devenu, avec ses contemporains obnubilé par internet, plus attentifs à leur téléphone portable qu'à leurs proches. A travers Earl, il est possible que ce soit Eastwood qui s'exprime, notamment lorsqu'il est question de l'importance de la famille. (La fille d'Earl est interprétée par une certaine Alison Eastwood !) Mais je pense qu'il faut prendre un peu de recul vis-à-vis de cela. Le film nous montre quand même un vieil homme qui a peur de finir sa vie seul, d'où son attachement à ses relations sociales (le club d"horticulteurs jadis, le bar de vétérans depuis toujours). Et si cet ex-mari fait de belles déclarations à son épouse, il n'en batifole pas moins avec des prostituées quand ses poches se remplissent d'argent (et profite des "hôtesses" de la villa du chef du Cartel).
Ce n'est pas aussi fort que Gran Torino, mais c'est un bon Eastwood, nourri de la pâte humaine qu'il sait si bien malaxer.
12:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 01 février 2019
Glass
Pour des raisons au moins autant économiques qu'artistiques, près de vingt ans après Incassable (le thriller le plus neurasthénique jamais produit par Hollywood), M. Night Shyamalan a écrit une suite à ce film et au récent Split, reprenant le maximum de comédiens présents dans les précédentes histoires.
Le début s'adresse plutôt aux spectateurs qui n'auraient pas vu celles-ci, ou qui en auraient en partie oublié le contenu. On prend plaisir à voir le Superviseur (Bruce Willis, très grisonnant) donner une bonne leçon à un duo de jeunes cons.
On change d'ambiance quand le trio d'hommes exceptionnels (ou supposés tels) se retrouve enfermé dans un hôpital psychiatrique un peu particulier, où tout semble conçu pour pouvoir les contrôler... sauf que, dès le début, on comprend que les infirmiers ne sont ni très éthiques ni très rigoureux dans leur travail. Si vous ajoutez à cela des mesures de protection dont on devine qu'elles seront tôt ou tard déjouées par les trois patients très spéciaux, vous comprendrez que je n'ai pas été extrêmement emballé par le début, en dépit de la petite baston entre le Superviseur et la Bête.
Fort heureusement, les acteurs font le job. Bruce Willis a encore une belle présence, même si le poids des ans se fait sentir. James McAvoy en fait trop dans la gestion de ses personnalités multiples... mais je pense que c'est ce qu'on attendait de lui. Pour moi, le plus impressionnant est Samuel L Jackson. Il faut dire qu'il est bien servi par le scénario, qui exploite à merveille ses aptitudes à la manipulation. Par contre, je trouve les principaux personnages féminins moins bien campés : celui de la psychologue et celui de Casey (déjà vue dans Split), pas plus convaincante que son partenaire dans leur numéro de "la Belle et la Bête".
Dès que le projet d'évasion prend forme, on est saisi. J'ai particulièrement aimé le passage au cours duquel la psy tente de convaincre ses trois pensionnaires qu'ils se bourrent le mou et que leur supposés super-pouvoirs ne sont qu'un effet de leur imagination, tout pouvant s'expliquer rationnellement. On sent la malice de Shyamalan, qui déconstruit ce sur quoi les deux films précédents étaient bâtis.
On s'attend évidemment à des surprises, à des retournements. La dernière demi-heure en est nourrie... un peu trop même. La meilleure idée consiste sans doute à faire tout partir de l'accident de train présenté dans Incassable (qu'il vaut mieux avoir revu avant). Le personnage masculin assis ci-dessous (pas très loin de David Dunn) figure dans les deux films (furtivement dans le premier). La découverte de son identité est l'une des clés de l'intrigue.
On se doute aussi que la psy cache son jeu, mais le coup du complot n'est pas très crédible. Shyamalan conclut sur une ultime pirouette, qui laisse ouverte la possibilité d'une suite...
PS
Comme dans Incassable, le réalisateur nous gratifie d'un caméo, dans la boutique gérée par David Dunn et son fils. Cette scène fait écho à une autre, se déroulant à l'entrée d'un stade, des années auparavant :
23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Glass
Pour des raisons au moins autant économiques qu'artistiques, près de vingt ans après Incassable (le thriller le plus neurasthénique jamais produit par Hollywood), M. Night Shyamalan a écrit une suite à ce film et au récent Split, reprenant le maximum de comédiens présents dans les précédentes histoires.
Le début s'adresse plutôt aux spectateurs qui n'auraient pas vu celles-ci, ou qui en auraient en partie oublié le contenu. On prend plaisir à voir le Superviseur (Bruce Willis, très grisonnant) donner une bonne leçon à un duo de jeunes cons.
On change d'ambiance quand le trio d'hommes exceptionnels (ou supposés tels) se retrouve enfermé dans un hôpital psychiatrique un peu particulier, où tout semble conçu pour pouvoir les contrôler... sauf que, dès le début, on comprend que les infirmiers ne sont ni très éthiques ni très rigoureux dans leur travail. Si vous ajoutez à cela des mesures de protection dont on devine qu'elles seront tôt ou tard déjouées par les trois patients très spéciaux, vous comprendrez que je n'ai pas été extrêmement emballé par le début, en dépit de la petite baston entre le Superviseur et la Bête.
Fort heureusement, les acteurs font le job. Bruce Willis a encore une belle présence, même si le poids des ans se fait sentir. James McAvoy en fait trop dans la gestion de ses personnalités multiples... mais je pense que c'est ce qu'on attendait de lui. Pour moi, le plus impressionnant est Samuel L Jackson. Il faut dire qu'il est bien servi par le scénario, qui exploite à merveille ses aptitudes à la manipulation. Par contre, je trouve les principaux personnages féminins moins bien campés : celui de la psychologue et celui de Casey (déjà vue dans Split), pas plus convaincante que son partenaire dans leur numéro de "la Belle et la Bête".
Dès que le projet d'évasion prend forme, on est saisi. J'ai particulièrement aimé le passage au cours duquel la psy tente de convaincre ses trois pensionnaires qu'ils se bourrent le mou et que leur supposés super-pouvoirs ne sont qu'un effet de leur imagination, tout pouvant s'expliquer rationnellement. On sent la malice de Shyamalan, qui déconstruit ce sur quoi les deux films précédents étaient bâtis.
On s'attend évidemment à des surprises, à des retournements. La dernière demi-heure en est nourrie... un peu trop même. La meilleure idée consiste sans doute à faire tout partir de l'accident de train présenté dans Incassable (qu'il vaut mieux avoir revu avant). Le personnage masculin assis ci-dessous (pas très loin de David Dunn) figure dans les deux films (furtivement dans le premier). La découverte de son identité est l'une des clés de l'intrigue.
On se doute aussi que la psy cache son jeu, mais le coup du complot n'est pas très crédible. Shyamalan conclut sur une ultime pirouette, qui laisse ouverte la possibilité d'une suite...
PS
Comme dans Incassable, le réalisateur nous gratifie d'un caméo, dans la boutique gérée par David Dunn et son fils. Cette scène fait écho à une autre, se déroulant à l'entrée d'un stade, des années auparavant :
23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 30 janvier 2019
Minuscule 2
Quatre ans après la sortie de La Vallée des fourmis perdues, les petites bestioles sont de retour pour des aventures exotiques, intitulées : "Les mandibules du bout du monde". Cela démarre pourtant en France métropolitaine, dans le Mercantour, où l'on découvre une famille de coccinelles en train de constituer un stock en prévision de leur période d'hibernation. Quand c'est nécessaire, maman coccinelle vient donner un coup de patte à son enfant, embêté par de vilaines mouches.
Pas très loin de là, un entrepôt est l'objet de bien des convoitises. On y retrouve une fourmi noire audacieuse, mais qui doit faire face à ses plus redoutables adversaires : les ignobles fourmis rouges. A l'issue d'une séquence particulièrement rocambolesque, une partie de ce petit monde finit dispersée dans plusieurs colis postés aux quatre coins de la planète.
C'est en Guadeloupe qu'atterrissent deux des coccinelles (le papa et le fiston, semble-t-il). Provisoirement séparés, ils vont devoir affronter de redoutables périls, comme les plantes carnivores, les mantes religieuses... et une drôle d'araignée poilue, dotée du comportement d'un jeune chien fou !
Les coccinelles se font aussi des amis. Le fiston va même connaître l'amour, au sein d'une communauté de congénères tropicaux très curieux. Pendant ce temps-là, deux personnages restés en France décident de partir à la recherche des héros : la fourmi entrepreneuse... et l'araignée (noire) muette, particulièrement imaginative... et mélomane.
C'est sans dialogue... et l'on comprend tout (si l'on est un adulte ; je déconseille le film aux tout-petits, qui risquent de vite décrocher). L'ambiance sonore est chouette (avec d'excellents bruitages), même si j'ai trouvé un peu envahissante la musique d'accompagnement (très élaborée, elle est de Mathieu Lamboley, qui a récemment oeuvré sur Le Retour du héros).
L'intrigue ménage pas mal de rebondissements. On sent ici ou là les influences cinématographiques. L'une des plus belles séquences (dans la tanière des chenilles urticantes) semble d'ailleurs inspirée de Star Wars. Lesdites chenilles vont se révéler particulièrement utiles aux héros, qui veulent empêcher un méchant promoteur de saccager une zone naturelle magnifique. Il y a donc aussi une morale à cette histoire, qui met en valeur l'entraide et l'amitié.
On passe un bon moment, sur un rythme toutefois un peu lent, pour qui connaît les petits films télévisés qui ont révélé cet univers si particulier.
22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Minuscule 2
Quatre ans après la sortie de La Vallée des fourmis perdues, les petites bestioles sont de retour pour des aventures exotiques, intitulées : "Les mandibules du bout du monde". Cela démarre pourtant en France métropolitaine, dans le Mercantour, où l'on découvre une famille de coccinelles en train de constituer un stock en prévision de leur période d'hibernation. Quand c'est nécessaire, maman coccinelle vient donner un coup de patte à son enfant, embêté par de vilaines mouches.
Pas très loin de là, un entrepôt est l'objet de bien des convoitises. On y retrouve une fourmi noire audacieuse, mais qui doit faire face à ses plus redoutables adversaires : les ignobles fourmis rouges. A l'issue d'une séquence particulièrement rocambolesque, une partie de ce petit monde finit dispersée dans plusieurs colis postés aux quatre coins de la planète.
C'est en Guadeloupe qu'atterrissent deux des coccinelles (le papa et le fiston, semble-t-il). Provisoirement séparés, ils vont devoir affronter de redoutables périls, comme les plantes carnivores, les mantes religieuses... et une drôle d'araignée poilue, dotée du comportement d'un jeune chien fou !
Les coccinelles se font aussi des amis. Le fiston va même connaître l'amour, au sein d'une communauté de congénères tropicaux très curieux. Pendant ce temps-là, deux personnages restés en France décident de partir à la recherche des héros : la fourmi entrepreneuse... et l'araignée (noire) muette, particulièrement imaginative... et mélomane.
C'est sans dialogue... et l'on comprend tout (si l'on est un adulte ; je déconseille le film aux tout-petits, qui risquent de vite décrocher). L'ambiance sonore est chouette (avec d'excellents bruitages), même si j'ai trouvé un peu envahissante la musique d'accompagnement (très élaborée, elle est de Mathieu Lamboley, qui a récemment oeuvré sur Le Retour du héros).
L'intrigue ménage pas mal de rebondissements. On sent ici ou là les influences cinématographiques. L'une des plus belles séquences (dans la tanière des chenilles urticantes) semble d'ailleurs inspirée de Star Wars. Lesdites chenilles vont se révéler particulièrement utiles aux héros, qui veulent empêcher un méchant promoteur de saccager une zone naturelle magnifique. Il y a donc aussi une morale à cette histoire, qui met en valeur l'entraide et l'amitié.
On passe un bon moment, sur un rythme toutefois un peu lent, pour qui connaît les petits films télévisés qui ont révélé cet univers si particulier.
22:57 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 19 janvier 2019
Holy Lands
L'écrivaine Amanda Sthers a adapté son livre Les Terres Saintes. L'action alterne entre Les Etats-Unis (un New-York très boboïsant), l'Europe (brièvement) et Israël (autour de Nazareth, Tel Aviv-Jaffa et l'agglomération de Jérusalem).
C'est cette partie de l'histoire qui m'a incité à aller voir le film. Harry Rosenmerck, un Américain à la retraite (James Caan, en petite forme) a tout laissé tomber (logement, famille, amis...) pour partir élever des porcs en Israël. Il y rencontre une vive opposition de la part de juifs religieux... et de chrétiens fanatiques, qui veulent mettre la main sur son exploitation, située à un endroit où aurait vécu Jésus.
Les tensions montent d'un degré quand on apprend que l'apprenti-éleveur garde l'un des porcelets... chez lui ! Un jour, l'une des truies, pourvue de douze tétines, a donné naissance à... 13 porcelets. Le plus faible d'entre eux risque de rapidement succomber, ne parvenant pas à se nourrir seul. Notre héros décide de le garder et d'en faire son animal de compagnie. Le voilà en train de nourrir au biberon un goret (une gorette, en réalité) assez docile, qui semble raffoler du lait ! (Même si le contexte est différent, les cinéphiles penseront au Cochon de Gaza.)
Loin, très loin de là, la famille de Harry se débat dans ses troubles existentiels. Le fils aîné est un metteur en scène de théâtre à la mode, qui cherche à adopter un enfant avec son compagnon. Il règle ses comptes familiaux (en particulier avec son père, qui ne communique plus avec lui) dans sa dernière pièce, dont le peu que l'on voit laisse supposer qu'elle est particulièrement intellichiante...
Sa soeur cadette, bien qu'âgée de 34 ans, vit toujours aux crochets de ses parents. Elle est interprétée par une sorte de mannequin qu'on a habillée comme jadis Julia Roberts, quand elle tournait des comédies sentimentales. C'est cette Annabelle qui va tenter de retisser les liens familiaux, se rendant chez sa mère, son frère, puis en Israël, où, à l'issue d'une alerte aux roquettes, sur une plage, elle va fougueusement copuler avec un jeune homme qu'elle vient à peine de rencontrer, dans une ambiance de contrejour esthétisante...
Et la mère dans tout ça ? Elle est interprétée par Rosanna Arquette, qui semble sortir d'une clinique de chirurgie esthétique. (Mais cela semble dans le ton du personnage.) On ne va pas trop l'accabler, puisqu'on apprend rapidement qu'elle développe un cancer incurable. C'est l'occasion pour les spectateurs Frenchies de découvrir que Patrick Bruel participe à cette drôle d'aventure (tournée en anglais et produite par Studiocanal). Il y joue le médecin ami de la famille. (J'ai appris après coup que c'est l'ex de la réalisatrice, qui, dans un premier temps, avait pensé à lui pour jouer le rabbin.)
Vous avez compris que je n'ai pas été emballé par ce produit cultureux... sauf quand l'action se déroule en Israël. Là, c'est (en général) bien réalisé, avec une superbe lumière en extérieur. Les relations entre le héros et le rabbin Moshe Cattan (interprété par Tom Hollander) sont souvent piquantes, parfois émouvantes. Mais cela ne suffit pas à faire de la vision de ce film un plaisir intégral.
12:26 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Holy Lands
L'écrivaine Amanda Sthers a adapté son livre Les Terres Saintes. L'action alterne entre Les Etats-Unis (un New-York très boboïsant), l'Europe (brièvement) et Israël (autour de Nazareth, Tel Aviv-Jaffa et l'agglomération de Jérusalem).
C'est cette partie de l'histoire qui m'a incité à aller voir le film. Harry Rosenmerck, un Américain à la retraite (James Caan, en petite forme) a tout laissé tomber (logement, famille, amis...) pour partir élever des porcs en Israël. Il y rencontre une vive opposition de la part de juifs religieux... et de chrétiens fanatiques, qui veulent mettre la main sur son exploitation, située à un endroit où aurait vécu Jésus.
Les tensions montent d'un degré quand on apprend que l'apprenti-éleveur garde l'un des porcelets... chez lui ! Un jour, l'une des truies, pourvue de douze tétines, a donné naissance à... 13 porcelets. Le plus faible d'entre eux risque de rapidement succomber, ne parvenant pas à se nourrir seul. Notre héros décide de le garder et d'en faire son animal de compagnie. Le voilà en train de nourrir au biberon un goret (une gorette, en réalité) assez docile, qui semble raffoler du lait ! (Même si le contexte est différent, les cinéphiles penseront au Cochon de Gaza.)
Loin, très loin de là, la famille de Harry se débat dans ses troubles existentiels. Le fils aîné est un metteur en scène de théâtre à la mode, qui cherche à adopter un enfant avec son compagnon. Il règle ses comptes familiaux (en particulier avec son père, qui ne communique plus avec lui) dans sa dernière pièce, dont le peu que l'on voit laisse supposer qu'elle est particulièrement intellichiante...
Sa soeur cadette, bien qu'âgée de 34 ans, vit toujours aux crochets de ses parents. Elle est interprétée par une sorte de mannequin qu'on a habillée comme jadis Julia Roberts, quand elle tournait des comédies sentimentales. C'est cette Annabelle qui va tenter de retisser les liens familiaux, se rendant chez sa mère, son frère, puis en Israël, où, à l'issue d'une alerte aux roquettes, sur une plage, elle va fougueusement copuler avec un jeune homme qu'elle vient à peine de rencontrer, dans une ambiance de contrejour esthétisante...
Et la mère dans tout ça ? Elle est interprétée par Rosanna Arquette, qui semble sortir d'une clinique de chirurgie esthétique. (Mais cela semble dans le ton du personnage.) On ne va pas trop l'accabler, puisqu'on apprend rapidement qu'elle développe un cancer incurable. C'est l'occasion pour les spectateurs Frenchies de découvrir que Patrick Bruel participe à cette drôle d'aventure (tournée en anglais et produite par Studiocanal). Il y joue le médecin ami de la famille. (J'ai appris après coup que c'est l'ex de la réalisatrice, qui, dans un premier temps, avait pensé à lui pour jouer le rabbin.)
Vous avez compris que je n'ai pas été emballé par ce produit cultureux... sauf quand l'action se déroule en Israël. Là, c'est (en général) bien réalisé, avec une superbe lumière en extérieur. Les relations entre le héros et le rabbin Moshe Cattan (interprété par Tom Hollander) sont souvent piquantes, parfois émouvantes. Mais cela ne suffit pas à faire de la vision de ce film un plaisir intégral.
12:26 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 16 janvier 2019
Edmond
Attention, ce film n'est pas un biopic d'Edmond Rostand, mais le récit (un peu romancé) des circonstances dans lesquelles la pièce Cyrano de Bergerac a été écrite et montée, à Paris, à la toute fin du XIXe siècle. La capitale tchèque française forme l'écrin (numérique) de cette histoire, avec un petit côté carte postale.
C'est ce qui m'a fait redouter le pire, au début, d'autant que j'ai un problème avec l'acteur principal, Thomas Solivérès, qui incarne l'écrivain avec une fadeur horripilante. (Il était meilleur dans Sales Gosses.) Fort heureusement, il est entouré d'une brochette de professionnels très compétents, au premier rang desquels je place Olivier Gourmet, excellent en Constant Coquelin, l'acteur charismatique et vibrionnant qui a créé le rôle de Cyrano en 1897. Du côté féminin, j'ai aimé les prestations de Mathilde Seigner en actrice virago et de Lucie Boujenah, qui prouve qu'on peut être "nièce de" et avoir du talent.
Autour d'eux gravite une quantité impressionnante de visages connus, de Clémentine Célarié à Dominique Pinon, en passant par Olivier Lejeune, Lionel Abelanski, Dominique Besnehard et Bernard Blancan. Les amateurs de comédies policières reconnaîtront deux acteurs des Petits Meurtres d'Agatha Christie et le commissaire de Profilage, très bon en tenancier de bar cultivé. Je place à part Simon Abkarian et Marc Andreoni, les producteurs corses du spectacle, dont je laisse à chacun le plaisir de découvrir la principale de source de revenus... Le soir de la Première, assis dans une petite loge en hauteur, ils m'ont fait un peu penser aux deux petits vieux acariâtres du Muppet Show (Statler et Waldorf)... en plus gentils.
Après un début poussif, l'histoire démarre quand Rostand rencontre Coquelin. La première séquence au Moulin Rouge est aussi très réussie. A partir de là, on ne s'ennuie plus. Le scénario fonctionne sur le principe de la mise en abyme : l'intrigue de la pièce de théâtre est un décalque de ce que vit l'auteur. De surcroît, comme l'époque est à la comédie de boulevard (avec notamment Georges Feydeau), l'histoire prend parfois la forme d'une farce, avec personnages hauts en couleur, répliques qui fusent et portes qui claquent.
Le succès de la pièce, hautement improbable au départ, nous est conté dans le détail, l'apothéose se situant lors de la Première, qui s'achève sur le décès du héros (Cyrano). Cette scène est tellement réussie que, pour paraphraser Sacha Guitry, on pourrait dire que le silence qui succède au texte d'Edmond Rostand est encore d'Edmond Rostand.
P.S.
Ne partez pas trop vite, à la fin. Pendant que se déroule le générique, on nous propose plusieurs extraits de pièces et de films, de l'époque de Coquelin à celle de Depardieu, à chaque fois avec un Cyrano différent. On découvre ensuite des photographies d'époque, montrant le vrai visage des personnages qui viennent de quitter l'écran.
23:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Edmond
Attention, ce film n'est pas un biopic d'Edmond Rostand, mais le récit (un peu romancé) des circonstances dans lesquelles la pièce Cyrano de Bergerac a été écrite et montée, à Paris, à la toute fin du XIXe siècle. La capitale tchèque française forme l'écrin (numérique) de cette histoire, avec un petit côté carte postale.
C'est ce qui m'a fait redouter le pire, au début, d'autant que j'ai un problème avec l'acteur principal, Thomas Solivérès, qui incarne l'écrivain avec une fadeur horripilante. (Il était meilleur dans Sales Gosses.) Fort heureusement, il est entouré d'une brochette de professionnels très compétents, au premier rang desquels je place Olivier Gourmet, excellent en Constant Coquelin, l'acteur charismatique et vibrionnant qui a créé le rôle de Cyrano en 1897. Du côté féminin, j'ai aimé les prestations de Mathilde Seigner en actrice virago et de Lucie Boujenah, qui prouve qu'on peut être "nièce de" et avoir du talent.
Autour d'eux gravite une quantité impressionnante de visages connus, de Clémentine Célarié à Dominique Pinon, en passant par Olivier Lejeune, Lionel Abelanski, Dominique Besnehard et Bernard Blancan. Les amateurs de comédies policières reconnaîtront deux acteurs des Petits Meurtres d'Agatha Christie et le commissaire de Profilage, très bon en tenancier de bar cultivé. Je place à part Simon Abkarian et Marc Andreoni, les producteurs corses du spectacle, dont je laisse à chacun le plaisir de découvrir la principale de source de revenus... Le soir de la Première, assis dans une petite loge en hauteur, ils m'ont fait un peu penser aux deux petits vieux acariâtres du Muppet Show (Statler et Waldorf)... en plus gentils.
Après un début poussif, l'histoire démarre quand Rostand rencontre Coquelin. La première séquence au Moulin Rouge est aussi très réussie. A partir de là, on ne s'ennuie plus. Le scénario fonctionne sur le principe de la mise en abyme : l'intrigue de la pièce de théâtre est un décalque de ce que vit l'auteur. De surcroît, comme l'époque est à la comédie de boulevard (avec notamment Georges Feydeau), l'histoire prend parfois la forme d'une farce, avec personnages hauts en couleur, répliques qui fusent et portes qui claquent.
Le succès de la pièce, hautement improbable au départ, nous est conté dans le détail, l'apothéose se situant lors de la Première, qui s'achève sur le décès du héros (Cyrano). Cette scène est tellement réussie que, pour paraphraser Sacha Guitry, on pourrait dire que le silence qui succède au texte d'Edmond Rostand est encore d'Edmond Rostand.
P.S.
Ne partez pas trop vite, à la fin. Pendant que se déroule le générique, on nous propose plusieurs extraits de pièces et de films, de l'époque de Coquelin à celle de Depardieu, à chaque fois avec un Cyrano différent. On découvre ensuite des photographies d'époque, montrant le vrai visage des personnages qui viennent de quitter l'écran.
23:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 12 janvier 2019
L'Heure de la sortie
Il y a deux ans et demi, Sébastien Marnier s'était fait remarquer par un excellent petit polar, sorti en douce, en plein été : Irréprochable (avec Marina Foïs). Aujourd'hui, il récidive avec Laurent Lafitte dans le rôle d'un enseignant remplaçant, plutôt habitué aux établissements situés en ZEP, et qui débarque dans un lycée privé huppé, où, de surcroît, on lui confie une classe expérimentale, à effectif réduit, constituée d'E.I.P. (élèves intellectuellement précoces).
Une fois le choc de la scène inaugurale passé, c'est plutôt le rire qui l'emporte, au fur et à mesure que le prof de lettres découvre les particularités de son public, auquel il va tenter de s'adapter. Une fois de plus, Lafitte est excellent (dans un rôle très différent de ceux qu'il a interprétés dans Au revoir là haut et Paul Sanchez est revenu !). Il est bien épaulé par une Emmanuelle Bercot limite foldingue (en prof de chant) et une brochette de jeunes acteurs épatants. Parmi ceux-ci, je distingue Luana Bajrami, qui incarne Apolline, sorte de tête pensante d'un noyau dur de surdoués, d'une surprenante maturité. La jeune actrice réussit à exprimer à la fois l'assurance, l'arrogance, l'intelligence, l'indifférence... et un poil de vice. (Elle n'est de plus pas dénuée de charme.)
Le réalisateur crée une ambiance oppressante en partant de plans apparemment anodins, où le surgissement d'un détail, accompagné d'une musique décalée, change le sens d'une scène.
L'enseignant remplaçant se fait un peu déstabiliser par ses nouveaux élèves. De son côté, il se met à espionner le noyau dur mené par Apolline. Que diable partent-ils faire ensemble le week-end ? Quel secret partagent-ils ? Sont-ils juste des ados qui testent leurs limites ? Des élèves difficiles à cerner, tant leur précocité est hors norme ? Ou bien leur comportement cache-t-il quelque chose de plus grave ?
C'est une très bonne surprise, qui se conclut par une scène totalement inattendue... qui a suscité le débat entre moi et l'amie avec laquelle j'ai vu ce film. Elle a une interprétation plutôt optimiste de cette fin, tandis que j'y vois quelque chose de plus noir, voire de machiavélique. Mais je laisse à chacun le loisir de se forger son opinion !
23:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
L'Heure de la sortie
Il y a deux ans et demi, Sébastien Marnier s'était fait remarquer par un excellent petit polar, sorti en douce, en plein été : Irréprochable (avec Marina Foïs). Aujourd'hui, il récidive avec Laurent Lafitte dans le rôle d'un enseignant remplaçant, plutôt habitué aux établissements situés en ZEP, et qui débarque dans un lycée privé huppé, où, de surcroît, on lui confie une classe expérimentale, à effectif réduit, constituée d'E.I.P. (élèves intellectuellement précoces).
Une fois le choc de la scène inaugurale passé, c'est plutôt le rire qui l'emporte, au fur et à mesure que le prof de lettres découvre les particularités de son public, auquel il va tenter de s'adapter. Une fois de plus, Lafitte est excellent (dans un rôle très différent de ceux qu'il a interprétés dans Au revoir là haut et Paul Sanchez est revenu !). Il est bien épaulé par une Emmanuelle Bercot limite foldingue (en prof de chant) et une brochette de jeunes acteurs épatants. Parmi ceux-ci, je distingue Luana Bajrami, qui incarne Apolline, sorte de tête pensante d'un noyau dur de surdoués, d'une surprenante maturité. La jeune actrice réussit à exprimer à la fois l'assurance, l'arrogance, l'intelligence, l'indifférence... et un poil de vice. (Elle n'est de plus pas dénuée de charme.)
Le réalisateur crée une ambiance oppressante en partant de plans apparemment anodins, où le surgissement d'un détail, accompagné d'une musique décalée, change le sens d'une scène.
L'enseignant remplaçant se fait un peu déstabiliser par ses nouveaux élèves. De son côté, il se met à espionner le noyau dur mené par Apolline. Que diable partent-ils faire ensemble le week-end ? Quel secret partagent-ils ? Sont-ils juste des ados qui testent leurs limites ? Des élèves difficiles à cerner, tant leur précocité est hors norme ? Ou bien leur comportement cache-t-il quelque chose de plus grave ?
C'est une très bonne surprise, qui se conclut par une scène totalement inattendue... qui a suscité le débat entre moi et l'amie avec laquelle j'ai vu ce film. Elle a une interprétation plutôt optimiste de cette fin, tandis que j'y vois quelque chose de plus noir, voire de machiavélique. Mais je laisse à chacun le loisir de se forger son opinion !
23:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 09 janvier 2019
Never-Ending Man : Hayao Miyazaki
Ce court (1h10) documentaire japonais est consacré à l'une des grandes figures du cinéma d'animation, qui a fortement contribué à renouveler le genre et à l'élever au rang d'art majeur. Nombre de cinéphiles gardent des souvenirs émus de Nausicaä, du Château dans le ciel, de Princesse Mononoké, du Voyage de Chihiro, entre autres. Ses dernières œuvres sont Ponyo sur la falaise et Le Vent se lève, qui devait être l'ultime, en 2013.
C'est donc un "jeune" retraité (de plus de 75 balais, quand même) que le réalisateur suit, caméra numérique au poing. Signalons tout de suite que l'image n'est pas d'une qualité exceptionnelle et, surtout, que le son est parfois épouvantable. Mais c'est pour mieux connaître le Maître que l'on va voir ce film.
On découvre un homme passionné par son art, qui ne peut se résoudre à raccrocher. J'ai beaucoup aimé les scènes qui le montrent en train de dessiner. Parfois, un extrait de l'un de ses films est placé en contrepoint. On le suit aussi dans sa vie quotidienne, dans sa maison, devant laquelle est garée une antique 2CV ! On ne verra toutefois pas son épouse, ni de détail scabreux. L'homme est pudique, resté modeste malgré la reconnaissance internationale.
Par contre, dans le boulot, il peut se montrer cassant. Exigeant avec les autres comme avec lui-même, il n'aime ni l'approximation, ni le travail bâclé. Mais, découragé par la somme d'efforts que nécessite la création à la main d'un long-métrage animé, Miyazaki expérimente l'outil numérique, en compagnie d'une nouvelle équipe de jeunes (l'ancienne ayant été dissoute après son dernier film), qui ne témoigne pas à son égard d'un respect particulier. J'ai eu l'impression que, certes, ils reconnaissaient l'apport du grand ancien, mais qu'ils le considéraient peut-être comme faisant partie d'un monde révolu. Les étapes de la création du court-métrage Boro la chenille n'en sont pas moins passionnantes à suivre.
Ce n'est pas trahir un grand secret que de révéler que Miyazaki n'a pas été conquis par l'animation numérique. Il devient même franchement hostile quand il apprend qu'une équipe japonaise, spécialiste d'intelligence artificielle, prévoit de créer un programme qui permettra de remplacer complètement les humains ! Du coup, malgré son grand âge, malgré l'affaiblissement de ses capacités intellectuelles et physiques (ce dont il est conscient), malgré le décès de certaines de ses collaboratrices historiques (une dessinatrice avec laquelle il a travaillé pendant quarante ans ainsi que sa coloriste attitrée), Miyazaki décide de se lancer dans un ultime projet (dont l'aboutissement est pour l'instant prévu en 2022).
Ce n'est pas un "beau" film sur le plan esthétique, mais il intéressera les fans de manga et d'animation de qualité.
22:55 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Never-Ending Man : Hayao Miyazaki
Ce court (1h10) documentaire japonais est consacré à l'une des grandes figures du cinéma d'animation, qui a fortement contribué à renouveler le genre et à l'élever au rang d'art majeur. Nombre de cinéphiles gardent des souvenirs émus de Nausicaä, du Château dans le ciel, de Princesse Mononoké, du Voyage de Chihiro, entre autres. Ses dernières œuvres sont Ponyo sur la falaise et Le Vent se lève, qui devait être l'ultime, en 2013.
C'est donc un "jeune" retraité (de plus de 75 balais, quand même) que le réalisateur suit, caméra numérique au poing. Signalons tout de suite que l'image n'est pas d'une qualité exceptionnelle et, surtout, que le son est parfois épouvantable. Mais c'est pour mieux connaître le Maître que l'on va voir ce film.
On découvre un homme passionné par son art, qui ne peut se résoudre à raccrocher. J'ai beaucoup aimé les scènes qui le montrent en train de dessiner. Parfois, un extrait de l'un de ses films est placé en contrepoint. On le suit aussi dans sa vie quotidienne, dans sa maison, devant laquelle est garée une antique 2CV ! On ne verra toutefois pas son épouse, ni de détail scabreux. L'homme est pudique, resté modeste malgré la reconnaissance internationale.
Par contre, dans le boulot, il peut se montrer cassant. Exigeant avec les autres comme avec lui-même, il n'aime ni l'approximation, ni le travail bâclé. Mais, découragé par la somme d'efforts que nécessite la création à la main d'un long-métrage animé, Miyazaki expérimente l'outil numérique, en compagnie d'une nouvelle équipe de jeunes (l'ancienne ayant été dissoute après son dernier film), qui ne témoigne pas à son égard d'un respect particulier. J'ai eu l'impression que, certes, ils reconnaissaient l'apport du grand ancien, mais qu'ils le considéraient peut-être comme faisant partie d'un monde révolu. Les étapes de la création du court-métrage Boro la chenille n'en sont pas moins passionnantes à suivre.
Ce n'est pas trahir un grand secret que de révéler que Miyazaki n'a pas été conquis par l'animation numérique. Il devient même franchement hostile quand il apprend qu'une équipe japonaise, spécialiste d'intelligence artificielle, prévoit de créer un programme qui permettra de remplacer complètement les humains ! Du coup, malgré son grand âge, malgré l'affaiblissement de ses capacités intellectuelles et physiques (ce dont il est conscient), malgré le décès de certaines de ses collaboratrices historiques (une dessinatrice avec laquelle il a travaillé pendant quarante ans ainsi que sa coloriste attitrée), Miyazaki décide de se lancer dans un ultime projet (dont l'aboutissement est pour l'instant prévu en 2022).
Ce n'est pas un "beau" film sur le plan esthétique, mais il intéressera les fans de manga et d'animation de qualité.
22:55 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 07 janvier 2019
Baisse des entrées au cinéma de Rodez
A l'heure des bilans de l'année 2018, on constate qu'à Rodez, le passage de Cap'Cinéma à CGR n'a pas enrayé la baisse du nombre d'entrées. Le quotidien Centre Presse évoque une diminution de 7 %, à 302 000 entrées en 2018. Cela implique qu'en 2017, le cinéma de Rodez ait vendu entre 324 000 et 325 000 tickets. Or, cela ne concorde pas avec les chiffres publiés l'an dernier, puisque le même quotidien évoquait 318 000 entrées, tandis que, dans La Dépêche du Midi, il était question de seulement 315 000. Cherchez l'erreur... (Il est possible que l'un des écarts soit dû au choix de prendre en compte -ou pas- les entrées gratuites.) En complétant avec les 315 000 entrées de 2014 (première année complète d'existence du Multiplexe)et les 317 979 et 332 559 de 2015 et 2016, on peut dégager une évolution.
De son inauguration, en octobre 2013, à la fin de 2016, le multiplexe Cap'Cinéma a rencontré un succès grandissant, auquel a succédé une indéniable baisse (la dernière plutôt de l'ordre de 4-5 %, conforme à l'évolution nationale), ce qui place l'année 2018 à la dernière place du palmarès des entrées.
Dans l'article de Centre Presse, une série de raisons plausibles est donnée, auxquelles il faudrait ajouter l'une des récriminations de certains spectateurs : l'augmentation du prix. Quelle que soit la formule ou le tarif retenu, il y a eu hausse. Pour les spectateurs qui ne peuvent acquérir un abonnement par l'intermédiaire d'un comité d'entreprise, l'addition peut se révéler salée en cas de sortie familiale. Pour les cinéphiles réguliers, il reste la possibilité d'acquérir la carte CGR avec le chargement le plus onéreux (qui donne accès au coût unitaire place le moins élevé), à croiser avec le tarif réduit du lundi et du jeudi (qui permet d'accumuler les points sur son compte). Ou alors, il faut se rabattre sur les séances de 11 heures... le week-end seulement pour ceux qui travaillent le reste de la semaine.
Il semble aussi que la stratégie de CGR ne porte pas ses fruits. Par rapport à l'époque de Cap'Cinéma, il a été décidé de programmer moins de films sur l'année, mais de les exposer davantage. Il y a aussi la tendance à favoriser, en première semaine, la version 3D (la plus rémunératrice pour le cinéma) des grosses productions, reléguant temporairement les séances 2D le matin et tard le soir. Résultat : en deuxième voire troisième semaine, certains blockbusters (comme Aquaman) font le plein en séance 2D, alors qu'ils sont en perte de vitesse au niveau national. Les séances en 3D ont tendance à vite disparaître de la grille.
Voilà qui nous mène à un autre critère d'appréciation du succès d'un complexe cinématographique : l'analyse de l'ensemble de ses recettes, incluant la vente de lunettes 3D (et le surcoût des séances associées) et, surtout, les profits tirés du rayon confiserie. Si le seuil de rentabilité officiel du multiplexe est fixé à 300 000 entrées (ouf !), un très bon rendement des "produits dérivés" peut le faire baisser. Mais ce sont là des informations qui restent confidentielles...
22:41 Publié dans Cinéma, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, actualité