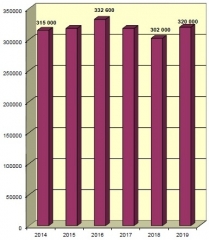lundi, 10 février 2020
Underwater
Il n'y a pas d'erreur dans la graphie du titre. Il ne s'agit pas de "Under water" (Sous l'eau), mais de "Underwater" (L'Eau de dessous). En perforant le plancher océanique de la fosse des Mariannes, une plate-forme pétrolière de dernière génération semble avoir libéré des forces inconnues... mais, pas un mégalodon, cette fois-ci.
On commence par découvrir l'une des protagonistes. C'est une jeune femme aux cheveux courts, mince et athlétique, ingénieure, blanche. (On pense évidemment à la Ripley d'Alien.) Comme elle est incarnée par Kristen Stewart, on se dit qu'elle risque d'échapper à pas mal de dangers. (La production n'a sans doute pas déboursé une tonne de blé pour voir mourir la vedette au bout de vingt minutes...) En plus, c'est une fille sympa, prête à aider son prochain... et qui ne tue pas l'araignée qui sort du lavabo, à plusieurs milliers de mètres de profondeur.
Cette station ultramoderne aurait-elle des défauts de conception ? En tout cas, dans les couloirs, les néons clignotent et on remarque une fuite d'eau. Décidément, les plombiers ne sont plus ce qu'ils étaient, y compris chez Oncle Sam !
Le truc flippant supplémentaire est le drôle de bruit qu'on finit par entendre... pas vraiment un bruit de tôle froissée ou tordue... quelque chose d'impossible à identifier. Pas le temps d'y réfléchir plus : la station est victime de gigantesques secousses, qui la brisent en plusieurs morceaux. Direction, le fond du fond de l'océan. (On pense à Abyss.)
Notre héroïne tente de rallier un poste de secours et de récupérer des survivants au passage. Elle finit par rejoindre un technicien noir, un autre (blanc) un peu grassouillet, une Asiatique et le commandant, un vieux loup de mer incarné par Vincent Cassel. Dès le départ, on se dit que, parmi la troupe hétéroclite qui compose le groupe de survivants (6 au total), tout le monde ne va pas s'en sortir. Faites vos jeux...
Vous avez compris que le scénario n'est pas d'une grande finesse, d'autant que l'un des personnages (la biologiste asiatique) est particulièrement agaçant : elle n'arrête pas de parler, tient des propos défaitistes ou d'une insondable vacuité. On aimerait bien qu'elle se fasse rapidement boulotter par la "chose" qui vit au fond de l'océan mais, vous l'aurez compris, comme c'est une femme et qu'elle appartient à une "minorité visible", il y a des chances que la production ait insisté pour la garder le plus longtemps possible à l'écran...
Le film est supportable en raison de son habillage sonore et visuel. Dans une grande salle, cela vaut le déplacement. (Par contre, sur petit écran, cela doit moins en jeter.) Bref, les rescapés vont successivement découvrir l'existence d'une petite bébête, puis de plusieurs grandes bébêtes et enfin d'une énooorrrme bébête, toute méchante et vilaine.
Notons qu'alors qu'une partie de l'intrigue semblait insister sur le nécessaire respect des fonds marins, le dénouement suit une voie diamétralement opposée. Moralité : trop d'écologie tue la science-fiction.
01:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 09 février 2020
Les Filles du Docteur March
Le hasard de mes pérégrinations cinématographiques fait que je viens de m'enquiller trois œuvres "féministes", chacune dans un genre différent, puisque Birds of Prey décentre le film de super-héros, Une Belle Equipe revivifie la comédie sportive, alors que Les Filles du Docteur March est la réadaptation d'un succès littéraire.
Tout tourne autour des quatre filles, chacune dotée d'un talent et d'un tempérament différents :
En partant de la gauche vers la droite (ci-dessus), on commence par rencontrer Meg (Emma Watson, à jamais mon Hermione adorée), la conformiste, pourtant douée pour le théâtre. A sa gauche se tient Jo (Saoirse Ronan, éblouissante), la garçonne, la rebelle, l'écrivaine. Juste à côté d'elle se trouve Amy (Florence Pugh, que l'on va bientôt revoir aux côtés de Scarlett Johansson...), la petite peste, assez douée pour la peinture. Enfin tout à droite est placée Beth la pianiste, la plus renfermée des sœurs, la plus pieuse aussi.
Habilement, le film alterne les allers-retours entre deux époques (qui correspondent aux deux premiers tomes de la série de romans écrite par Louisa May Alcott). La partie "moderne" montre les jeunes femmes devenues adultes, moins attachées à la maison familiale, empêtrées dans leurs problèmes personnels. C'est filmé sous une lumière crue, limite frontale.
Par contraste, le passé (celui de la fin de la Guerre de Sécession, en 1864-1865) apparaît sous des tons chauds, ocres. Un formidable travail a été fait au niveau de l'éclairage et des décors. Je pourrais aussi ajouter les costumes, mais je commence à en avoir un peu marre de ces films dont l'action est située dans le passé et où les personnages ne salissent pas leurs vêtements... Les retours en arrière ressuscitent un cocon, celui dans lequel baignait la cellule familiale, certes privée du père (parti à la guerre), mais où la solidarité entre filles faisait tout supporter. C'était aussi une époque où les adolescentes pouvaient croire en leurs rêves.
Cela nous amène au propos du film (en écho au XXIe siècle) : la difficulté d'être femme, dans une société qui les empêche de vivre de manière indépendante. Le personnage de Jo se fait le porte-parole de la romancière... et de la cinéaste, dont elle est un alter-ego. Si les actrices sont convaincantes, on ne peut pas dire que les personnages masculins soient particulièrement réussis. J'ai lu l'un des romans il y a très très longtemps mais, je n'avais pas gardé en mémoire un tableau aussi fade de la gent masculine. Pour être clair, Timothée Chalamet fait ce qu'il peut pour rendre crédible son personnage de dilettante efféminé, tandis que Louis Garrel et James Norton (oui, l'ancien révérend de Grantchester !) peinent à sortir le manche à balai resté coincé aux tréfonds de leur anatomie. Seuls les trois "vieux" ont de la personnalité : le père des héroïnes (dévoué à leur épanouissement), le voisin grand-père (qui, depuis qu'il a perdu sa fille, regarde avec envie la maison animée par les petites March) et le directeur de publication d'une revue, le seul ouvertement misogyne. C'est d'ailleurs le principal problème de fond : on a du mal à comprendre comment pouvait s'exercer une telle domination patriarcale, presque tous les hommes visibles à l'écran finissant par céder aux héroïnes ! Ici, Greta Gerwig rate son coup, en particulier si elle vise les États-Unis d'aujourd'hui. Les exemples de misogynie y sont si nombreux (jusqu'au plus haut niveau) qu'on a du mal à comprendre comment elle a pu en tirer quelque chose d'aussi fade.
Le film n'en demeure pas moins très regardable, en raison de son habillage visuel réussi et de la prestation d'une brochette d'actrices de talent.
Les Filles du Docteur March
Le hasard de mes pérégrinations cinématographiques fait que je viens de m'enquiller trois œuvres "féministes", chacune dans un genre différent, puisque Birds of Prey décentre le film de super-héros, Une Belle Equipe revivifie la comédie sportive, alors que Les Filles du Docteur March est la réadaptation d'un succès littéraire.
Tout tourne autour des quatre filles, chacune dotée d'un talent et d'un tempérament différents :
En partant de la gauche vers la droite (ci-dessus), on commence par rencontrer Meg (Emma Watson, à jamais mon Hermione adorée), la conformiste, pourtant douée pour le théâtre. A sa gauche se tient Jo (Saoirse Ronan, éblouissante), la garçonne, la rebelle, l'écrivaine. Juste à côté d'elle se trouve Amy (Florence Pugh, que l'on va bientôt revoir aux côtés de Scarlett Johansson...), la petite peste, assez douée pour la peinture. Enfin tout à droite est placée Beth la pianiste, la plus renfermée des sœurs, la plus pieuse aussi.
Habilement, le film alterne les allers-retours entre deux époques (qui correspondent aux deux premiers tomes de la série de romans écrite par Louisa May Alcott). La partie "moderne" montre les jeunes femmes devenues adultes, moins attachées à la maison familiale, empêtrées dans leurs problèmes personnels. C'est filmé sous une lumière crue, limite frontale.
Par contraste, le passé (celui de la fin de la Guerre de Sécession, en 1864-1865) apparaît sous des tons chauds, ocres. Un formidable travail a été fait au niveau de l'éclairage et des décors. Je pourrais aussi ajouter les costumes, mais je commence à en avoir un peu marre de ces films dont l'action est située dans le passé et où les personnages ne salissent pas leurs vêtements... Les retours en arrière ressuscitent un cocon, celui dans lequel baignait la cellule familiale, certes privée du père (parti à la guerre), mais où la solidarité entre filles faisait tout supporter. C'était aussi une époque où les adolescentes pouvaient croire en leurs rêves.
Cela nous amène au propos du film (en écho au XXIe siècle) : la difficulté d'être femme, dans une société qui les empêche de vivre de manière indépendante. Le personnage de Jo se fait le porte-parole de la romancière... et de la cinéaste, dont elle est un alter-ego. Si les actrices sont convaincantes, on ne peut pas dire que les personnages masculins soient particulièrement réussis. J'ai lu l'un des romans il y a très très longtemps mais, je n'avais pas gardé en mémoire un tableau aussi fade de la gent masculine. Pour être clair, Timothée Chalamet fait ce qu'il peut pour rendre crédible son personnage de dilettante efféminé, tandis que Louis Garrel et James Norton (oui, l'ancien révérend de Grantchester !) peinent à sortir le manche à balai resté coincé aux tréfonds de leur anatomie. Seuls les trois "vieux" ont de la personnalité : le père des héroïnes (dévoué à leur épanouissement), le voisin grand-père (qui, depuis qu'il a perdu sa fille, regarde avec envie la maison animée par les petites March) et le directeur de publication d'une revue, le seul ouvertement misogyne. C'est d'ailleurs le principal problème de fond : on a du mal à comprendre comment pouvait s'exercer une telle domination patriarcale, presque tous les hommes visibles à l'écran finissant par céder aux héroïnes ! Ici, Greta Gerwig rate son coup, en particulier si elle vise les États-Unis d'aujourd'hui. Les exemples de misogynie y sont si nombreux (jusqu'au plus haut niveau) qu'on a du mal à comprendre comment elle a pu en tirer quelque chose d'aussi fade.
Le film n'en demeure pas moins très regardable, en raison de son habillage visuel réussi et de la prestation d'une brochette d'actrices de talent.
Une Belle Equipe
Quand bien même le titre évoque un vieux film de Julien Duvivier (sorti en 1936), c'est à un autre long-métrage qu'Une Belle Equipe fait penser : Comme des garçons, sorti il y a deux ans dans une relative confidentialité (malheureusement).
C'est d'ailleurs ce qui m'a retenu d'aller voir ce film plus tôt. J'avais trop peur du déjà-vu. Mais, comme le bouche-à-oreille est bon et que, derrière la caméra, se trouve Mohamed Hamidi, auteur de La Vache, je me suis laissé tenter.
La première partie est une pure comédie, qui a pour théâtre une petite ville des Hauts-de-France, terre de football, de sociabilité ouvrière... et d'intense consommation de bière. Le modeste club (masculin) de football bat de l'aile. Il risque même la disparition, à moins que son entraîneur (Kad Merad, fidèle à lui-même) ne trouve une solution. Celle-ci va lui être suggérée par sa fille : remplacer les joueurs suspendus par... des femmes !
Les comportements masculins sont l'occasion d'enfiler les clichés (hélas pas toujours désuets). La plupart des compagnons/maris ne s'occupent guère des enfants ni des tâches ménagères. Ce sont très souvent des alcooliques (certains jouant au football plus par habitude que par souci d'exercer une activité physique), à l'esprit étroit. Sans surprise, le président du club est un notable du cru, assez antipathique.
Je rassure mes lecteurs mâles : le scénario offre la possibilité à ces personnages caricaturaux d'évoluer... dans le mauvais sens comme dans le bon. La deuxième partie voit les mauvais penchants de certains d'entre eux l'emporter, dans une farandole de mesquineries qui plombe un peu l'ambiance.
Face à cette masse de testostérone bedonnante, les apprenties joueuses déploient une belle énergie. Je dis "apprenties joueuses" parce qu'apparemment, la plupart des actrices n'avaient quasiment jamais touché un ballon de football auparavant. Quand on voit ce qu'elles finissent par réussir à faire à l'écran, on se dit que l'entraînement a dû être sacrément bon... ou bien que certaines d'entre elles avaient des prédispositions cachées. C'est d'ailleurs ce qui est suggéré à propos des principaux personnages féminins. Si l'on excepte les deux qui pratiquent déjà la ballopied, toutes les autres sont jeunes et s'entretiennent physiquement. Leur manquent juste la technique et la mise en pratique de schémas tactiques... et il leur faut apprendre vite : il leur reste trois matchs pour tenter de grappiller le point qui permettrait à l'équipe de rester dans la division.
Toutes les actrices sont formidables. Je retiens particulièrement Laure Calamy en bourgeoise qui se lâche, Sabrina Ouazani rayonnante, Manika Auxire effrayante de vulgarité et Céline Sallette parfaite en mère-courage, la grande soeur dont le groupe a besoin... et l'adjointe sur les épaules de laquelle l'entraîneur pourrait se reposer d'une partie de sa charge.
Le résultat est un feel good movie, durant lequel j'ai souvent ri (dans la première partie). Comme on s'achemine vers une fin consensuelle, il faut bien que les hommes obtus se rachètent. Le scénario tombe alors dans la facilité (qu'il frôle souvent au cours du film) en reportant toute la culpabilité sur la Fédération de football, nouvelle incarnation d'un pouvoir parisien lointain et oppresseur des bons p'tits gars de la Province. Cette limite posée, l'ensemble forme vraiment un bon film.
14:10 Publié dans Cinéma, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Une Belle Equipe
Quand bien même le titre évoque un vieux film de Julien Duvivier (sorti en 1936), c'est à un autre long-métrage qu'Une Belle Equipe fait penser : Comme des garçons, sorti il y a deux ans dans une relative confidentialité (malheureusement).
C'est d'ailleurs ce qui m'a retenu d'aller voir ce film plus tôt. J'avais trop peur du déjà-vu. Mais, comme le bouche-à-oreille est bon et que, derrière la caméra, se trouve Mohamed Hamidi, auteur de La Vache, je me suis laissé tenter.
La première partie est une pure comédie, qui a pour théâtre une petite ville des Hauts-de-France, terre de football, de sociabilité ouvrière... et d'intense consommation de bière. Le modeste club (masculin) de football bat de l'aile. Il risque même la disparition, à moins que son entraîneur (Kad Merad, fidèle à lui-même) ne trouve une solution. Celle-ci va lui être suggérée par sa fille : remplacer les joueurs suspendus par... des femmes !
Les comportements masculins sont l'occasion d'enfiler les clichés (hélas pas toujours désuets). La plupart des compagnons/maris ne s'occupent guère des enfants ni des tâches ménagères. Ce sont très souvent des alcooliques (certains jouant au football plus par habitude que par souci d'exercer une activité physique), à l'esprit étroit. Sans surprise, le président du club est un notable du cru, assez antipathique.
Je rassure mes lecteurs mâles : le scénario offre la possibilité à ces personnages caricaturaux d'évoluer... dans le mauvais sens comme dans le bon. La deuxième partie voit les mauvais penchants de certains d'entre eux l'emporter, dans une farandole de mesquineries qui plombe un peu l'ambiance.
Face à cette masse de testostérone bedonnante, les apprenties joueuses déploient une belle énergie. Je dis "apprenties joueuses" parce qu'apparemment, la plupart des actrices n'avaient quasiment jamais touché un ballon de football auparavant. Quand on voit ce qu'elles finissent par réussir à faire à l'écran, on se dit que l'entraînement a dû être sacrément bon... ou bien que certaines d'entre elles avaient des prédispositions cachées. C'est d'ailleurs ce qui est suggéré à propos des principaux personnages féminins. Si l'on excepte les deux qui pratiquent déjà la ballopied, toutes les autres sont jeunes et s'entretiennent physiquement. Leur manquent juste la technique et la mise en pratique de schémas tactiques... et il leur faut apprendre vite : il leur reste trois matchs pour tenter de grappiller le point qui permettrait à l'équipe de rester dans la division.
Toutes les actrices sont formidables. Je retiens particulièrement Laure Calamy en bourgeoise qui se lâche, Sabrina Ouazani rayonnante, Manika Auxire effrayante de vulgarité et Céline Sallette parfaite en mère-courage, la grande soeur dont le groupe a besoin... et l'adjointe sur les épaules de laquelle l'entraîneur pourrait se reposer d'une partie de sa charge.
Le résultat est un feel good movie, durant lequel j'ai souvent ri (dans la première partie). Comme on s'achemine vers une fin consensuelle, il faut bien que les hommes obtus se rachètent. Le scénario tombe alors dans la facilité (qu'il frôle souvent au cours du film) en reportant toute la culpabilité sur la Fédération de football, nouvelle incarnation d'un pouvoir parisien lointain et oppresseur des bons p'tits gars de la Province. Cette limite posée, l'ensemble forme vraiment un bon film.
14:10 Publié dans Cinéma, Société, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
samedi, 08 février 2020
Birds of Prey
Ces oiseaux de proie sont d'abord des victimes, avant de devenir des prédatrices. L'histoire est centrée sur l'une d'entre elles, Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie... qui coproduit le film. On n'est jamais si bien servie que par soi-même ! En tout cas, on sent que la blondissime actrice a jubilé dans l'interprétation de cette garce farfelue, diplômée en psychologie, tombée amoureuse du Joker. En moins de deux ans, la voici passée du patin à glace au patin à roulettes !
Le film est à l'image de son héroïne, bruyant et clinquant, charmant et agaçant, désordonné. C'est d'ailleurs Harley elle-même qui nous raconte cette histoire... à sa manière. Il convient d'être attentif au décalage qui peut exister entre ce que la dame affirme et ce qui est visible à l'écran. Je recommande aussi de lire avec attention les incrustations, certaines étant désopilantes.
Les autres gazelles sont une tenace policière noire méprisée par sa hiérarchie, une chanteuse de club exploitée par son patron, une mystérieuse motarde (aux origines siciliennes...) et une ado kleptomane, placée en famille d'accueil. Ces cinq très fortes individualités vont petit à petit apprendre à évoluer ensemble, jusqu'à la séquence de l'assaut du parc d'attractions, où Harley Quinn a préparé quelques surprises à destination de la bande de malfrats qui déboule pour les massacrer.
On notera que, si de gros efforts ont été déployés dans la chorégraphie des bastons, le réalisme n'est pas le souci principal de la réalisatrice... qui ne s'en cache pas. L'une des héroïnes finit par remarquer qu'Harley, qui jusque-là évoluait en bottines, se retrouve tout à coup chaussée de patins ! Quand on en a le loisir, on peut aussi s'amuser à observer l'évolution des tenues...
Enfin, il y a un propos sociologique derrière cette intrigue. Le film dénonce l'oppression des femmes : Harley a été utilisée puis jetée par le Joker, la policière a été privée des fruits de son travail par ses collègues masculins, la chanteuse est sous la coupe du truand qui dirige le club où elle se produit et l'Italienne a vu sa famille se faire massacrer par un quatuor de mecs horribles. Même la petite dernière est victime du machisme, celui de l'homme de sa famille d'accueil, qui semble très violent. La référence au mouvement #Metoo est perceptible dans une scène se déroulant à l'intérieur du club. Son propriétaire, odieux et paranoïaque, s'en prend à l'une des clientes, qu'il humilie en public, personne n'osant intervenir. (La victime est interprétée par Bojana Novakovic, vue dans Moi, Tonya, mais remarquée surtout depuis qu'elle interprète une policière très consciencieuse dans la série Instinct.)
Mais, que l'on se rassure : c'est d'abord un film d'action divertissant, assez potache, parfois puéril, durant lequel je ne me suis pas du tout ennuyé.
P.S.
Celles et ceux qui restent jusqu'à la fin du générique ont une chance d'entendre la voix de Harley révéler un secret intime de Batman, avec lequel la jeune femme semble entretenir une relation d'amour-haine (susceptible d'être développée dans des films à venir ?).
21:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Birds of Prey
Ces oiseaux de proie sont d'abord des victimes, avant de devenir des prédatrices. L'histoire est centrée sur l'une d'entre elles, Harley Quinn, interprétée par Margot Robbie... qui coproduit le film. On n'est jamais si bien servie que par soi-même ! En tout cas, on sent que la blondissime actrice a jubilé dans l'interprétation de cette garce farfelue, diplômée en psychologie, tombée amoureuse du Joker. En moins de deux ans, la voici passée du patin à glace au patin à roulettes !
Le film est à l'image de son héroïne, bruyant et clinquant, charmant et agaçant, désordonné. C'est d'ailleurs Harley elle-même qui nous raconte cette histoire... à sa manière. Il convient d'être attentif au décalage qui peut exister entre ce que la dame affirme et ce qui est visible à l'écran. Je recommande aussi de lire avec attention les incrustations, certaines étant désopilantes.
Les autres gazelles sont une tenace policière noire méprisée par sa hiérarchie, une chanteuse de club exploitée par son patron, une mystérieuse motarde (aux origines siciliennes...) et une ado kleptomane, placée en famille d'accueil. Ces cinq très fortes individualités vont petit à petit apprendre à évoluer ensemble, jusqu'à la séquence de l'assaut du parc d'attractions, où Harley Quinn a préparé quelques surprises à destination de la bande de malfrats qui déboule pour les massacrer.
On notera que, si de gros efforts ont été déployés dans la chorégraphie des bastons, le réalisme n'est pas le souci principal de la réalisatrice... qui ne s'en cache pas. L'une des héroïnes finit par remarquer qu'Harley, qui jusque-là évoluait en bottines, se retrouve tout à coup chaussée de patins ! Quand on en a le loisir, on peut aussi s'amuser à observer l'évolution des tenues...
Enfin, il y a un propos sociologique derrière cette intrigue. Le film dénonce l'oppression des femmes : Harley a été utilisée puis jetée par le Joker, la policière a été privée des fruits de son travail par ses collègues masculins, la chanteuse est sous la coupe du truand qui dirige le club où elle se produit et l'Italienne a vu sa famille se faire massacrer par un quatuor de mecs horribles. Même la petite dernière est victime du machisme, celui de l'homme de sa famille d'accueil, qui semble très violent. La référence au mouvement #Metoo est perceptible dans une scène se déroulant à l'intérieur du club. Son propriétaire, odieux et paranoïaque, s'en prend à l'une des clientes, qu'il humilie en public, personne n'osant intervenir. (La victime est interprétée par Bojana Novakovic, vue dans Moi, Tonya, mais remarquée surtout depuis qu'elle interprète une policière très consciencieuse dans la série Instinct.)
Mais, que l'on se rassure : c'est d'abord un film d'action divertissant, assez potache, parfois puéril, durant lequel je ne me suis pas du tout ennuyé.
P.S.
Celles et ceux qui restent jusqu'à la fin du générique ont une chance d'entendre la voix de Harley révéler un secret intime de Batman, avec lequel la jeune femme semble entretenir une relation d'amour-haine (susceptible d'être développée dans des films à venir ?).
21:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
The Gentlemen
Moins d'un an après le poussif Aladdin, Guy Ritchie revient sur nos écrans avec un film plus personnel, un film de genre, un de ceux qu'affectionnait jadis la société Miramax (rachetée en 2016 par une célèbre société qatarie), qui produit celui-ci.
Raconter ne serait-ce qu'une partie du début relève de la gageure. Comme l'intrigue est un entrelacs de complots et de trahisons, elle est difficile à restituer dans son cadre général sans trop la déflorer. On peut quand même dire qu'il s'agit d'une histoire de rivalités entre voyous londoniens (d'origines diverses : américaine WASP, juive, chinoise, russe, irlandaise, britannique...), sur fond de trafic de drogue.
Une partie du film est construite comme une série de retours en arrière. Après un générique de toute beauté, on découvre le "héros", Michael Pearson (Matthew McConaughey, impérial), dans son bar de prédilection, dans une scène qu'on reverra plus tard sous deux angles différents. C'est malin.
La suite (ou plutôt ce qui précède) nous est racontée par un journaliste véreux, qui travaille dans une feuille de chou sensationnaliste. Hugh Grant est parfait dans le rôle, qui le voit notamment se confronter au bras droit de Pearson, un barbu taiseux interprété par Charlie Hunnam. Le petit jeu du chat et de la souris entre les deux hommes alterne avec des scènes enlevées, fort bien tournées. Des truands purs et durs y croisent de jeunes voyous en quête de reconnaissance (et d'argent facile). C'est à ce moment-là que débarque le personnage le plus improbable de cette histoire, le Coach, merveilleusement incarné par Colin Farrell (avec l'accent à savourer dans la V.O.). Cet entraîneur de boxe charismatique essaie de remettre les petites frappes de son quartier dans le droit chemin... quitte à enfreindre (un peu) la loi pour cela !
Les ennuis de Pearson débutent vraiment quand il annonce qu'il veut se retirer du "jeu". Autour de lui, cela commence à ressembler à une curée, avec le vieux rival chinois faux-jeton, son potentiel successeur aux dents longues, le "collègue" juif avec lequel Pearson traite... sans parler d'un oligarque russe, qu'on ne voit jamais, mais dont l'action se fait ressentir.
Les péripéties sont souvent jouissives, avec la dose de violence que l'on s'attend à trouver dans ce genre d'histoire... et beaucoup d'ironie, jusque dans la manière de présenter l'organisation méticuleuse du trafic de marijuana. Je laisse à chacun le plaisir de découvrir quel ingénieux système Pearson a mis au point pour échapper aux radars, ceux de la police comme ceux de ses rivaux...
Un autre point à souligner est la manière dont les trafics sont gérés. Les truands sont devenus des managers, qui parlent coût de production, marge opérationnelle, investissement... Ritchie nous présente ces salauds ("gentlemen" étant évidemment une antiphrase) comme des patrons d'entreprise, à ceci près qu'ils ont intégré à leur méthode de gestion la torture et le meurtre.
J'ai passé un très bon moment.
P.S.
A la fin, on voit l'un des personnages apporter son scénario à un producteur de cinéma, qui a comme un air de ressemblance avec l'un des frères Weinstein. Dans la pièce, sur le mur situé derrière le bureau du producteur, se trouve l'affiche du film Agents très spéciaux, réalisé par un certain... Guy Ritchie !
17:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
The Gentlemen
Moins d'un an après le poussif Aladdin, Guy Ritchie revient sur nos écrans avec un film plus personnel, un film de genre, un de ceux qu'affectionnait jadis la société Miramax (rachetée en 2016 par une célèbre société qatarie), qui produit celui-ci.
Raconter ne serait-ce qu'une partie du début relève de la gageure. Comme l'intrigue est un entrelacs de complots et de trahisons, elle est difficile à restituer dans son cadre général sans trop la déflorer. On peut quand même dire qu'il s'agit d'une histoire de rivalités entre voyous londoniens (d'origines diverses : américaine WASP, juive, chinoise, russe, irlandaise, britannique...), sur fond de trafic de drogue.
Une partie du film est construite comme une série de retours en arrière. Après un générique de toute beauté, on découvre le "héros", Michael Pearson (Matthew McConaughey, impérial), dans son bar de prédilection, dans une scène qu'on reverra plus tard sous deux angles différents. C'est malin.
La suite (ou plutôt ce qui précède) nous est racontée par un journaliste véreux, qui travaille dans une feuille de chou sensationnaliste. Hugh Grant est parfait dans le rôle, qui le voit notamment se confronter au bras droit de Pearson, un barbu taiseux interprété par Charlie Hunnam. Le petit jeu du chat et de la souris entre les deux hommes alterne avec des scènes enlevées, fort bien tournées. Des truands purs et durs y croisent de jeunes voyous en quête de reconnaissance (et d'argent facile). C'est à ce moment-là que débarque le personnage le plus improbable de cette histoire, le Coach, merveilleusement incarné par Colin Farrell (avec l'accent à savourer dans la V.O.). Cet entraîneur de boxe charismatique essaie de remettre les petites frappes de son quartier dans le droit chemin... quitte à enfreindre (un peu) la loi pour cela !
Les ennuis de Pearson débutent vraiment quand il annonce qu'il veut se retirer du "jeu". Autour de lui, cela commence à ressembler à une curée, avec le vieux rival chinois faux-jeton, son potentiel successeur aux dents longues, le "collègue" juif avec lequel Pearson traite... sans parler d'un oligarque russe, qu'on ne voit jamais, mais dont l'action se fait ressentir.
Les péripéties sont souvent jouissives, avec la dose de violence que l'on s'attend à trouver dans ce genre d'histoire... et beaucoup d'ironie, jusque dans la manière de présenter l'organisation méticuleuse du trafic de marijuana. Je laisse à chacun le plaisir de découvrir quel ingénieux système Pearson a mis au point pour échapper aux radars, ceux de la police comme ceux de ses rivaux...
Un autre point à souligner est la manière dont les trafics sont gérés. Les truands sont devenus des managers, qui parlent coût de production, marge opérationnelle, investissement... Ritchie nous présente ces salauds ("gentlemen" étant évidemment une antiphrase) comme des patrons d'entreprise, à ceci près qu'ils ont intégré à leur méthode de gestion la torture et le meurtre.
J'ai passé un très bon moment.
P.S.
A la fin, on voit l'un des personnages apporter son scénario à un producteur de cinéma, qui a comme un air de ressemblance avec l'un des frères Weinstein. Dans la pièce, sur le mur situé derrière le bureau du producteur, se trouve l'affiche du film Agents très spéciaux, réalisé par un certain... Guy Ritchie !
17:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 07 février 2020
Le Voyage du Dr Dolittle
Cette pochade numérique est une nouvelle adaptation d'un personnage de romans qui, jadis, contribua à la célébrité d'Eddy Murphy. Ici, c'est Robert Downey Jr qui endosse le costume du vétérinaire qui converse avec les animaux. Je pense que je ne vais surprendre aucun cinéphile en affirmant que, depuis le tournage d'Avengers Endgame, l'acteur a compris que son agenda était a priori assez dégagé pour les années à venir...
On nous propose un univers féérique, fait d'un XIXe siècle victorien mythifié, mêlant l'atmosphère du film de pirates à quelque chose qui ressemble à Alice au pays des merveilles. La surabondance d'effets spéciaux est visible mais, franchement, dans une grande salle, avec un bon son, c'est un sacré spectacle.
Après une introduction sous forme de mini-film d'animation, on découvre les "personnages réels", en particulier le véto déprimé, qu'un potentiel apprenti (aidé d'une suivante de la cour royale d'Angleterre) va tenter de sortir de sa torpeur, épaulé par la ménagerie qui a élu domicile dans la propriété transformée en refuge.
Les péripéties sont dignes d'un roman-feuilleton. Entre passage secret, empoisonnement, trahison, espionnage et course-poursuite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est de surcroît allègrement saupoudré d'humour, qui émerge en général des personnages animaux, grands comme petits (en particulier le gorille, les souris et l'écureuil). A l'oreille, dans la version française, on reconnaît quantité de voix familières, habituées du doublage de films comme de séries télévisées.
Deux séquences sont particulièrement emballantes : le face-à-face entre Doolittle et le tigre Barry et toute l'aventure au sein de la grotte, avec notamment la dragonne.
Bref, même si cela ne vole pas très haut, c'est un très agréable divertissement, qui aurait d'ailleurs pu constituer un excellent film de Noël, tant l'ambiance est féérique et bon enfant.
22:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Le Voyage du Dr Dolittle
Cette pochade numérique est une nouvelle adaptation d'un personnage de romans qui, jadis, contribua à la célébrité d'Eddy Murphy. Ici, c'est Robert Downey Jr qui endosse le costume du vétérinaire qui converse avec les animaux. Je pense que je ne vais surprendre aucun cinéphile en affirmant que, depuis le tournage d'Avengers Endgame, l'acteur a compris que son agenda était a priori assez dégagé pour les années à venir...
On nous propose un univers féérique, fait d'un XIXe siècle victorien mythifié, mêlant l'atmosphère du film de pirates à quelque chose qui ressemble à Alice au pays des merveilles. La surabondance d'effets spéciaux est visible mais, franchement, dans une grande salle, avec un bon son, c'est un sacré spectacle.
Après une introduction sous forme de mini-film d'animation, on découvre les "personnages réels", en particulier le véto déprimé, qu'un potentiel apprenti (aidé d'une suivante de la cour royale d'Angleterre) va tenter de sortir de sa torpeur, épaulé par la ménagerie qui a élu domicile dans la propriété transformée en refuge.
Les péripéties sont dignes d'un roman-feuilleton. Entre passage secret, empoisonnement, trahison, espionnage et course-poursuite, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est de surcroît allègrement saupoudré d'humour, qui émerge en général des personnages animaux, grands comme petits (en particulier le gorille, les souris et l'écureuil). A l'oreille, dans la version française, on reconnaît quantité de voix familières, habituées du doublage de films comme de séries télévisées.
Deux séquences sont particulièrement emballantes : le face-à-face entre Doolittle et le tigre Barry et toute l'aventure au sein de la grotte, avec notamment la dragonne.
Bref, même si cela ne vole pas très haut, c'est un très agréable divertissement, qui aurait d'ailleurs pu constituer un excellent film de Noël, tant l'ambiance est féérique et bon enfant.
22:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
L'Esprit de famille
Attiré par la distribution quatre étoiles (Josiane Balasko, Isabelle Carré, François Berléand, Guillaume De Tonquédec...), j'ai tenté cette comédie française, qui oscille entre drame familial et portrait de société.
L'une des meilleures scènes se trouve au début. Je ne vais pas divulgâcher grand chose en révélant qu'elle se conclut par le décès du père. Mais cette mort est amenée avec une certaine subtilité. Dans le même temps, le problème de la relation entre le père et le fils est bien posé.
C'est le véritable sujet de cette histoire très balisée. Aucun des membres de la famille ne se remet de la disparition du père (François Berléand)... alors que tous avaient encore tant de choses à lui dire. La veuve (J. Balasko) se comporte bizarrement... en fait pour tester si l'esprit du défunt hante les murs de la maison familiale. Le fils aîné (G. De Tonquédec) lui le voit carrément au quotidien. C'est le personnage qui est amené le plus à évoluer... pour le meilleur bien sûr : c'était (jusqu'à présent) un mari distant, un père absent, un fils lointain et un ami peu fiable.
Il découvre l'ampleur des dégâts un matin, au petit-déjeuner, quand il se retrouve face à sa belle-sœur dépressive, un personnage jusque-là très caricatural qui, tout à coup, trouve les mots pour caractériser son beau-frère. La scène est assez savoureuse. Pour ce personnage féminin (interprété par Marie-Julie Baup), cela marque l'amorce d'un changement qui va culminer au cours d'une mémorable partie de rugby de plage, en compagnie d'un joueur professionnel fidjien qui a le mal du pays... et des biceps épais comme deux cuisses.
A rebours de nombre de ses collègues auteurs de comédies "populaires" françaises, le réalisateur Eric Besnard a soigné la mise en scène. Certains plans font preuve d'une certaine élaboration et l'image est vraiment chiadée.
Du coup, je me suis laissé prendre à cette torpeur mélancolique, cette petite chose parfois drôle, qui évoque avec tendresse les rapports familiaux.
19:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
L'Esprit de famille
Attiré par la distribution quatre étoiles (Josiane Balasko, Isabelle Carré, François Berléand, Guillaume De Tonquédec...), j'ai tenté cette comédie française, qui oscille entre drame familial et portrait de société.
L'une des meilleures scènes se trouve au début. Je ne vais pas divulgâcher grand chose en révélant qu'elle se conclut par le décès du père. Mais cette mort est amenée avec une certaine subtilité. Dans le même temps, le problème de la relation entre le père et le fils est bien posé.
C'est le véritable sujet de cette histoire très balisée. Aucun des membres de la famille ne se remet de la disparition du père (François Berléand)... alors que tous avaient encore tant de choses à lui dire. La veuve (J. Balasko) se comporte bizarrement... en fait pour tester si l'esprit du défunt hante les murs de la maison familiale. Le fils aîné (G. De Tonquédec) lui le voit carrément au quotidien. C'est le personnage qui est amené le plus à évoluer... pour le meilleur bien sûr : c'était (jusqu'à présent) un mari distant, un père absent, un fils lointain et un ami peu fiable.
Il découvre l'ampleur des dégâts un matin, au petit-déjeuner, quand il se retrouve face à sa belle-sœur dépressive, un personnage jusque-là très caricatural qui, tout à coup, trouve les mots pour caractériser son beau-frère. La scène est assez savoureuse. Pour ce personnage féminin (interprété par Marie-Julie Baup), cela marque l'amorce d'un changement qui va culminer au cours d'une mémorable partie de rugby de plage, en compagnie d'un joueur professionnel fidjien qui a le mal du pays... et des biceps épais comme deux cuisses.
A rebours de nombre de ses collègues auteurs de comédies "populaires" françaises, le réalisateur Eric Besnard a soigné la mise en scène. Certains plans font preuve d'une certaine élaboration et l'image est vraiment chiadée.
Du coup, je me suis laissé prendre à cette torpeur mélancolique, cette petite chose parfois drôle, qui évoque avec tendresse les rapports familiaux.
19:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 05 février 2020
L'Adieu
Ironiquement, une incrustation placée au tout début informe les spectateurs que l'intrigue du film est inspirée... d'un mensonge. Celui-ci est au coeur de la réunion de famille qui s'organise un peu à l'arrache, en Chine, officiellement pour célébrer le mariage de l'un des petits-enfants. En réalité, les adultes de la "tribu" ont appris que la grand-mère est en phase terminale de son cancer du poumon, un état de santé qu'on lui a jusqu'à présent soigneusement caché.
Avant d'en arriver aux retrouvailles, on nous présente les différentes branches de la famille. Les deux fils de la matriarche se sont expatriés des dizaines d'années auparavant (si on lit entre les lignes : quelques années à peine après la répression du printemps de Pékin...). Le premier couple vit à New York, en plus ou moins bons termes avec la fille unique, une trentenaire pas encore fixée sur ce qu'elle veut faire de sa vie. Le second couple vit au Japon, où est né le fils sur le point de convoler avec une ressortissante nippone. En Chine, on découvre le reste de la famille : la tante et les cousins.
Cette histoire pleine de délicatesse se déguste d'abord pour la description du fossé culturel qui s'est creusé entre les expatriés, leurs enfants et les Chinois de Chine. Les premiers ne parlent plus aussi bien leur langue maternelle, méconnaissent les traditions, tandis que, chez les seconds, on sent un petit complexe d'infériorité, ainsi qu'une observance quasi servile des rituels surannés..
L'humour n'est pas absent. En fil rouge, il y a cette plaisanterie de fin de repas, qu'on nous raconte au début. Je laisse à chacun le plaisir de découvrir ce que cache l'euphémisme "monter sur le toit"... Toutefois, qu'on ne s'attende pas à de la franche rigolade. C'est un humour discret, saupoudré (à bon escient) en quelques endroits.
L'autre intérêt du film est sa mise en scène des relations entre femmes. C'est d'ailleurs peut-être le moment de préciser que la réalisation est due à une représentante du "deuxième sexe", Lulu Wang. Elle a clairement choisi de mettre l'accent sur les personnages féminins... et elle a eu raison, tant ceux-ci sont bien incarnés. Il y a bien sûr la grand-mère, une femme simple, qui, dans les difficultés de la vie, a acquis une sagesse dont elle tente de faire profiter ses cadettes. Il y a aussi l'une de ses brus, dotée d'une forte personnalité, et qui semble "porter la culotte" dans son ménage. Il y a enfin Billi, la petite-fille préférée, l'artiste un peu ratée, le cul entre deux chaises, mal à l'aise dans la culture chinoise comme dans l'hyper-urbanité individualiste new-yorkaise. Dans le rôle, Awkwafina (vue notamment dans Ocean's 8 et Jumanji 2) est formidable.
L'un des sommets du film est le repas de mariage, avec déclarations convenues et karaoké consternant. Mais deux autres scènes m'ont davantage marqué. La première est le petit affrontement entre Billi et sa mère, au cours duquel chacune vide son sac. Dans un premier temps, la réalisatrice semble diriger notre sympathie vers la jeune (qui est très attachée à sa grand-mère). Mais la scène bascule quand la mère révèle quelques aspects de sa vie passée et affirme nettement son caractère, ce qu'elle évite de faire en public, aux côtés de son mari.
La deuxième scène marquante est le dialogue, dans une chambre, entre la grand-mère et la petite-fille. Il s'y dit beaucoup de choses. On en sous-entend d'autres, plus difficilement exprimables. C'est superbement joué et j'ai été ému.
P.S.
Ne partez pas trop vite à la fin : on découvre que cette intrigue mensongère est inspirée d'une histoire vraie.
21:28 Publié dans Chine, Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
L'Adieu
Ironiquement, une incrustation placée au tout début informe les spectateurs que l'intrigue du film est inspirée... d'un mensonge. Celui-ci est au coeur de la réunion de famille qui s'organise un peu à l'arrache, en Chine, officiellement pour célébrer le mariage de l'un des petits-enfants. En réalité, les adultes de la "tribu" ont appris que la grand-mère est en phase terminale de son cancer du poumon, un état de santé qu'on lui a jusqu'à présent soigneusement caché.
Avant d'en arriver aux retrouvailles, on nous présente les différentes branches de la famille. Les deux fils de la matriarche se sont expatriés des dizaines d'années auparavant (si on lit entre les lignes : quelques années à peine après la répression du printemps de Pékin...). Le premier couple vit à New York, en plus ou moins bons termes avec la fille unique, une trentenaire pas encore fixée sur ce qu'elle veut faire de sa vie. Le second couple vit au Japon, où est né le fils sur le point de convoler avec une ressortissante nippone. En Chine, on découvre le reste de la famille : la tante et les cousins.
Cette histoire pleine de délicatesse se déguste d'abord pour la description du fossé culturel qui s'est creusé entre les expatriés, leurs enfants et les Chinois de Chine. Les premiers ne parlent plus aussi bien leur langue maternelle, méconnaissent les traditions, tandis que, chez les seconds, on sent un petit complexe d'infériorité, ainsi qu'une observance quasi servile des rituels surannés..
L'humour n'est pas absent. En fil rouge, il y a cette plaisanterie de fin de repas, qu'on nous raconte au début. Je laisse à chacun le plaisir de découvrir ce que cache l'euphémisme "monter sur le toit"... Toutefois, qu'on ne s'attende pas à de la franche rigolade. C'est un humour discret, saupoudré (à bon escient) en quelques endroits.
L'autre intérêt du film est sa mise en scène des relations entre femmes. C'est d'ailleurs peut-être le moment de préciser que la réalisation est due à une représentante du "deuxième sexe", Lulu Wang. Elle a clairement choisi de mettre l'accent sur les personnages féminins... et elle a eu raison, tant ceux-ci sont bien incarnés. Il y a bien sûr la grand-mère, une femme simple, qui, dans les difficultés de la vie, a acquis une sagesse dont elle tente de faire profiter ses cadettes. Il y a aussi l'une de ses brus, dotée d'une forte personnalité, et qui semble "porter la culotte" dans son ménage. Il y a enfin Billi, la petite-fille préférée, l'artiste un peu ratée, le cul entre deux chaises, mal à l'aise dans la culture chinoise comme dans l'hyper-urbanité individualiste new-yorkaise. Dans le rôle, Awkwafina (vue notamment dans Ocean's 8 et Jumanji 2) est formidable.
L'un des sommets du film est le repas de mariage, avec déclarations convenues et karaoké consternant. Mais deux autres scènes m'ont davantage marqué. La première est le petit affrontement entre Billi et sa mère, au cours duquel chacune vide son sac. Dans un premier temps, la réalisatrice semble diriger notre sympathie vers la jeune (qui est très attachée à sa grand-mère). Mais la scène bascule quand la mère révèle quelques aspects de sa vie passée et affirme nettement son caractère, ce qu'elle évite de faire en public, aux côtés de son mari.
La deuxième scène marquante est le dialogue, dans une chambre, entre la grand-mère et la petite-fille. Il s'y dit beaucoup de choses. On en sous-entend d'autres, plus difficilement exprimables. C'est superbement joué et j'ai été ému.
P.S.
Ne partez pas trop vite à la fin : on découvre que cette intrigue mensongère est inspirée d'une histoire vraie.
21:28 Publié dans Chine, Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 31 janvier 2020
Jojo Rabbit
Quand le réalisateur (talentueux) de Thor : Ragnarok se lance dans la comédie dramatique historique, cela donne ce film inclassable, qui ambitionne de passer des messages importants en recourant (notamment) à la farce.
Le héros est un bon petit Allemand, dont le papa est parti sur le front de l'Est. L'action se déroule la dernière année de la Seconde Guerre mondiale... et l'on envie un peu ce gamin, parce que sa maman est Scarlett Johansson. Très vite, le gamin, bouffé par la propagande nazie, se retrouve dans les Jeunesses hitlériennes (dans la section réservée aux pré-adolescents). Il a pour confident un ami imaginaire : Adolf Hitler. (Quelqu'un aurait dû déconseiller au réalisateur d'interpréter ce personnage...)
La première partie de l'intrigue se veut cocasse, misant sur le grotesque. Le problème est que cela ne marche pas (à de très rares exceptions près). On rit vraiment peu aux mésaventures des gamins comme à la stupidité des adultes qui les encadrent. Je me suis demandé ce que je faisais dans cette salle...
L'intérêt s'accroît lorsque le garçon fanatisé découvre qu'une pièce secrète de la chambre de sa sœur aînée abrite... une adolescente juive, pour laquelle il se met à éprouver des sentiments ambivalents. Celle-ci est dotée d'un solide caractère. Les échanges avec le gamin sont assez réussis et jouent sur les stéréotypes accolés aux juifs. (Il convient donc de réserver la vision de ce film aux personnes aptes à comprendre qu'il s'agit de second degré...) Je pense qu'on reparlera un jour de Thomasin McKenzie, la ravissante et talentueuse comédienne néo-zélandaise qui incarne Elsa.
En dépit du regain d'intérêt, je trouve que la satire n'est guère plus évoluée qu'en début d'histoire. Fort heureusement survient l'une des meilleures séquences du film : l'arrivée d'agents de la Gestapo, qui viennent fouiller le domicile de la mère du héros, qui est soupçonnée de distribuer des tracts antinazis. C'est l'occasion de profiter du meilleur gag, la récurrence ridicule des "Heil Hitler !"... dans laquelle tous les cinéphiles verront un pompage éhonté d'une excellente scène de To be or not to be (celui d'Ernst Lubitsch). Jojo Rabbit fait vraiment pâle figure à côté de ce prestigieux ancien... sans parler même de The Great Dictator, le chef-d’œuvre de Chaplin.
Néanmoins, j'ai apprécié le changement de ton, à partir d'une scène assez bien fichue, qui voit le gamin découvrir une paire de chaussures familières se balançant au-dessus de sa tête. Cela oriente l'intrigue dans un sens plus dramatique, lorsque l'Allemagne est en pleine déliquescence, jusqu'à l'arrivée des troupes alliées. La relation entre Jojo et Elsa prend encore plus de force, même si j'ai trouvé la conclusion un peu nunuche.
Voilà. Ne vous attendez pas à une œuvre d'exception. Les décors sont certes soignés et quelques moments méritent le détour, surtout si, comme à Rodez, vous avez accès à la version originale sous-titrée.
17:37 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Jojo Rabbit
Quand le réalisateur (talentueux) de Thor : Ragnarok se lance dans la comédie dramatique historique, cela donne ce film inclassable, qui ambitionne de passer des messages importants en recourant (notamment) à la farce.
Le héros est un bon petit Allemand, dont le papa est parti sur le front de l'Est. L'action se déroule la dernière année de la Seconde Guerre mondiale... et l'on envie un peu ce gamin, parce que sa maman est Scarlett Johansson. Très vite, le gamin, bouffé par la propagande nazie, se retrouve dans les Jeunesses hitlériennes (dans la section réservée aux pré-adolescents). Il a pour confident un ami imaginaire : Adolf Hitler. (Quelqu'un aurait dû déconseiller au réalisateur d'interpréter ce personnage...)
La première partie de l'intrigue se veut cocasse, misant sur le grotesque. Le problème est que cela ne marche pas (à de très rares exceptions près). On rit vraiment peu aux mésaventures des gamins comme à la stupidité des adultes qui les encadrent. Je me suis demandé ce que je faisais dans cette salle...
L'intérêt s'accroît lorsque le garçon fanatisé découvre qu'une pièce secrète de la chambre de sa sœur aînée abrite... une adolescente juive, pour laquelle il se met à éprouver des sentiments ambivalents. Celle-ci est dotée d'un solide caractère. Les échanges avec le gamin sont assez réussis et jouent sur les stéréotypes accolés aux juifs. (Il convient donc de réserver la vision de ce film aux personnes aptes à comprendre qu'il s'agit de second degré...) Je pense qu'on reparlera un jour de Thomasin McKenzie, la ravissante et talentueuse comédienne néo-zélandaise qui incarne Elsa.
En dépit du regain d'intérêt, je trouve que la satire n'est guère plus évoluée qu'en début d'histoire. Fort heureusement survient l'une des meilleures séquences du film : l'arrivée d'agents de la Gestapo, qui viennent fouiller le domicile de la mère du héros, qui est soupçonnée de distribuer des tracts antinazis. C'est l'occasion de profiter du meilleur gag, la récurrence ridicule des "Heil Hitler !"... dans laquelle tous les cinéphiles verront un pompage éhonté d'une excellente scène de To be or not to be (celui d'Ernst Lubitsch). Jojo Rabbit fait vraiment pâle figure à côté de ce prestigieux ancien... sans parler même de The Great Dictator, le chef-d’œuvre de Chaplin.
Néanmoins, j'ai apprécié le changement de ton, à partir d'une scène assez bien fichue, qui voit le gamin découvrir une paire de chaussures familières se balançant au-dessus de sa tête. Cela oriente l'intrigue dans un sens plus dramatique, lorsque l'Allemagne est en pleine déliquescence, jusqu'à l'arrivée des troupes alliées. La relation entre Jojo et Elsa prend encore plus de force, même si j'ai trouvé la conclusion un peu nunuche.
Voilà. Ne vous attendez pas à une œuvre d'exception. Les décors sont certes soignés et quelques moments méritent le détour, surtout si, comme à Rodez, vous avez accès à la version originale sous-titrée.
17:37 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 30 janvier 2020
1917
Sam Mendes est un de ces cinéastes qui mettent trois à quatre ans pour créer une œuvre. Sa filmographie est donc assez restreinte, se limitant à huit longs-métrages, les derniers sortis étant Skyfall et 007 Spectre. Ici, on s'éloigne de l'univers de James Bond pour se plonger dans la Première Guerre mondiale.
Pour immerger les spectateurs dans l'univers apocalyptique dans lequel évoluent les personnages, le réalisateur a recouru aux plans-séquences. Pas un seul, contrairement à ce que certains commentateurs imprudents ont affirmé. Si l'on est attentif, on distingue plusieurs coupures, la première intervenant peut-être au sein d'une scène de tranchées, lors d'un croisement. Par la suite, c'est une explosion, puis une fusillade et deux plongées dans l'eau d'une rivière qui permettent au cinéaste de poser sa caméra. Un œil exercé remarquera aussi que l'obscurité de certains plans est propice à des raccords subtils (comme lorsque l'un des héros court la nuit dans une ville en ruines, ou quand il quitte une cave en remontant un escalier sombre).
Le procédé n'a rien d'artificiel, d'abord parce qu'il se passe plein de choses autour de la caméra (qui, souvent, suit ou précède les personnages principaux), au premier plan et à l'arrière-plan. La minutie avec laquelle les scènes sont construites est parfois stupéfiante, comme cette sortie d'un tunnel, qui débouche à l'arrière des lignes allemandes, sans doute au niveau d'une ancienne batterie d'artillerie. La caméra continue d'évoluer autour des deux messagers anglais, après que l'un deux a lancé une fusée d'alerte, qui s'échappe du cadre. Un moment plus tard, les deux hommes repartent alors qu'au loin, derrière eux, on voit la fusée retomber. Les détails de ce genre sont assez nombreux.
C'est un film de guerre atypique. On y voit très peu de combats. Par contre, les conséquences de ceux-ci sont omniprésentes. On ne nous épargne ni la boue, ni la crasse, ni les rats, ni les cadavres gonflés. C'est l'une des grandes qualités de ce film que de nous faire toucher du doigt toute la réalité de la guerre, à partir d'une histoire somme toute anecdotique.
Visuellement, on suit les deux jeunes messagers (des acteurs quasi inconnus, pour moi), dans le labyrinthe des tranchées, d'abord britanniques, ensuite allemandes. C'est l'occasion de découvrir (pour ceux qui l'ignoreraient) que les aménagements des Allemands étaient plus élaborés que ceux de leurs adversaires (français comme britanniques). Au niveau des décors, ce sont toutefois les villes et villages en ruines qui impressionnent le plus. J'ai encore en mémoire les déambulations du héros dans une localité fantomatique, éclairée uniquement par des fusées lancées au pistolet et un gigantesque incendie. Marquante aussi est la scène de la ferme abandonnée, qui est le théâtre d'un combat aérien et d'une péripétie qui fait basculer l'intrigue. Enfin, la rencontre entre le héros et celle que l'on prend d'abord pour une jeune mère éplorée est touchante au possible... et c'est surtout l'occasion de voir enfin une femme !
Si les rôles principaux sont tenus par des figures méconnues, quelques vedettes viennent densifier la distribution : Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott et Benedict Cumberbatch (tous deux anciens de la série Sherlock). Tous les interprètes sont irréprochables. Comme la photographie est soignée et que la musique s'ajoute sans s'imposer, l'ensemble forme un excellent film de guerre, qui échappe au tintamarre héroïsant comme à l'introspection nombriliste. C'est pour moi (déjà) l'un des films de l'année.
22:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
1917
Sam Mendes est un de ces cinéastes qui mettent trois à quatre ans pour créer une œuvre. Sa filmographie est donc assez restreinte, se limitant à huit longs-métrages, les derniers sortis étant Skyfall et 007 Spectre. Ici, on s'éloigne de l'univers de James Bond pour se plonger dans la Première Guerre mondiale.
Pour immerger les spectateurs dans l'univers apocalyptique dans lequel évoluent les personnages, le réalisateur a recouru aux plans-séquences. Pas un seul, contrairement à ce que certains commentateurs imprudents ont affirmé. Si l'on est attentif, on distingue plusieurs coupures, la première intervenant peut-être au sein d'une scène de tranchées, lors d'un croisement. Par la suite, c'est une explosion, puis une fusillade et deux plongées dans l'eau d'une rivière qui permettent au cinéaste de poser sa caméra. Un œil exercé remarquera aussi que l'obscurité de certains plans est propice à des raccords subtils (comme lorsque l'un des héros court la nuit dans une ville en ruines, ou quand il quitte une cave en remontant un escalier sombre).
Le procédé n'a rien d'artificiel, d'abord parce qu'il se passe plein de choses autour de la caméra (qui, souvent, suit ou précède les personnages principaux), au premier plan et à l'arrière-plan. La minutie avec laquelle les scènes sont construites est parfois stupéfiante, comme cette sortie d'un tunnel, qui débouche à l'arrière des lignes allemandes, sans doute au niveau d'une ancienne batterie d'artillerie. La caméra continue d'évoluer autour des deux messagers anglais, après que l'un deux a lancé une fusée d'alerte, qui s'échappe du cadre. Un moment plus tard, les deux hommes repartent alors qu'au loin, derrière eux, on voit la fusée retomber. Les détails de ce genre sont assez nombreux.
C'est un film de guerre atypique. On y voit très peu de combats. Par contre, les conséquences de ceux-ci sont omniprésentes. On ne nous épargne ni la boue, ni la crasse, ni les rats, ni les cadavres gonflés. C'est l'une des grandes qualités de ce film que de nous faire toucher du doigt toute la réalité de la guerre, à partir d'une histoire somme toute anecdotique.
Visuellement, on suit les deux jeunes messagers (des acteurs quasi inconnus, pour moi), dans le labyrinthe des tranchées, d'abord britanniques, ensuite allemandes. C'est l'occasion de découvrir (pour ceux qui l'ignoreraient) que les aménagements des Allemands étaient plus élaborés que ceux de leurs adversaires (français comme britanniques). Au niveau des décors, ce sont toutefois les villes et villages en ruines qui impressionnent le plus. J'ai encore en mémoire les déambulations du héros dans une localité fantomatique, éclairée uniquement par des fusées lancées au pistolet et un gigantesque incendie. Marquante aussi est la scène de la ferme abandonnée, qui est le théâtre d'un combat aérien et d'une péripétie qui fait basculer l'intrigue. Enfin, la rencontre entre le héros et celle que l'on prend d'abord pour une jeune mère éplorée est touchante au possible... et c'est surtout l'occasion de voir enfin une femme !
Si les rôles principaux sont tenus par des figures méconnues, quelques vedettes viennent densifier la distribution : Colin Firth, Mark Strong, Andrew Scott et Benedict Cumberbatch (tous deux anciens de la série Sherlock). Tous les interprètes sont irréprochables. Comme la photographie est soignée et que la musique s'ajoute sans s'imposer, l'ensemble forme un excellent film de guerre, qui échappe au tintamarre héroïsant comme à l'introspection nombriliste. C'est pour moi (déjà) l'un des films de l'année.
22:27 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 25 janvier 2020
Les Mystérieuses Cités d'or, saison 3
France 4 vient d'achever la rediffusion de la troisième saison de la série animée. Depuis un peu plus d'un an, la première saison (culte), qui date des années 1980, est disponible intégralement sur le site de la chaîne. Jadis, l'annonce de la mise en chantier d'une suite (composée de deux saisons) avait suscité l'intérêt. Mais la diffusion de la saison 2, si elle avait conquis un public enfantin, avait déçu les adultes, qui en ont trouvé le ton plus immature que dans la première mouture. Sur le fond, les épisodes associent toujours histoire et science-fiction, avec un mini-documentaire en toute fin. L'intrigue, située en Chine, avait sans doute contribué au succès.
Cela s'est nettement amélioré dans la saison trois, je trouve. Les héros sont transportés du Japon en Inde puis en Iran, dans une farandole de civilisations propre à émerveiller et éveiller la curiosité des enfants. C'est plus rythmé, moins puéril, avec même l'ébauche d'une histoire d'amour adulte entre deux personnages (Mendoza et Laguerra).
Cette redoutable et ravissante jeune femme est d'ailleurs la plus belle révélation de la troisième saison. C'est la fille d'un personnage aperçu dans la saison 1, qui a été recueillie par le méchant de l'histoire (lui-même très réussi). L'effrayant Zarès en a fait sa comparse, une comparse particulièrement redoutable au fouet et à l'épée... mais qui n'a pas mauvais fond. Son apparition coïncide avec la mise en avant de Zia, le membre féminin du trio de héros enfants. Elle se découvre des pouvoirs insoupçonnés et, contrairement à ce qui se passait dans la saison 1, elle va sauver la mise des garçons à plusieurs reprises :
A l'issue de cette troisième saison, quatre cités d'or ont été découvertes : en pays maya, au Tibet, à proximité des côtes japonaises et en Iran. Celles et ceux qui connaissent la série savent que, dès la première saison, il était question de sept cités. Mais, du côté français, TF1 semblait avoir renoncé à financer la suite. C'est France Télévisions qui a pris le relais. L'année 2020 verra la diffusion de la quatrième et dernière saison, dont on présume qu'elle conduira les héros en Afrique... et peut-être quelque part en Europe.
20:50 Publié dans Chine, Histoire, Japon, Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
Les Mystérieuses Cités d'or, saison 3
France 4 vient d'achever la rediffusion de la troisième saison de la série animée. Depuis un peu plus d'un an, la première saison (culte), qui date des années 1980, est disponible intégralement sur le site de la chaîne. Jadis, l'annonce de la mise en chantier d'une suite (composée de deux saisons) avait suscité l'intérêt. Mais la diffusion de la saison 2, si elle avait conquis un public enfantin, avait déçu les adultes, qui en ont trouvé le ton plus immature que dans la première mouture. Sur le fond, les épisodes associent toujours histoire et science-fiction, avec un mini-documentaire en toute fin. L'intrigue, située en Chine, avait sans doute contribué au succès.
Cela s'est nettement amélioré dans la saison trois, je trouve. Les héros sont transportés du Japon en Inde puis en Iran, dans une farandole de civilisations propre à émerveiller et éveiller la curiosité des enfants. C'est plus rythmé, moins puéril, avec même l'ébauche d'une histoire d'amour adulte entre deux personnages (Mendoza et Laguerra).
Cette redoutable et ravissante jeune femme est d'ailleurs la plus belle révélation de la troisième saison. C'est la fille d'un personnage aperçu dans la saison 1, qui a été recueillie par le méchant de l'histoire (lui-même très réussi). L'effrayant Zarès en a fait sa comparse, une comparse particulièrement redoutable au fouet et à l'épée... mais qui n'a pas mauvais fond. Son apparition coïncide avec la mise en avant de Zia, le membre féminin du trio de héros enfants. Elle se découvre des pouvoirs insoupçonnés et, contrairement à ce qui se passait dans la saison 1, elle va sauver la mise des garçons à plusieurs reprises :
A l'issue de cette troisième saison, quatre cités d'or ont été découvertes : en pays maya, au Tibet, à proximité des côtes japonaises et en Iran. Celles et ceux qui connaissent la série savent que, dès la première saison, il était question de sept cités. Mais, du côté français, TF1 semblait avoir renoncé à financer la suite. C'est France Télévisions qui a pris le relais. L'année 2020 verra la diffusion de la quatrième et dernière saison, dont on présume qu'elle conduira les héros en Afrique... et peut-être quelque part en Europe.
20:50 Publié dans Chine, Histoire, Japon, Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
vendredi, 24 janvier 2020
Scandale
Bienvenue dans le monde des riches mâles blancs dominants, harceleurs sexuels de surcroît ! S'inspirant d'une affaire bien réelle (celle impliquant l'ancien patron de Fox News), Charles Randolph (aussi scénariste de The Big Short) et Jay Roach (plus connu comme réalisateur des mémorables Austin Powers...) ont monté ce film féministe, s'appuyant sur trois comédiennes pleines de classe : Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie.
Commençons donc par ce que le film a d'emballant : le jeu des acteurs. En dépit des ravages de la chirurgie esthétique, Nicole Kidman réussit à faire passer de l'émotion, tandis que Charlize Theron développe toute l'épaisseur et la complexité de son personnage. De son côté, Margot Robbie excelle à transmettre les espoirs et les craintes ressentis par Kayla... et Dieu qu'elle est belle !
Mais ce fantastique trio d'Amazones ne doit pas nous faire oublier la foultitude de seconds rôles féminins bien campés, au premier rang desquels se trouve Jess, la collègue homo de gauche qui n'a trouvé qu'un boulot à Fox News pour gagner sa croûte ! Elle a les traits de Kate McKinnon, remarquée ces dernières années dans S.O.S. Fantômes, L'Espion qui m'a larguée et Yesterday.
Du côté des messieurs, il faut souligner l'excellente composition de John Lithgow, parfaitement crédible en patron de médias roublard et odieux. D'autres personnages masculins ont droit à un traitement qui sort de la caricature.
C'est une autre qualité de ce film, qui, face à des comportements dégueulasses, prend le temps d'expliquer les choses et nous propose des portraits nuancés aussi bien des victimes que des prédateurs et des témoins plus ou moins complices. Bien que très individualistes, tous se sentent liés au succès de la chaîne d'information, quitte à passer par pertes et profits quelques incartades, en affectant d'ignorer leur gravité.
Je suis néanmoins réservé sur le film pour plusieurs raisons. La première est le décalage que j'ai ressenti entre mon mode de vie et celui des personnages représentés à l'écran. Je trouve qu'ils évoluent dans un monde superficiel, clinquant, pourri par le fric... mais que c'est plutôt montré comme quelque chose de chouette. La deuxième réserve tient à l'hypocrisie de la mise en scène. Le fond dénonce vigoureusement l'exploitation des (jolies) femmes... mais le réalisateur a filmé avec une évidente gourmandise les formes avantageuses des actrices, pas uniquement celles du trio vedette, mais aussi celles des nombreuses figurantes, dont on présume qu'elles n'ont pas été recrutées sur leur connaissance de la mécanique quantique.
Et puis il y a (surtout) la présentation de Fox News et du travail de ses supposés journalistes. Je ne vais plus regarder ce qui s'y passe depuis des années mais, sous les présidences Bush et Obama, il m'arrivait régulièrement d'aller y jeter un oeil... et je trouvais cela assez consternant. Ici, on se contente de quelques petites piques sur l'aspect orienté de la chaîne d'info, mais il n'y a quasiment rien sur le manque de professionnalisme. Je pense que c'est pour que l'attention des spectateurs se concentre sur le problème du harcèlement. Du coup, parce que ce sont des victimes, on évite de dire que ces femmes faisaient un boulot de merde.
22:12 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Scandale
Bienvenue dans le monde des riches mâles blancs dominants, harceleurs sexuels de surcroît ! S'inspirant d'une affaire bien réelle (celle impliquant l'ancien patron de Fox News), Charles Randolph (aussi scénariste de The Big Short) et Jay Roach (plus connu comme réalisateur des mémorables Austin Powers...) ont monté ce film féministe, s'appuyant sur trois comédiennes pleines de classe : Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie.
Commençons donc par ce que le film a d'emballant : le jeu des acteurs. En dépit des ravages de la chirurgie esthétique, Nicole Kidman réussit à faire passer de l'émotion, tandis que Charlize Theron développe toute l'épaisseur et la complexité de son personnage. De son côté, Margot Robbie excelle à transmettre les espoirs et les craintes ressentis par Kayla... et Dieu qu'elle est belle !
Mais ce fantastique trio d'Amazones ne doit pas nous faire oublier la foultitude de seconds rôles féminins bien campés, au premier rang desquels se trouve Jess, la collègue homo de gauche qui n'a trouvé qu'un boulot à Fox News pour gagner sa croûte ! Elle a les traits de Kate McKinnon, remarquée ces dernières années dans S.O.S. Fantômes, L'Espion qui m'a larguée et Yesterday.
Du côté des messieurs, il faut souligner l'excellente composition de John Lithgow, parfaitement crédible en patron de médias roublard et odieux. D'autres personnages masculins ont droit à un traitement qui sort de la caricature.
C'est une autre qualité de ce film, qui, face à des comportements dégueulasses, prend le temps d'expliquer les choses et nous propose des portraits nuancés aussi bien des victimes que des prédateurs et des témoins plus ou moins complices. Bien que très individualistes, tous se sentent liés au succès de la chaîne d'information, quitte à passer par pertes et profits quelques incartades, en affectant d'ignorer leur gravité.
Je suis néanmoins réservé sur le film pour plusieurs raisons. La première est le décalage que j'ai ressenti entre mon mode de vie et celui des personnages représentés à l'écran. Je trouve qu'ils évoluent dans un monde superficiel, clinquant, pourri par le fric... mais que c'est plutôt montré comme quelque chose de chouette. La deuxième réserve tient à l'hypocrisie de la mise en scène. Le fond dénonce vigoureusement l'exploitation des (jolies) femmes... mais le réalisateur a filmé avec une évidente gourmandise les formes avantageuses des actrices, pas uniquement celles du trio vedette, mais aussi celles des nombreuses figurantes, dont on présume qu'elles n'ont pas été recrutées sur leur connaissance de la mécanique quantique.
Et puis il y a (surtout) la présentation de Fox News et du travail de ses supposés journalistes. Je ne vais plus regarder ce qui s'y passe depuis des années mais, sous les présidences Bush et Obama, il m'arrivait régulièrement d'aller y jeter un oeil... et je trouvais cela assez consternant. Ici, on se contente de quelques petites piques sur l'aspect orienté de la chaîne d'info, mais il n'y a quasiment rien sur le manque de professionnalisme. Je pense que c'est pour que l'attention des spectateurs se concentre sur le problème du harcèlement. Du coup, parce que ce sont des victimes, on évite de dire que ces femmes faisaient un boulot de merde.
22:12 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 22 janvier 2020
Les Vétos
Le film ruraliste a le vent en poupe, ces dernières années... et ce n'est pas moi qui vais le déplorer. Cela nous a permis de voir de jolies réussites comme Petit Paysan ou, plus récemment, Au nom de la terre. Ici, on se place plutôt entre Médecin de campagne (le personnage interprété par Clovis Cornillac étant presque un double de celui incarné naguère par François Cluzet) et Une Hirondelle a fait le printemps, à ceci près que, contrairement à Sandrine (Mathilde Seigner), l'héroïne Alexandra cherche à fuir la campagne plutôt qu'à s'y installer.
La première partie est filmée sur le ton de la comédie, avec, à intervalle régulier, des moments cocasses, qui jouent sur le comique de situation et le "choc des cultures". Alexandra la Parisienne (Noémie Schmidt, vue notamment dans la mini-série A l'intérieur) ne cherche pas à se rendre sympathique... et, surtout, après cet été, elle ambitionne d'entrer dans un prestigieux laboratoire avec, en ligne de mire, un centre de recherches aux États-Unis.
J'ai apprécié l'ironie du début, même si je trouve que l'actrice principale surjoue un peu. Le trait est trop appuyé, mais comme, en face, des comédiens chevronnés (Clovis Cornillac, excellent, et Carole Franck) font le job, cela passe.
Le point de bascule est la mise-bas, une scène particulièrement difficile à tourner (et qui, là encore, rappelle Une Hirondelle a fait le printemps). C'est une réussite. On sent l'actrice impliquée et, à la fin, j'ai été ému. J'ajoute que, dans cette scène comme dans les autres, les animaux (chiens, chats, vaches, souris...) sont particulièrement bien filmés, une qualité à signaler alors que la réalisatrice (Julie Manoukian) est semble-t-il novice dans cet exercice.
Du coup, j'ai bien supporté les grosses ficelles du scénario. Évidemment, l'héroïne va entrer en conflit avec les habitants du cru. Évidemment, elle va aussi se faire des amis... un jeune homme en particulier, beau garçon attentionné dont on a immédiatement compris qu'il n'avait pas vocation à rester un simple collègue de travail. C'est aussi une histoire de passation de témoin, avec l'oncle Michel et entre Nico et Alexandra.
Petit à petit, le personnage de la jeune femme s'étoffe et, aux côté de Nico, Lila (et Zelda, adorable gamine interprétée par Juliane Lepoureau), elle forme un groupe attachant, qui nous communique un bel appétit de vivre.
20:47 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Les Vétos
Le film ruraliste a le vent en poupe, ces dernières années... et ce n'est pas moi qui vais le déplorer. Cela nous a permis de voir de jolies réussites comme Petit Paysan ou, plus récemment, Au nom de la terre. Ici, on se place plutôt entre Médecin de campagne (le personnage interprété par Clovis Cornillac étant presque un double de celui incarné naguère par François Cluzet) et Une Hirondelle a fait le printemps, à ceci près que, contrairement à Sandrine (Mathilde Seigner), l'héroïne Alexandra cherche à fuir la campagne plutôt qu'à s'y installer.
La première partie est filmée sur le ton de la comédie, avec, à intervalle régulier, des moments cocasses, qui jouent sur le comique de situation et le "choc des cultures". Alexandra la Parisienne (Noémie Schmidt, vue notamment dans la mini-série A l'intérieur) ne cherche pas à se rendre sympathique... et, surtout, après cet été, elle ambitionne d'entrer dans un prestigieux laboratoire avec, en ligne de mire, un centre de recherches aux États-Unis.
J'ai apprécié l'ironie du début, même si je trouve que l'actrice principale surjoue un peu. Le trait est trop appuyé, mais comme, en face, des comédiens chevronnés (Clovis Cornillac, excellent, et Carole Franck) font le job, cela passe.
Le point de bascule est la mise-bas, une scène particulièrement difficile à tourner (et qui, là encore, rappelle Une Hirondelle a fait le printemps). C'est une réussite. On sent l'actrice impliquée et, à la fin, j'ai été ému. J'ajoute que, dans cette scène comme dans les autres, les animaux (chiens, chats, vaches, souris...) sont particulièrement bien filmés, une qualité à signaler alors que la réalisatrice (Julie Manoukian) est semble-t-il novice dans cet exercice.
Du coup, j'ai bien supporté les grosses ficelles du scénario. Évidemment, l'héroïne va entrer en conflit avec les habitants du cru. Évidemment, elle va aussi se faire des amis... un jeune homme en particulier, beau garçon attentionné dont on a immédiatement compris qu'il n'avait pas vocation à rester un simple collègue de travail. C'est aussi une histoire de passation de témoin, avec l'oncle Michel et entre Nico et Alexandra.
Petit à petit, le personnage de la jeune femme s'étoffe et, aux côté de Nico, Lila (et Zelda, adorable gamine interprétée par Juliane Lepoureau), elle forme un groupe attachant, qui nous communique un bel appétit de vivre.
20:47 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
dimanche, 12 janvier 2020
Zidane mène l'enquête
Maiiiis, non ! L'ancien joueur vedette de l'équipe de France (devenu entraîneur) n'a pas quitté le Real Madrid pour s'engager dans la police. Toutefois, un quasi-homonyme officie au département de la Justice américain. Il s'agit d'Omar Zidan, ancien agent infiltré dans un groupe djihadiste, devenu enquêteur au FBI, dans la série du même nom :
Les scénaristes ont conçu un beau personnage de policier musulman très impliqué dans son travail... et sans doute pas insensible au charme de sa coéquipière Maggie Bell, une fonceuse comme lui, mais qui peine à dissimuler ses failles.
Le premier épisode (Bombe à retardement) démarre fort, avec une explosion en plein New York. Le deuxième épisode (L'Oiseau vert) est centré sur les "fiancées du djihad". Le troisième (Portées disparues) a pour cadre l'exploitation sexuelle des femmes ukrainiennes. A chaque fois, le sujet est prenant, le rythme soutenu. On retrouve les qualités et les défauts des séries américaines grand public : c'est divertissant, avec un arrière-plan socio-politique, mais les énigmes sont résolues un peu trop vite par les enquêteurs.
J'ajoute que c'est produit par Dick Wolf, à qui l'on doit une brochette de séries tournés à New York. D'ailleurs, l'un des personnages principaux, Jubal Valentine, est incarné par Jeremy Sisto, un ancien de New York, Police judiciaire. Quant aux fans des Experts Manhattan (et de Dr House), ils reconnaîtront un autre visage familier, celui de Sela Ward, qui incarna Jo Danville.
Parmi les nouveautés télévisuelles de 2020, je trouve FBI plus intéressante que la nouvelle version de Magnum (diffusée sur TF1), assez insipide, en dépit de l'introduction d'un Higgins féminin.
23:03 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
Zidane mène l'enquête
Maiiiis, non ! L'ancien joueur vedette de l'équipe de France (devenu entraîneur) n'a pas quitté le Real Madrid pour s'engager dans la police. Toutefois, un quasi-homonyme officie au département de la Justice américain. Il s'agit d'Omar Zidan, ancien agent infiltré dans un groupe djihadiste, devenu enquêteur au FBI, dans la série du même nom :
Les scénaristes ont conçu un beau personnage de policier musulman très impliqué dans son travail... et sans doute pas insensible au charme de sa coéquipière Maggie Bell, une fonceuse comme lui, mais qui peine à dissimuler ses failles.
Le premier épisode (Bombe à retardement) démarre fort, avec une explosion en plein New York. Le deuxième épisode (L'Oiseau vert) est centré sur les "fiancées du djihad". Le troisième (Portées disparues) a pour cadre l'exploitation sexuelle des femmes ukrainiennes. A chaque fois, le sujet est prenant, le rythme soutenu. On retrouve les qualités et les défauts des séries américaines grand public : c'est divertissant, avec un arrière-plan socio-politique, mais les énigmes sont résolues un peu trop vite par les enquêteurs.
J'ajoute que c'est produit par Dick Wolf, à qui l'on doit une brochette de séries tournés à New York. D'ailleurs, l'un des personnages principaux, Jubal Valentine, est incarné par Jeremy Sisto, un ancien de New York, Police judiciaire. Quant aux fans des Experts Manhattan (et de Dr House), ils reconnaîtront un autre visage familier, celui de Sela Ward, qui incarna Jo Danville.
Parmi les nouveautés télévisuelles de 2020, je trouve FBI plus intéressante que la nouvelle version de Magnum (diffusée sur TF1), assez insipide, en dépit de l'introduction d'un Higgins féminin.
23:03 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
vendredi, 10 janvier 2020
La bonne santé du cinéma de Rodez
Les chiffres sont tombés cette semaine : en 2019, le nombre d'entrées a progressé au CGR de l'Esplanade des Rutènes, dépassant les 320 000 (contre 302 000 l'année précédente).
Quand on regarde les choses avec un peu de recul, on constate que 2019 a été la deuxième meilleure année pour le multiplexe, qu'il ait porté la marque Cap'Cinéma ou CGR. En 2015 et 2017, le nombre d'entrées avait atteint 318 000.
On notera que, cumulés, les cinq films ayant attiré le plus de public l'an dernier pèsent 18,75 % des entrées. C'est plus qu'en 2018, où le top 5 ne pesait que 14 % du total. Cela confirme les déclarations du directeur du multiplexe, qui voit dans certains films populaires des locomotives pour son établissement.
L'article de Centre Presse n'évoque cependant pas une autre composante du succès financier du cinéma : les recettes de la confiserie. Entre les bonbons, les boissons et le pop-corn, il y a de quoi améliorer la marge... et dégoûter les spectateurs qui aiment profiter du spectacle sans baigner dans une ambiance de cantine ou d'écurie. J'ai trouvé que, durant la période des fêtes de fin d'année, certaines salles avaient un aspect particulièrement répugnant, une partie du public n'ayant visiblement reçu qu'une éducation rudimentaire...
Voilà le principal grief à formuler contre ce cinéma (plutôt que les horaires), où, par ailleurs, je note un effort dans la programmation (y compris au niveau de la V.O.), pour qui fait l'effort de lire en détail chaque semaine la grille de programmes. Il reste que, pour les cinéphiles purs et durs, un passage par les autres cinémas de la région est indispensable pour ne pas rater certaines sorties.
21:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, occitanie, actualité, actualite, actu, actualites, actualités
La bonne santé du cinéma de Rodez
Les chiffres sont tombés cette semaine : en 2019, le nombre d'entrées a progressé au CGR de l'Esplanade des Rutènes, dépassant les 320 000 (contre 302 000 l'année précédente).
Quand on regarde les choses avec un peu de recul, on constate que 2019 a été la deuxième meilleure année pour le multiplexe, qu'il ait porté la marque Cap'Cinéma ou CGR. En 2015 et 2017, le nombre d'entrées avait atteint 318 000.
On notera que, cumulés, les cinq films ayant attiré le plus de public l'an dernier pèsent 18,75 % des entrées. C'est plus qu'en 2018, où le top 5 ne pesait que 14 % du total. Cela confirme les déclarations du directeur du multiplexe, qui voit dans certains films populaires des locomotives pour son établissement.
L'article de Centre Presse n'évoque cependant pas une autre composante du succès financier du cinéma : les recettes de la confiserie. Entre les bonbons, les boissons et le pop-corn, il y a de quoi améliorer la marge... et dégoûter les spectateurs qui aiment profiter du spectacle sans baigner dans une ambiance de cantine ou d'écurie. J'ai trouvé que, durant la période des fêtes de fin d'année, certaines salles avaient un aspect particulièrement répugnant, une partie du public n'ayant visiblement reçu qu'une éducation rudimentaire...
Voilà le principal grief à formuler contre ce cinéma (plutôt que les horaires), où, par ailleurs, je note un effort dans la programmation (y compris au niveau de la V.O.), pour qui fait l'effort de lire en détail chaque semaine la grille de programmes. Il reste que, pour les cinéphiles purs et durs, un passage par les autres cinémas de la région est indispensable pour ne pas rater certaines sorties.
21:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, occitanie, actualité, actualite, actu, actualites, actualités
vendredi, 03 janvier 2020
Le Miracle du saint inconnu
Cette coproduction franco-marocaine aborde le thème de la croyance de manière ironique. Tout commence avec la cavale d'un délinquant, qui, pour cacher son butin, creuse un trou au sommet d'une colline isolée, à côté d'un arbuste, dans le désert marocain. Juste après, il se fait arrêter.
Quand, quelques années plus tard, il sort de prison, il retourne dans le village où il pense récupérer son butin. Sauf qu'entre temps, un mausolée a été construit autour du trou, réputé être la tombe d'un saint inconnu. Cette sorte de chapelle attire pèlerins et touristes dans le village. Il y a du monde toute la journée et, la nuit, un gardien particulièrement vigilant protège les lieux, avec son chien.
L'intrigue joue sur les deux tableaux. D'un côté, elle se moque des superstitions. De l'autre, elle fait intervenir quelques événements quasi surnaturels, qui contenteront les croyants de base.
Le film vaut surtout par le tableau du village provincial brossé par le réalisateur. Les paysans s'appauvrissent, victimes de la sécheresse persistante. Leurs enfants ont tendance à quitter le village. D'autres professions s'en sortent mieux. Le coiffeur (apparemment uniquement pour messieurs) est aussi barbier et, à l'occasion, dentiste ! On découvre rapidement qu'il utilise deux mousses à raser de qualités différentes, en fonction du client. L'autre "boutique" incontournable est le cabinet du nouveau médecin, épaulé par un infirmier très au fait des coutumes villageoises. Le jeune homme fringant est vite déçu du travail qui s'offre à lui, mais il va trouver un moyen de se rendre très utile à la communauté... Le dernier endroit fréquenté du village (après le hammam) est l'hôtel, où se croisent touristes, pèlerins... et délinquants.
Cela nous mène au "héros" de l'histoire, le désormais ex-taulard. Celui-ci, rejoint par un comparse assez maladroit, échafaude des plans pour récupérer son magot. A chaque fois, cela échoue, pour une raison différente (surgissement d'un autre cambrioleur, début d'une procession, trouille du comparse...). C'est ma foi assez savoureux, même si l'on ne rit pas aux éclats.
Attention toutefois : le film a été un peu "survendu" par la presse spécialisée. C'est une petite comédie ironique, sympathique, avec une morale.
14:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films