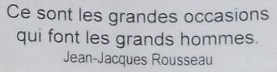mardi, 26 décembre 2023
Miss Fisher et le tombeau des larmes
Hier, en deuxième partie de soirée, après Downton Abbey, France 3 a diffusé Miss Fisher et le tombeau des larmes, l'adaptation en long-métrage de la série Miss Fisher enquête. Cette production australienne, très plaisante, raconte les aventures d'une femme célibataire, libre et fortunée, farouchement indépendante, qui joue les détectives à l'autre bout du monde durant l'Entre-deux-guerres.
L'intrigue de ce qui ressemble à un épisode double (censé, peut-être, conclure une série qui n'a pas eu droit à une quatrième saison) transporte les héros d'Australie au Royaume-Uni et (surtout) au Proche-Orient, plus précisément dans la Palestine sous mandat britannique. (Les téléspectateurs attentifs remarqueront que dans ce territoire ne semblent vivre que des Arabes et des Britanniques, sans aucune tension autre qu'une montée des revendications indépendantistes...)
D'abord engagée pour sauver la nièce d'un cheikh d'un destin funeste, l'intrépide détective va tenter d'élucider la mort étrange de presque tous les habitants d'un village. En parallèle, une énigme pose problème aux héros (Miss Fisher et son commissaire chéri, quelque peu malmené dans cette histoire) : celle d'un mystérieux tombeau, entouré d'une malédiction.
L'ambiance de la série est bien restituée, avec une touche d'Agatha Christie. Les personnages secondaires sont plutôt bien campés, même si l'on sent que l'attention de la scénariste comme du réalisateur s'est concentrée sur Essie Davis, toujours aussi pétillante dans le rôle principal... et quelle diversité de tenues, à la fois sexy et colorées !
C'est rythmé, émaillé d'humour, bref, divertissant.
P.S. I
Les fans de la série regretteront que certains de ses personnages récurrents (comme Dottie et Collins) n'apparaissent que fugacement.
P.S. II
C'est visible en replay jusqu'au 2 janvier 2024.
10:12 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, télé, médias, séries télé, séries télévisées
Miss Fisher et le tombeau des larmes
Hier, en deuxième partie de soirée, après Downton Abbey, France 3 a diffusé Miss Fisher et le tombeau des larmes, l'adaptation en long-métrage de la série Miss Fisher enquête. Cette production australienne, très plaisante, raconte les aventures d'une femme célibataire, libre et fortunée, farouchement indépendante, qui joue les détectives à l'autre bout du monde durant l'Entre-deux-guerres.
L'intrigue de ce qui ressemble à un épisode double (censé, peut-être, conclure une série qui n'a pas eu droit à une quatrième saison) transporte les héros d'Australie au Royaume-Uni et (surtout) au Proche-Orient, plus précisément dans la Palestine sous mandat britannique. (Les téléspectateurs attentifs remarqueront que dans ce territoire ne semblent vivre que des Arabes et des Britanniques, sans aucune tension autre qu'une montée des revendications indépendantistes...)
D'abord engagée pour sauver la nièce d'un cheikh d'un destin funeste, l'intrépide détective va tenter d'élucider la mort étrange de presque tous les habitants d'un village. En parallèle, une énigme pose problème aux héros (Miss Fisher et son commissaire chéri, quelque peu malmené dans cette histoire) : celle d'un mystérieux tombeau, entouré d'une malédiction.
L'ambiance de la série est bien restituée, avec une touche d'Agatha Christie. Les personnages secondaires sont plutôt bien campés, même si l'on sent que l'attention de la scénariste comme du réalisateur s'est concentrée sur Essie Davis, toujours aussi pétillante dans le rôle principal... et quelle diversité de tenues, à la fois sexy et colorées !
C'est rythmé, émaillé d'humour, bref, divertissant.
P.S. I
Les fans de la série regretteront que certains de ses personnages récurrents (comme Dottie et Collins) n'apparaissent que fugacement.
P.S. II
C'est visible en replay jusqu'au 2 janvier 2024.
10:12 Publié dans Cinéma, Proche-Orient, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, télé, médias, séries télé, séries télévisées
lundi, 25 décembre 2023
Jeff Panacloc - A la poursuite de Jean-Marc
- Comment ça, tes gamins ne veulent pas aller au jardin public ? Ils ne vont tout de même pas rester plantés devant la télé ou les jeux vidéos ?
- Rien ne les oblige à faire tout comme les autres. Si certains veulent aller au parc, qu'ils y aillent !
- Si je peux me permettre... Il y aurait bien la solution d'une sortie ciné, pour tout le monde ou ceux qui ne vont pas au jardin public... C'est moi qui invite !
- Ça dépend de ce que tu les emmènes voir, Riton... pas un de tes film scabreux, j'espère !
- Euh... non. Je pensais aux Trois Mousquetaires - Milady.
- Trop violent.
- Ou alors Aquaman 2 ?
- Plutôt pour des ados, ça.
- Migration ?
- Déjà vu.
La conversation risquait de s'éterniser. Il fallait proposer une solution de compromis, entre le film enfantin et l’œuvre plus mature.
- Et pourquoi pas Jeff Panacloc ? C'est tout public.
- C'est quoi, ça ? Une comédie améric...
- ... Maiiis non, voyons ! C'est l'histoire du ventriloque et de sa marionnette, un peu comme Tatayet autrefois.
Et voilà comment on se retrouve dans une salle obscure avec deux préadolescents, ravis d'échapper à la promenade au jardin public.
C'est le moment où le « tonton cinéphile » doit reconnaître qu'il a présenté le film de manière un peu biaisée. Par exemple, il a oublié de préciser que Jean-Marc (le singe-marionnette) est d'une abominable grossièreté, affectionnant les blagues scabreuses, souvent à connotation sexuelle. Le (jeune) public a été ravi...
L'histoire est celle de la rencontre (fictive) entre Jean-Marc et son "maître", Panacloc donc. Celui-ci est un brave gars, pas très dynamique ni vraiment futé, mais dont le charme et la gentillesse ont séduit la fille d'un richissime industriel (interprété par un Nicolas Marié toujours aussi cabotineur). Au cours du film, l'un des personnages suggère que la dulcinée a peut-être aussi été conquise par le « gros engin » de son fiancé...
Jean-Marc lui est une créature de laboratoire qui ne pense qu'à s'échapper et connaître la vraie vie. S'en suit une course-poursuite entre les deux héros et une bande de militaires psychopathes, la pire d'entre eux étant une lieutenante incarnée avec gourmandise par Claude Perron.
La mise en scène de Pierre-François Martin-Laval ne va pas rester dans les mémoires (ce qui n'étonnera pas de la part de celui dont on ne retiendra comme œuvre peut-être que Fahim). Je relève surtout l'énergie des acteurs et les punchlines grossières qui sortent de la bouche peluchée de Jean-Marc. Le public a aussi beaucoup ri aux (prévisibles) mésaventures du précédent fiancé (qui ne désespère pas de retrouver son ancien "poste").
Le film est tout à fait oubliable, mais l'on passe un bon moment.
P.S.
ATTENTION ! PETIT DIVULGÂCHAGE !
La conclusion du film pourrait sembler belle (et politiquement correcte) : le fiancé lâche la blanche fille de bourges (un peu cul pincé) pour épouser la charmante mécano (métisse), l'ex-fiancée se consolant dans les bras de son précédent prétendant, issu du même moule qu'elle. En gros, les prolos avec les prolos et les riches avec les riches. Bonjour la mixité sociale !
21:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Jeff Panacloc - A la poursuite de Jean-Marc
- Comment ça, tes gamins ne veulent pas aller au jardin public ? Ils ne vont tout de même pas rester plantés devant la télé ou les jeux vidéos ?
- Rien ne les oblige à faire tout comme les autres. Si certains veulent aller au parc, qu'ils y aillent !
- Si je peux me permettre... Il y aurait bien la solution d'une sortie ciné, pour tout le monde ou ceux qui ne vont pas au jardin public... C'est moi qui invite !
- Ça dépend de ce que tu les emmènes voir, Riton... pas un de tes film scabreux, j'espère !
- Euh... non. Je pensais aux Trois Mousquetaires - Milady.
- Trop violent.
- Ou alors Aquaman 2 ?
- Plutôt pour des ados, ça.
- Migration ?
- Déjà vu.
La conversation risquait de s'éterniser. Il fallait proposer une solution de compromis, entre le film enfantin et l’œuvre plus mature.
- Et pourquoi pas Jeff Panacloc ? C'est tout public.
- C'est quoi, ça ? Une comédie améric...
- ... Maiiis non, voyons ! C'est l'histoire du ventriloque et de sa marionnette, un peu comme Tatayet autrefois.
Et voilà comment on se retrouve dans une salle obscure avec deux préadolescents, ravis d'échapper à la promenade au jardin public.
C'est le moment où le « tonton cinéphile » doit reconnaître qu'il a présenté le film de manière un peu biaisée. Par exemple, il a oublié de préciser que Jean-Marc (le singe-marionnette) est d'une abominable grossièreté, affectionnant les blagues scabreuses, souvent à connotation sexuelle. Le (jeune) public a été ravi...
L'histoire est celle de la rencontre (fictive) entre Jean-Marc et son "maître", Panacloc donc. Celui-ci est un brave gars, pas très dynamique ni vraiment futé, mais dont le charme et la gentillesse ont séduit la fille d'un richissime industriel (interprété par un Nicolas Marié toujours aussi cabotineur). Au cours du film, l'un des personnages suggère que la dulcinée a peut-être aussi été conquise par le « gros engin » de son fiancé...
Jean-Marc lui est une créature de laboratoire qui ne pense qu'à s'échapper et connaître la vraie vie. S'en suit une course-poursuite entre les deux héros et une bande de militaires psychopathes, la pire d'entre eux étant une lieutenante incarnée avec gourmandise par Claude Perron.
La mise en scène de Pierre-François Martin-Laval ne va pas rester dans les mémoires (ce qui n'étonnera pas de la part de celui dont on ne retiendra comme œuvre peut-être que Fahim). Je relève surtout l'énergie des acteurs et les punchlines grossières qui sortent de la bouche peluchée de Jean-Marc. Le public a aussi beaucoup ri aux (prévisibles) mésaventures du précédent fiancé (qui ne désespère pas de retrouver son ancien "poste").
Le film est tout à fait oubliable, mais l'on passe un bon moment.
P.S.
ATTENTION ! PETIT DIVULGÂCHAGE !
La conclusion du film pourrait sembler belle (et politiquement correcte) : le fiancé lâche la blanche fille de bourges (un peu cul pincé) pour épouser la charmante mécano (métisse), l'ex-fiancée se consolant dans les bras de son précédent prétendant, issu du même moule qu'elle. En gros, les prolos avec les prolos et les riches avec les riches. Bonjour la mixité sociale !
21:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 24 décembre 2023
Aquaman et le royaume perdu
Il a fallu cinq ans à la Warner pour sortir la suite d'Aquaman. En cette période de fêtes, on imagine certains super-héros dégustant d'énormes escargots à l'ail... d'où, sans doute, le retour à l'écran des fourchettes géantes.
Le début se veut disruptif. On y découvre un Aquaman marié (à Mera) et père de famille. Quand il ne remplit pas sa fonction de roi des Atlantes, il vit sur Terre, boit des bières avec son vieux papa... et s'occupe de son rejeton. Ce n'est pas la première fois qu'on nous présente un personnage héroïque confronté aux soucis du quotidien, mais le combat d'Aquadad contre le pipi d'Aquababy ne manque pas de saveur.
La suite est plus classique... et bien mise en scène. On nous propose une séquence de "casse" (sous-marine) très enlevée et une autre d'évasion tout aussi réussie (en plein désert), avec un peu d'humour. Les effets spéciaux sont éblouissants et l'on prend plaisir aux retrouvailles des deux demi-frères.
Dans cet épisode, l'Antarctique va jouer un rôle particulier. Une partie du début y fait référence et la fin de l'histoire va nous y ramener. C'est là que se trouvent les vestiges du septième royaume d'Atlantis, une localisation qui n'étonnera en rien les lecteurs de La Nuit des temps, de René Barjavel.
Je n'ai en revanche guère apprécié l'un des arguments principaux du film : la lutte contre le réchauffement climatique provoqué par le méchant. La manière dont celui-ci s'y prend pour provoquer des catastrophes atmosphériques m'est apparue trop farfelue. Ceci dit, tout ce qui se passe sur l'île volcanique est plaisant à voir, entre les chamailleries des frères, la présence d'animaux fantastiques (dont un poulpe espion... assez facétieux) et le combat contre les vilains.
Sur très grand écran, c'est vraiment joli à voir... et cela permet aux vieux cinéphiles de supporter l'impression de déjà-vu au niveau scénaristique. Je ne vais pas trop en dire, mais cela ressemble quand même bigrement au Seigneur des anneaux.
Autre avantage de ce divertissement balisé : au contraire de nombre de ses semblables (qui nous embarquent pour 2h30-3h de bagarres numérisées), ce film de super-héros ne dure qu'1h50.
09:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Aquaman et le royaume perdu
Il a fallu cinq ans à la Warner pour sortir la suite d'Aquaman. En cette période de fêtes, on imagine certains super-héros dégustant d'énormes escargots à l'ail... d'où, sans doute, le retour à l'écran des fourchettes géantes.
Le début se veut disruptif. On y découvre un Aquaman marié (à Mera) et père de famille. Quand il ne remplit pas sa fonction de roi des Atlantes, il vit sur Terre, boit des bières avec son vieux papa... et s'occupe de son rejeton. Ce n'est pas la première fois qu'on nous présente un personnage héroïque confronté aux soucis du quotidien, mais le combat d'Aquadad contre le pipi d'Aquababy ne manque pas de saveur.
La suite est plus classique... et bien mise en scène. On nous propose une séquence de "casse" (sous-marine) très enlevée et une autre d'évasion tout aussi réussie (en plein désert), avec un peu d'humour. Les effets spéciaux sont éblouissants et l'on prend plaisir aux retrouvailles des deux demi-frères.
Dans cet épisode, l'Antarctique va jouer un rôle particulier. Une partie du début y fait référence et la fin de l'histoire va nous y ramener. C'est là que se trouvent les vestiges du septième royaume d'Atlantis, une localisation qui n'étonnera en rien les lecteurs de La Nuit des temps, de René Barjavel.
Je n'ai en revanche guère apprécié l'un des arguments principaux du film : la lutte contre le réchauffement climatique provoqué par le méchant. La manière dont celui-ci s'y prend pour provoquer des catastrophes atmosphériques m'est apparue trop farfelue. Ceci dit, tout ce qui se passe sur l'île volcanique est plaisant à voir, entre les chamailleries des frères, la présence d'animaux fantastiques (dont un poulpe espion... assez facétieux) et le combat contre les vilains.
Sur très grand écran, c'est vraiment joli à voir... et cela permet aux vieux cinéphiles de supporter l'impression de déjà-vu au niveau scénaristique. Je ne vais pas trop en dire, mais cela ressemble quand même bigrement au Seigneur des anneaux.
Autre avantage de ce divertissement balisé : au contraire de nombre de ses semblables (qui nous embarquent pour 2h30-3h de bagarres numérisées), ce film de super-héros ne dure qu'1h50.
09:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 23 décembre 2023
Voyage au pôle Sud
Jadis, avec La Marche de l'empereur, Luc Jacquet m'a procuré certaines de mes plus belles émotions cinématographiques. Six ans après le "tome 2" (L'Empereur), il revient avec un nouveau documentaire, mi-naturaliste mi-autobiographique, en forme de testament.
Le début nous emmène en Amérique du Sud, de plus en plus au sud, jusqu'au détroit de Magellan... et au-delà. Ici, le choix du noir et blanc s'avère pertinent, avec ces paysages filmés comme si nous étions en des temps homériques... mais sans humain (à part le réalisateur, fort heureusement pas trop présent à l'écran).
Cela se poursuit par le voyage en bateau et la rencontre avec la banquise... et des manchots papous, plus petits que leurs célèbres cousins. Jacquet sait que nombre de ses spectateurs attendent de retrouver ses "héros"... et il fait durer le plaisir, le coquin.
Dans un premier temps, les animaux les plus présents à l'écran sont les phoques, filmés avec une évidente tendresse et un grand souci du détail. On les voit se prélasser sur la banquise, se gratter, se faire des câlins... et même rêver ! L'un des caméramans a réussi à capturer un moment extraordinaire, qui nous montre l'un de ces phoques sans doute en plein sommeil paradoxal. Celles et ceux qui ont déjà vu un chat rêver ne seront pas (trop) surpris.
L'équipe montée autour du réalisateur est en quête d'une colonie particulière de manchots empereurs. Pour la trouver, il va falloir quitter le confort (relatif) du bateau pour s'aventurer un peu au-delà... mais le résultat en vaut la peine. Jacquet finit par tomber sur une tribu de sosies de Napoléon Bonaparte d'Apténodytes, bien plus expressifs que Joaquin Phoenix dans le dernier film de Ridley Scott.
Le documentaire ne s'arrête pas là. Jacquet s'aventure dans l'intérieur du continent et conclut sur de superbes images... hélas en noir et blanc. Certains plans somptueux auraient mérité un peu de couleur (utilisée épisodiquement).
Le film n'en constitue pas moins un salutaire bain de fraîcheur cinématographique.
17:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Voyage au pôle Sud
Jadis, avec La Marche de l'empereur, Luc Jacquet m'a procuré certaines de mes plus belles émotions cinématographiques. Six ans après le "tome 2" (L'Empereur), il revient avec un nouveau documentaire, mi-naturaliste mi-autobiographique, en forme de testament.
Le début nous emmène en Amérique du Sud, de plus en plus au sud, jusqu'au détroit de Magellan... et au-delà. Ici, le choix du noir et blanc s'avère pertinent, avec ces paysages filmés comme si nous étions en des temps homériques... mais sans humain (à part le réalisateur, fort heureusement pas trop présent à l'écran).
Cela se poursuit par le voyage en bateau et la rencontre avec la banquise... et des manchots papous, plus petits que leurs célèbres cousins. Jacquet sait que nombre de ses spectateurs attendent de retrouver ses "héros"... et il fait durer le plaisir, le coquin.
Dans un premier temps, les animaux les plus présents à l'écran sont les phoques, filmés avec une évidente tendresse et un grand souci du détail. On les voit se prélasser sur la banquise, se gratter, se faire des câlins... et même rêver ! L'un des caméramans a réussi à capturer un moment extraordinaire, qui nous montre l'un de ces phoques sans doute en plein sommeil paradoxal. Celles et ceux qui ont déjà vu un chat rêver ne seront pas (trop) surpris.
L'équipe montée autour du réalisateur est en quête d'une colonie particulière de manchots empereurs. Pour la trouver, il va falloir quitter le confort (relatif) du bateau pour s'aventurer un peu au-delà... mais le résultat en vaut la peine. Jacquet finit par tomber sur une tribu de sosies de Napoléon Bonaparte d'Apténodytes, bien plus expressifs que Joaquin Phoenix dans le dernier film de Ridley Scott.
Le documentaire ne s'arrête pas là. Jacquet s'aventure dans l'intérieur du continent et conclut sur de superbes images... hélas en noir et blanc. Certains plans somptueux auraient mérité un peu de couleur (utilisée épisodiquement).
Le film n'en constitue pas moins un salutaire bain de fraîcheur cinématographique.
17:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 20 décembre 2023
Perfect Days
J'ai enfin pu accéder à la dernière fiction de Wim Wenders (qui m'a récemment enchanté avec son documentaire Anselm : le bruit du temps).
Les dix premières minutes sont sans dialogue. On y découvre l'anti-héros, Hirayama, quinquagénaire taiseux, solitaire, qui vit dans un appartement modeste, aménagé (avec d'autres) dans ce qui ressemble à un ancien entrepôt. Très vite, on comprend qu'il a habilement tiré profit du moindre centimètre carré de son habitat. Chaque chose est à sa place.
Le matin, il se réveille au bruit du balayeur. Il enchaîne le même rituel, qui le conduit du brossage de dents à sa camionnette de fonction, en route pour nettoyer les toilettes publiques de Tokyo.
Une fois par semaine, cette succession d'actes habituels cède la place au jour de "repos", consacré au ménage, à la lessive, aux courses... et au développement des photographies prises avec un appareil argentique.
Hirayama est consciencieux, méticuleux. Il nettoie avec soin les cabinets de toilettes, du sol au plafond, en passant par les glaces et les parois extérieures. (On notera toutefois que les "lieux", quand il les prend en charge, ne sont pas d'une saleté repoussante. Viens en France, mon gaillard, on verra si tu kiffes autant !)
La mise en scène est d'une grande limpidité, ce qui ne signifie pas qu'elle soit insignifiante. A l'image de son personnage principal (interprété par Koji Yashuko, prix amplement mérité à Cannes), Wenders est parfois sur un nuage. Il réussit à rendre sa dignité aux gestes du quotidien et met en scène la beauté du simple (à moins que ce ne soit la simplicité belle).
Ce personnage m'a un peu rappelé un facteur, que j'ai connu autrefois. On avait discuté de nos boulots respectifs et lui s'était déclaré content de son sort. Certes, il se levait très tôt le matin, mais il aimait l'ambiance des débuts de journée endormis. Il adorait faire sa tournée, discutant au passage avec les gens. Il terminait son travail en début d'après-midi ; il avait ainsi le reste de la journée à lui, sachant qu'il lui fallait se coucher tôt.
Hirayama est de cette trempe. Après son travail, il va aux bains publics, boire un coup, se balade, lit un peu. C'est un habitué des commerces qu'il fréquente. Avec cette routine, il s'est constitué un triple cocon : celui de l'appartement, celui du travail et celui des loisirs. Tout cela est filmé avec empathie. On perçoit comme une petite musique du bonheur, rythmée par des titres anglo-saxons, souvent de style glam-rock.
Bien que côtoyant des centaines de ses contemporains, le héros semble vivre sur une autre planète, sans télévision, ni ordinateur, ni smartphone, écoutant de vieilles cassettes, achetant des livres d'occasion, se déplaçant le plus souvent à bicyclette. Cette "sobriété heureuse" a visiblement séduit au moins autant que les qualités strictement cinématographiques du film.
Et puis... cette rassurante petite routine va un peu se gripper. A cause de ce jeune collègue (IN-SU-PPOR-TABLE), paresseux et égocentrique. A cause de la nièce envahissante, qui compte sur l'oncle dont la famille a honte pour vaincre son mal-être. Il y a aussi de belles rencontres, comme celle de la petite copine du collègue, celle de la tenancière du bistrot et celle de son ex-mari. On attend (espère) aussi la rencontre avec l'auteur(e) du jeu glissé dans un recoin d'un cabinet.
C'est beau, apaisant, parfois un peu agaçant (quand le petit con est à l'écran), parfois longuet. (Wenders étire un peu trop ses effets.) Mais c'est un film à nul autre pareil, d'un septuagénaire à l'apogée de son art, qui ne cherche à suivre aucune mode, aucun conformisme ambiant.
22:40 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Perfect Days
J'ai enfin pu accéder à la dernière fiction de Wim Wenders (qui m'a récemment enchanté avec son documentaire Anselm : le bruit du temps).
Les dix premières minutes sont sans dialogue. On y découvre l'anti-héros, Hirayama, quinquagénaire taiseux, solitaire, qui vit dans un appartement modeste, aménagé (avec d'autres) dans ce qui ressemble à un ancien entrepôt. Très vite, on comprend qu'il a habilement tiré profit du moindre centimètre carré de son habitat. Chaque chose est à sa place.
Le matin, il se réveille au bruit du balayeur. Il enchaîne le même rituel, qui le conduit du brossage de dents à sa camionnette de fonction, en route pour nettoyer les toilettes publiques de Tokyo.
Une fois par semaine, cette succession d'actes habituels cède la place au jour de "repos", consacré au ménage, à la lessive, aux courses... et au développement des photographies prises avec un appareil argentique.
Hirayama est consciencieux, méticuleux. Il nettoie avec soin les cabinets de toilettes, du sol au plafond, en passant par les glaces et les parois extérieures. (On notera toutefois que les "lieux", quand il les prend en charge, ne sont pas d'une saleté repoussante. Viens en France, mon gaillard, on verra si tu kiffes autant !)
La mise en scène est d'une grande limpidité, ce qui ne signifie pas qu'elle soit insignifiante. A l'image de son personnage principal (interprété par Koji Yashuko, prix amplement mérité à Cannes), Wenders est parfois sur un nuage. Il réussit à rendre sa dignité aux gestes du quotidien et met en scène la beauté du simple (à moins que ce ne soit la simplicité belle).
Ce personnage m'a un peu rappelé un facteur, que j'ai connu autrefois. On avait discuté de nos boulots respectifs et lui s'était déclaré content de son sort. Certes, il se levait très tôt le matin, mais il aimait l'ambiance des débuts de journée endormis. Il adorait faire sa tournée, discutant au passage avec les gens. Il terminait son travail en début d'après-midi ; il avait ainsi le reste de la journée à lui, sachant qu'il lui fallait se coucher tôt.
Hirayama est de cette trempe. Après son travail, il va aux bains publics, boire un coup, se balade, lit un peu. C'est un habitué des commerces qu'il fréquente. Avec cette routine, il s'est constitué un triple cocon : celui de l'appartement, celui du travail et celui des loisirs. Tout cela est filmé avec empathie. On perçoit comme une petite musique du bonheur, rythmée par des titres anglo-saxons, souvent de style glam-rock.
Bien que côtoyant des centaines de ses contemporains, le héros semble vivre sur une autre planète, sans télévision, ni ordinateur, ni smartphone, écoutant de vieilles cassettes, achetant des livres d'occasion, se déplaçant le plus souvent à bicyclette. Cette "sobriété heureuse" a visiblement séduit au moins autant que les qualités strictement cinématographiques du film.
Et puis... cette rassurante petite routine va un peu se gripper. A cause de ce jeune collègue (IN-SU-PPOR-TABLE), paresseux et égocentrique. A cause de la nièce envahissante, qui compte sur l'oncle dont la famille a honte pour vaincre son mal-être. Il y a aussi de belles rencontres, comme celle de la petite copine du collègue, celle de la tenancière du bistrot et celle de son ex-mari. On attend (espère) aussi la rencontre avec l'auteur(e) du jeu glissé dans un recoin d'un cabinet.
C'est beau, apaisant, parfois un peu agaçant (quand le petit con est à l'écran), parfois longuet. (Wenders étire un peu trop ses effets.) Mais c'est un film à nul autre pareil, d'un septuagénaire à l'apogée de son art, qui ne cherche à suivre aucune mode, aucun conformisme ambiant.
22:40 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 16 décembre 2023
Hunger Games - La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
Je n'ai lu aucun des romans de Suzanne Collins. J'ai fini par voir la quadrilogie d'origine (poussé par une mienne connaissance d'un âge moins avancé que le mien), mais je ne l'avais pas chroniquée. En gros, j'avais apprécié la mise en scène d'un régime totalitaire appuyé sur de la télé-réalité, mais les errements sentimentaux du personnage principal (interprété de surcroît par une actrice peu expressive au possible) avaient fini par me lasser.
Je n'avais donc pas l'intention de rempiler avec ce préquelle... mais le bouche-à-oreille étant bon (voir notamment ce qu'en dit dasola), je me suis laissé tenter.
Le début m'a fait un peu peur, parce que j'ai eu une impression de déjà-vu, avec la chanson en prime. Il ne faut pas le cacher : ce volet de la saga a un petit goût de The Voice. (Beurk...)
Où réside l'intérêt ? Dans la formation intellectuelle et morale du futur dictateur Coriolanus Snow. On est 64 ans avant le temps du premier épisode sorti en salles et le jeune Snow, bien qu'issu d'une famille de l'élite, connaît une forme de déclassement social depuis le décès de son père. Il tente de s'élever par les études... mais c'est sa participation forcée (en tant que mentor) aux dixièmes Hunger Games qui pourrait lui servir de tremplin. Les choses se compliquent pour lui quand il commence à éprouver des sentiments pour sa "protégée", une semi-roulure du District 12 (celui de la future Katniss Everdeen... tiens, tiens), évidemment incarnée par une pure beauté.
La suite est vraiment prenante. C'est un excellent film d'aventures, avec manigances, trahisons, coups fourrés, rebondissements, ruptures de rythme, de l'émotion, de l'action, du sang... et pas un poil de sexe. J'ai juste noté un gros temps mort, dans la troisième partie. On aurait pu et dû faire plus court... et un peu mieux travailler le profil psychologique du "héros". En gros, un jeune homme ambitieux, revanchard, privé de ses parents, connaissant un amour contrarié et ne devant sa survie qu'à la prise de décisions cornéliennes va devenir le maître du monde. (Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, Hollywood va nous pondre un biopic pour nous expliquer qu'Adolf Hitler a connu une jeunesse difficile et, qu'au fond, c'était un type plutôt sympa. Quand on voit comment a été géré le récent scandale de l'université Harvard, on comprend qu'une partie de la supposée élite états-unienne commence à pourrir par la moelle.)
Si on laisse de côté le fait qu'une future ordure fasse l'objet d'un film conduisant les spectateurs à éprouver de l'empathie pour lui, on peut se laisser aller à ces 2h30 divertissantes. C'est bien fichu.
P.S.
ATTENTION !
DIVULGÂCHAGES
EN VUE !
A plusieurs reprises, de petits détails sont insérés, soit pour préparer les épisodes suivants, soit pour relier de manière plus évidente ce préquelle à la saga d'origine.
Ainsi, lorsque le couple de "héros" gambade dans les folles prairies de l'insouciance, la jeune Lucy Gray évoque sa fleur préférée, la katniss. Elle disparaît à la fin de cet épisode... et l'on ne peut pas croire que les scénaristes ne l'ont pas gardée sous le coude, ne serait-ce que pour accoucher. (Même si l'on n'a jamais vu les tourtereaux aller jusqu'à l'acte, il va sans dire qu'ils ont déjà joué au docteur...) Compte tenu de l'écart qui sépare ce film de la saga ayant pour héroïne Katniss Everdeen, il semble plausible d'imaginer qu'on va faire d'elle une descendante de Lucy et Coriolanus (une petite ou arrière-petite-fille ?). Le geai moqueur est-il apparenté à l'oiseau chanteur ? Le suspens est insoutenable...
21:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Hunger Games - La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
Je n'ai lu aucun des romans de Suzanne Collins. J'ai fini par voir la quadrilogie d'origine (poussé par une mienne connaissance d'un âge moins avancé que le mien), mais je ne l'avais pas chroniquée. En gros, j'avais apprécié la mise en scène d'un régime totalitaire appuyé sur de la télé-réalité, mais les errements sentimentaux du personnage principal (interprété de surcroît par une actrice peu expressive au possible) avaient fini par me lasser.
Je n'avais donc pas l'intention de rempiler avec ce préquelle... mais le bouche-à-oreille étant bon (voir notamment ce qu'en dit dasola), je me suis laissé tenter.
Le début m'a fait un peu peur, parce que j'ai eu une impression de déjà-vu, avec la chanson en prime. Il ne faut pas le cacher : ce volet de la saga a un petit goût de The Voice. (Beurk...)
Où réside l'intérêt ? Dans la formation intellectuelle et morale du futur dictateur Coriolanus Snow. On est 64 ans avant le temps du premier épisode sorti en salles et le jeune Snow, bien qu'issu d'une famille de l'élite, connaît une forme de déclassement social depuis le décès de son père. Il tente de s'élever par les études... mais c'est sa participation forcée (en tant que mentor) aux dixièmes Hunger Games qui pourrait lui servir de tremplin. Les choses se compliquent pour lui quand il commence à éprouver des sentiments pour sa "protégée", une semi-roulure du District 12 (celui de la future Katniss Everdeen... tiens, tiens), évidemment incarnée par une pure beauté.
La suite est vraiment prenante. C'est un excellent film d'aventures, avec manigances, trahisons, coups fourrés, rebondissements, ruptures de rythme, de l'émotion, de l'action, du sang... et pas un poil de sexe. J'ai juste noté un gros temps mort, dans la troisième partie. On aurait pu et dû faire plus court... et un peu mieux travailler le profil psychologique du "héros". En gros, un jeune homme ambitieux, revanchard, privé de ses parents, connaissant un amour contrarié et ne devant sa survie qu'à la prise de décisions cornéliennes va devenir le maître du monde. (Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, Hollywood va nous pondre un biopic pour nous expliquer qu'Adolf Hitler a connu une jeunesse difficile et, qu'au fond, c'était un type plutôt sympa. Quand on voit comment a été géré le récent scandale de l'université Harvard, on comprend qu'une partie de la supposée élite états-unienne commence à pourrir par la moelle.)
Si on laisse de côté le fait qu'une future ordure fasse l'objet d'un film conduisant les spectateurs à éprouver de l'empathie pour lui, on peut se laisser aller à ces 2h30 divertissantes. C'est bien fichu.
P.S.
ATTENTION !
DIVULGÂCHAGES
EN VUE !
A plusieurs reprises, de petits détails sont insérés, soit pour préparer les épisodes suivants, soit pour relier de manière plus évidente ce préquelle à la saga d'origine.
Ainsi, lorsque le couple de "héros" gambade dans les folles prairies de l'insouciance, la jeune Lucy Gray évoque sa fleur préférée, la katniss. Elle disparaît à la fin de cet épisode... et l'on ne peut pas croire que les scénaristes ne l'ont pas gardée sous le coude, ne serait-ce que pour accoucher. (Même si l'on n'a jamais vu les tourtereaux aller jusqu'à l'acte, il va sans dire qu'ils ont déjà joué au docteur...) Compte tenu de l'écart qui sépare ce film de la saga ayant pour héroïne Katniss Everdeen, il semble plausible d'imaginer qu'on va faire d'elle une descendante de Lucy et Coriolanus (une petite ou arrière-petite-fille ?). Le geai moqueur est-il apparenté à l'oiseau chanteur ? Le suspens est insoutenable...
21:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan
Même si c'est peut-être principalement pour une raison commerciale, je trouve que la ressortie en salles du premier volet des aventures des mousquetaires est une excellente idée, le film étant tout de même conçu pour être d'abord vu au cinéma.
Parmi les bonnes idées des scénaristes, il y a la volonté de s'émanciper un peu de la trame écrite jadis par Alexandre Dumas (et ses "assistants"...). Ainsi, dans le roman, le jeune d'Artagnan en route pour Paris ne croise pas aussi tôt le chemin de Milady. De même, Athos n'est pas enfermé à cause d'un complot contre sa personne... mais cela donne du tonus à un début d'intrigue qu'on croit connaître par cœur.
C'est aussi dû au talent des acteurs. On sent notamment que Pio Marmaï et Romain Duris ont "kiffé" incarner respectivement Porthos et Aramis, de surcroît servis par de bonnes répliques. Vincent Cassel est ténébreux à souhait en Athos. Je trouve toutefois François Civil un ton en-dessous dans le rôle de d'Artagnan... mais la romance qui s'ébauche avec Constance Bonacieux est à la fois drôle et touchante, grâce sans doute au talent (et au charme) de Lyna Khoudri.
Cela m'amène au principal personnage féminin (appelé peut-être à devenir le principal personnage tout court) : Milady, qui était déjà fascinante dans le roman et à laquelle Eva Green apporte sa beauté vénéneuse... mmm.
Je ne voudrais cependant pas oublier les rôles secondaires (parfois déterminants dans l'intrigue) : Louis Garrel est très bon en Louis XIII, Marc Barbé impeccable en capitaine de Tréville... et Eric Ruf sulfureux en cardinal de Richelieu, un personnage particulièrement maltraité par Dumas, dont l’œuvre n'a pas grand chose d'historique. Celui qui, ici, est sur le point de devenir le principal ministre du roi, a consacré une grande partie de son labeur politique à lutter contre les factions et les complots, au service du royaume et non de ses intérêts propres.
Fort heureusement, Dumas comme ses adaptateurs (contrairement à Ridley Scott) n'ont pas de prétention historique. Ils sont là pour nous divertir. On a donc droit à un foisonnement de péripéties, des complots, des poursuites, des enlèvements, des duels (sanglants quand il le faut... ce n'est pas un film de Bisounours). C'est spectaculaire, enlevé (réalisation très efficace)... et joli à voir.
J'ai beaucoup entendu parler du grain de l'image et de son aspect un peu sombre. Franchement, sur un grand écran, ce n'est aucunement gênant. (Évidemment, en téléchargement, cela doit moins "donner"...) Peut-être plusieurs scènes ont-elles été un peu moins éclairées pour masquer le fait que, dans certains plans (lors des combats à l'épée et de la poursuite à cheval), les acteurs ont parfois été remplacés par des doublures. Le procédé a d'ailleurs parfaitement fonctionné, puisqu'il est quasiment impossible de voir quand on a procédé à une substitution.
Ce furent deux heures de grand spectacle, feuilletonnesque, et j'attends la suite avec impatience.
13:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Les Trois Mousquetaires : D'Artagnan
Même si c'est peut-être principalement pour une raison commerciale, je trouve que la ressortie en salles du premier volet des aventures des mousquetaires est une excellente idée, le film étant tout de même conçu pour être d'abord vu au cinéma.
Parmi les bonnes idées des scénaristes, il y a la volonté de s'émanciper un peu de la trame écrite jadis par Alexandre Dumas (et ses "assistants"...). Ainsi, dans le roman, le jeune d'Artagnan en route pour Paris ne croise pas aussi tôt le chemin de Milady. De même, Athos n'est pas enfermé à cause d'un complot contre sa personne... mais cela donne du tonus à un début d'intrigue qu'on croit connaître par cœur.
C'est aussi dû au talent des acteurs. On sent notamment que Pio Marmaï et Romain Duris ont "kiffé" incarner respectivement Porthos et Aramis, de surcroît servis par de bonnes répliques. Vincent Cassel est ténébreux à souhait en Athos. Je trouve toutefois François Civil un ton en-dessous dans le rôle de d'Artagnan... mais la romance qui s'ébauche avec Constance Bonacieux est à la fois drôle et touchante, grâce sans doute au talent (et au charme) de Lyna Khoudri.
Cela m'amène au principal personnage féminin (appelé peut-être à devenir le principal personnage tout court) : Milady, qui était déjà fascinante dans le roman et à laquelle Eva Green apporte sa beauté vénéneuse... mmm.
Je ne voudrais cependant pas oublier les rôles secondaires (parfois déterminants dans l'intrigue) : Louis Garrel est très bon en Louis XIII, Marc Barbé impeccable en capitaine de Tréville... et Eric Ruf sulfureux en cardinal de Richelieu, un personnage particulièrement maltraité par Dumas, dont l’œuvre n'a pas grand chose d'historique. Celui qui, ici, est sur le point de devenir le principal ministre du roi, a consacré une grande partie de son labeur politique à lutter contre les factions et les complots, au service du royaume et non de ses intérêts propres.
Fort heureusement, Dumas comme ses adaptateurs (contrairement à Ridley Scott) n'ont pas de prétention historique. Ils sont là pour nous divertir. On a donc droit à un foisonnement de péripéties, des complots, des poursuites, des enlèvements, des duels (sanglants quand il le faut... ce n'est pas un film de Bisounours). C'est spectaculaire, enlevé (réalisation très efficace)... et joli à voir.
J'ai beaucoup entendu parler du grain de l'image et de son aspect un peu sombre. Franchement, sur un grand écran, ce n'est aucunement gênant. (Évidemment, en téléchargement, cela doit moins "donner"...) Peut-être plusieurs scènes ont-elles été un peu moins éclairées pour masquer le fait que, dans certains plans (lors des combats à l'épée et de la poursuite à cheval), les acteurs ont parfois été remplacés par des doublures. Le procédé a d'ailleurs parfaitement fonctionné, puisqu'il est quasiment impossible de voir quand on a procédé à une substitution.
Ce furent deux heures de grand spectacle, feuilletonnesque, et j'attends la suite avec impatience.
13:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 15 décembre 2023
Napoléon pour les nuls
- Dis tonton, pourquoi tu n'aimes pas ce film ?
- Eh bien, ma petite Apolline, tout d'abord parce qu'il est farci d'erreurs historiques... un comble pour ce qui se présente comme un biopic !
- Des erreurs... comme quoi ?
- Dès le début, dans la séquence sur Marie-Antoinette. Tu te rappelles ?
- Oui, elle a pourtant bien été guillotinée ?
- Oui, et en présence d'une foule hostile (voire hargneuse), ce que même des dirigeants révolutionnaires ont regretté. L'ex-reine de France a fait preuve à cette occasion d'une incontestable dignité... un beau contraste avec ce que fut son comportement passé.
- Alors, c'est vrai ?
- Pas totalement. Tout d'abord, d'après ce qu'on voit dans le film, elle aurait été exécutée dans la cour d'un château (Versailles ?)... alors que la scène a eu lieu à 30-40 kilomètres de là, en plein centre de Paris, place de la Révolution (actuelle place de la Concorde). De plus, quand elle a été conduite sur le lieu de l'exécution, ses cheveux avaient été coupés (pour éviter qu'ils ne gênent le tranchant de la guillotine)...
- C'est super glauque !
- Les gros plans faits (dans le film) sur la main du bourreau retenant les cheveux le sont encore plus... parce qu'ils sont historiquement faux !
- Et Napoléon, il était bien là ?
- Eh non ! A cette époque, il se trouvait déjà à Toulon. En revanche, la manière dont est mise en scène la prise de la ville (et le départ des Anglais) n'est pas très éloignée de la réalité.
- Il a bien utilisé des canons alors ?
- Oui.
- Comme sur les pyramides ?
- Pas du tout. Il n'a pas fait tirer sur ces monuments... Les canons de l'armée française n'auraient pas été capables, à l'époque, de faire de genre de dégâts.
- Et Joséphine, c'était bien sa meuf ?
- Ah, ça, oui. Il en a même été raide dingue à une époque. Sur la fin de sa vie, malgré les rancœurs et les reproches, il avait gardé des sentiments pour elle. Mais, contrairement à ce qui est montré dans le film, c'est lorsqu'il se trouvait à l'île d'Elbe (lors de son premier exil) qu'il a appris sa mort, pas en arrivant en France métropolitaine.
- Elle l'a trompé, non ?
- Oui !... et plus d'une fois... tout comme lui, d'ailleurs.
- Avec la fille que sa mère lui a présentée ?
- Oui, mais cela ne s'est pas passé comme dans le film. Celui-ci montre Letizia Bonaparte comme une entremetteuse, alors que la liaison entre Napoléon et la jeune noble est plus née du hasard que d'un plan visant à vérifier sa capacité à avoir des enfants.
- Ils ont bien eu un fils ?
- Oui et on l'a appelé Léon (sans "Napo" devant). Il paraît qu'il ressemblait physiquement à son père biologique... mais qu'il n'avait pas ses qualités intellectuelles.
- Dis tonton, Napoléon s'est bien remarié avec une Autrichienne et ils ont eu un enfant ?
- Oui Apolline. La relation de couple entre l'empereur et la jeune Marie-Louise (petite-nièce de Marie-Antoinette !), qui avait 22 ans de moins que lui...
- Le vieux cochon !
- Oh, on a connu pire, avant et après. Ceci dit, le couple se serait bien entendu. Leur fils, celui qu'on a surnommé "le Roi de Rome" puis "l'Aiglon", n'a pas vécu très longtemps. Né en 1811, Napoléon II, emprisonné par les Autrichiens, appelé désormais duc de Reichstadt, était de santé fragile. Il est mort en 1832.
- Et avec Joséphine, Napoléon n'a pas eu d'enfant ?
- Non, et le film le montre bien. Elle avait eu deux enfants de son premier mariage, avec Alexandre de Beauharnais... dont Hortense, qui a épousé un frère de Napoléon (Louis), dont elle a eu un fils... le futur Napoléon III !
- Mais c'est Dallas, ton histoire, tonton !
- Et tu ne sais pas tout. Figure-toi que Joséphine était plus âgée que Napoléon. Étant née en 1763, elle avait six ans de plus que lui, contrairement à ce que montre le film (au moment de la signature du contrat de mariage). Autre erreur : la représentation du sacre. C'est bien Napoléon qui a posé la couronne sur sa tête et sur celle de Joséphine, mais cela n'a pas provoqué de mouvement de surprise dans l'assemblée, puisque ce rituel avait été négocié et programmé avec les services du Pape Pie VII. En outre, Ridley Scott, qui ne veut présenter Napoléon que comme un restaurateur de monarchie, "oublie" la suite de la cérémonie, quand le nouvel empereur prête serment de fidélité aux valeurs de la Révolution et promet de conserver les propriétés acquises sur les biens de l’Église et de la noblesse (ce qu'on a appelé les "biens nationaux").
- Dis donc, il n'aurait pas quelque chose contre la France, ce Ridley Scott ?
- Tu poses une bonne question, Apolline. On avait eu la même impression avec son Robin des Bois, une nouvelle version de la légende. Rappelle-toi, tu l'as vu à la télé.
- Oui. D'ailleurs, c'était pas terrible.
- Ici, il n'y a quasiment aucun personnage français à sauver. Napoléon est un dictateur, un général sanguinaire, un mauvais mari, mauvais amant. Les Françaises sont des "femmes faciles" (gros cliché qui a la vie dure chez les Anglo-Saxons). Les révolutionnaires sont soit des barbares soit des corrompus. Louis XVIII est un abruti... Cela se ressent jusque dans la représentation des batailles.
- Elles sont pourtant impressionnantes.
- Je le reconnais... et c'est peut-être la seule raison d'aller voir ce film, en salle. Il est toutefois dommage que Scott ait "zappé" la campagne d'Italie, au cours de laquelle le jeune officier corse a fait des merveilles avec peu de moyens. Mais la mise en scène de la bataille d'Austerlitz, bien qu'émaillée d'inexactitudes, ne manque pas de souffle. De même la campagne de Russie, bien qu'écourtée à l'extrême, témoigne d'un réel savoir-faire. Quant à Waterloo, elle n'est présentée que d'un point de vue favorable aux Anglais, qui ont sans doute été sauvés sur le fil par les Prussiens, tandis que Napoléon, malade, était moins alerte que d'habitude... et qu'il n'a pas pu compter sur les renforts attendus.
- En clair, c'est pas si nul que ça, mais c'est plus du roman que de l'histoire.
- Tu as tout compris.
19:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Napoléon pour les nuls
- Dis tonton, pourquoi tu n'aimes pas ce film ?
- Eh bien, ma petite Apolline, tout d'abord parce qu'il est farci d'erreurs historiques... un comble pour ce qui se présente comme un biopic !
- Des erreurs... comme quoi ?
- Dès le début, dans la séquence sur Marie-Antoinette. Tu te rappelles ?
- Oui, elle a pourtant bien été guillotinée ?
- Oui, et en présence d'une foule hostile (voire hargneuse), ce que même des dirigeants révolutionnaires ont regretté. L'ex-reine de France a fait preuve à cette occasion d'une incontestable dignité... un beau contraste avec ce que fut son comportement passé.
- Alors, c'est vrai ?
- Pas totalement. Tout d'abord, d'après ce qu'on voit dans le film, elle aurait été exécutée dans la cour d'un château (Versailles ?)... alors que la scène a eu lieu à 30-40 kilomètres de là, en plein centre de Paris, place de la Révolution (actuelle place de la Concorde). De plus, quand elle a été conduite sur le lieu de l'exécution, ses cheveux avaient été coupés (pour éviter qu'ils ne gênent le tranchant de la guillotine)...
- C'est super glauque !
- Les gros plans faits (dans le film) sur la main du bourreau retenant les cheveux le sont encore plus... parce qu'ils sont historiquement faux !
- Et Napoléon, il était bien là ?
- Eh non ! A cette époque, il se trouvait déjà à Toulon. En revanche, la manière dont est mise en scène la prise de la ville (et le départ des Anglais) n'est pas très éloignée de la réalité.
- Il a bien utilisé des canons alors ?
- Oui.
- Comme sur les pyramides ?
- Pas du tout. Il n'a pas fait tirer sur ces monuments... Les canons de l'armée française n'auraient pas été capables, à l'époque, de faire de genre de dégâts.
- Et Joséphine, c'était bien sa meuf ?
- Ah, ça, oui. Il en a même été raide dingue à une époque. Sur la fin de sa vie, malgré les rancœurs et les reproches, il avait gardé des sentiments pour elle. Mais, contrairement à ce qui est montré dans le film, c'est lorsqu'il se trouvait à l'île d'Elbe (lors de son premier exil) qu'il a appris sa mort, pas en arrivant en France métropolitaine.
- Elle l'a trompé, non ?
- Oui !... et plus d'une fois... tout comme lui, d'ailleurs.
- Avec la fille que sa mère lui a présentée ?
- Oui, mais cela ne s'est pas passé comme dans le film. Celui-ci montre Letizia Bonaparte comme une entremetteuse, alors que la liaison entre Napoléon et la jeune noble est plus née du hasard que d'un plan visant à vérifier sa capacité à avoir des enfants.
- Ils ont bien eu un fils ?
- Oui et on l'a appelé Léon (sans "Napo" devant). Il paraît qu'il ressemblait physiquement à son père biologique... mais qu'il n'avait pas ses qualités intellectuelles.
- Dis tonton, Napoléon s'est bien remarié avec une Autrichienne et ils ont eu un enfant ?
- Oui Apolline. La relation de couple entre l'empereur et la jeune Marie-Louise (petite-nièce de Marie-Antoinette !), qui avait 22 ans de moins que lui...
- Le vieux cochon !
- Oh, on a connu pire, avant et après. Ceci dit, le couple se serait bien entendu. Leur fils, celui qu'on a surnommé "le Roi de Rome" puis "l'Aiglon", n'a pas vécu très longtemps. Né en 1811, Napoléon II, emprisonné par les Autrichiens, appelé désormais duc de Reichstadt, était de santé fragile. Il est mort en 1832.
- Et avec Joséphine, Napoléon n'a pas eu d'enfant ?
- Non, et le film le montre bien. Elle avait eu deux enfants de son premier mariage, avec Alexandre de Beauharnais... dont Hortense, qui a épousé un frère de Napoléon (Louis), dont elle a eu un fils... le futur Napoléon III !
- Mais c'est Dallas, ton histoire, tonton !
- Et tu ne sais pas tout. Figure-toi que Joséphine était plus âgée que Napoléon. Étant née en 1763, elle avait six ans de plus que lui, contrairement à ce que montre le film (au moment de la signature du contrat de mariage). Autre erreur : la représentation du sacre. C'est bien Napoléon qui a posé la couronne sur sa tête et sur celle de Joséphine, mais cela n'a pas provoqué de mouvement de surprise dans l'assemblée, puisque ce rituel avait été négocié et programmé avec les services du Pape Pie VII. En outre, Ridley Scott, qui ne veut présenter Napoléon que comme un restaurateur de monarchie, "oublie" la suite de la cérémonie, quand le nouvel empereur prête serment de fidélité aux valeurs de la Révolution et promet de conserver les propriétés acquises sur les biens de l’Église et de la noblesse (ce qu'on a appelé les "biens nationaux").
- Dis donc, il n'aurait pas quelque chose contre la France, ce Ridley Scott ?
- Tu poses une bonne question, Apolline. On avait eu la même impression avec son Robin des Bois, une nouvelle version de la légende. Rappelle-toi, tu l'as vu à la télé.
- Oui. D'ailleurs, c'était pas terrible.
- Ici, il n'y a quasiment aucun personnage français à sauver. Napoléon est un dictateur, un général sanguinaire, un mauvais mari, mauvais amant. Les Françaises sont des "femmes faciles" (gros cliché qui a la vie dure chez les Anglo-Saxons). Les révolutionnaires sont soit des barbares soit des corrompus. Louis XVIII est un abruti... Cela se ressent jusque dans la représentation des batailles.
- Elles sont pourtant impressionnantes.
- Je le reconnais... et c'est peut-être la seule raison d'aller voir ce film, en salle. Il est toutefois dommage que Scott ait "zappé" la campagne d'Italie, au cours de laquelle le jeune officier corse a fait des merveilles avec peu de moyens. Mais la mise en scène de la bataille d'Austerlitz, bien qu'émaillée d'inexactitudes, ne manque pas de souffle. De même la campagne de Russie, bien qu'écourtée à l'extrême, témoigne d'un réel savoir-faire. Quant à Waterloo, elle n'est présentée que d'un point de vue favorable aux Anglais, qui ont sans doute été sauvés sur le fil par les Prussiens, tandis que Napoléon, malade, était moins alerte que d'habitude... et qu'il n'a pas pu compter sur les renforts attendus.
- En clair, c'est pas si nul que ça, mais c'est plus du roman que de l'histoire.
- Tu as tout compris.
19:33 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 10 décembre 2023
Fremont
Le titre de cette fiction un peu austère, en noir et blanc, fait référence à une ville californienne, située au nord de la célèbre Silicon Valley... mais où vivent (et travaillent) des personnes moins fortunées que les geeks qui transforment notre monde.
On y trouve paraît-il la plus importante communauté afghane des États-Unis, y compris l'héroïne de l'histoire, Donya, ex-traductrice pour l'armée d'Oncle Sam, qui a réussi à fuir son pays avant de finir entre quatre planches...
En s'installant aux States, elle a préservé sa liberté, mais connaît une forme de déclassement social : elle est simple employée dans une usine de fabrication de cookies fortune, ces petits gâteaux d'origine chinoise, dont la coque contient un papier sur lequel est inscrite une courte formule, en général sujette à plusieurs interprétations.
Cette entreprise appartient à un couple de Sino-Américains, l'époux étant le fils du fondateur. Il est bienveillant avec la nouvelle employée, peut-être parce qu'elle est jolie, peut-être parce qu'elle est sérieuse... peut-être parce qu'elle lui rappelle ses propres débuts. C'est une autre migrante asiatique, qui tente de faire son trou au pays de la libre entreprise. L'épouse est beaucoup moins amicale avec le "petit personnel", comme on va pouvoir s'en rendre compte tout au long du film.
Celui-ci est constitué d'un montage de plans presque tous fixes, souvent en champ-contrechamp, dans un nombre limité de lieux : l'usine de cookies, les logements des employées, le cabinet du psychiatre, le restaurant communautaire... On respire un peu plus vers la fin, quand la jeune femme tente de forcer son destin... (Je n'en dis pas plus.)
Le début n'est pas le plus agréable à suivre. Il faut s'habituer au style du réalisateur (qui mise beaucoup sur l'implicite, le non-dit)... et supporter la description d'un quotidien au départ peu épanouissant.
Petit à petit, cela s'éclaire, non pas tant parce que la situation s'améliore soudainement, mais parce que Donya se prend davantage en mains. Le cinéaste introduit aussi de rafraîchissantes petites pointes d'humour. Tout d'abord, il y a les circonstances dans lesquelles l'héroïne va connaître une promotion, au sein de l'entreprise. Il y a ensuite la drôle de relation médecin-patiente qui se noue, à tel point qu'on finit par se demander qui analyse l'autre ! Il y a aussi la découverte des messages dans les petits gâteaux... et les conséquences insoupçonnées de la tentative effectuée par Donya. (On ne sait jamais entre quelles mains peut tomber "son" message...) Il y a encore le comportement du patron du petit resto, accro à une sorte de télénovela afghane, et qui donne des conseils à sa cliente régulière. Il y a enfin la réaction de la jeune femme, à la fin, délicieuse.
La plus belle des rencontres n'est pas celle qu'elle avait prévue, et c'est à ce moment-là que la caméra se fait plus libre et que la vie de la jeune femme gagne en saveur.
J'ai trouvé cela très beau.
P.S. I
En lisant Le Canard enchaîné de cette semaine, j'ai appris que la personne qui incarne Donya, Anaita Wali Zada, est une ancienne présentatrice de télévision, qui a dû fuir l'Afghanistan en 2021. Ses débuts d'actrice sont prometteurs.
P.S. II
Avec mon ticket d'entrée (pour la séance de ce film), j'ai reçu un cookie fortune, qui contenait le message suivant :
(Ce serait extrait d'une de ses œuvres : Discours sur les sciences et les arts.)
Je crois qu'une puissance immanente m'incite à enfin parler d'un biopic qui ne m'a guère enchanté.
19:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes
Fremont
Le titre de cette fiction un peu austère, en noir et blanc, fait référence à une ville californienne, située au nord de la célèbre Silicon Valley... mais où vivent (et travaillent) des personnes moins fortunées que les geeks qui transforment notre monde.
On y trouve paraît-il la plus importante communauté afghane des États-Unis, y compris l'héroïne de l'histoire, Donya, ex-traductrice pour l'armée d'Oncle Sam, qui a réussi à fuir son pays avant de finir entre quatre planches...
En s'installant aux States, elle a préservé sa liberté, mais connaît une forme de déclassement social : elle est simple employée dans une usine de fabrication de cookies fortune, ces petits gâteaux d'origine chinoise, dont la coque contient un papier sur lequel est inscrite une courte formule, en général sujette à plusieurs interprétations.
Cette entreprise appartient à un couple de Sino-Américains, l'époux étant le fils du fondateur. Il est bienveillant avec la nouvelle employée, peut-être parce qu'elle est jolie, peut-être parce qu'elle est sérieuse... peut-être parce qu'elle lui rappelle ses propres débuts. C'est une autre migrante asiatique, qui tente de faire son trou au pays de la libre entreprise. L'épouse est beaucoup moins amicale avec le "petit personnel", comme on va pouvoir s'en rendre compte tout au long du film.
Celui-ci est constitué d'un montage de plans presque tous fixes, souvent en champ-contrechamp, dans un nombre limité de lieux : l'usine de cookies, les logements des employées, le cabinet du psychiatre, le restaurant communautaire... On respire un peu plus vers la fin, quand la jeune femme tente de forcer son destin... (Je n'en dis pas plus.)
Le début n'est pas le plus agréable à suivre. Il faut s'habituer au style du réalisateur (qui mise beaucoup sur l'implicite, le non-dit)... et supporter la description d'un quotidien au départ peu épanouissant.
Petit à petit, cela s'éclaire, non pas tant parce que la situation s'améliore soudainement, mais parce que Donya se prend davantage en mains. Le cinéaste introduit aussi de rafraîchissantes petites pointes d'humour. Tout d'abord, il y a les circonstances dans lesquelles l'héroïne va connaître une promotion, au sein de l'entreprise. Il y a ensuite la drôle de relation médecin-patiente qui se noue, à tel point qu'on finit par se demander qui analyse l'autre ! Il y a aussi la découverte des messages dans les petits gâteaux... et les conséquences insoupçonnées de la tentative effectuée par Donya. (On ne sait jamais entre quelles mains peut tomber "son" message...) Il y a encore le comportement du patron du petit resto, accro à une sorte de télénovela afghane, et qui donne des conseils à sa cliente régulière. Il y a enfin la réaction de la jeune femme, à la fin, délicieuse.
La plus belle des rencontres n'est pas celle qu'elle avait prévue, et c'est à ce moment-là que la caméra se fait plus libre et que la vie de la jeune femme gagne en saveur.
J'ai trouvé cela très beau.
P.S. I
En lisant Le Canard enchaîné de cette semaine, j'ai appris que la personne qui incarne Donya, Anaita Wali Zada, est une ancienne présentatrice de télévision, qui a dû fuir l'Afghanistan en 2021. Ses débuts d'actrice sont prometteurs.
P.S. II
Avec mon ticket d'entrée (pour la séance de ce film), j'ai reçu un cookie fortune, qui contenait le message suivant :
(Ce serait extrait d'une de ses œuvres : Discours sur les sciences et les arts.)
Je crois qu'une puissance immanente m'incite à enfin parler d'un biopic qui ne m'a guère enchanté.
19:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes
samedi, 09 décembre 2023
Migration
Séance familiale et pop corn pour ce film d'animation du studio Illumination (celui auquel on doit, entre autres, les Minions). Il est réalisé par Benjamin Renner, auteur du Grand Méchant Renard et (surtout) d'Ernest et Célestine.
Le bouche-à-oreille a dû faire son effet : personne n'est arrivé en retard, pour ne pas rater le court-métrage introductif, intitulé Mooned. On y retrouve l'un des protagonistes du premier Moi, moche et méchant... et quelques Minions, pour agrémenter le tout. Cela confirme la sortie prochaine de Moi, moche et méchant 4.
Ensuite débute l'histoire de la famille canard (colvert), que le papa aimerait voir cantonnée à sa sécurisante mare, loin des dangers représentés par la forêt proche et le reste du monde, plus lointain. Ce film réussit à jouer sur le double niveau de lecture, l'un pour les enfants, l'autre pour les adultes. Ainsi, le couple de parents bat de l'aile (si j'ose dire), papa canard étant très casanier, alors que maman cane aimerait voyager, peut-être pour retrouver la fougue de leur relation naissante. De leur côté, sans surprise, les canetons (un mâle ado et une femelle plus jeune) rêvent d'aventure et sont inconscients des dangers.
L'animation est de toute beauté. On a soigné les plumages et les visages, avec de grands yeux expressifs... dotés d'impressionnants sourcils. (Il ne faut bien sûr pas s'attendre à un rigoureux traité d'ornithologie.) L'humour est présent, à travers le personnage de l'oncle (en général ridicule) et les réflexions de la benjamine, qui excelle à susciter le malaise chez son aîné. Dans la salle, jeunes et moins jeunes rient, pas forcément aux mêmes moments. (Les -pas trop- petits sont surtout sensibles aux gadins et coups de théâtre.)
La famille finit par décoller, direction la Jamaïque... avec quelques détours. En chemin, nos héros vont croiser d'étranges hérons, des pigeons pas très propres (mais plus sympas qu'il n'y paraît), un perroquet, des congénères adeptes du yoga... Ils vont aussi découvrir New York, avec ses gratte-ciel, ses lumières et ses dangers. C'est évidemment une métaphore d'humains provinciaux débarquant dans la grande ville.
Sans surprise, les jeunes vont faire des bêtises, les parents (tenter de) se rapprocher de leurs enfants. Tout ce petit monde vit ce voyage comme un roman d'apprentissage, dont ils sortiront transformés, meilleurs... à condition d'échapper au méchant de l'histoire : un cuisinier réputé de Big Apple, ignoble personnage qui ne s'exprime que par rugissements et borborygmes. C'est le principal point faible de l'intrigue, un discours anti-viande manichéen, qui avance avec de gros sabots.
Le film n'en est pas moins un très agréable divertissement.
En sortant de là, je suis allé au resto et j'ai commandé du confit de canard. Je me suis régalé !
22:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Migration
Séance familiale et pop corn pour ce film d'animation du studio Illumination (celui auquel on doit, entre autres, les Minions). Il est réalisé par Benjamin Renner, auteur du Grand Méchant Renard et (surtout) d'Ernest et Célestine.
Le bouche-à-oreille a dû faire son effet : personne n'est arrivé en retard, pour ne pas rater le court-métrage introductif, intitulé Mooned. On y retrouve l'un des protagonistes du premier Moi, moche et méchant... et quelques Minions, pour agrémenter le tout. Cela confirme la sortie prochaine de Moi, moche et méchant 4.
Ensuite débute l'histoire de la famille canard (colvert), que le papa aimerait voir cantonnée à sa sécurisante mare, loin des dangers représentés par la forêt proche et le reste du monde, plus lointain. Ce film réussit à jouer sur le double niveau de lecture, l'un pour les enfants, l'autre pour les adultes. Ainsi, le couple de parents bat de l'aile (si j'ose dire), papa canard étant très casanier, alors que maman cane aimerait voyager, peut-être pour retrouver la fougue de leur relation naissante. De leur côté, sans surprise, les canetons (un mâle ado et une femelle plus jeune) rêvent d'aventure et sont inconscients des dangers.
L'animation est de toute beauté. On a soigné les plumages et les visages, avec de grands yeux expressifs... dotés d'impressionnants sourcils. (Il ne faut bien sûr pas s'attendre à un rigoureux traité d'ornithologie.) L'humour est présent, à travers le personnage de l'oncle (en général ridicule) et les réflexions de la benjamine, qui excelle à susciter le malaise chez son aîné. Dans la salle, jeunes et moins jeunes rient, pas forcément aux mêmes moments. (Les -pas trop- petits sont surtout sensibles aux gadins et coups de théâtre.)
La famille finit par décoller, direction la Jamaïque... avec quelques détours. En chemin, nos héros vont croiser d'étranges hérons, des pigeons pas très propres (mais plus sympas qu'il n'y paraît), un perroquet, des congénères adeptes du yoga... Ils vont aussi découvrir New York, avec ses gratte-ciel, ses lumières et ses dangers. C'est évidemment une métaphore d'humains provinciaux débarquant dans la grande ville.
Sans surprise, les jeunes vont faire des bêtises, les parents (tenter de) se rapprocher de leurs enfants. Tout ce petit monde vit ce voyage comme un roman d'apprentissage, dont ils sortiront transformés, meilleurs... à condition d'échapper au méchant de l'histoire : un cuisinier réputé de Big Apple, ignoble personnage qui ne s'exprime que par rugissements et borborygmes. C'est le principal point faible de l'intrigue, un discours anti-viande manichéen, qui avance avec de gros sabots.
Le film n'en est pas moins un très agréable divertissement.
En sortant de là, je suis allé au resto et j'ai commandé du confit de canard. Je me suis régalé !
22:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Pierre Feuille Pistolet
Le titre de ce documentaire est un décalque du nom du jeu "pierre feuille ciseaux", auquel a été ajouté un élément : l'arme à feu, qui ne l'emporte toutefois pas systématiquement, comme on peut le constater quand on voit une jeune Ukrainienne y jouer avec le caméraman.
C'est donc de la guerre en Ukraine (sa première année) qu'il est question dans ce huis-clos automobile. Le réalisateur polonais Maciek Hamela s'est lancé dans l'action humanitaire, transportant des réfugiés ukrainiens des zones (parfois très) proches des combats vers l'ouest du pays, voire la Pologne. Au volant de son Espace, il discute au téléphone ou avec ses passagers et les personnes qu'il croise au cours de ses "courses", des autoroutes asphaltées aux chemins de campagne.
Le dispositif n'est pas sans rappeler celui de Taxi Téhéran (qui était une fiction), à ceci près qu'une seule caméra (me semble-t-il) filme les scènes et que le cinéaste évite en général d'apparaître à l'écran.
Le montage introduit une intensité dramatique. Le début évoque les difficultés du quotidien et la douleur du départ chez des Ukrainiens ordinaires. Une gamine voudrait qu'on lui prête un smartphone, celui de sa mère ayant sa batterie épuisée... le grand frère gardant le sien pour lui. Un trio de ruraux se désole d'avoir dû abandonner son chien et son unique vache, Beauté, dont on apprend qu'elle est vraiment exceptionnelle, vu qu'elle mange tout ce qu'on lui donne ! D'autres passagers sont séparés des membres de leur famille, soit que les hommes se soient enrôlés (dans le véhicule, on ne voit quasiment que des femmes, des enfants et des personnes âgées), soit que les adultes aient laissé les anciens sur place, pour diverses raisons.
Ces témoins de la guerre m'ont semblé parfois très proches. Ils pourraient être nos voisins. Indirectement, à travers les vêtements et les objets du quotidien, le film montre que la classe moyenne ukrainienne a un mode de vie occidental, même si le pays n'était (avant guerre) qu'émergent. D'autres habitants (en particulier les personnes âgées vivant à la campagne) m'ont plus fait penser à des Européens de l'Est ou des Russes tels qu'on se les représente.
Le coffre de la voiture est bien rempli. Les passagers ont tenté d'emporter le maximum, parfois jusqu'au chat de la famille, telle cette femme qui demande au chauffeur de procéder à un arrêt, pour que le minou puisse faire ses besoins à l'extérieur... évitant ainsi d'empester le véhicule.
Il y a aussi ce qu'on ne dit pas, mais qu'on voit à l'écran. De temps en temps, le caméraman tourne son équipement vers l'extérieur du monospace. On ne voit pas de cadavre, mais des soldats à un point de contrôle, des chars, des véhicules de l'armée, parfois impressionnants, parfois camouflés, parfois à moitié détruits.
La deuxième partie du film introduit des passagers qui ont des histoires moins gaies à raconter. Il est question de deuil, de tortures infligées par les soldats russes. Pour les spectateurs, c'est parfois un peu difficile à suivre, parce qu'il faut faire l'effort de lire des sous-titres (pendant 1h20), et parce que certaines histoires sont terribles, quand bien même il ne s'agit que de mots.
Notons que ce film est polyglotte. On y entend parler ukrainien, russe aussi me semble-t-il, polonais, anglais... et même français.
Alors que, dans le cœur des indignés professionnels, l'Ukraine a été (depuis longtemps) remplacée par d'autres causes à la mode, il est urgent de voir ce film. La guerre, que l'état-major poutinien comptait boucler en moins d'une semaine, dure depuis près de deux ans. Sans doute plus de 200 000 personnes (tous bords confondus) ont été tuées, sans parler des blessés.
09:56 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualités, actualité
Pierre Feuille Pistolet
Le titre de ce documentaire est un décalque du nom du jeu "pierre feuille ciseaux", auquel a été ajouté un élément : l'arme à feu, qui ne l'emporte toutefois pas systématiquement, comme on peut le constater quand on voit une jeune Ukrainienne y jouer avec le caméraman.
C'est donc de la guerre en Ukraine (sa première année) qu'il est question dans ce huis-clos automobile. Le réalisateur polonais Maciek Hamela s'est lancé dans l'action humanitaire, transportant des réfugiés ukrainiens des zones (parfois très) proches des combats vers l'ouest du pays, voire la Pologne. Au volant de son Espace, il discute au téléphone ou avec ses passagers et les personnes qu'il croise au cours de ses "courses", des autoroutes asphaltées aux chemins de campagne.
Le dispositif n'est pas sans rappeler celui de Taxi Téhéran (qui était une fiction), à ceci près qu'une seule caméra (me semble-t-il) filme les scènes et que le cinéaste évite en général d'apparaître à l'écran.
Le montage introduit une intensité dramatique. Le début évoque les difficultés du quotidien et la douleur du départ chez des Ukrainiens ordinaires. Une gamine voudrait qu'on lui prête un smartphone, celui de sa mère ayant sa batterie épuisée... le grand frère gardant le sien pour lui. Un trio de ruraux se désole d'avoir dû abandonner son chien et son unique vache, Beauté, dont on apprend qu'elle est vraiment exceptionnelle, vu qu'elle mange tout ce qu'on lui donne ! D'autres passagers sont séparés des membres de leur famille, soit que les hommes se soient enrôlés (dans le véhicule, on ne voit quasiment que des femmes, des enfants et des personnes âgées), soit que les adultes aient laissé les anciens sur place, pour diverses raisons.
Ces témoins de la guerre m'ont semblé parfois très proches. Ils pourraient être nos voisins. Indirectement, à travers les vêtements et les objets du quotidien, le film montre que la classe moyenne ukrainienne a un mode de vie occidental, même si le pays n'était (avant guerre) qu'émergent. D'autres habitants (en particulier les personnes âgées vivant à la campagne) m'ont plus fait penser à des Européens de l'Est ou des Russes tels qu'on se les représente.
Le coffre de la voiture est bien rempli. Les passagers ont tenté d'emporter le maximum, parfois jusqu'au chat de la famille, telle cette femme qui demande au chauffeur de procéder à un arrêt, pour que le minou puisse faire ses besoins à l'extérieur... évitant ainsi d'empester le véhicule.
Il y a aussi ce qu'on ne dit pas, mais qu'on voit à l'écran. De temps en temps, le caméraman tourne son équipement vers l'extérieur du monospace. On ne voit pas de cadavre, mais des soldats à un point de contrôle, des chars, des véhicules de l'armée, parfois impressionnants, parfois camouflés, parfois à moitié détruits.
La deuxième partie du film introduit des passagers qui ont des histoires moins gaies à raconter. Il est question de deuil, de tortures infligées par les soldats russes. Pour les spectateurs, c'est parfois un peu difficile à suivre, parce qu'il faut faire l'effort de lire des sous-titres (pendant 1h20), et parce que certaines histoires sont terribles, quand bien même il ne s'agit que de mots.
Notons que ce film est polyglotte. On y entend parler ukrainien, russe aussi me semble-t-il, polonais, anglais... et même français.
Alors que, dans le cœur des indignés professionnels, l'Ukraine a été (depuis longtemps) remplacée par d'autres causes à la mode, il est urgent de voir ce film. La guerre, que l'état-major poutinien comptait boucler en moins d'une semaine, dure depuis près de deux ans. Sans doute plus de 200 000 personnes (tous bords confondus) ont été tuées, sans parler des blessés.
09:56 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualités, actualité
vendredi, 08 décembre 2023
Ça tourne à Séoul !
Aux cinéphiles français, le titre hexagonal de ce long-métrage sud-coréen rappellera le Ça tourne à Manhattan de Tom DiCillo, un autre film dans le film sur les affres de la création cinématographique. Seul le contexte change : les États-Unis de la fin du XXe siècle sont remplacés par la Corée du Sud dictatoriale de 1970. Cela "épice" quelque peu l'intrigue, puisque l'équipe de tournage doit ruser avec la censure gouvernementale... au besoin à coups d'alcool fort.
On comprend vite que l'esprit de sérieux n'est pas la marque de fabrique de cette production un peu foutraque, qui commence par nous montrer un nanard en cours de réalisation. De surcroît, on ne comprend pas pourquoi le scénario fait référence à la descente d'escaliers d'un personnage féminin (alors qu'il les monte)... pas plus que la mention d'un plan-séquence, la scène retournée étant d'évidence montée. Mais l'on sent bien que le personnage du réalisateur a l'ambition de conclure son œuvre ainsi. La manière d'y parvenir consiste l'un des attraits de cette comédie autocentrée, qui joue sur les codes du petit monde du cinéma.
La suite est un puzzle de types de scènes. Celles en noir et blanc nous proposent la version du film de 1970 en tournage. Les autres sont en couleurs. Elles évoquent soit le tournage du film, soit le passé de certains personnages (qui ont des choses à se reprocher), soit les hallucinations du réalisateur, qui se bourre de cachetons et, dans ses rêves, imagine la manière de boucler son film.
L'équipe a deux jours pour retourner la fin de l'histoire (en fait près de la moitié du film). Le cinéaste va bien entendu collectionner les emmerdes, entre une productrice autoritaire, des acteurs à l'égo surdimensionné, les histoires de cul des uns et des autres... et les aspirations des "sans grade", qui aimeraient bien capter une part de la lumière.
Cela fonctionne parce que les acteurs sont bons. Je ne suis toutefois pas particulièrement impressionné par la prestation de Song Kang-Ho (vu notamment dans Parasite). Ce sont les comédiennes qui m'ont épaté. Toutes interprètent deux personnages : le rôle du film de 1970 en cours de tournage et le rôle qui leur est assigné par le film du XXIe siècle, l'un étant parfois très éloigné de l'autre. Trois d'entre elles sont des actrices qui jouent des actrices. Toutes sont formidables. Il faut y ajouter le duo de productrices : la tante (autoritaire et un brin manipulatrice) et la nièce (une groupie du cinéaste, prête à cogner pour lui... et rêvant secrètement de passer devant la caméra).
C'est bien fichu, souvent drôle, mais un peu long. Il aurait fallu pratiquer quelques coupes. On sent quand même bien passer les 2h10. Mais l'ensemble constitue un indéniable plaisir de cinéphile.
23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Ça tourne à Séoul !
Aux cinéphiles français, le titre hexagonal de ce long-métrage sud-coréen rappellera le Ça tourne à Manhattan de Tom DiCillo, un autre film dans le film sur les affres de la création cinématographique. Seul le contexte change : les États-Unis de la fin du XXe siècle sont remplacés par la Corée du Sud dictatoriale de 1970. Cela "épice" quelque peu l'intrigue, puisque l'équipe de tournage doit ruser avec la censure gouvernementale... au besoin à coups d'alcool fort.
On comprend vite que l'esprit de sérieux n'est pas la marque de fabrique de cette production un peu foutraque, qui commence par nous montrer un nanard en cours de réalisation. De surcroît, on ne comprend pas pourquoi le scénario fait référence à la descente d'escaliers d'un personnage féminin (alors qu'il les monte)... pas plus que la mention d'un plan-séquence, la scène retournée étant d'évidence montée. Mais l'on sent bien que le personnage du réalisateur a l'ambition de conclure son œuvre ainsi. La manière d'y parvenir consiste l'un des attraits de cette comédie autocentrée, qui joue sur les codes du petit monde du cinéma.
La suite est un puzzle de types de scènes. Celles en noir et blanc nous proposent la version du film de 1970 en tournage. Les autres sont en couleurs. Elles évoquent soit le tournage du film, soit le passé de certains personnages (qui ont des choses à se reprocher), soit les hallucinations du réalisateur, qui se bourre de cachetons et, dans ses rêves, imagine la manière de boucler son film.
L'équipe a deux jours pour retourner la fin de l'histoire (en fait près de la moitié du film). Le cinéaste va bien entendu collectionner les emmerdes, entre une productrice autoritaire, des acteurs à l'égo surdimensionné, les histoires de cul des uns et des autres... et les aspirations des "sans grade", qui aimeraient bien capter une part de la lumière.
Cela fonctionne parce que les acteurs sont bons. Je ne suis toutefois pas particulièrement impressionné par la prestation de Song Kang-Ho (vu notamment dans Parasite). Ce sont les comédiennes qui m'ont épaté. Toutes interprètent deux personnages : le rôle du film de 1970 en cours de tournage et le rôle qui leur est assigné par le film du XXIe siècle, l'un étant parfois très éloigné de l'autre. Trois d'entre elles sont des actrices qui jouent des actrices. Toutes sont formidables. Il faut y ajouter le duo de productrices : la tante (autoritaire et un brin manipulatrice) et la nièce (une groupie du cinéaste, prête à cogner pour lui... et rêvant secrètement de passer devant la caméra).
C'est bien fichu, souvent drôle, mais un peu long. Il aurait fallu pratiquer quelques coupes. On sent quand même bien passer les 2h10. Mais l'ensemble constitue un indéniable plaisir de cinéphile.
23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 02 décembre 2023
The Marvels
Les héroïnes sont au nombre de trois, trois jeunes femmes (deux adultes et une ado) possédant des pouvoirs assez proches, bien que d'intensités différentes. On se dit que Disney-Marvel tente de renouveler le succès de Spider-Man : no way home, version féminine, avec le multivers en bonus.
Le début est engageant : on découvre la plus jeune des trois, une Américaine dont la famille vient sans doute d'Asie du Sud (gros potentiel de spectateurs dans cette partie du monde). Elle est fan de comic books en général, de Captain Marvel en particulier. Du coup, à l'écran, quand son imagination s'emballe, on a comme un petit air de Spider-Man : across the spider-verse. De surcroît, la comédienne qui incarne Kamala Khan (Iman Vellani) a du tempérament et de la tchatche. C'est sans doute de sa bouche que sortent les répliques les plus intéressantes, souvent drôles, le reste des dialogues étant d'une affligeante platitude (sauf quand ça se passe au sein de la famille Khan).
Dans des circonstances que je ne révèlerai pas, les trois jeunes femmes (Captain Marvel, sa nièce travaillant désormais pour Nick Fury et la petite Khan) voient leurs pouvoirs s'entremêler, l'une prenant la place de l'autre quand elles utilisent simultanément leur énergie vitale. Cela donne naissance à des situations cocasses, culminant dans une baston se déroulant à la fois chez les Khan, dans l'espace et un monde lointain. C'est un bon délire, qui va se renouveler deux fois. Lors du deuxième combat, le trio est mis en échec par la méchante (qui, dans la BD d'origine, est un homme). Lors du troisième, celles qui sont devenues des amies se sont entraînées et ont élaboré un plan. C'est bien mis en scène, judicieusement monté. On ne s'ennuie pas. Les effets spéciaux sont de qualité.
Sur le fond, par contre, ça ne décolle pas trop. Il fut un temps où les super-héros luttaient contre les délinquants, sauvaient la veuve et l'orphelin. Point de tout cela ici. C'est trop trivial. Il faut que ce soit grandiose, intersidéral, que l'on sauve ou détruise des univers. Cet aspect-là m'a un peu saoulé, d'autant que je doute de la vraisemblance de certains présupposés physiques énoncés avec aplomb. Soit c'est trop compliqué pour moi, soit c'est complètement débile.
Fort heureusement, l'intérêt est relevé par la quatrième super-héroïne de l'histoire... Goose, le chat (découvert dans le premier Captain Marvel). Le minou s'est attaché à Carol Danvers... et force est de reconnaître qu'il est parfois d'une grande utilité.
Enfin, quand je dis « il », la V.O. dit « she », pronom utilisé indistinctement en anglais pour désigner les boules de poils, quel que soit leur sexe. Figurez-vous que, d'une manière que je m'interdis de dévoiler, Goose va en quelque sorte avoir des petits... et que ceux-ci vont jouer un rôle capital dans le sauvetage des occupants d'une station spatiale. Cette séquence constitue l'un des meilleurs moments du film. Dans la salle, les petits et les grands rient.
En revanche, je n'ai pas du tout aimé la partie se déroulant sur la planète aqueuse, dont les habitants parlent en chantant. Ce fut un supplice, à tel point que je soutenais presque la méchante venue leur piquer toute leur eau.
Le final essaie de concilier tout le monde. La méchante n'est peut-être pas si méchante que cela. (Normal, me diraient les producteurs : elle est noire.) En fait, la responsable de tout est cette pauvre Carol Danvers. Quand elle est en forme, la blonde anorexique est capable de niquer un univers ou de détruire une intelligence artificielle, avec d'incommensurables conséquences. (Cela rappellera un peu le personnage du Phénix noir aux vieux lecteurs de comics.) Le politiquement correct hollywoodien est donc sauf : ce sont les femmes qui peuvent sauver le monde et, quand une catastrophe se produit, c'est la faute de la Blanche.
23:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
The Marvels
Les héroïnes sont au nombre de trois, trois jeunes femmes (deux adultes et une ado) possédant des pouvoirs assez proches, bien que d'intensités différentes. On se dit que Disney-Marvel tente de renouveler le succès de Spider-Man : no way home, version féminine, avec le multivers en bonus.
Le début est engageant : on découvre la plus jeune des trois, une Américaine dont la famille vient sans doute d'Asie du Sud (gros potentiel de spectateurs dans cette partie du monde). Elle est fan de comic books en général, de Captain Marvel en particulier. Du coup, à l'écran, quand son imagination s'emballe, on a comme un petit air de Spider-Man : across the spider-verse. De surcroît, la comédienne qui incarne Kamala Khan (Iman Vellani) a du tempérament et de la tchatche. C'est sans doute de sa bouche que sortent les répliques les plus intéressantes, souvent drôles, le reste des dialogues étant d'une affligeante platitude (sauf quand ça se passe au sein de la famille Khan).
Dans des circonstances que je ne révèlerai pas, les trois jeunes femmes (Captain Marvel, sa nièce travaillant désormais pour Nick Fury et la petite Khan) voient leurs pouvoirs s'entremêler, l'une prenant la place de l'autre quand elles utilisent simultanément leur énergie vitale. Cela donne naissance à des situations cocasses, culminant dans une baston se déroulant à la fois chez les Khan, dans l'espace et un monde lointain. C'est un bon délire, qui va se renouveler deux fois. Lors du deuxième combat, le trio est mis en échec par la méchante (qui, dans la BD d'origine, est un homme). Lors du troisième, celles qui sont devenues des amies se sont entraînées et ont élaboré un plan. C'est bien mis en scène, judicieusement monté. On ne s'ennuie pas. Les effets spéciaux sont de qualité.
Sur le fond, par contre, ça ne décolle pas trop. Il fut un temps où les super-héros luttaient contre les délinquants, sauvaient la veuve et l'orphelin. Point de tout cela ici. C'est trop trivial. Il faut que ce soit grandiose, intersidéral, que l'on sauve ou détruise des univers. Cet aspect-là m'a un peu saoulé, d'autant que je doute de la vraisemblance de certains présupposés physiques énoncés avec aplomb. Soit c'est trop compliqué pour moi, soit c'est complètement débile.
Fort heureusement, l'intérêt est relevé par la quatrième super-héroïne de l'histoire... Goose, le chat (découvert dans le premier Captain Marvel). Le minou s'est attaché à Carol Danvers... et force est de reconnaître qu'il est parfois d'une grande utilité.
Enfin, quand je dis « il », la V.O. dit « she », pronom utilisé indistinctement en anglais pour désigner les boules de poils, quel que soit leur sexe. Figurez-vous que, d'une manière que je m'interdis de dévoiler, Goose va en quelque sorte avoir des petits... et que ceux-ci vont jouer un rôle capital dans le sauvetage des occupants d'une station spatiale. Cette séquence constitue l'un des meilleurs moments du film. Dans la salle, les petits et les grands rient.
En revanche, je n'ai pas du tout aimé la partie se déroulant sur la planète aqueuse, dont les habitants parlent en chantant. Ce fut un supplice, à tel point que je soutenais presque la méchante venue leur piquer toute leur eau.
Le final essaie de concilier tout le monde. La méchante n'est peut-être pas si méchante que cela. (Normal, me diraient les producteurs : elle est noire.) En fait, la responsable de tout est cette pauvre Carol Danvers. Quand elle est en forme, la blonde anorexique est capable de niquer un univers ou de détruire une intelligence artificielle, avec d'incommensurables conséquences. (Cela rappellera un peu le personnage du Phénix noir aux vieux lecteurs de comics.) Le politiquement correct hollywoodien est donc sauf : ce sont les femmes qui peuvent sauver le monde et, quand une catastrophe se produit, c'est la faute de la Blanche.
23:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
L'Abbé Pierre
J'ai mis du temps à me décider à aller voir ce film. Je n'ai pas gardé un excellent souvenir d'Hiver 54 (la précédente tentative, avec Lambert Wilson) et, pour moi, l'abbé Pierre était devenu un vieil homme un peu gâteux, tenant des propos parfois nauséabonds. Le biopic sorti le mois dernier n'élude d'ailleurs pas cette part d'ombre, même si elle est rapidement évacuée.
Avant d'en arriver là, les spectateurs vont suivre une vie extraordinaire, celle d'un homme d'engagement(s), interprété avec brio par Benjamin Lavernhe (César en vue, à mon avis). Il ressemble physiquement à son personnage et demeure crédible dans le rôle, quel que soit son âge. Mais le film ne serait pas aussi puissant si un autre personnage ne rayonnait pas à ses côtés, celui de Lucie Coutaz, la cheville ouvrière d'Emmaüs, la petite main de l'ombre, incarnée de manière stupéfiante par Emmanuelle Bercot (qui avait déjà croisé la route de Lavernhe dans De Grandes Espérances). Un troisième larron, un peu en retrait, complète ce duo : Michel Vuillermoz, dans le rôle de Georges Legay, ex-taulard suicidaire devenu un nouvel apôtre de la bonne cause.
J'ai tout de même eu du mal à entrer dans le film. Le début ne m'a pas emballé, notamment tout ce qui touche à la ferveur du jeune apprenti religieux. Pour moi, l'histoire décolle à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec une séquence particulièrement réussie autour de la Résistance, mise en scène sans tambour ni pathos. C'est aussi le moment où Henri Grouès rencontre Lucie Coutaz, dans des circonstances qui vont forger une amitié amoureuse de près de quarante ans.
A la réalisation, Frédéric Tellier (auteur notamment de L'Affaire SK1) réussit son coup. Je n'aime pas du tout les scènes tire-larmes, dont tant de films, français comme étrangers abusent. En général, cela me paraît factice ou surjoué. Tel n'est pas le cas ici. Que ce soit pour décrire les conditions de vie dans la France de l'immédiate après-guerre ou celles du redoutable hiver 1954, le réalisateur reste mesuré, soignant ses effets. Il n'a pas besoin de plus pour bien faire sentir l'horreur de la mort d'un enfant, dans un vieux bus stationné dans un bois. Même l'intervention du ministre est présentée avec doigté.
On retrouve cette veine, plus tard, quand on nous montre ce qui ressemble à un vieux couple, retiré des affaires. Ils sont touchants tous les deux et la conclusion de leur "histoire" est vraiment poignante.
J'ai beau tiquer un peu face à l'héroïsation du personnage principal et l'aspect militant d'une partie de la fin (autour des migrants), je trouve ce film très beau, instructif... et utile.
17:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
L'Abbé Pierre
J'ai mis du temps à me décider à aller voir ce film. Je n'ai pas gardé un excellent souvenir d'Hiver 54 (la précédente tentative, avec Lambert Wilson) et, pour moi, l'abbé Pierre était devenu un vieil homme un peu gâteux, tenant des propos parfois nauséabonds. Le biopic sorti le mois dernier n'élude d'ailleurs pas cette part d'ombre, même si elle est rapidement évacuée.
Avant d'en arriver là, les spectateurs vont suivre une vie extraordinaire, celle d'un homme d'engagement(s), interprété avec brio par Benjamin Lavernhe (César en vue, à mon avis). Il ressemble physiquement à son personnage et demeure crédible dans le rôle, quel que soit son âge. Mais le film ne serait pas aussi puissant si un autre personnage ne rayonnait pas à ses côtés, celui de Lucie Coutaz, la cheville ouvrière d'Emmaüs, la petite main de l'ombre, incarnée de manière stupéfiante par Emmanuelle Bercot (qui avait déjà croisé la route de Lavernhe dans De Grandes Espérances). Un troisième larron, un peu en retrait, complète ce duo : Michel Vuillermoz, dans le rôle de Georges Legay, ex-taulard suicidaire devenu un nouvel apôtre de la bonne cause.
J'ai tout de même eu du mal à entrer dans le film. Le début ne m'a pas emballé, notamment tout ce qui touche à la ferveur du jeune apprenti religieux. Pour moi, l'histoire décolle à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec une séquence particulièrement réussie autour de la Résistance, mise en scène sans tambour ni pathos. C'est aussi le moment où Henri Grouès rencontre Lucie Coutaz, dans des circonstances qui vont forger une amitié amoureuse de près de quarante ans.
A la réalisation, Frédéric Tellier (auteur notamment de L'Affaire SK1) réussit son coup. Je n'aime pas du tout les scènes tire-larmes, dont tant de films, français comme étrangers abusent. En général, cela me paraît factice ou surjoué. Tel n'est pas le cas ici. Que ce soit pour décrire les conditions de vie dans la France de l'immédiate après-guerre ou celles du redoutable hiver 1954, le réalisateur reste mesuré, soignant ses effets. Il n'a pas besoin de plus pour bien faire sentir l'horreur de la mort d'un enfant, dans un vieux bus stationné dans un bois. Même l'intervention du ministre est présentée avec doigté.
On retrouve cette veine, plus tard, quand on nous montre ce qui ressemble à un vieux couple, retiré des affaires. Ils sont touchants tous les deux et la conclusion de leur "histoire" est vraiment poignante.
J'ai beau tiquer un peu face à l'héroïsation du personnage principal et l'aspect militant d'une partie de la fin (autour des migrants), je trouve ce film très beau, instructif... et utile.
17:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 01 décembre 2023
Testament
Quatre ans après avoir clôturé sa trilogie autobiographico-sociétale (avec La Chute de l'empire américain), le Québécois Denys Arcand revient avec une comédie sociétale acide, que la critique bien-pensante (notamment celle du Monde) a détesté. Essayons de comprendre pourquoi.
L'histoire a pour cadre un EHPAD une maison de retraite des aînés, dont la cuisine propose quantité de menus adaptés à toutes les allergies, tous les (dé)goûts, toutes les fulgurances à la mode. C'est un établissement plutôt haut-de-gamme, dont les résidents vivent dans des appartements privés. Le narrateur Jean-Michel est l'un de ces résidents, documentaliste à la retraite, septuagénaire du genre anar, libertaire, qui pose un regard goguenard sur son époque. (C'est évidemment un double du réalisateur.)
L'une des rares fois où on le suit hors de sa résidence, il assiste à une remise de prix littéraires, dont il est le seul lauréat masculin, les récompenses étant quasi monopolisées par des femmes. Celles-ci sont censées représenter toutes les "catégories" à valoriser, puisqu'on rencontre une lesbienne, une Afro-américaine, une obèse, une musulmane (intégriste)... Bref, on nage en plein politiquement correct, à la sauce multiculturelle. Ce n'est pas leur talent littéraire que l'on a primé, mais le fait que les auteures appartiennent à telle ou telle catégorie de "personnes opprimées". La satire n'est pas d'une grande finesse, mais elle est diablement efficace : dans la salle, le public (majoritairement féminin) riait de bon cœur.
L'hospice (comme il est appelé à une reprise, par une personne qui ne manie pas la langue de bois) n'est pas sans mystères. Ainsi, on se demande ce que peut bien faire Jean-Michel chaque semaine, pendant une heure, lorsqu'il reçoit une sculpturale beauté blonde. On se dit aussi que l'apparence rigide de la directrice doit cacher quelques lourds secrets... et l'on se demande bien pourquoi la fresque qui orne la salle de musique de l'établissement suscite une telle polémique.
Elle devient l'objet de la colère d'un groupe de jeunes activistes, qui prétendent représenter les "nations premières" du pays... alors qu'aucun d'entre eux n'en fait partie. Leur langage comme leurs manifestations sont rodés. Ce sont des habitués de l'agitprop, des enfants de la classe moyenne, inscrits à l'université, mais qui passent plus de temps à manifester qu'à étudier. Le portrait qui en est brossé par Arcand pourrait sembler exagéré mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de croiser certains individus de cette espèce (en France), je n'ai pas eu l'impression qu'il grossissait le trait.
Si le film se limitait à cette distrayante satire, il pourrait sembler anecdotique (bien que nécessaire, à une époque où de nouveaux curés de la pensée tentent d'imposer leurs interdits). Fort heureusement, Arcand y a aussi instillé de la tendresse, celle qui existe, de manière surprenante, entre le héros et sa "visiteuse", celle qui naît, de manière tout aussi étonnante, entre la directrice et le pensionnaire. Commence alors une autre histoire, celle d'une réconciliation familiale et du début d'une nouvelle vie, malgré l'âge avancé.
Le cinéaste n'oublie cependant pas son projet initial. La troisième partie est le théâtre d'un délicieux retournement, au cours duquel on voit notamment une députée progressiste défendre avec la même conviction que dans la première partie une position presque antagoniste à la précédente... Bravo à la comédienne !
Le film se conclut sur un triple clin d’œil. Le premier concerne le héros et sa nouvelle vie, qui a des conséquences sur ses opinions. Le second est une vision futuriste, qui ne manque pas de saveur. Le troisième est constitué par la chanson finale, qui renvoie de manière ironique à un dialogue du film.
Je suis sorti de là d'excellente humeur !
21:41 Publié dans Chine, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Testament
Quatre ans après avoir clôturé sa trilogie autobiographico-sociétale (avec La Chute de l'empire américain), le Québécois Denys Arcand revient avec une comédie sociétale acide, que la critique bien-pensante (notamment celle du Monde) a détesté. Essayons de comprendre pourquoi.
L'histoire a pour cadre un EHPAD une maison de retraite des aînés, dont la cuisine propose quantité de menus adaptés à toutes les allergies, tous les (dé)goûts, toutes les fulgurances à la mode. C'est un établissement plutôt haut-de-gamme, dont les résidents vivent dans des appartements privés. Le narrateur Jean-Michel est l'un de ces résidents, documentaliste à la retraite, septuagénaire du genre anar, libertaire, qui pose un regard goguenard sur son époque. (C'est évidemment un double du réalisateur.)
L'une des rares fois où on le suit hors de sa résidence, il assiste à une remise de prix littéraires, dont il est le seul lauréat masculin, les récompenses étant quasi monopolisées par des femmes. Celles-ci sont censées représenter toutes les "catégories" à valoriser, puisqu'on rencontre une lesbienne, une Afro-américaine, une obèse, une musulmane (intégriste)... Bref, on nage en plein politiquement correct, à la sauce multiculturelle. Ce n'est pas leur talent littéraire que l'on a primé, mais le fait que les auteures appartiennent à telle ou telle catégorie de "personnes opprimées". La satire n'est pas d'une grande finesse, mais elle est diablement efficace : dans la salle, le public (majoritairement féminin) riait de bon cœur.
L'hospice (comme il est appelé à une reprise, par une personne qui ne manie pas la langue de bois) n'est pas sans mystères. Ainsi, on se demande ce que peut bien faire Jean-Michel chaque semaine, pendant une heure, lorsqu'il reçoit une sculpturale beauté blonde. On se dit aussi que l'apparence rigide de la directrice doit cacher quelques lourds secrets... et l'on se demande bien pourquoi la fresque qui orne la salle de musique de l'établissement suscite une telle polémique.
Elle devient l'objet de la colère d'un groupe de jeunes activistes, qui prétendent représenter les "nations premières" du pays... alors qu'aucun d'entre eux n'en fait partie. Leur langage comme leurs manifestations sont rodés. Ce sont des habitués de l'agitprop, des enfants de la classe moyenne, inscrits à l'université, mais qui passent plus de temps à manifester qu'à étudier. Le portrait qui en est brossé par Arcand pourrait sembler exagéré mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de croiser certains individus de cette espèce (en France), je n'ai pas eu l'impression qu'il grossissait le trait.
Si le film se limitait à cette distrayante satire, il pourrait sembler anecdotique (bien que nécessaire, à une époque où de nouveaux curés de la pensée tentent d'imposer leurs interdits). Fort heureusement, Arcand y a aussi instillé de la tendresse, celle qui existe, de manière surprenante, entre le héros et sa "visiteuse", celle qui naît, de manière tout aussi étonnante, entre la directrice et le pensionnaire. Commence alors une autre histoire, celle d'une réconciliation familiale et du début d'une nouvelle vie, malgré l'âge avancé.
Le cinéaste n'oublie cependant pas son projet initial. La troisième partie est le théâtre d'un délicieux retournement, au cours duquel on voit notamment une députée progressiste défendre avec la même conviction que dans la première partie une position presque antagoniste à la précédente... Bravo à la comédienne !
Le film se conclut sur un triple clin d’œil. Le premier concerne le héros et sa nouvelle vie, qui a des conséquences sur ses opinions. Le second est une vision futuriste, qui ne manque pas de saveur. Le troisième est constitué par la chanson finale, qui renvoie de manière ironique à un dialogue du film.
Je suis sorti de là d'excellente humeur !
21:41 Publié dans Chine, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société