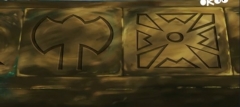samedi, 09 janvier 2021
"Les Mystérieuses Cités d'or", encore
France Télévisions poursuit la diffusion de la quatrième (et dernière) saison de la série d'animation. À la fin de décembre dernier, on s'était arrêté au quatorzième épisode. Deux nouveaux viennent d'être mis en ligne.
La Sorcière met en scène la reine des hommes-léopard, dont la couronne n'est pas sans rappeler un objet déjà vu dans la saison 3. L'intrigue sépare les enfants de leurs amis adultes. Le résultat est très inégal. Les aventures de Mendoza et de ses stupides compagnons ne sont guère intéressantes (ni vraisemblables), tandis que les découvertes réalisées par les enfants sont passionnantes.
J'ai préféré l'épisode suivant, intitulé Orunigi. Il y est question d'une mystérieuse cité africaine, liée au fameux masque découvert au cours de cette saison par les enfants. Celui-ci leur réserve d'ailleurs de nouvelles surprises.
La petite Zia est de nouveau à l'honneur, au cours notamment d'une séquence un peu agaçante en raison des pleurnicheries d'Esteban. (Je trouve regrettable qu'au bout de quatre saisons d'aventures, ce personnage, qui souffre du vertige tout en pilotant sans la moindre gêne un aéronef solaire, n'ait quasiment pas évolué.) Fort heureusement, on nous réserve le meilleur pour la fin, avec quelques scènes particulièrement réussies sur le plan visuel... et un coup de théâtre :
À suivre...
12:09 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, télévision, cinéma, cinema, film, films
"Les Mystérieuses Cités d'or", encore
France Télévisions poursuit la diffusion de la quatrième (et dernière) saison de la série d'animation. À la fin de décembre dernier, on s'était arrêté au quatorzième épisode. Deux nouveaux viennent d'être mis en ligne.
La Sorcière met en scène la reine des hommes-léopard, dont la couronne n'est pas sans rappeler un objet déjà vu dans la saison 3. L'intrigue sépare les enfants de leurs amis adultes. Le résultat est très inégal. Les aventures de Mendoza et de ses stupides compagnons ne sont guère intéressantes (ni vraisemblables), tandis que les découvertes réalisées par les enfants sont passionnantes.
J'ai préféré l'épisode suivant, intitulé Orunigi. Il y est question d'une mystérieuse cité africaine, liée au fameux masque découvert au cours de cette saison par les enfants. Celui-ci leur réserve d'ailleurs de nouvelles surprises.
La petite Zia est de nouveau à l'honneur, au cours notamment d'une séquence un peu agaçante en raison des pleurnicheries d'Esteban. (Je trouve regrettable qu'au bout de quatre saisons d'aventures, ce personnage, qui souffre du vertige tout en pilotant sans la moindre gêne un aéronef solaire, n'ait quasiment pas évolué.) Fort heureusement, on nous réserve le meilleur pour la fin, avec quelques scènes particulièrement réussies sur le plan visuel... et un coup de théâtre :
À suivre...
12:09 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, télévision, cinéma, cinema, film, films
lundi, 04 janvier 2021
La Promesse
Il ne va pas être question de l'excellent film des frères Dardenne, mais d'une nouvelle mini-série, dont la diffusion commence jeudi 7 janvier sur TF1. J'ai eu l'occasion d'en voir le premier épisode.
Deux enquêtes sont montrées en parallèle. À chaque fois, il est question de l'enlèvement d'une petite fille. La première affaire se déroule dans les Landes. Elle est traitée par un duo de policiers incarnés par Olivier Marchal et Loránt Deutsch (méconnaissable) :
La deuxième affaire a pour théâtre l'agglomération bordelaise. C'est un trio de policiers qui la prend en charge, sous la houlette d'une capitaine interprétée par Sofia Essaïdi (à droite ci-dessous) :
On comprend assez rapidement que les deux enlèvements sont liés... tout comme certains enquêteurs (mais je vous laisse découvrir comment). Sachez simplement qu'on nous propose deux trames temporelles en parallèle. L'intrigue est lancée pour un suspens de six épisodes, un peu à l'image de Disparue, Les Oubliées ou Les Témoins. La distribution est de qualité.
C'est alléchant mais, au vu de ce que contiennent les cinquante premières minutes, je me demande quand même comment les scénaristes sont parvenus à faire tenir l'histoire durant six épisodes. À suivre donc.
04:56 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinema, cinéma, film, films
La Promesse
Il ne va pas être question de l'excellent film des frères Dardenne, mais d'une nouvelle mini-série, dont la diffusion commence jeudi 7 janvier sur TF1. J'ai eu l'occasion d'en voir le premier épisode.
Deux enquêtes sont montrées en parallèle. À chaque fois, il est question de l'enlèvement d'une petite fille. La première affaire se déroule dans les Landes. Elle est traitée par un duo de policiers incarnés par Olivier Marchal et Loránt Deutsch (méconnaissable) :
La deuxième affaire a pour théâtre l'agglomération bordelaise. C'est un trio de policiers qui la prend en charge, sous la houlette d'une capitaine interprétée par Sofia Essaïdi (à droite ci-dessous) :
On comprend assez rapidement que les deux enlèvements sont liés... tout comme certains enquêteurs (mais je vous laisse découvrir comment). Sachez simplement qu'on nous propose deux trames temporelles en parallèle. L'intrigue est lancée pour un suspens de six épisodes, un peu à l'image de Disparue, Les Oubliées ou Les Témoins. La distribution est de qualité.
C'est alléchant mais, au vu de ce que contiennent les cinquante premières minutes, je me demande quand même comment les scénaristes sont parvenus à faire tenir l'histoire durant six épisodes. À suivre donc.
04:56 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinema, cinéma, film, films
dimanche, 03 janvier 2021
"Meurtres au paradis" bientôt de retour...
... sur la BBC. C'est ce qu'annonce le compte twitter officiel de la série britannique. La diffusion de la saison 10 démarre jeudi 7 janvier.
Une première surprise nous attend : sur la photographie d'illustration, Ralf Little (qui incarne l'inspecteur-chef Neville Parker) est accompagné par Joséphine Jobert. Or, rappelez-vous, celle-ci avait quitté la série il y a deux ans. Le compte twitter de la comédienne n'en dit pas plus, mais il met en ligne une bande-annonce dans laquelle son personnage apparaît... tout comme celui d'une autre "ancienne" :
Sara Martins, qui incarna avec talent le sergent Camille Bordey pendant les quatre premières saisons (avant donc que Joséphine Jobert ne prenne le relai), serait de retour pour un épisode double. C'est l'une des nouvelles que l'on peut glaner sur le site Radiotimes, qui en annonce d'autres.
Ainsi, deux personnages féminins quittent la série (la volubile Ruby Patterson et la rigoureuse Madeline Dumas), sans qu'on sache trop pourquoi. Un autre "ancien" revient faire coucou : il s'agit de Ben Miller, qui fut l'inénarrable inspecteur-chef Poole... mais qui mourut assassiné au début de la saison 3. Je suis impatient de voir comment les scénaristes l'ont réintroduit dans la série !
La production a réussi à faire tourner les huit épisodes entre les deux périodes de confinement, en Guadeloupe. J'espère que la version française ne tardera pas trop à débarquer sur France Télévisions.
P.S.
En bonus, je mets un lien vers une vidéo humoristique tournée par Ralf Little et Joséphine Jobert, en loge, entre deux scènes. Regardez bien jusqu'au bout !
16:41 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
"Meurtres au paradis" bientôt de retour...
... sur la BBC. C'est ce qu'annonce le compte twitter officiel de la série britannique. La diffusion de la saison 10 démarre jeudi 7 janvier.
Une première surprise nous attend : sur la photographie d'illustration, Ralf Little (qui incarne l'inspecteur-chef Neville Parker) est accompagné par Joséphine Jobert. Or, rappelez-vous, celle-ci avait quitté la série il y a deux ans. Le compte twitter de la comédienne n'en dit pas plus, mais il met en ligne une bande-annonce dans laquelle son personnage apparaît... tout comme celui d'une autre "ancienne" :
Sara Martins, qui incarna avec talent le sergent Camille Bordey pendant les quatre premières saisons (avant donc que Joséphine Jobert ne prenne le relai), serait de retour pour un épisode double. C'est l'une des nouvelles que l'on peut glaner sur le site Radiotimes, qui en annonce d'autres.
Ainsi, deux personnages féminins quittent la série (la volubile Ruby Patterson et la rigoureuse Madeline Dumas), sans qu'on sache trop pourquoi. Un autre "ancien" revient faire coucou : il s'agit de Ben Miller, qui fut l'inénarrable inspecteur-chef Poole... mais qui mourut assassiné au début de la saison 3. Je suis impatient de voir comment les scénaristes l'ont réintroduit dans la série !
La production a réussi à faire tourner les huit épisodes entre les deux périodes de confinement, en Guadeloupe. J'espère que la version française ne tardera pas trop à débarquer sur France Télévisions.
P.S.
En bonus, je mets un lien vers une vidéo humoristique tournée par Ralf Little et Joséphine Jobert, en loge, entre deux scènes. Regardez bien jusqu'au bout !
16:41 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
samedi, 02 janvier 2021
Un épisode très "sociétal"...
... et politiquement incorrect. J'aime regarder les séries policières anglo-saxonnes "grand public". Elles visent l'efficacité : un divertissement bien conçu sur le plan formel et d'une durée limitée (avec des épisodes de 40 minutes environ).
À la trame policière se superpose souvent une question sociétale, traitée avec délicatesse. C'est le cas dans l'un des derniers épisodes de feue la série Londres, police judiciaire (un décalque de ses grandes soeurs états-uniennes). Il est intitulé "Le poids des traditions".
Cela commence par la découverte du cadavre d'une femme, sous un pont, en plein hiver. Rapidement, les enquêteurs découvrent qu'elle est d'origine égyptienne et grand-mère. Mais, à la compassion du début va succéder le malaise quand on apprend que la famille se déchire à propos de l'excision.
C'est un sujet très brûlant, qui voit s'opposer deux principes généreux : la défense de l'intégrité du corps des femmes et la volonté de ne pas stigmatiser une "minorité visible" (une "communauté" diraient nos amis anglo-saxons).
La France n'est pas épargnée par le phénomène. Au début des années 2000, on estimait à environ 60 000 le nombre de femmes excisées (pas toutes étrangères) vivant dans notre pays. Il y a 18 mois, c'est encore sur cette estimation que s'appuyait Libération (et le gouvernement), tout en se demandant si ce n'était pas plus répandu. C'est sans doute le cas, si l'on fie au Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 23 juillet 2019 : cette publication estime à plus de 120 000 le nombre de femmes excisées vivant en France. La forte augmentation du nombre de cas ne serait pas due au développement de cette mutilation sexuelle, qui aurait quasiment disparu de notre pays. C'est l'arrivée de nouvelles vagues de migrant.e.s, en provenance de pays où l'excision est fortement pratiquée, qui expliquerait cette augmentation.
À lire aussi, une publication ancienne de l'INED, qui explique les conséquences de cette mutilation sur la vie des femmes.
19:24 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films
Un épisode très "sociétal"...
... et politiquement incorrect. J'aime regarder les séries policières anglo-saxonnes "grand public". Elles visent l'efficacité : un divertissement bien conçu sur le plan formel et d'une durée limitée (avec des épisodes de 40 minutes environ).
À la trame policière se superpose souvent une question sociétale, traitée avec délicatesse. C'est le cas dans l'un des derniers épisodes de feue la série Londres, police judiciaire (un décalque de ses grandes soeurs états-uniennes). Il est intitulé "Le poids des traditions".
Cela commence par la découverte du cadavre d'une femme, sous un pont, en plein hiver. Rapidement, les enquêteurs découvrent qu'elle est d'origine égyptienne et grand-mère. Mais, à la compassion du début va succéder le malaise quand on apprend que la famille se déchire à propos de l'excision.
C'est un sujet très brûlant, qui voit s'opposer deux principes généreux : la défense de l'intégrité du corps des femmes et la volonté de ne pas stigmatiser une "minorité visible" (une "communauté" diraient nos amis anglo-saxons).
La France n'est pas épargnée par le phénomène. Au début des années 2000, on estimait à environ 60 000 le nombre de femmes excisées (pas toutes étrangères) vivant dans notre pays. Il y a 18 mois, c'est encore sur cette estimation que s'appuyait Libération (et le gouvernement), tout en se demandant si ce n'était pas plus répandu. C'est sans doute le cas, si l'on fie au Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 23 juillet 2019 : cette publication estime à plus de 120 000 le nombre de femmes excisées vivant en France. La forte augmentation du nombre de cas ne serait pas due au développement de cette mutilation sexuelle, qui aurait quasiment disparu de notre pays. C'est l'arrivée de nouvelles vagues de migrant.e.s, en provenance de pays où l'excision est fortement pratiquée, qui expliquerait cette augmentation.
À lire aussi, une publication ancienne de l'INED, qui explique les conséquences de cette mutilation sur la vie des femmes.
19:24 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films
Les "Riton" 2020
2020, annus horribilis cinematografici. Triste constat pour un secteur culturel majeur, qui risque de se faire définitivement bouffer par les plateformes. Dans un article du Monde du 18 décembre dernier, on apprenait que Netflix avait atteint le chiffre faramineux de 200 millions d'abonnés, devant Disney+ (87 millions), Hulu (39 millions) et HBO Max (13 millions). Il faudrait y ajouter Amazon Prime (plus de 150 millions d'abonnés, mais à un panier de services) et de petits nouveaux comme Apple TV. Si l'on ajoute à cela que la réouverture des cinémas est repoussée, il y a de quoi s'inquiéter pour celles et ceux qui aiment jouir des fictions et documentaires sur grand écran, en salle obscure.
Dans cet océan d'incertitude et de nouvelles déprimantes, l'année qui vient de s'achever nous a quand même procuré de nombreux plaisirs cinéphiliques. En voici un palmarès forcément très subjectif.
L'année 2019 a vu la sortie de nombreux longs-métrages de talent évoquant la place des femmes dans notre société ou les combats qu'elles ont menés.
- Riton du biopic rayonnant : Radioactive (un des films de l'année)
- Riton de l'héroïne "bad ass" : Birds of Prey
- Riton anti-harcèlement : Invisible Man
- Riton de la crise de couple : Chained (un des films de l'année)
- Riton de la chieuse qui veut faire de la politique en milieu patriarcal : The Perfect Candidate
- Riton de la chieuse qui voyage dans le temps : L'Aventure des Marguerite
- Riton de la bande de gonzesses : La Bonne Épouse
Cela nous mène aux comédies françaises, un genre d'ordinaire pas très relevé, mais qui a donné lieu à quelques réussites.
- Riton de la mère indigne : La Daronne
- Riton des grands-pères indignes : Papi-Sitter
- Riton de l'amoureuse indigne : Antoinette dans les Cévennes
- Riton de l'humoriste indigne : Tout simplement noir (un des films de l'année)
La société états-unienne contemporaine, comme la société française, a été interrogée par certaines œuvres cinématographiques.
- Riton du film antiesclavagiste : Antebellum
- Riton du film antiflic : Queen & Slim
- Riton du film antimédiatique : Le Cas Richard Jewell
- Riton du film anti-politicien : Irresistible
- Riton du film crypto-castriste : Cuban Network
- Riton du film anti-corporation : Dark Waters
Paradoxalement, en cette année historique à bien des égards, j'ai été marqué par très peu de films d'époque, plutôt par ceux qui faisaient montre d'une ambition esthétique.
- Riton du film antitotalitaire : L'Ombre de Staline
- Riton du film immersif : 1917 (un des films de l'année)
- Riton du film colonial : Mosquito
- Riton du film habité : Michel Ange
De la fiction au documentaire, il n'y a qu'un pas. Certains ont été particulièrement réussis.
- Riton de la résurrection d'une œuvre : Une Nuit au Louvre
- Riton de la résurrection d'une femme : Be natural (un des films de l'année)
- Riton de la possibilité d'une rédemption : Des Hommes
- Riton de la résurrection d'une ville : Dawson City (un des films de l'année)
Peut-être est-ce lié à l'importance que j'accorde à l'image. En tout cas, cette année encore, les films d'animation sont très présents dans mon palmarès, en dépit d'un nombre restreint de sorties en salles.
- Riton de l'animation historique : Josep
- Riton de l'animation féministe : Calamity
- Riton de l'animation merveilleuse : Dreams (un des films de l'année)
- Riton du Pixar cuvée 2020 : En avant (un des films de l'année)
- Riton de l'animation fantasmagorique : Ailleurs
- Riton de l'animation comique : L'Équipe de secours
- Riton de l'animation asiatique : Lupin III - The First
Si les films d'animation sont, en général, très cadrés, faciles à identifier dans leur propos et leur genre, d'autres œuvres sont pour moi inclassables.
- Riton de la lutte contre le désespoir : Né à Jérusalem
- Riton de la lutte spirituelle : La Communion (un des films de l'année)
- Riton de la lutte pour la survie : Light of my life
- Riton de la lutte des classes : Trois Étés
- Riton de la lutte familiale : Séjour dans les monts Fushun (un des films de l'année)
- Riton de la lutte contre la mort : L'Adieu
- Riton de la lutte en zone semi-désertique : La Femme des steppes, le flic et l'oeuf
Tout cela nous mène aux films de genre, une catégorie un peu fourre-tout, dans laquelle on trouve principalement des polars.
- Riton du polar enfumé : Lucky Strike
- Riton du polar cynégétique : The Hunt
- Riton du polar poisseux : Lands of Murders (un des films de l'année)
- Riton du polar classieux : The Gentlemen (un des films de l'année)
- Riton du polar schizophrénique : Abou Leila
- Riton du polar cérébralo-futuriste : Tenet (un des films de l'année)
Voilà. En dépit de la fermeture des cinémas la moitié de l'année, les salles obscures m'ont procuré de nombreux moments de plaisir. Sur cette liste de 44 très bons moments, j'arrive à mettre en valeur douze longs-métrages, parmi lesquels, peut-être, je pourrais distinguer tout particulièrement 1917, La Communion et Séjour dans les monts Fushun.
BON, MAINTENANT, ÇA SUFFIT ! IL FAUT ROUVRIR LES SALLES DE CINÉMA !
16:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Les "Riton" 2020
2020, annus horribilis cinematografici. Triste constat pour un secteur culturel majeur, qui risque de se faire définitivement bouffer par les plateformes. Dans un article du Monde du 18 décembre dernier, on apprenait que Netflix avait atteint le chiffre faramineux de 200 millions d'abonnés, devant Disney+ (87 millions), Hulu (39 millions) et HBO Max (13 millions). Il faudrait y ajouter Amazon Prime (plus de 150 millions d'abonnés, mais à un panier de services) et de petits nouveaux comme Apple TV. Si l'on ajoute à cela que la réouverture des cinémas est repoussée, il y a de quoi s'inquiéter pour celles et ceux qui aiment jouir des fictions et documentaires sur grand écran, en salle obscure.
Dans cet océan d'incertitude et de nouvelles déprimantes, l'année qui vient de s'achever nous a quand même procuré de nombreux plaisirs cinéphiliques. En voici un palmarès forcément très subjectif.
L'année 2019 a vu la sortie de nombreux longs-métrages de talent évoquant la place des femmes dans notre société ou les combats qu'elles ont menés.
- Riton du biopic rayonnant : Radioactive (un des films de l'année)
- Riton de l'héroïne "bad ass" : Birds of Prey
- Riton anti-harcèlement : Invisible Man
- Riton de la crise de couple : Chained (un des films de l'année)
- Riton de la chieuse qui veut faire de la politique en milieu patriarcal : The Perfect Candidate
- Riton de la chieuse qui voyage dans le temps : L'Aventure des Marguerite
- Riton de la bande de gonzesses : La Bonne Épouse
Cela nous mène aux comédies françaises, un genre d'ordinaire pas très relevé, mais qui a donné lieu à quelques réussites.
- Riton de la mère indigne : La Daronne
- Riton des grands-pères indignes : Papi-Sitter
- Riton de l'amoureuse indigne : Antoinette dans les Cévennes
- Riton de l'humoriste indigne : Tout simplement noir (un des films de l'année)
La société états-unienne contemporaine, comme la société française, a été interrogée par certaines œuvres cinématographiques.
- Riton du film antiesclavagiste : Antebellum
- Riton du film antiflic : Queen & Slim
- Riton du film antimédiatique : Le Cas Richard Jewell
- Riton du film anti-politicien : Irresistible
- Riton du film crypto-castriste : Cuban Network
- Riton du film anti-corporation : Dark Waters
Paradoxalement, en cette année historique à bien des égards, j'ai été marqué par très peu de films d'époque, plutôt par ceux qui faisaient montre d'une ambition esthétique.
- Riton du film antitotalitaire : L'Ombre de Staline
- Riton du film immersif : 1917 (un des films de l'année)
- Riton du film colonial : Mosquito
- Riton du film habité : Michel Ange
De la fiction au documentaire, il n'y a qu'un pas. Certains ont été particulièrement réussis.
- Riton de la résurrection d'une œuvre : Une Nuit au Louvre
- Riton de la résurrection d'une femme : Be natural (un des films de l'année)
- Riton de la possibilité d'une rédemption : Des Hommes
- Riton de la résurrection d'une ville : Dawson City (un des films de l'année)
Peut-être est-ce lié à l'importance que j'accorde à l'image. En tout cas, cette année encore, les films d'animation sont très présents dans mon palmarès, en dépit d'un nombre restreint de sorties en salles.
- Riton de l'animation historique : Josep
- Riton de l'animation féministe : Calamity
- Riton de l'animation merveilleuse : Dreams (un des films de l'année)
- Riton du Pixar cuvée 2020 : En avant (un des films de l'année)
- Riton de l'animation fantasmagorique : Ailleurs
- Riton de l'animation comique : L'Équipe de secours
- Riton de l'animation asiatique : Lupin III - The First
Si les films d'animation sont, en général, très cadrés, faciles à identifier dans leur propos et leur genre, d'autres œuvres sont pour moi inclassables.
- Riton de la lutte contre le désespoir : Né à Jérusalem
- Riton de la lutte spirituelle : La Communion (un des films de l'année)
- Riton de la lutte pour la survie : Light of my life
- Riton de la lutte des classes : Trois Étés
- Riton de la lutte familiale : Séjour dans les monts Fushun (un des films de l'année)
- Riton de la lutte contre la mort : L'Adieu
- Riton de la lutte en zone semi-désertique : La Femme des steppes, le flic et l'oeuf
Tout cela nous mène aux films de genre, une catégorie un peu fourre-tout, dans laquelle on trouve principalement des polars.
- Riton du polar enfumé : Lucky Strike
- Riton du polar cynégétique : The Hunt
- Riton du polar poisseux : Lands of Murders (un des films de l'année)
- Riton du polar classieux : The Gentlemen (un des films de l'année)
- Riton du polar schizophrénique : Abou Leila
- Riton du polar cérébralo-futuriste : Tenet (un des films de l'année)
Voilà. En dépit de la fermeture des cinémas la moitié de l'année, les salles obscures m'ont procuré de nombreux moments de plaisir. Sur cette liste de 44 très bons moments, j'arrive à mettre en valeur douze longs-métrages, parmi lesquels, peut-être, je pourrais distinguer tout particulièrement 1917, La Communion et Séjour dans les monts Fushun.
BON, MAINTENANT, ÇA SUFFIT ! IL FAUT ROUVRIR LES SALLES DE CINÉMA !
16:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 31 décembre 2020
Une fiction pré-covid
Ce soir, France 3 rediffuse deux épisodes de la série «Meurtres à...». Les programmateurs ont choisi deux numéros qui avaient rencontré le succès, en terme d'audience. Ainsi, le samedi 14 septembre 2019, pour sa première diffusion, Meurtres à Colmar était arrivé en tête, avec plus de quatre millions de téléspectateurs.
L'autre épisode est Meurtres dans les Landes. Il est un peu plus ancien (2017) et il a déjà été diffusé deux fois... d'où sans doute sa programmation en seconde partie de soirée. En septembre 2017, cette fiction avait elle aussi attiré plus de quatre millions de téléspectateurs, mais était arrivée derrière l'émission The Voice Kids. Rebelote en février 2019, avec la deuxième place (derrière la série SWAT), encore avec un peu plus de quatre millions de téléspectateurs. Le 14 février dernier, la magie était un peu retombée pour la deuxième rediffusion (en attendant donc la troisième, ce soir), puisqu'à peine trois millions de téléspectateurs l'ont regardée, ce qui a quand même placé France 3 en deuxième position ce soir-là.
Je l'ai déjà écrit en avril dernier, la qualité des épisodes est très inégale. En général, l'imagerie est soignée : c'est joli à regarder, avec de superbes paysages et la mise en valeur du patrimoine architectural. Le scénario est souvent assez retors. Tout dépend donc des dialogues et de l'interprétation (et sans doute du nombre de prises). Dans le genre, Meurtres à Colmar est plutôt pas mal. Le duo (au départ toujours tendu) formé par Pierre Arditi et Garance Thenault est convaincant. Au niveau des seconds rôles, on peut signaler la présence d'Isabelle Candelier, de Stéphane Soo Mongo (remarqué jadis dans Section de recherches) et de Vincent Deniard.
C'est un détail présent dans cet épisode (tourné en 2018, donc avant la pandémie) qui a attiré mon attention. Il se trouve dans une scène qui se déroule à l'institut médico-légal. Le héros Étienne Ronsard (qui cherche à en savoir plus sur les circonstances exactes du décès de son fils policier) rend visite au médecin légiste, en quête d'informations. Voici ce que l'on peut voir à son arrivée :
Vous remarquerez qu'un masque chirurgical est posé contre la boîte à crayons du médecin. Sa présence n'est pas incongrue dans le bureau de ce professionnel... mais, en terme de norme hygiénique, il y a de quoi tiquer. Quoi qu'il en soit, au vu des circonstances actuelles, j'ai trouvé cette présence assez cocasse.
16:47 Publié dans Cinéma, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films
Une fiction pré-covid
Ce soir, France 3 rediffuse deux épisodes de la série «Meurtres à...». Les programmateurs ont choisi deux numéros qui avaient rencontré le succès, en terme d'audience. Ainsi, le samedi 14 septembre 2019, pour sa première diffusion, Meurtres à Colmar était arrivé en tête, avec plus de quatre millions de téléspectateurs.
L'autre épisode est Meurtres dans les Landes. Il est un peu plus ancien (2017) et il a déjà été diffusé deux fois... d'où sans doute sa programmation en seconde partie de soirée. En septembre 2017, cette fiction avait elle aussi attiré plus de quatre millions de téléspectateurs, mais était arrivée derrière l'émission The Voice Kids. Rebelote en février 2019, avec la deuxième place (derrière la série SWAT), encore avec un peu plus de quatre millions de téléspectateurs. Le 14 février dernier, la magie était un peu retombée pour la deuxième rediffusion (en attendant donc la troisième, ce soir), puisqu'à peine trois millions de téléspectateurs l'ont regardée, ce qui a quand même placé France 3 en deuxième position ce soir-là.
Je l'ai déjà écrit en avril dernier, la qualité des épisodes est très inégale. En général, l'imagerie est soignée : c'est joli à regarder, avec de superbes paysages et la mise en valeur du patrimoine architectural. Le scénario est souvent assez retors. Tout dépend donc des dialogues et de l'interprétation (et sans doute du nombre de prises). Dans le genre, Meurtres à Colmar est plutôt pas mal. Le duo (au départ toujours tendu) formé par Pierre Arditi et Garance Thenault est convaincant. Au niveau des seconds rôles, on peut signaler la présence d'Isabelle Candelier, de Stéphane Soo Mongo (remarqué jadis dans Section de recherches) et de Vincent Deniard.
C'est un détail présent dans cet épisode (tourné en 2018, donc avant la pandémie) qui a attiré mon attention. Il se trouve dans une scène qui se déroule à l'institut médico-légal. Le héros Étienne Ronsard (qui cherche à en savoir plus sur les circonstances exactes du décès de son fils policier) rend visite au médecin légiste, en quête d'informations. Voici ce que l'on peut voir à son arrivée :
Vous remarquerez qu'un masque chirurgical est posé contre la boîte à crayons du médecin. Sa présence n'est pas incongrue dans le bureau de ce professionnel... mais, en terme de norme hygiénique, il y a de quoi tiquer. Quoi qu'il en soit, au vu des circonstances actuelles, j'ai trouvé cette présence assez cocasse.
16:47 Publié dans Cinéma, Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : société, télévision, cinéma, cinema, film, films
mardi, 29 décembre 2020
Pépites "starwarsiennes"
Les fans de l'univers créé (principalement) par George Lucas sont légion. Plusieurs millions d'entre eux sont abonnés à la chaîne Youtube Star Wars Theory. Celle-ci a mis en ligne deux vidéos dont l'action se déroule entre les épisodes III et IV de la saga, autour du personnage de Dark Vador (Darth Vader dans la version originale).
Vader Episode 1 est un court-métrage d'une douzaine de minutes, qui fait principalement intervenir l'empereur Palpatine et le nouveau seigneur Sith, qui n'a pas encore complètement rompu avec son passé (récent) d'Anakin Skywalker. C'est tourné avec de vrais acteurs (pas connus), mais l'habillage sonore et visuel des longs-métrages "officiels". Dans une courte vidéo, l'un des créateurs explique comment il a obtenu l'accord de LucasFilm.
Le résultat est bien plus emballant que ce que les films de la "postlogie" (le copié-collé Réveil de la Force, l'inégal Les Derniers Jedi et la décevante Ascension de Skywalker) ont donné à voir. Je recommande tout particulièrement la scène saisissante qui se déroule dans l'antre de Vador (et qui fait évidemment écho à ce que l'on voit à la fin de La Revanche des Sith).
Ce petit film chiadé, réalisé par Danny Ramirez, a suscité un tel enthousiasme qu'une suite était attendue... d'autant qu'il existe du matériau support, aussi bien dans l'univers "Légendes" que dans les bandes dessinées sorties ces dernières années. (De mon côté, je pense que les promoteurs du film avaient le secret espoir que Disney se lance dans la production d'une série ou d'un long-métrage "officiel".)
Quoi qu'il en soit, très récemment, l'épisode 2 a été mis en ligne. Il ne dure que trois minutes et a été réalisé sous forme d'animation cinématique. On y voit Vador se rendre sur la planète Naboo (où sont nés aussi bien Padmé que l'ex-chancelier Palpatine), pour mettre hors d'état de nuire l'un des derniers Jedi survivants... et on le connaît, puisque c'est l'un des personnages de la prélogie. Je vous donne un indice : l'acteur qui interprète ce Jedi avait demandé à disposer d'un sabre-laser d'une couleur particulière...
Aux amateurs de drogue dure, je signale une autre création du web, plus précisément de la chaîne Cinematic Captures. Il s'agit aussi d'un court-métrage, intitulé Shadow of the Republic. L'action se déroule pendant la Guerre des clones. Les héros sont ces fameux soldats clones, vus dans la prélogie ainsi que dans les séries d'animation développées par Disney (le plus célèbre d'entre eux s'appelant Rex). Je rappelle qu'au départ, ils constituaient l'armée de défense de la République, avant d'être récupérés par l'Empire. (Ils ont même ardemment participé au massacre des Jedi) Dans les épisodes IV, V et VI (les premiers sortis en salles), ils ont été remplacés par les funestes stormtroopers, ces soldats en armure blanche qui font tellement penser aux militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale.
P.S.
A venir (en 2021 ou 2022), une nouvelle série, destinée à remplacer un film au départ prévu autour du personnage d'Obi-Wan Kenobi. Elle sera diffusée sur Disney +. On y verra Ewan McGregor... et le fadasse Hayden Christensen, heureusement dissimulé par le costume de Dark Vador. Il reste à savoir qui sera la voix du "chevalier noir".
P.S. II
Un dernier bonus, pour la route : la reconstruction (en plus violent) du combat entre Vador et Kenobi, à la fin de l'épisode IV. Il faut imaginer un Alec Guinness en forme olympique. Le résultat est assez emballant.
01:04 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Pépites "starwarsiennes"
Les fans de l'univers créé (principalement) par George Lucas sont légion. Plusieurs millions d'entre eux sont abonnés à la chaîne Youtube Star Wars Theory. Celle-ci a mis en ligne deux vidéos dont l'action se déroule entre les épisodes III et IV de la saga, autour du personnage de Dark Vador (Darth Vader dans la version originale).
Vader Episode 1 est un court-métrage d'une douzaine de minutes, qui fait principalement intervenir l'empereur Palpatine et le nouveau seigneur Sith, qui n'a pas encore complètement rompu avec son passé (récent) d'Anakin Skywalker. C'est tourné avec de vrais acteurs (pas connus), mais l'habillage sonore et visuel des longs-métrages "officiels". Dans une courte vidéo, l'un des créateurs explique comment il a obtenu l'accord de LucasFilm.
Le résultat est bien plus emballant que ce que les films de la "postlogie" (le copié-collé Réveil de la Force, l'inégal Les Derniers Jedi et la décevante Ascension de Skywalker) ont donné à voir. Je recommande tout particulièrement la scène saisissante qui se déroule dans l'antre de Vador (et qui fait évidemment écho à ce que l'on voit à la fin de La Revanche des Sith).
Ce petit film chiadé, réalisé par Danny Ramirez, a suscité un tel enthousiasme qu'une suite était attendue... d'autant qu'il existe du matériau support, aussi bien dans l'univers "Légendes" que dans les bandes dessinées sorties ces dernières années. (De mon côté, je pense que les promoteurs du film avaient le secret espoir que Disney se lance dans la production d'une série ou d'un long-métrage "officiel".)
Quoi qu'il en soit, très récemment, l'épisode 2 a été mis en ligne. Il ne dure que trois minutes et a été réalisé sous forme d'animation cinématique. On y voit Vador se rendre sur la planète Naboo (où sont nés aussi bien Padmé que l'ex-chancelier Palpatine), pour mettre hors d'état de nuire l'un des derniers Jedi survivants... et on le connaît, puisque c'est l'un des personnages de la prélogie. Je vous donne un indice : l'acteur qui interprète ce Jedi avait demandé à disposer d'un sabre-laser d'une couleur particulière...
Aux amateurs de drogue dure, je signale une autre création du web, plus précisément de la chaîne Cinematic Captures. Il s'agit aussi d'un court-métrage, intitulé Shadow of the Republic. L'action se déroule pendant la Guerre des clones. Les héros sont ces fameux soldats clones, vus dans la prélogie ainsi que dans les séries d'animation développées par Disney (le plus célèbre d'entre eux s'appelant Rex). Je rappelle qu'au départ, ils constituaient l'armée de défense de la République, avant d'être récupérés par l'Empire. (Ils ont même ardemment participé au massacre des Jedi) Dans les épisodes IV, V et VI (les premiers sortis en salles), ils ont été remplacés par les funestes stormtroopers, ces soldats en armure blanche qui font tellement penser aux militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale.
P.S.
A venir (en 2021 ou 2022), une nouvelle série, destinée à remplacer un film au départ prévu autour du personnage d'Obi-Wan Kenobi. Elle sera diffusée sur Disney +. On y verra Ewan McGregor... et le fadasse Hayden Christensen, heureusement dissimulé par le costume de Dark Vador. Il reste à savoir qui sera la voix du "chevalier noir".
P.S. II
Un dernier bonus, pour la route : la reconstruction (en plus violent) du combat entre Vador et Kenobi, à la fin de l'épisode IV. Il faut imaginer un Alec Guinness en forme olympique. Le résultat est assez emballant.
01:04 Publié dans Cinéma, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 20 décembre 2020
"Les Mystérieuses Cités d'or", suite
France télévisions, par l'entremise de sa plateforme Okoo, poursuit la diffusion de la quatrième (et dernière) saison de la célèbre série d'animation. Début décembre, on en était resté à l'épisode 11 (sur 26). Il y a quelques jours, trois nouveaux épisodes ont été mis en ligne.
Le douzième, intitulé "Adieu Maître !", est centré sur le personnage d'Ambrosius, qui croit toucher au but... mais se retrouve face à de dangereux concurrents. Dans le même temps, les enfants remontent la piste du masque, en Afrique. Ils comptent le remettre à sa place d'origine, où les attend peut-être une autre cité d'or. Mais une nouvelle menace se dresse devant eux...
Le treizième épisode ("La nuit des masques", curieusement mal orthographié dans l'incrustation comme dans le sous-titre) voit l'action s'accélérer. Dans la base secrète d'Ambrosius, les Olmèques affrontent l'alchimiste épaulé par Gaspard et Laguerra. En Afrique, Mendoza et les enfants sont opposés à d'étranges hommes-léopards.
Cette série de nouveautés s'achève par "La falaise aux esprits", dont l'action se déroule essentiellement en Afrique, en pays dogon. Les héros partent à la recherche de Zia, qui a été enlevée. Ils pénètrent dans une mystérieuse cité abandonnée, à flanc de falaise.
Même si l'intrigue générale est toujours aussi captivante, cet épisode fut pour moi une déception, en raison des incohérences qu'il contient, la pire étant celle-ci :
Même les enfants en bas âge s'étonneront que la tentative d'infiltration de Sancho et Pedro (dans la secte des hommes-léopards) ne soit pas remarquée par les autres membres du groupe, alors que ce sont les deux seuls Blancs !
Ceci dit, l'épisode s'achève sur un bon "cliffhanger"... mais il va falloir (a priori) attendre le mois de janvier pour connaître la suite !
15:35 Publié dans Loisirs, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
"Les Mystérieuses Cités d'or", suite
France télévisions, par l'entremise de sa plateforme Okoo, poursuit la diffusion de la quatrième (et dernière) saison de la célèbre série d'animation. Début décembre, on en était resté à l'épisode 11 (sur 26). Il y a quelques jours, trois nouveaux épisodes ont été mis en ligne.
Le douzième, intitulé "Adieu Maître !", est centré sur le personnage d'Ambrosius, qui croit toucher au but... mais se retrouve face à de dangereux concurrents. Dans le même temps, les enfants remontent la piste du masque, en Afrique. Ils comptent le remettre à sa place d'origine, où les attend peut-être une autre cité d'or. Mais une nouvelle menace se dresse devant eux...
Le treizième épisode ("La nuit des masques", curieusement mal orthographié dans l'incrustation comme dans le sous-titre) voit l'action s'accélérer. Dans la base secrète d'Ambrosius, les Olmèques affrontent l'alchimiste épaulé par Gaspard et Laguerra. En Afrique, Mendoza et les enfants sont opposés à d'étranges hommes-léopards.
Cette série de nouveautés s'achève par "La falaise aux esprits", dont l'action se déroule essentiellement en Afrique, en pays dogon. Les héros partent à la recherche de Zia, qui a été enlevée. Ils pénètrent dans une mystérieuse cité abandonnée, à flanc de falaise.
Même si l'intrigue générale est toujours aussi captivante, cet épisode fut pour moi une déception, en raison des incohérences qu'il contient, la pire étant celle-ci :
Même les enfants en bas âge s'étonneront que la tentative d'infiltration de Sancho et Pedro (dans la secte des hommes-léopards) ne soit pas remarquée par les autres membres du groupe, alors que ce sont les deux seuls Blancs !
Ceci dit, l'épisode s'achève sur un bon "cliffhanger"... mais il va falloir (a priori) attendre le mois de janvier pour connaître la suite !
15:35 Publié dans Loisirs, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, médias, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
vendredi, 11 décembre 2020
Balthazar force 7
Depuis le mois dernier, TF1 diffuse la troisième saison de la série Balthazar. C'est un carton d'audience : le jeudi en soirée (comme hier), ce programme réunit trois à six fois plus de spectateurs que ses concurrents les plus proches.
Le succès est tel que la chaîne a décidé de plus diffuser qu'un seul épisode inédit par semaine, suivi de ceux des saisons précédentes, susceptibles eux aussi d'intéresser une partie du public, qui a découvert la série cette année.
Je trouve que la qualité des aventures inédites du brillant légiste et de la policière tenace ne cesse d'augmenter. L'épisode 7 ("À la folie") a débuté par une scène à la fois tendre et comique, qui a permis aux spectatrices de se rincer l’œil avec la plastique abdominale quasi parfaite de Tomer Sisley :
L'intrigue s'est ensuite emballée : un nouveau tueur en série semble sévir... et c'est un clown ! Les enquêteurs vont finir par découvrir que ce type en apparence dérangé applique en réalité un plan très rationnel. Il faut relever la qualité de l'interprétation de Thierry Lopez, qui incarne un "méchant" très humain, qui n'est pas sans rappeler le Joker.
En parallèle progresse l'intrigue fil rouge : l'arrestation du tueur de la première compagne du médecin légiste. Je sens qu'on nous prépare un joli coup de théâtre (pas uniquement son évasion). Il n'est pas impossible que ce tueur impitoyable soit lié à une personne très proche de Balthazar...
17:12 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias
Balthazar force 7
Depuis le mois dernier, TF1 diffuse la troisième saison de la série Balthazar. C'est un carton d'audience : le jeudi en soirée (comme hier), ce programme réunit trois à six fois plus de spectateurs que ses concurrents les plus proches.
Le succès est tel que la chaîne a décidé de plus diffuser qu'un seul épisode inédit par semaine, suivi de ceux des saisons précédentes, susceptibles eux aussi d'intéresser une partie du public, qui a découvert la série cette année.
Je trouve que la qualité des aventures inédites du brillant légiste et de la policière tenace ne cesse d'augmenter. L'épisode 7 ("À la folie") a débuté par une scène à la fois tendre et comique, qui a permis aux spectatrices de se rincer l’œil avec la plastique abdominale quasi parfaite de Tomer Sisley :
L'intrigue s'est ensuite emballée : un nouveau tueur en série semble sévir... et c'est un clown ! Les enquêteurs vont finir par découvrir que ce type en apparence dérangé applique en réalité un plan très rationnel. Il faut relever la qualité de l'interprétation de Thierry Lopez, qui incarne un "méchant" très humain, qui n'est pas sans rappeler le Joker.
En parallèle progresse l'intrigue fil rouge : l'arrestation du tueur de la première compagne du médecin légiste. Je sens qu'on nous prépare un joli coup de théâtre (pas uniquement son évasion). Il n'est pas impossible que ce tueur impitoyable soit lié à une personne très proche de Balthazar...
17:12 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias
lundi, 07 décembre 2020
Les Mystérieuses Cités d'or - saison 4
Deux ans après avoir mis en ligne l'intégralité de la saison 1 de cette série mythique des années 1980 (toujours accessible à l'heure où j'écris ces lignes), France Télévisions vient de lancer la diffusion (inédite) des premiers épisodes de la quatrième et ultime saison. Cerise sur la gâteau : ces épisodes resteront accessibles jusqu'en février prochain.
La recette n'a pas changé. Si le fond de l'histoire (les séquelles de la rivalité entre deux antiques civilisations très évoluées) est une invention totale, le contexte de la conquête du monde par les Européens, au XVIe siècle, est bien réel, et nourri de nombreux exemples. Les scénaristes ont successivement emmené leur public en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Iran, en Arabie. Nous voilà conduits à présent en Afrique... et un peu en France.
Le premier épisode ("Lalibela") nous fait découvrir le christianisme éthiopien et ses étonnantes constructions :
Le deuxième épisode ("Le Rêve de Zia") met davantage en valeur l'élément féminin du trio (où figurent les garçons Esteban et Tao). Après avoir sauvé ses amis, la jeune fille, épuisée, tombe dans un sommeil extralucide, durant lequel elle découvre un élément qui pourrait aider la petite troupe à mener sa quête à son terme :
Le troisième épisode ("Enchaînés") a pour arrière-plan la traite des esclaves, à laquelle se livrent aussi bien des Africains que les Portugais qui contrôlent la côte sud-orientale de l'Afrique. Cela révolte nos héros qui, temporairement, se détournent de leur quête. C'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis (une situation envisageable si l'on accepte la convention de ce genre de productions : tous les personnages se comprennent)... et de retrouver une vieille connaissance.
Peut-être pour contrebalancer cet épisode un peu macabre, le suivant ("La grande évasion") est beaucoup plus joyeux. La manière dont les héros vont se débarrasser de la menace représentée par les soldats de la garde est particulièrement cocasse. C'est l'occasion pour le perroquet Pichu de jouer un rôle capital :
Le merveilleux est de retour avec l'épisode 5 ("La porte des anciens"), qui conduit nos héros dans une célèbre bâtisse française, par un moyen que je laisse à chacun le plaisir de découvrir. (Un indice : le souverain a pour emblème une salamandre.) Dans le même temps, on découvre la base secrète d'Ambrosius... et ses mystérieux acolytes, tout droit sortis de la première saison.
Les révélations s'enchaînent au cours de l'épisode 6 ("Le fondateur"). Tao se verrait bien rester dans ce château de la Renaissance, où a séjourné un célèbre artiste polyvalent. Au quotidien, il y côtoie un passionné d'astrologie, pas encore très connu...
L'action s'accélère dans le septième épisode ("La fumée qui gronde"). Sans Tao, l'équipe de héros tente de prendre de vitesse le vilain Ambrosius (toujours épaulé par Gaspard et Laguerra, auxquels se sont joints des alliés quelque peu encombrants). La cinquième cité d'or n'est plus très loin... à condition d'éviter les pièges tendus par des marches aux gravures énigmatiques :
L'épisode 8 ("Ophir") voit déferler un torrent de couleurs et de lumière, dans un contexte agité. La lutte pour la possession d'un objet redoutable est à son comble. Dans le même temps, de nouveaux mystères surgissent, l'un étant lié à d'étranges pyramides :
De nouvelles révélations sont distillées au cours de l'épisode 9 ("La pierre d'éternité"). On y apprend l'origine du peuple appelé "Olmèque" (et qui n'a rien à voir avec les authentiques précolombiens). En France, Tao découvre qu'un célèbre peintre a dissimulé des messages dans la plupart de ses œuvres. Notons que, pour mettre en scène cet aspect de l'intrigue, les auteurs ont quelque peu tordu la réalité :
Fort logiquement, on arrive à l'épisode 10 ("La dame qui sourit"), au cours duquel Tao fait la connaissance d'un tableau qu'on ne présente plus. Les recherches des héros semblent progresser, tandis que le vaisseau d'Ambrosius est victime d'une avarie. Il y a du complot dans l'air...
Le suspens gagne encore en intensité au cours de l'épisode 11 ("Le Bako"), le dernier diffusé jusqu'à présent. Au centre de l'intrigue se trouve le fameux masque vu en rêve par Zia dans l'épisode 2. Lâchée par ses compagnons un peu immatures, la jeune fille prend les choses en mains (notamment le manche du Grand Condor) et retourne dans le port esclavagiste du début... avec un passager clandestin.
L'épisode se conclut par de nouvelles révélations. On attend la suite avec impatience ! Le scénario est trépidant, avec de nombreux rebondissements. L'animation est vraiment de qualité, notamment au niveau des décors et des objets luisants. Quant à la caractérisation des personnages, elle me semble meilleure que dans la saison 2. Les deux assistants de Mendoza, Sancho et Pedro, sont moins agaçants. Du côté des héros, on a parfois envie de secouer Tao et Esteban... mais c'est volontaire de la part des scénaristes, qui ont choisi de ne pas mettre en scène des personnages idéalisés dès le début. Ils ont certes des qualités exceptionnelles, mais ils font aussi des bêtises, par impétuosité, orgueil ou égocentrisme. Les aventures qu'ils vivent les font mûrir, en même temps qu'elles font croître les sentiments entre deux (séduisants) adultes, Mendoza et Laguerra.
D'après un blog spécialisé, les épisodes 12 à 14 seront bientôt mis en ligne, les suivants un peu plus tard, au mois de janvier.
P.S.
La pandémie n'est pas absente de cette série d'animation. Il y a quelques mois, j'avais ironisé sur des images présentes dans certains épisodes de la saison 3 (actuellement rediffusée sur Okoo, tout comme la deuxième), qui pouvaient faire écho à la situation dans laquelle est plongé notre pays. Cette fois-ci, c'est directement, dans les images des petits documentaires placés en fin d'épisode que l'on voit l'impact du covid-19. A plusieurs reprises (par exemple à la fin des épisodes 6 et 10), on remarque que les personnes visitant les sites touristiques portent un masque :
01:15 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
Les Mystérieuses Cités d'or - saison 4
Deux ans après avoir mis en ligne l'intégralité de la saison 1 de cette série mythique des années 1980 (toujours accessible à l'heure où j'écris ces lignes), France Télévisions vient de lancer la diffusion (inédite) des premiers épisodes de la quatrième et ultime saison. Cerise sur la gâteau : ces épisodes resteront accessibles jusqu'en février prochain.
La recette n'a pas changé. Si le fond de l'histoire (les séquelles de la rivalité entre deux antiques civilisations très évoluées) est une invention totale, le contexte de la conquête du monde par les Européens, au XVIe siècle, est bien réel, et nourri de nombreux exemples. Les scénaristes ont successivement emmené leur public en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Iran, en Arabie. Nous voilà conduits à présent en Afrique... et un peu en France.
Le premier épisode ("Lalibela") nous fait découvrir le christianisme éthiopien et ses étonnantes constructions :
Le deuxième épisode ("Le Rêve de Zia") met davantage en valeur l'élément féminin du trio (où figurent les garçons Esteban et Tao). Après avoir sauvé ses amis, la jeune fille, épuisée, tombe dans un sommeil extralucide, durant lequel elle découvre un élément qui pourrait aider la petite troupe à mener sa quête à son terme :
Le troisième épisode ("Enchaînés") a pour arrière-plan la traite des esclaves, à laquelle se livrent aussi bien des Africains que les Portugais qui contrôlent la côte sud-orientale de l'Afrique. Cela révolte nos héros qui, temporairement, se détournent de leur quête. C'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis (une situation envisageable si l'on accepte la convention de ce genre de productions : tous les personnages se comprennent)... et de retrouver une vieille connaissance.
Peut-être pour contrebalancer cet épisode un peu macabre, le suivant ("La grande évasion") est beaucoup plus joyeux. La manière dont les héros vont se débarrasser de la menace représentée par les soldats de la garde est particulièrement cocasse. C'est l'occasion pour le perroquet Pichu de jouer un rôle capital :
Le merveilleux est de retour avec l'épisode 5 ("La porte des anciens"), qui conduit nos héros dans une célèbre bâtisse française, par un moyen que je laisse à chacun le plaisir de découvrir. (Un indice : le souverain a pour emblème une salamandre.) Dans le même temps, on découvre la base secrète d'Ambrosius... et ses mystérieux acolytes, tout droit sortis de la première saison.
Les révélations s'enchaînent au cours de l'épisode 6 ("Le fondateur"). Tao se verrait bien rester dans ce château de la Renaissance, où a séjourné un célèbre artiste polyvalent. Au quotidien, il y côtoie un passionné d'astrologie, pas encore très connu...
L'action s'accélère dans le septième épisode ("La fumée qui gronde"). Sans Tao, l'équipe de héros tente de prendre de vitesse le vilain Ambrosius (toujours épaulé par Gaspard et Laguerra, auxquels se sont joints des alliés quelque peu encombrants). La cinquième cité d'or n'est plus très loin... à condition d'éviter les pièges tendus par des marches aux gravures énigmatiques :
L'épisode 8 ("Ophir") voit déferler un torrent de couleurs et de lumière, dans un contexte agité. La lutte pour la possession d'un objet redoutable est à son comble. Dans le même temps, de nouveaux mystères surgissent, l'un étant lié à d'étranges pyramides :
De nouvelles révélations sont distillées au cours de l'épisode 9 ("La pierre d'éternité"). On y apprend l'origine du peuple appelé "Olmèque" (et qui n'a rien à voir avec les authentiques précolombiens). En France, Tao découvre qu'un célèbre peintre a dissimulé des messages dans la plupart de ses œuvres. Notons que, pour mettre en scène cet aspect de l'intrigue, les auteurs ont quelque peu tordu la réalité :
Fort logiquement, on arrive à l'épisode 10 ("La dame qui sourit"), au cours duquel Tao fait la connaissance d'un tableau qu'on ne présente plus. Les recherches des héros semblent progresser, tandis que le vaisseau d'Ambrosius est victime d'une avarie. Il y a du complot dans l'air...
Le suspens gagne encore en intensité au cours de l'épisode 11 ("Le Bako"), le dernier diffusé jusqu'à présent. Au centre de l'intrigue se trouve le fameux masque vu en rêve par Zia dans l'épisode 2. Lâchée par ses compagnons un peu immatures, la jeune fille prend les choses en mains (notamment le manche du Grand Condor) et retourne dans le port esclavagiste du début... avec un passager clandestin.
L'épisode se conclut par de nouvelles révélations. On attend la suite avec impatience ! Le scénario est trépidant, avec de nombreux rebondissements. L'animation est vraiment de qualité, notamment au niveau des décors et des objets luisants. Quant à la caractérisation des personnages, elle me semble meilleure que dans la saison 2. Les deux assistants de Mendoza, Sancho et Pedro, sont moins agaçants. Du côté des héros, on a parfois envie de secouer Tao et Esteban... mais c'est volontaire de la part des scénaristes, qui ont choisi de ne pas mettre en scène des personnages idéalisés dès le début. Ils ont certes des qualités exceptionnelles, mais ils font aussi des bêtises, par impétuosité, orgueil ou égocentrisme. Les aventures qu'ils vivent les font mûrir, en même temps qu'elles font croître les sentiments entre deux (séduisants) adultes, Mendoza et Laguerra.
D'après un blog spécialisé, les épisodes 12 à 14 seront bientôt mis en ligne, les suivants un peu plus tard, au mois de janvier.
P.S.
La pandémie n'est pas absente de cette série d'animation. Il y a quelques mois, j'avais ironisé sur des images présentes dans certains épisodes de la saison 3 (actuellement rediffusée sur Okoo, tout comme la deuxième), qui pouvaient faire écho à la situation dans laquelle est plongé notre pays. Cette fois-ci, c'est directement, dans les images des petits documentaires placés en fin d'épisode que l'on voit l'impact du covid-19. A plusieurs reprises (par exemple à la fin des épisodes 6 et 10), on remarque que les personnes visitant les sites touristiques portent un masque :
01:15 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, histoire, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
lundi, 30 novembre 2020
Bodyguard (suite et fin)
France 2 vient d'achever la diffusion de cette excellente série britannique. Dans l'épisode 5, la situation semble se décanter quelque peu. L'enquête policière progresse, mais elle est contrecarrée par les efforts de la Sécurité intérieure, dont on se demande si ses agents cherchent à étouffer un banal scandale politique ou à empêcher la révélation de l'origine du complot. La mise en images est toujours aussi soignée.
Dans le même temps, le piège se referme autour du héros (David, le vétéran d'Afghanistan), qui doit protéger sa famille et se méfier de tout le monde : il y a (au moins) une taupe dans la police.
L'épisode 6 est absolument for-mi-da-ble. Il entremêle ambitions politiques, rivalités sécuritaires, extrémisme religieux, appât du gain, crime crapuleux et l'histoire personnelle du héros, émouvante. C'est tendu de bout en bout. Les acteurs sont subtils, le suspens ach'ment bien mené, avec des coups de théâtre jusqu'au bout.
23:53 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, société, cinéma, cinema, film, films
Bodyguard (suite et fin)
France 2 vient d'achever la diffusion de cette excellente série britannique. Dans l'épisode 5, la situation semble se décanter quelque peu. L'enquête policière progresse, mais elle est contrecarrée par les efforts de la Sécurité intérieure, dont on se demande si ses agents cherchent à étouffer un banal scandale politique ou à empêcher la révélation de l'origine du complot. La mise en images est toujours aussi soignée.
Dans le même temps, le piège se referme autour du héros (David, le vétéran d'Afghanistan), qui doit protéger sa famille et se méfier de tout le monde : il y a (au moins) une taupe dans la police.
L'épisode 6 est absolument for-mi-da-ble. Il entremêle ambitions politiques, rivalités sécuritaires, extrémisme religieux, appât du gain, crime crapuleux et l'histoire personnelle du héros, émouvante. C'est tendu de bout en bout. Les acteurs sont subtils, le suspens ach'ment bien mené, avec des coups de théâtre jusqu'au bout.
23:53 Publié dans Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, société, cinéma, cinema, film, films
mardi, 17 novembre 2020
Bodyguard
France 2 vient de commencer la diffusion de la mini-série britannique Bodyguard. Elle raconte l'histoire de David Budd, un vétéran d'Afghanistan retourné à la vie civile, lesté d'un syndrome de stress post-traumatique. Il a été affecté au service de protection des personnes, à l'origine plutôt des notabilités étrangères de passage à Londres. Dans le rôle, Richard Madden (vu dans 1917 et Bastille Day) est excellent.
Le premier épisode commence dans un train. Le héros s'y trouve avec ses deux enfants, qu'il ramène à leur mère, dont il est séparé. Dans la voiture, il ne peut s'empêcher d'observer les passagers. Il remarque deux trois choses bizarres... et il a raison de s'inquiéter :
Je trouve particulièrement réussie cette mise en bouche, avec une implacable montée en tension, servie par une musique très bien choisie. (À titre de comparaison, j'ai trouvé cela meilleur que Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood.) La conclusion de la séquence est de surcroît surprenante, le héros tentant de régler le problème par le dialogue, s'appuyant sur la confiance suscitée par son assurance tranquille.
Dans la foulée, David va changer d'affectation. Est-ce le fait du hasard ? (On commence à s'interroger sur les causes de certains événements.) Toujours est-il que le vétéran devient le garde du corps de la ministre de l'Intérieur (nom de code "Lavande"), une politicienne entre deux âges, ambitieuse et cassante, très intéressée par tout ce qui touche au terrorisme. La comédienne Keeley Hawes campe avec talent un personnage qui, aux yeux du public français, semble être un mélange de Valérie Pécresse et Marine Le Pen.
Le deuxième épisode maintient l'attention au même niveau. Il fait même monter la tension d'un cran, grâce à deux séquences haletantes : celle du camion piégé et celle de l'attentat final, que je me garderai de déflorer. Les scènes non politiques, plus intimes, permettent de voir certains personnages sous un autre jour. Notons que le héros David fait une étonnante découverte, qui risque de bouleverser ses certitudes... mais (autant le dire tout de suite) j'ajoute qu'il n'est pas au bout de ses surprises.
Vite, la suite !
P.S.
Le scénariste, Jed Mercurio, est celui de Line of Duty.
23:10 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
Bodyguard
France 2 vient de commencer la diffusion de la mini-série britannique Bodyguard. Elle raconte l'histoire de David Budd, un vétéran d'Afghanistan retourné à la vie civile, lesté d'un syndrome de stress post-traumatique. Il a été affecté au service de protection des personnes, à l'origine plutôt des notabilités étrangères de passage à Londres. Dans le rôle, Richard Madden (vu dans 1917 et Bastille Day) est excellent.
Le premier épisode commence dans un train. Le héros s'y trouve avec ses deux enfants, qu'il ramène à leur mère, dont il est séparé. Dans la voiture, il ne peut s'empêcher d'observer les passagers. Il remarque deux trois choses bizarres... et il a raison de s'inquiéter :
Je trouve particulièrement réussie cette mise en bouche, avec une implacable montée en tension, servie par une musique très bien choisie. (À titre de comparaison, j'ai trouvé cela meilleur que Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood.) La conclusion de la séquence est de surcroît surprenante, le héros tentant de régler le problème par le dialogue, s'appuyant sur la confiance suscitée par son assurance tranquille.
Dans la foulée, David va changer d'affectation. Est-ce le fait du hasard ? (On commence à s'interroger sur les causes de certains événements.) Toujours est-il que le vétéran devient le garde du corps de la ministre de l'Intérieur (nom de code "Lavande"), une politicienne entre deux âges, ambitieuse et cassante, très intéressée par tout ce qui touche au terrorisme. La comédienne Keeley Hawes campe avec talent un personnage qui, aux yeux du public français, semble être un mélange de Valérie Pécresse et Marine Le Pen.
Le deuxième épisode maintient l'attention au même niveau. Il fait même monter la tension d'un cran, grâce à deux séquences haletantes : celle du camion piégé et celle de l'attentat final, que je me garderai de déflorer. Les scènes non politiques, plus intimes, permettent de voir certains personnages sous un autre jour. Notons que le héros David fait une étonnante découverte, qui risque de bouleverser ses certitudes... mais (autant le dire tout de suite) j'ajoute qu'il n'est pas au bout de ses surprises.
Vite, la suite !
P.S.
Le scénariste, Jed Mercurio, est celui de Line of Duty.
23:10 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
samedi, 14 novembre 2020
Le retour de Balthazar
Bien que le mois de décembre approche, il ne va pas être question ici de l'un des rois mages. Non, je vais causer de la saison 3 de la série qui porte ce nom, dont la diffusion a débuté jeudi sur TF1. En terme d'audience, les deux épisodes inédits ont fait un carton. De mon côté, j'ai été un peu déçu.
C'est tout d'abord en Bretagne que nous a emmenés le premier épisode ("Paradis perdu"), dont l'intrigue navigue entre new age et "celtitude". Certes, c'est dépaysant (sauf sans doute pour les Bretons), mais j'ai eu du mal à accrocher à une histoire qui plonge les héros dans un petit monde quasi sectaire. Fort heureusement, les interprètes (Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles et tous les seconds rôles) sont bons.
J'ai trouvé l'épisode suivant ("Vendredi treize") plus emballant. Les situations sont à la fois scabreuses et cocasses (avec une pointe de drame et d'émotion, juste ce qu'il faut). J'ai tout de même un gros regret : j'ai très vite deviné qui est la deuxième sœur, ce qui m'a un peu gâché le plaisir. J'aurais souhaité un peu plus de raffinement dans l'intrigue.
Je conseille donc aux amateurs de se replonger dans la saison 2. TF1 nous en propose deux épisodes. "Marche funèbre" se déroule dans le milieu des pianistes. "Dernière demeure" est un petit bijou macabre, au centre duquel se trouve une maison lugubre, que certains personnages pensent hantée :
Mais revenons à la saison 3. Le médecin-légiste et l'enquêtrice continuent leur jeu du chat et de la souris. En dépit des sentiments qu'elle éprouve, la capitaine n'a pas envie de se lancer dans une aventure avec un type qu'elle ne juge pas fiable, tandis que le flamboyant docteur craint de la mettre en danger si le tueur en série qui a assassiné sa compagne apprend qu'il se rapproche de la capitaine. (On n'est pas très loin du Mentalist.) De surcroît, au moment où il est sur le point de s'engager avec celle-ci, le médecin constate que le spectre de Lise disparaît, ce qu'il n'est pas encore prêt à accepter. (Là, on sent le parallèle avec Perception.) On comprend que les scénaristes (Clélia Constantine et Clothilde Jamin, qui ont travaillé auparavant sur Falco) se sont creusé la tête pour tenter d'éviter que les deux héros ne couchent ensemble, la tension sexuelle palpable entre eux constituant un des sels de l'intrigue. (Les auteurs de Castle sont naguère assez bien parvenus à surmonter le problème.)
13:46 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
Le retour de Balthazar
Bien que le mois de décembre approche, il ne va pas être question ici de l'un des rois mages. Non, je vais causer de la saison 3 de la série qui porte ce nom, dont la diffusion a débuté jeudi sur TF1. En terme d'audience, les deux épisodes inédits ont fait un carton. De mon côté, j'ai été un peu déçu.
C'est tout d'abord en Bretagne que nous a emmenés le premier épisode ("Paradis perdu"), dont l'intrigue navigue entre new age et "celtitude". Certes, c'est dépaysant (sauf sans doute pour les Bretons), mais j'ai eu du mal à accrocher à une histoire qui plonge les héros dans un petit monde quasi sectaire. Fort heureusement, les interprètes (Tomer Sisley, Hélène de Fougerolles et tous les seconds rôles) sont bons.
J'ai trouvé l'épisode suivant ("Vendredi treize") plus emballant. Les situations sont à la fois scabreuses et cocasses (avec une pointe de drame et d'émotion, juste ce qu'il faut). J'ai tout de même un gros regret : j'ai très vite deviné qui est la deuxième sœur, ce qui m'a un peu gâché le plaisir. J'aurais souhaité un peu plus de raffinement dans l'intrigue.
Je conseille donc aux amateurs de se replonger dans la saison 2. TF1 nous en propose deux épisodes. "Marche funèbre" se déroule dans le milieu des pianistes. "Dernière demeure" est un petit bijou macabre, au centre duquel se trouve une maison lugubre, que certains personnages pensent hantée :
Mais revenons à la saison 3. Le médecin-légiste et l'enquêtrice continuent leur jeu du chat et de la souris. En dépit des sentiments qu'elle éprouve, la capitaine n'a pas envie de se lancer dans une aventure avec un type qu'elle ne juge pas fiable, tandis que le flamboyant docteur craint de la mettre en danger si le tueur en série qui a assassiné sa compagne apprend qu'il se rapproche de la capitaine. (On n'est pas très loin du Mentalist.) De surcroît, au moment où il est sur le point de s'engager avec celle-ci, le médecin constate que le spectre de Lise disparaît, ce qu'il n'est pas encore prêt à accepter. (Là, on sent le parallèle avec Perception.) On comprend que les scénaristes (Clélia Constantine et Clothilde Jamin, qui ont travaillé auparavant sur Falco) se sont creusé la tête pour tenter d'éviter que les deux héros ne couchent ensemble, la tension sexuelle palpable entre eux constituant un des sels de l'intrigue. (Les auteurs de Castle sont naguère assez bien parvenus à surmonter le problème.)
13:46 Publié dans Cinéma, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
mardi, 10 novembre 2020
En quête de séries
Je me retrouve orphelin d'une pitance qui me permettait tant bien que mal de supporter la fermeture (totalement injustifiée) des salles de cinéma. France 3 vient d'achever la diffusion de la treizième saison des Enquêtes de Murdoch (l'une des meilleures de l'ensemble de la série), par un épisode fort bien construit, qui met davantage en valeur le personnage de la légiste afro-américaine Violet Hart.
Dans le même temps, TF1 a bouclé la diffusion de la troisième saison de Good Doctor, une des (très) rares séries médicales regardables (avec Dr House). Alors que cette saison a connu de gros coups de mou (à tel point que je me demande si l'histoire de ce médecin autiste va pouvoir tenir la route une saison de plus), le final (sous la forme d'un épisode double) est assez flamboyant, dans le genre dramatique.
Que reste-t-il à se mettre sous la dent ? Pas grand chose. J'ai testé The Rookie (sur M6). J'ai eu plaisir à retrouver Nathan Fillion (eh oui, Castle !), entouré d'une brochette d'acteurs sympathiques. La télévision française reprogramme les épisodes de la saison 1, en alternance de ceux de la saison 2. Je trouve que la série, assez anodine de prime abord, gagne en densité avec le temps. Elle mêle humour et action, avec un fond sociétal pas inintéressant. Je dois reconnaître que je suis particulièrement séduit par la distribution féminine, côté policiers. On a choisi des comédiennes au visage superbe, aux traits fins, mis en valeur par des coiffures parfois très savantes (tout en s'intégrant au port de l'uniforme). Les spectateurs les plus observateurs remarqueront que ces comédiennes n'ont en général pas un physique stéréotypé : si le visage est des plus avenants, elles sont assez trapues, avec notamment des cuisses musclées, comme celles de la recrue Lucy Chen (à gauche ci-dessous) et celles du lieutenant-instructeur Nyla Harper (dont les changements de coiffure ne cessent de me fasciner) :
Tant que je suis sur M6, j'en profite pour signaler le retour de NCIS. La "petite chaîne qui monte" a repris la diffusion de la saison 17, qui voit le retour du personnage de Ziva. Fidèle à son habitude, M6 ne programme qu'un seul épisode inédit par semaine...
Du coup, je suis allé voir ailleurs et je suis tombé sur Limitless, une série dérivée d'un film de fiction de 2011, avec Bradley Cooper. J'ai bien aimé les premiers épisodes, qui reprennent l'argument du long-métrage, tout en réutilisant la figure éculée du consultant atypique de la police, qui va bien sûr se rapprocher de la charmante fliquette qu'il assiste... en respectant plus ou moins les règles. C'est sans surprise, assez drôle, mais surtout intéressant sur le plan visuel. Les scènes sont souvent pimentées de truquages numériques plutôt bien distillés :
Les amateurs de séries américaines retrouveront avec plaisir des figures connues, dans des seconds rôles : Hill Harper (vu dans Les Experts Manhattan et Good Doctor), et Blair Brown (Fringe). Le monde du cinéma est lui aussi présent, à travers Mary Elizabeth Mastrantonio... et un comédien dont le personnage apparaît furtivement, dès le début du premier épisode :
Ce soir débute (sur TF1) la diffusion de la deuxième saison de Manifest, une série de science-fiction "familiale", dont le scénario s'inspire d'autres histoires déjà vues : un groupe de personnes (ici les passagers d'un avion) réapparaissent après cinq ans durant lesquels leurs familles ont été sans nouvelles. Mais, quand ils reviennent, ils semblent avoir changé, intérieurement.
Les auteurs ont choisi de mettre en scène des vies ordinaires perturbées par l'intrusion du fantastique. La saison 1 n'était pas mauvaise, quoi qu'inégale. Quand l'aspect fantastique de l'histoire l'emporte, c'est prenant, mais, quand la vie familiale occupe le devant de la scène, c'est trop boursouflé de pathos à mon goût.
20:55 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision
En quête de séries
Je me retrouve orphelin d'une pitance qui me permettait tant bien que mal de supporter la fermeture (totalement injustifiée) des salles de cinéma. France 3 vient d'achever la diffusion de la treizième saison des Enquêtes de Murdoch (l'une des meilleures de l'ensemble de la série), par un épisode fort bien construit, qui met davantage en valeur le personnage de la légiste afro-américaine Violet Hart.
Dans le même temps, TF1 a bouclé la diffusion de la troisième saison de Good Doctor, une des (très) rares séries médicales regardables (avec Dr House). Alors que cette saison a connu de gros coups de mou (à tel point que je me demande si l'histoire de ce médecin autiste va pouvoir tenir la route une saison de plus), le final (sous la forme d'un épisode double) est assez flamboyant, dans le genre dramatique.
Que reste-t-il à se mettre sous la dent ? Pas grand chose. J'ai testé The Rookie (sur M6). J'ai eu plaisir à retrouver Nathan Fillion (eh oui, Castle !), entouré d'une brochette d'acteurs sympathiques. La télévision française reprogramme les épisodes de la saison 1, en alternance de ceux de la saison 2. Je trouve que la série, assez anodine de prime abord, gagne en densité avec le temps. Elle mêle humour et action, avec un fond sociétal pas inintéressant. Je dois reconnaître que je suis particulièrement séduit par la distribution féminine, côté policiers. On a choisi des comédiennes au visage superbe, aux traits fins, mis en valeur par des coiffures parfois très savantes (tout en s'intégrant au port de l'uniforme). Les spectateurs les plus observateurs remarqueront que ces comédiennes n'ont en général pas un physique stéréotypé : si le visage est des plus avenants, elles sont assez trapues, avec notamment des cuisses musclées, comme celles de la recrue Lucy Chen (à gauche ci-dessous) et celles du lieutenant-instructeur Nyla Harper (dont les changements de coiffure ne cessent de me fasciner) :
Tant que je suis sur M6, j'en profite pour signaler le retour de NCIS. La "petite chaîne qui monte" a repris la diffusion de la saison 17, qui voit le retour du personnage de Ziva. Fidèle à son habitude, M6 ne programme qu'un seul épisode inédit par semaine...
Du coup, je suis allé voir ailleurs et je suis tombé sur Limitless, une série dérivée d'un film de fiction de 2011, avec Bradley Cooper. J'ai bien aimé les premiers épisodes, qui reprennent l'argument du long-métrage, tout en réutilisant la figure éculée du consultant atypique de la police, qui va bien sûr se rapprocher de la charmante fliquette qu'il assiste... en respectant plus ou moins les règles. C'est sans surprise, assez drôle, mais surtout intéressant sur le plan visuel. Les scènes sont souvent pimentées de truquages numériques plutôt bien distillés :
Les amateurs de séries américaines retrouveront avec plaisir des figures connues, dans des seconds rôles : Hill Harper (vu dans Les Experts Manhattan et Good Doctor), et Blair Brown (Fringe). Le monde du cinéma est lui aussi présent, à travers Mary Elizabeth Mastrantonio... et un comédien dont le personnage apparaît furtivement, dès le début du premier épisode :
Ce soir débute (sur TF1) la diffusion de la deuxième saison de Manifest, une série de science-fiction "familiale", dont le scénario s'inspire d'autres histoires déjà vues : un groupe de personnes (ici les passagers d'un avion) réapparaissent après cinq ans durant lesquels leurs familles ont été sans nouvelles. Mais, quand ils reviennent, ils semblent avoir changé, intérieurement.
Les auteurs ont choisi de mettre en scène des vies ordinaires perturbées par l'intrusion du fantastique. La saison 1 n'était pas mauvaise, quoi qu'inégale. Quand l'aspect fantastique de l'histoire l'emporte, c'est prenant, mais, quand la vie familiale occupe le devant de la scène, c'est trop boursouflé de pathos à mon goût.
20:55 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision
dimanche, 08 novembre 2020
Peninsula
C'est l'un des deux derniers films vus avant la fermeture (injustifiée) des salles obscures françaises. (L'autre est 30 jours max, que je recommande aux amateurs de comédies pas subtiles mais efficaces.)
Il y a un peu plus de quatre ans, Yeon Sang-Ho s'était fait remarquer par son Dernier train pour Busan. Le film, plutôt classé art et essai au départ, s'était taillé une jolie réputation dans le genre épouvante. C'est d'ailleurs plutôt le public raffolant de ces productions-là que j'ai vu dans la salle où était projeté le film. Force est de constater qu'il n'a pas le même comportement que le public amateur d'art et essai...
Le début de l'histoire nous remet dans le bain. On a droit à ses premiers moments gores... et à du larmoyant, le défaut majeur du réalisateur. La Corée est ensuite montrée confinée. Les rescapés de l'épidémie ont été envoyés dans d'autres pays d'Asie de l'Est ou du Sud-Est (le Japon et la Chine notamment). Cela donne un aspect polyglotte à ce film (quand on le voit en version originale sous-titrée) : on y parle coréen, anglais et (sans doute) cantonais.
J'ai beaucoup aimé les premières images du retour d'une petite équipe en Corée. On y voit un monde post-apocalyptique, apparemment sans vie, de nuit. C'est superbe. (Précisons que le réalisateur a bénéficié d'un budget doublé par rapport au précédent film).
J'ai aussi apprécié les rencontres faites par la bande de baroudeurs. Elle découvre qu'il y a des survivants, qui ont échappé aux morsures des zombis. Certains sont des "sauvages", de petits groupes éparpillés, qui ont appris à survivre en milieu hostile. Le réalisateur s'attarde particulièrement sur une famille, dont on a aperçu certains membres dans la séquence introductive. Le personnage de la mère est transformé (bravo l'actrice, Lee Jung-hyung). Les personnages les plus attachants sont les deux filles, habiles à esquiver les dangers et faire la nique aux adultes.
L'autre groupe de survivants est composé de délinquants sans foi ni loi, barricadés dans une forteresse où ils organisent des jeux sanguinaires. Quand ils en sortent, c'est pour partir à la pêche aux esclaves ou aux objets précieux, dans des véhicules qui font immanquablement penser à ceux de Mad Max. Cela donne des scènes très rythmées, diablement bien mises en scènes.
Tout cela aurait pu constituer un agréable film de divertissement, s'il n'y avait pas eu la fin. Le dernier quart d'heure est bourré de pathos, à tel point que cela en devient ridicule. Dommage.
P.S.
Le film suscite des réactions contrastées. Pascale est moins indulgente que moi, tandis que dasola a bien aimé.
21:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Peninsula
C'est l'un des deux derniers films vus avant la fermeture (injustifiée) des salles obscures françaises. (L'autre est 30 jours max, que je recommande aux amateurs de comédies pas subtiles mais efficaces.)
Il y a un peu plus de quatre ans, Yeon Sang-Ho s'était fait remarquer par son Dernier train pour Busan. Le film, plutôt classé art et essai au départ, s'était taillé une jolie réputation dans le genre épouvante. C'est d'ailleurs plutôt le public raffolant de ces productions-là que j'ai vu dans la salle où était projeté le film. Force est de constater qu'il n'a pas le même comportement que le public amateur d'art et essai...
Le début de l'histoire nous remet dans le bain. On a droit à ses premiers moments gores... et à du larmoyant, le défaut majeur du réalisateur. La Corée est ensuite montrée confinée. Les rescapés de l'épidémie ont été envoyés dans d'autres pays d'Asie de l'Est ou du Sud-Est (le Japon et la Chine notamment). Cela donne un aspect polyglotte à ce film (quand on le voit en version originale sous-titrée) : on y parle coréen, anglais et (sans doute) cantonais.
J'ai beaucoup aimé les premières images du retour d'une petite équipe en Corée. On y voit un monde post-apocalyptique, apparemment sans vie, de nuit. C'est superbe. (Précisons que le réalisateur a bénéficié d'un budget doublé par rapport au précédent film).
J'ai aussi apprécié les rencontres faites par la bande de baroudeurs. Elle découvre qu'il y a des survivants, qui ont échappé aux morsures des zombis. Certains sont des "sauvages", de petits groupes éparpillés, qui ont appris à survivre en milieu hostile. Le réalisateur s'attarde particulièrement sur une famille, dont on a aperçu certains membres dans la séquence introductive. Le personnage de la mère est transformé (bravo l'actrice, Lee Jung-hyung). Les personnages les plus attachants sont les deux filles, habiles à esquiver les dangers et faire la nique aux adultes.
L'autre groupe de survivants est composé de délinquants sans foi ni loi, barricadés dans une forteresse où ils organisent des jeux sanguinaires. Quand ils en sortent, c'est pour partir à la pêche aux esclaves ou aux objets précieux, dans des véhicules qui font immanquablement penser à ceux de Mad Max. Cela donne des scènes très rythmées, diablement bien mises en scènes.
Tout cela aurait pu constituer un agréable film de divertissement, s'il n'y avait pas eu la fin. Le dernier quart d'heure est bourré de pathos, à tel point que cela en devient ridicule. Dommage.
P.S.
Le film suscite des réactions contrastées. Pascale est moins indulgente que moi, tandis que dasola a bien aimé.
21:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films