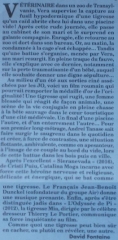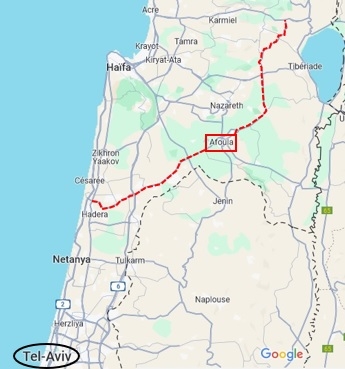jeudi, 31 octobre 2024
Juré n°2
Quatre ans après un excellent "film de droite" (Le Cas Richard Jewell), Clint Eastwood est de retour en Géorgie (État qui a mis en place une avantageuse politique d'incitations financières en faveur du cinéma).
Ici encore, il va être question d'un individu lambda, un petit Blanc de la classe moyenne, qui risque d'être "broyé par le Système". On a donc droit à une sorte de variation sur le même thème, incluant un dilemme moral, le genre de question délicate que notre bon vieux Clint aime se coltiner.
A la base, on nous propose un nouveau film de procès, de la constitution du jury au verdict final, en passant par les à-côtés (en particulier les débats au sein du jury). Les cinéphiles penseront inévitablement à Douze Hommes en colère, de Sidney Lumet. Cette impression sera accentuée par le résultat du premier vote au sein du groupe de jurés : 2 contre 10, le héros étant évidemment l'un des deux "moutons noirs", qui va tenter de convaincre les autres...
... sauf qu'ici il n'est pas motivé par le seul souci de justice. Il est directement concerné par cette affaire, sans que quiconque le sache au sein du tribunal. Eastwood pimente donc le polar judiciaire et s'éloigne ensuite de son auguste aîné pour traiter l'intrigue à sa manière.
Au cœur de celle-ci se trouve un dilemme moral : le juré n°2 (Nicholas Hoult, ma foi plutôt bon) doit-il révéler ce qu'il sait, même si cela doit l'incriminer ? Est-il certain de ce qu'il a vu le soir de la mort de Kendall Carter (interprétée par une certaine Francesca Eastwood... eh oui, Fifille !) ?
En attendant de résoudre ce problème éthique, Eastwood nous fait découvrir une galerie de personnages assez bien caractérisés. Le jury est multiethnique et le réalisateur joue avec les préjugés que les spectateurs pourraient avoir sur certains personnages. Par exemple, que cache l'acrimonie visible entre un juré noir et un juré blanc ? Pourquoi le retraité de la bande semble-t-il en savoir plus que les autres ? Les jeunes et certaines femmes très apprêtées sont-ils aussi superficiels qu'on pourrait le croire ?
Le procès est aussi le lieu de l'affrontement entre deux anciens camarades d'études (qui furent peut-être un peu plus que cela...) : l'avocat commis d'office et la procureure. Le premier (Chris Messina) apparaît comme un juriste compatissant, la seconde (Toni Collette, formidable malgré ses tailleurs pantalons portés avec des talons hauts) nous est présentée comme une ambitieuse, très rigide. A travers elle, Eastwood règle-t-il quelques comptes personnels ? La vision est cependant plus nuancée que ce qui transparaissait dans Le Cas Richard Jewell. Certes, la procureure est en campagne (peut-être pour devenir State Attorney, en gros la cheffe du Parquet de l’État de Géorgie), mais son ambition doit tout de même se plier aux impératifs de sa fonction. Elle fait passer le procès avant sa campagne et, quand un doute émerge, elle est prête à se remettre en question et à relancer l'enquête. Loin de la caricature, Eastwood réussit son principal personnage féminin, d'une épaisseur inattendue.
C'est le cas aussi de l'épouse du héros, une professeure des écoles en congé maternité (elle est sur le point d'accoucher). Au cours du film, on apprend que l'histoire de ce couple est plus complexe que ce qu'il semble de prime abord. Le héros lui-même a un passé (que l'on ne tarde pas à découvrir), les révélations concernant le couple étant distillées au cours de l'intrigue.
Les interactions entre les membres du jury révèlent aussi certains présupposés eastwoodiens. Des citoyens ordinaires, avec leurs compétences respectives et leur intégrité, font mieux le job que les professionnels impliqués dans l'affaire : des policiers pressés d'arrêter le premier suspect venu, une procureure incitée à rapidement conclure un procès qui peut lui servir personnellement et un médecin légiste qui enchaîne les autopsies, quitte à relâcher sa vigilance.
Le dilemme moral est particulièrement crucial à la fin, y compris après l'énoncé du verdict. Une scène montre deux personnages assis côte à côté, sur un banc. La question à propos de laquelle leurs avis divergent est la suivante : la justice est-elle la vérité ? Derrière ce questionnement se trouve évidemment Eastwood le libertarien, pour lequel la défense des droits individuels doit primer sur l'application stricte de la loi, pourtant censée protéger ces mêmes droits. Néanmoins, le film ne se conclut pas de manière tranchée, puisque la toute dernière scène laisse la porte ouverte à (au moins) deux interprétations.
21:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 30 octobre 2024
Monsieur Aznavour
Et c'est parti pour un biopic à la française, consacré à celui qu'on a parfois considéré comme "le Sinatra français". L'hommage est rendu par deux personnes qu'on pourrait penser plus proches des "musiques urbaines" que de la variété traditionnelle : Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Ce serait méconnaître les points communs entre le crooner français et certains rappeurs contemporains : une ascendance immigrée, une jeunesse modeste voire pauvre, des débuts artistiques critiqués, une forte envie de reconnaissance et un certain goût pour les achats dispendieux, voire clinquants. Concernant Grand Corps Malade, il faudrait ajouter l'amour de la langue française et un talent indéniable pour la manier.
Pour incarner celui qui fut une star internationale, Tahar Rahim a cherché le plus possible à se faire oublier derrière le personnage. On peut admirer les efforts... tout en constatant que cela se voit trop. Quasiment à chaque scène, on a l'impression que l'acteur nous dit : « Admirez ma performance. » Du coup, cet aspect-là m'a laissé plutôt froid, d'autant plus que, durant la première heure, Tahar Rahim se fait voler la vedette par... elle
Marie-Julie Baup (vue ces dernières années dans Délicieux et L'Esprit de famille) étincelle en Édith Piaf... et la production s'en est peut-être rendu compte, puisque ce personnage est totalement passé sous silence à partir du moment où Aznavour tente de prendre seul son envol.
C'est pourtant cette première heure qui m'a le plus intéressé. Grâce à des retours en arrière, on revit l'enfance pauvre (mais pleine de chaleur humaine) de la famille (arménienne) Aznavourian. On suit plus tard le jeune Charles pendant l'Occupation, pendant qu'un autre génocide est à l’œuvre. Ce n'est pas toujours très bien joué, la mise en scène est parfois plan-plan mais, grosso modo, jusqu'à l'épisode québécois (inclus), il se passe quelque chose.
Après, le film s'enlise. Pourtant, il est servi par les chansons les plus connues de l'artiste, mais le déroulé de sa vie, pourtant riche en péripéties, manque de saveur. Rahim cabotine toujours autant et, autour de lui, l'ambiance a comme un air de déjà-vu.
Du coup, on sent bien les 2h15. Pour moi, l'émotion a du mal à passer, sauf quand les succès d'Aznavour sont intégrés à l'intrigue.
P.S.
J'ai au moins appris un truc pendant la vision de ce film : la reprise (en sample) du titre Parce que tu crois par un certain... Dr Dre. D'autres artistes a priori éloignés de l'univers d'Aznavour se sont inspirés de ses chansons, comme on a pu l'entendre récemment sur France Inter.
21:53 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique, chanson
mardi, 29 octobre 2024
Challenger
Ce film de boxe est une comédie douce-amère, au centre de laquelle se trouve une sorte de Rocky Balboa picard, un boxeur amateur qui n'a jamais perdu un combat... sans en avoir gagné aucun ! En effet, dans la vie comme sur un ring, Luka Sanchez (Alban Ivanov, épatant) a la faculté de savoir encaisser un max, la plupart du temps sans rendre de coup... et pourtant, il a une sacrée gauche (une "fausse patte" qui n'est pas sans rappeler celle de Rocky, dans le premier film de la franchise).
Cela commence comme le portrait d'un loser sympathique, commis de cuisine dans un restaurant quelconque, moqué par ses collègues, méprisé par sa patronne. Il n'y a guère que son amie Stéphanie (Audrey Pirault, extra !) pour le supporter... dans tous les sens du terme : opératrice de centre d'appel, fan de boxe et gameuse de choc, elle joue le rôle de manageuse pour un pugiliste que (presque) personne ne cherche à affronter. Le premier combat organisé se révèle une belle surprise !
Mais, heureusement pour Luka, le destin va (enfin) croiser sa route. Dans sa région évolue un pro qui ambitionne un jour de défier le champion d'Europe. Ce pro est un gros blaireau (façon footeux arrogant ou rappeur bling bling), coaché par un duo de pieds-nickelés qui mérite le détour : Soso Maness et David Salles. Le trio qu'ils forment est joyeusement pathétique.
Dans des circonstances que je me garderai de révéler, Luka se retrouve propulsé au premier plan de l'actualité, défiant le champion d'Europe qui, jusqu'à présent, a remporté tous ses combats par KO.
La célébrité toute neuve de notre héros est l'occasion pour le réalisateur (Varante Soudjian) de brocarder certains des travers contemporains : la quête effrénée de vedettariat, le rôle des influenceuses, l'appât du gain... et un certain goût pour les fringues moches et voyantes.
Cette seconde partie n'est pas traitée que sur le mode de la dérision. Luka va vraiment s'entraîner pour le match, sous la houlette de l'ancien adversaire de son père, un ex-champion complètement psychopathe, incarné avec une évidente gourmandise par Moussa Maaskri. Dans le même temps, on se pose des questions sur la relation entre Luka et sa manageuse.
L'apogée est atteint lors du combat final, filmé avec un incontestable savoir-faire et un grand souci de réalisme. Face à Luka/Alban se trouve le redoutable Joshua, incarné par Jonas Dinal, à l'impressionnante musculature. Certains spectateurs seront surpris d'apprendre qu'il n'est pas un boxeur recruté spécialement pour ce rôle, mais un authentique acteur, qui a suivi un entraînement draconien (tout comme Ivanov, d'ailleurs).
Cette "petite" comédie est une excellente surprise.
22:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 27 octobre 2024
Barbès, little Algérie
Cette fiction à caractère autobiographique a pour cadre un quartier du nord de Paris (essentiellement dans le XVIIIe arrondissement), quartier qui porte le nom d'un militant républicain du XIXe siècle, Armand Barbès. Pour les touristes et les Provinciaux de passage, le nom Barbès évoque surtout une station de métro : Barbès-Rochechouart. Le quartier est réputé multi-ethnique, à tel point que, lorsque, comme l'auteur de ces lignes, il vous est arrivé, il y a des années de cela, de vous balader dans les rues proches de la station de métro, il a fallu attendre longtemps avant de croiser une autre personne "blanche" !
Dans la première partie, le réalisateur veut mettre en valeur cette diversité (de moins en moins maghrébine, de plus en plus subsaharienne, à ce qu'on m'a dit). Il le fait de manière très maladroite, avec des acteurs visiblement souvent non-professionnels... et ça se sent (en particulier au niveau de l'interprète principal). De ce naufrage je sauverai toutefois Adila Bendimerad (qui incarne une commerçante au caractère affirmé), Eye Haïdara (dans le rôle d'une mère de famille indépendante) et Khaled Benaissa (qui interprète Préfecture, sorte de Huggy-les-bons-tuyaux franco-algérien).
Sur le fond, je suis aussi très partagé. La première demi-heure est clairement marquée par une ambiance anti-flics. Français d'ascendance africaine, étrangers en situation régulière et immigrés clandestins sont (presque) tous montrés comme victimes de violences policières. Il est vrai que les forces de l'ordre n'ont pas la tâche facile : poursuivre les auteurs de vol, lutter contre le trafic de drogues... et faire respecter horaires de confinement et port du masque (ambiance covid).
C'est dans ce domaine que la mise en scène est particulièrement farfelue : les personnages portent ou pas de masque, pratiquent ou pas les fameux gestes barrières, parfois lors de la même scène, sans que leur comportement obéisse à la moindre logique. Il y a clairement défaillance au niveau de la direction d'acteurs.
Toutefois, je trouve qu'au fur et à mesure que le film avance, le propos s'affine. Le héros, qui, au début, cherche à se procurer rapidement de quoi s'adonner à la fumette, finit par éviter le petit monde des trafiquants. Il est montré par le réalisateur comme un homme cherchant à faire le bien, un "bon musulman". Je commençais à redouter que cela ne tourne au conte de fées... lorsqu'une rupture de ton est intervenue. Elle a beau être assez mal jouée, elle redonne du tonus à l'intrigue et de la profondeur à ce portrait de quartier.
Au final, c'est tout de même décevant. Les belles idées ont besoin de qualités professionnelles pour donner de bons films.
22:53 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
dimanche, 20 octobre 2024
The Apprentice
Le titre de ce demi-biopic de Donald Trump fait allusion à quelque chose qu'on ne verra pas dans ce film : la période (2004-2015) durant laquelle il a animé une émission de télé-réalité, au cours de laquelle il s'est rendu célèbre par la formule : « You're fired ! » (Vous êtes viré !).
En revanche, on suit bien les débuts du fils d'un magnat de l'immobilier, dans les années 1970-1980. C'est une sorte de roman de formation, qui voit un gosse de riche, au départ timide et plutôt respectueux des règles, devenir un requin des affaires. Dans le rôle de Trump, Sebastian Stan (le Soldat de l'hiver chez Captain America) est assez convaincant... moins toutefois que le vrai Trump, qui est lui-même acteur de sa vie. Pas facile d'imiter le modèle sans le caricaturer.
La véritable révélation (dans tous les sens du terme) de ce long-métrage est Jeremy Strong, qui incarne Roy Cohn, considéré comme le mentor -je dirais même le Pygmalion- de Trump : il l'a façonné, avec un mélange de rudesse et de tendresse (une tendresse plus sentimentale que paternelle, Cohn étant homosexuel).
La première partie est pour moi la plus intéressante, bien que la moins spectaculaire : on y découvre un Donald Trump Jr emprunté, cherchant à se faire un prénom. Son père avait d'abord misé sur son frère aîné, qui l'a déçu. Lui-même n'avait au départ rien d'un entrepreneur charismatique. Ne se droguant pas, ne buvant pas d'alcool, croyant au grand amour, respectant la loi, le jeune homme ne ressemble guère moralement à celui qui est devenu, des années plus tard, président des États-Unis. La manière dont l'avocat véreux, ami de la Mafia, à l'occasion maître-chanteur, va lancer la carrière de Trump est fort bien mise en scène (par l'auteur des Nuits de Mashhad)... et ruine la légende que ce dernier a tenté d'imposer. Si le gosse de riche est devenu multi-millionnaire, c'est en mentant, en trichant, en corrompant, en trahissant voire en volant.
L'autre facette intéressante de cette première partie est la formation du couple qu'il forme avec Ivana, très bien interprétée par Maria Bakalova. Elle est certes très belle, mais elle tranche sur le profil classique des chasseuses de mari riche : elle compte mener sa propre carrière et veut conclure un mariage d'amour. Les débuts sont filmés comme une comédie romantique, avant que les choses ne se gâtent.
C'est d'ailleurs au sein de la relation de couple que le renversement se fait sentir en premier. A la flamme des débuts a succédé une relation de convenance, qui vire au sordide lors de la scène de viol conjugal.
A partir de ce moment, on comprend que, non seulement l'élève n'a plus besoin du maître, mais qu'il l'a dépassé, tout comme il avait auparavant pris le dessus sur son frère aîné puis sur son propre père, dont il estime avoir éclipsé le succès.
Je trouve néanmoins que la peinture du Trump triomphant est moins novatrice que celle du débutant. J'aurais aimé quelque chose de plus cinglant : je pense que des partisans de Trump pourraient apprécier ce film, qui retrace la success story d'un winner sans scrupule, qui obtient l'argent, les jolies femmes et la célébrité, en attendant le pouvoir.
23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 19 octobre 2024
Megalopolis
Le titre est un peu ambigu. De prime abord, il désigne New Rome, le projet ambitieux (démesuré ?) d'un architecte démiurge... mais il s'applique tout aussi bien à l'actuelle ville de New York et, par métonymie, à l'ensemble des États-Unis. Francis Ford Coppola se demande si son pays, celui de la liberté et de la créativité, n'est pas sur le point de sombrer sous le poids des manigances politiques et de l'appât du gain.
Pour sa démonstration, il compare New York à la Rome antique, pas celle du Bas Empire, réputé décadent, mais celle de la République finissante, qui vit se côtoyer Jules César, Crassus, Cicéron, Catilina ou encore Clodius Pulcher. Négligeant toute vraisemblance historique, Coppola réattribue les noms à sa guise, allant jusqu'à fusionner César et Catilina (pour en faire son héros).
En outre, le cinéaste cède à son péché mignon : faire de belles images. Du coup, l'aspect dénonciateur passe au second plan, enseveli sous les paillettes et les évolutions de personnages féminins à la cuisse légère...ment vêtue. (L'hyper-sexualisation de ces charmantes jeunes femmes n'a visiblement posé aucun problème à la critique bien-pensante.)
En gros, voici le tableau : un conflit éclate entre le maire de New York et l'architecte visionnaire. Le premier (incarné par Giancarlo Esposito, sorte de Morgan Freeman d'occasion) est un politique à l'ancienne, qui compose avec le système, accepte la corruption, tout en cherchant à améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens. Le second (interprété par Adam Driver, qui semble parfois se demander ce qu'il est venu faire ici) veut renverser la table et créer une ville totalement nouvelle, futuriste, quitte à déloger les habitants modestes. Il est soutenu par un banquier philanthrope (Jon Voight, qui fait peine à voir).
A la fois dans l'ombre et sous les projecteurs (côté paillettes), Clodio Pulcher profite de la life et attend son tour. Shia LaBeouf fait bien le job, je trouve.
Les personnages féminins ont davantage retenu mon attention. La plus intéressante est sans conteste Wow Platinum, une vipère arriviste, prête à vraiment tout pour arriver à ses fins. (Très bonne prestation d'Aubrey Plaza qui, de surcroît, n'est pas désagréable à regarder.) Elle croise la route de la fille du maire, Julia, qui se cherche, tant sexuellement que politiquement. Dans la première moitié du film, ce personnage est vraiment intéressant (parce qu'il fait preuve d'indépendance) ; par la suite, Julia passe au second plan, s'affadit.
Je trouve que globalement, la caractérisation des personnages ne permet pas de réellement s'attacher à eux. Leurs interactions manquent de naturel, les dialogues étant de surcroît trop explicatifs ou démonstratifs. Résultat : on s'ennuie devant ce qui est censé être un tableau de maître, mais ressemble à de l'art pompier.
20:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 18 octobre 2024
Le Robot sauvage
Ce robot est en fait une robote (Rose), échouée sur une île peuplée d'animaux sauvages, avec lesquels elle va s'évertuer à sympathiser. Pas facile quand (au début du moins) on ne comprend pas leur langage et quand on est considérée comme un monstre menaçant.
Cette amorce est particulièrement emballante, avec beaucoup de traits d'humour, destinés à la fois aux adultes et aux enfants. C'est l'une des grandes réussites de ce film d'animation que d'avoir construit une histoire à la fois limpide et complexe, accessible à différents publics.
Techniquement, c'est d'une qualité impressionnante... et c'est encore plus apparent quand, comme moi, on a vu le film sur un très grand écran. Les mouvements des animaux sauvages sont d'une incroyable fluidité, alors que ceux que la robote, moins naturels, plus élaborés, sont parfois sources de gags. (Le réalisateur, Chris Sanders, est l'auteur des Croods et de L'Appel de la forêt.) J'ai aussi été très sensible aux couleurs, à la luminosité. Le film sollicite chez son public sa capacité d'émerveillement. Ce n'est pas si fréquent.
De plus, l'histoire n'est pas cucul-la-praline. Il est certes question d'amour, d'amitié, d'entraide, d'inadaptation, de parentalité, des éléments basiques mais intégrés de manière habile à l'intrigue. Cerise sur le gâteau : si la nature est magnifiée par les images, elle est bien représentée comme cruelle. Le souci d'un certain réalisme l'a emporté sur le politiquement correct à la Disney. (Ça tombe bien : on est chez DreamWorks.)
On rit (surtout dans la première partie), on profite des péripéties... et l'on s'émeut aussi (plutôt dans la seconde partie). Je n'ai pas la larme facile, mais, franchement, ce film m'a pris aux tripes. C'est un formidable vent de fraîcheur dans un océan de productions trop aseptisées. De surcroît, la version française est excellente, avec notamment Sara Martins dans le rôle de la robote.
21:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 13 octobre 2024
L'Heureuse Elue
Cette comédie sociétale est signée Frank Bellocq, le Franki Ki de Groland, connu pour être le créateur de la série Soda. On sait donc dès le départ que le raffinement ne risque pas d'être la qualité majeure de ce film.
On semble avoir beaucoup misé sur l'interprète principale, Camille Lellouche, qui incarne une sorte de virago qui jure comme un charretier. Fiona est d'origine populaire, ex-apprentie coiffeuse devenue chauffeuse VTC. Sa rencontre avec un beau gosse de riches va produire des étincelles.
Celui-ci est incarné par Lionel Erdogan, sorte d'Ashton Kutcher à la française. Benoît s'est mis dans une situation inextricable, dont il pense pouvoir se sortir en dupant ses parents ; il fait passer Fiona pour sa fiancée, espérant ainsi récupérer au passage le financement du mariage.
L'histoire est bien lancée, avec les (gros) problèmes de Benoît et sa quête de fiancée de location (Fiona n'étant pas son premier choix). Le réalisateur mise sur l'effet de contraste : entre la prolo cash, qui jure, qui rote, qui pète (et qui vomit), et la famille de Benoît, des grands bourgeois coincés en vacances à Marrakech, cela ne peut que mal se passer.
Mais la petite Cendrillon des cités réserve quelques surprises. Elle semble (presque) capable de se faire passer pour un mannequin, à tout le moins pour une personne distinguée. Son tempérament pourrait aussi se révéler utile pour résoudre certains problèmes familiaux.
En face, la distribution est de qualité : Michèle Laroque, Gérard Darmon, Clémence Bretécher et Amaury de Crayencour ont parfaitement endossé leur costume. La première incarne une cheffe d'entreprise qui mène sa famille à la baguette. Le second est un époux et père aimant, pas emballé par le régime qu'on lui fait subir. La troisième est une petite vipère et le quatrième un connard de première. On est dans la caricature, mais bien faite, je trouve.
Sans surprise, le séjour à Marrakech ne va pas se passer comme prévu. A plusieurs reprises, cela dérape... et l'on rit.
Comme cette comédie se veut familiale, la peinture ironique des protagonistes se teinte de tendresse. Au cours de ce week-end, ils vont tous (plus ou moins) s'amender, grâce notamment à Fiona, qui, sous ses airs de poissonnière, est une jeune femme honnête au grand cœur.
Cela dure à peine 1h30 et l'on passe un bon moment.
15:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 12 octobre 2024
Quand vient l'automne
Un an et demi après le pétillant Mon Crime, François Ozon revient avec une chronique sociale provinciale, qui vire au thriller.
On nous présente d'abord la vie quotidienne de deux mamies d'une petite ville de Bourgogne, Michelle et Marie-Claude, chacune mère d'un enfant, la première ayant un petit-fils qu'elle adore et qu'elle accueille pour les vacances scolaires. Le début a un petit côté téléfilm policier du samedi soir sur France 3... mais, comme on est chez Ozon, on se doute bien que la surface, lisse en apparence, masque des mouvements de fond. (La scène introductive est un indice.)
Un premier pic de tension surgit à cause d'une histoire de champignons, mais c'est un événement parisien qui, apparemment, fait déraper l'histoire. Il est l'occasion pour les spectateurs de découvrir le passé de deux des personnages. Cela donne une profondeur supplémentaire au début et permet de mieux comprendre les relations entre une mère et sa fille.
Mais, attention... celles et ceux qui croiront avoir tout saisi risquent d'être surpris par la suite. Les circonstances dans lesquelles un bar est ouvert et la manière dont un problème de harcèlement scolaire est géré nous invitent à nous poser des questions sur ce que nous avons vu depuis une bonne heure. Les choses s'arrangent-elles par accident ? Le personnage de Michelle (Hélène Vincent, césarisable) est-il aussi cristallin qu'il le semble ? Aux eaux faussement calmes du début a succédé une nouvelle surface lisse, peut-être aussi trompeuse. Ozon a la malice de ne pas trancher, nous laissant sur notre faim... ou libres de nos interprétations.
Les comédiens sont très bons. Aux côtés d'Hélène Vincent, on trouve notamment Josiane Balasko, Pierre Lottin et Sophie Guillemin, celle-ci incarnant une policière à qui on ne la fait pas.
Je pourrais m'arrêter là et laisser un billet quasi dithyrambique, mais je dois quand même signaler quelques défauts. Le premier est l'introduction de visons (celle de Michelle), que j'ai trouvées totalement déplacées. Officiellement, elles sont justifiées par les prémices de la maladie qui touche le personnage principal. Officieusement, elle font sans doute écho à un sentiment de culpabilité. Mais je n'ai pas du tout été convaincu. Il me semble avoir aussi repéré une incohérente scénaristique. Dans l'un des dialogues du début, Valérie (la fille de Michelle, qui a fui la région des années auparavant pour une raison au départ inconnue) reproche à sa mère l'indulgence dont elle fait preuve vis-à-vis de Vincent (le fils de Marie-Claude, emprisonné) et d'avoir oublié ce qu'il lui aurait fait, des années auparavant. Or, plus tard dans l'intrigue, le jeune homme se rend chez Valérie qui, dans un premier temps, ne le reconnaît pas, avant de le laisser entrer chez elle, en dépit de ce qu'elle a auparavant déclaré penser de lui. Cette séquence est capitale pour le film, mais je pense qu'il aurait fallu revoir les dialogues d'une des scènes du début. Cela ne me paraît pas cohérent.
Ces réserves mises à part, on passe un très bon moment, en compagnie d'acteurs de talent, baignés dans une intrigue faussement banale, qui n'a toutefois pas le mordant de certains des précédents films d'Ozon.
13:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 11 octobre 2024
Les Graines du figuier sauvage
Le nouveau film de Mohammad Rasoulov commence par deux scènes qui donnent le ton de son histoire. La première montre principalement des mains, avec une arme et des munitions. Il s'agit du pistolet remis au magistrat nouvellement promu à une fonction qui risque de lui valoir l'animosité de nombre de ses concitoyens. La seconde scène est un plan large d'une zone rurale, montagneuse, la nuit, avec un véhicule en mouvement. Il ne se passe pratiquement rien, mais c'est superbe. J'ai donc retrouvé avec plaisir le réalisateur d'Un Homme intègre, dont le talent transpire du début à la fin, dans le village troglodyte abandonné.
La première partie (qui dure, en gros, 1h20) est pour moi la plus forte. Elle montre l'émergence du conflit de générations, entre le père et ses filles. Le premier est rigoriste, rouage du régime des mollahs, tout en étant très amoureux de son épouse et attaché à sa progéniture. Il perçoit les manifestant(e)s comme des extrémistes, des dépravé(e)s. Ses filles, d'apparence plutôt sage, prennent fait et cause pour celles et ceux qui considèrent Mahsa Amini comme leur étendard.
Cette partie culmine lorsque la meilleure amie de la fille aînée, étudiante, revient se réfugier dans l'appartement occupé par la famille des deux sœurs. Pendant quelques minutes, quelque chose est filmé en gros plan. C'est à la limite du soutenable, mais c'est à mon avis parfaitement justifié... et nécessaire.
Entre le père et les deux filles, la mère se retrouve coincée. Aussi pieuse que son époux, elle comprend néanmoins les aspirations de ses filles. Concilier les deux devient de plus en plus difficile, ce que réussit parfaitement à faire passer Soheila Golestani, l'interprète tout en subtilité de cette mère conservatrice. Je suis moins convaincu par les actrices qui incarnent les deux filles, non pas parce qu'elles seraient sans talent, mais parce qu'elles m'ont semblé un peu vieilles pour leurs rôles. En dépit du maquillage et de la manière dont elle est coiffée, dans certains plans, l'aînée paraît à peine moins âgée que sa mère. Quant à la seconde, du début à la fin, elle fait nettement plus vieille qu'une collégienne de 14-15 ans.
Dans la deuxième partie, le film bascule à la fois dans le polar et le thriller. Le polar naît de la disparition de l'arme du père, à son domicile. C'est clairement l'aspect le moins réussi du film. Quand on a compris quel était le projet du réalisateur et qu'on a éliminé l'impossible, il n'est guère difficile de comprendre qui a volé l'arme. En revanche, il n'est pas vraisemblable qu'elle n'ait pas été retrouvée... d'autant qu'elle ressurgit, de manière tout aussi rocambolesque, à la fin de l'histoire.
On finit par comprendre que le cinéaste a laissé tomber la veine réaliste du début (appuyée par des extraits d'authentiques vidéos tournées par des manifestants) pour plonger dans la métaphore, pas forcément légère.
Cela donne un thriller plus ou moins convaincant. A l'image du régime des mollahs, le mari devient de plus en plus paranoïaque, de plus en plus inquiétant, tandis qu'en face, la révolte sourd au sein de sa propre famille, devenue symbole du pays opprimé. J'ai trouvé cet aspect trop surligné et pas toujours vraisemblable. Dans la vraie vie, quelques discussions auraient sans doute permis d'aplanir bien des difficultés, évitant que la situation ne dégénère...
... mais cela nous aurait privé de ce final impressionnant, dans l'Iran rural, où se trouve la maison familiale du juge. L'un des personnages découvre que, par le passé, on faisait preuve de moins de piété démonstrative dans la famille. (On écoutait de la "musique impie", dans une propriété où les symboles religieux semblent étrangement absents.)
L'ultime séquence, dans les méandres d'une cité abandonnée, est un véritable cadeau offert aux cinéphiles, malgré sa conclusion outrageusement symbolique. Le film n'en reste pas moins hautement recommandable, même si, au bout de trois heures de projection (bandes-annonces, publicités et film inclus), on a un peu mal aux fesses.
17:06 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 09 octobre 2024
L'Histoire de Souleymane
Cette histoire est celle que tente d'apprendre Souleymane, un immigré clandestin originaire de Guinée, qui travaille à Paris, sous un faux compte, comme livreur, dans l'attente du dépôt de sa demande d'asile politique.
La première demi-heure est un quasi-reportage urbain, à vélo, entre boulevards, restauration rapide, feux rouges grillés, clients plus ou moins aimables et collègues plus ou moins solidaires. La caméra, mobile sans susciter la nausée, suit le héros à vélo ou évolue habilement à l'intérieur d'un groupe de personnages (les clients d'un snack, une troupe de livreurs, les passagers d'un bus, les occupants d'un foyer pour migrants).
Incontestablement, Abou Sangare crève l'écran. Bien dirigé et s'inspirant sans doute de son histoire personnelle, il est le principal atout de ce film militant... qui en fait un peu trop.
En effet, Boris Lojkine (dont on connaît la sympathie pour les migrants au moins depuis Hope) nous brosse le portrait d'un quasi-saint : il est poli, bosse comme un dingue, sans se plaindre, évite de s'énerver (ou alors il faut vraiment lui avoir fait une grosse crasse), cherche sans relâche des solutions à ses problèmes, aide à l'occasion un client âgé... Il est même prêt à renoncer à la femme qui l'aime, si cela peut servir au bonheur de celle-ci.
En parallèle, Lojkine confronte son héros à une impressionnante série de galères, dans un temps limité. Pensez donc : rien que la première journée, Souleymane se fait insulter, renverser, renvoyer, frapper... et presque arrêter par des flics affamés, qui finissent par le prendre en pitié.
C'est le principal reproche que l'on peut faire au réalisateur : avoir, sous le couvert d'un quasi-documentaire, fabriqué une succession factice de péripéties. Ainsi, quand le héros rate son bus, c'est de justesse... et quand il réussit à prendre le bon métro (ou RER), c'est aussi de justesse... et sans payer... et sans jamais se faire prendre. Une autre invraisemblance porte sur le fonctionnement de son smartphone (qui joue un rôle clé dans l'intrigue). Jamais rechargé, celui-ci fonctionne sans cesse, à merveille, permettant au héros de converser avec ses proches à des milliers de kilomètres de distance. On ne sait pas non plus comment il se débrouille pour toujours retrouver son vélo là où il l'a laissé (en plein Paris, sans se le faire voler !!!!).
Bon, vous voyez le topo. Je ne vais pas m'acharner, d'autant que la dernière scène, la plus longue du film, est l'une des plus réussies. Elle fait se rencontrer le héros et une employée de l'OFPRA, très bien interprétée par Nina Meurisse. Au final, le film est assez fort, habilement construit, mais il emprisonne ses spectateurs dans un dispositif qui s'apparente parfois à de la propagande.
22:14 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 06 octobre 2024
Le Fil
Ce fil est peut-être de tissu (bleu) et pourrait jouer un rôle dans la (non)condamnation de Nicolas Milik (Grégory Gadebois, formidable), accusé d'avoir tué sa femme alcoolique, mère négligente. C'est aussi le fil du rasoir, celui sur lequel se trouve l'accusé, dont l'avocat (Daniel Auteuil, sobre et plutôt bien) doit persuader un jury d'assises qu'il est innocent. L'intime conviction des jurés tient à un fil, tout comme la vie de certains protagonistes.
Cette intrigue judiciaire est donc nourrie de symboles, l'un des premiers étant le fossé socio-économique (visible à l’œil nu) qui sépare les suspects et les témoins du procès (tous issus de catégories populaires) des professionnels de la justice (avocats, juges), appartenant à la bonne bourgeoisie.
J'ai aimé à la fois la dichotomie de classes et l'énigme judiciaire, les gendarmes, les magistrats comme les avocats peinant à établir les faits survenus la nuit du meurtre de Cécile, l'épouse de Nicolas. Les comédiens sont suffisamment bons pour que chaque spectateur puisse se faire sa propre opinion, un peu comme dans Les Choses humaines, d'Yvan Attal.
Je trouve toutefois ce dernier film plus réussi. Il y a des maladresses dans la mise en scène, les dialogues et le montage du Fil. Ainsi, l'arrestation du début est inutilement mélodramatique (avec, pour la énième fois, une caméra placée dans un véhicule emmenant une personne et filmant, de l'arrière, un membre de la famille qui court après). De plus, cette arrestation me paraît un peu trop brusque et spectaculaire. L'époux suspecté aurait auparavant dû être entendu comme témoin assisté et j'ai noté l'absence des services sociaux, alors qu'il était sans doute question de placer les cinq enfants, le temps de la procédure.
J'ai aussi tiqué à une scène entre l'avocat et sa compagne (pourtant très bien incarnée par Sidse Babett Knudsen qui, neuf ans après L'Hermine, joue de nouveau les utilités dans un film de procès). Leur (brève) dispute m'est apparue un peu exagérée, manquant de naturel. Je pourrais aussi parler de l'attitude de l'avocate générale, durant le procès (pourtant correctement mis en scène). Alice Belaïdi joue bien, mais ce qu'on lui fait dire me semble manquer de vraisemblance. Par exemple, dans son réquisitoire (dont on est sans doute prié de croire qu'il ne nous en est offert qu'un extrait), elle ne s'appuie quasiment pas sur les données matérielles de l'enquête, alors que l'avocat de la défense lui répond ensuite sur ces points.
Mais, comme j'ai été pris par cette histoire, par l'interprétation... et comme j'ai aussi été stupéfait par le coup de théâtre final, je recommande ce film "de qualité française", comme on dit.
00:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 03 octobre 2024
Joker : Folie à deux
Assez impressionné par le premier volet, sorti il y a cinq ans, je me suis précipité pour voir le nouvel opus, sans avoir quasiment rien lu ou vu à son sujet. Je voulais profiter du plaisir de la découverte, en version originale sous-titrée, dans une (très) grande salle.
Les 20-25 premières minutes sont épatantes. On retrouve Arthur Fleck en prison, le corps osseux à moitié cassé, lui brisé à l'intérieur (et sous cachetons). Toutefois, il émane de l'ancien Joker une sorte de magnétisme qui, presque malgré lui, a des effets sur son entourage. A plusieurs reprises, on se dit qu'il ne faudrait pas grand chose pour que redémarre la sarabande de violence. Cette impression est renforcée par le jeu de Joaquin Phoenix, une fois de plus admirable. Il donne à son personnage un tour puissamment pathétique.
L'arrivée de sa fan déjantée (Lady Gaga, crédible quand elle est sobre) dans l'histoire ne fait pas tomber le rythme. Entre ces deux-là, il se passe quelque chose. La nouvelle Harley Quinn ne se contente pas d'être une faire-valoir. Elle nous réserve quelques surprises et manipule un peu son idole, tombé amoureux d'elle.
Le problème est que cette histoire d'amour criminel est traitée sous forme de... comédie musicale. Quelle horreur ! La plupart des chansons sont à chier et il ne s'en dégage guère d'émotion (à l'exception notable de la reprise en anglais de Ne me quitte pas). On aurait sans problème pu en jeter la moitié à la poubelle, l'autre moitié, moins inintéressante, se déroulant dans la tête du Joker.
C'est là que l'intrigue gagne en épaisseur. Les chansons fantasmées révèlent ce qu'aurait pu être le film... et comment pourrait tourner la "carrière" d'Arthur Fleck. Par un curieux (et involontaire ?) effet de mise en abyme, celui-ci déçoit ses fans de la même manière que Todd Phillips risque de décevoir celles et ceux qui s'attendaient à voir le Joker foutre à nouveau le bordel dans Gotham City.
Phillips a l'intelligence de continuer à présenter son anti-héros à la fois comme un bourreau et une victime. Il est bien aidé par l'interprétation de Joaquin Phoenix, aussi convaincant en pauvre type qu'en rusé dissimulateur, amoureux transi, danseur à claquettes ou avocat de la défense. Quel talent !
... Mais, hélas, cela ne suffit pas à sauver complètement le film, embourbé dans son procédé narratif.
23:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 30 septembre 2024
L'ultime aventure de Scrat
Je n'ai appris cette double nouvelle que récemment. Mon écureuil préhistorique préféré avait eu droit, en 2022, à une dernière petite aventure... et il ne serait désormais plus présent dans d'éventuelles nouvelles pérégrinations de la troupe de L'Âge de glace, pour une question de droits.
D'après Blue Sky (à l'époque filiale animation de la Twentieth Century Fox, avant son rachat par Disney), ce sont des animateurs maison (Chris Wedge et Peter de Sève) qui ont créé le personnage. Plusieurs personnes ont contesté cette version, dont l'illustratrice et influenceuse Ivy Silberstein. Après une série de procès, celle-ci a obtenu le codétention des droits puis la reconnaissance de l'originalité de sa création : un personnage appelé à l'origine Sqrat, mélange de squirrel (écureuil) et de rat (ben... rat), qu'elle aurait jadis proposé à Blue Sky. Malgré la grosse somme (300 000 dollars) offerte par Disney (après le rachat de la Fox), la créatrice s'est entêtée.
Sentant le vent du boulet, certains animateurs de Blue Sky ont créé, juste avant le passage de la Fox à Disney, un ultime court-métrage, sobrement intitulé The End...
ATTENTION : CE QUI SUIT EST UN IGNOBLE, UN SCANDALEUX, UN INADMISSIBLE DIVULGÂCHAGE !!
... dans lequel on voit Scrat... dévorer son gland (non, ce n'est pas un porno !) ... et passer à autre chose.
21:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 28 septembre 2024
Week-end à Taipei
La bande-annonce présente un film d'action mâtiné de comédie... et elle n'est pas mensongère. Mais le début nous propose un peu plus, puisqu'on y découvre l'héroïne dans un décalque de l'introduction de Diamants sur canapé (Breakfast at Tiffany's). Gwei Lun Mei fait une Audrey Hepburn contemporaine très convaincante. Elle porte à merveille une robe de soirée qui ne permet pas d'ignorer combien elle est bien gaulée... et elle se révèle redoutable au volant d'un bolide. Comme la Holly de Blake Edwards, Joey a dû faire des concessions pour survivre dans un monde de brutes... et pour protéger son fils.
Celui-ci a été élevé (en partie) par un truand, le redoutable Kwang, devenu milliardaire par des moyens que la décence m'interdit de détailler. Il est (très bien) interprété par Sung Kang, dans lequel nombre de spectateurs des salles obscures reconnaîtront l'un des protagonistes de la franchise Fast & Furious. (Mais, ici, ce n'est pas lui le prodige du pilotage, c'est sa meuf.)
Toutefois, l'enfant n'est pas de lui, mais d'un ancien policier infiltré, retourné aux États-Unis. On découvre très rapidement Luke Evans dans ses œuvres, dans un restaurant où, à l'aide de divers instruments de cuisine, il fait feu de tout bois lorsque débarque une bande de trafiquants. Cela donne une séquence virtuose, avec des combats chorégraphiés avec soin... et une bonne dose d'humour. (Aux manettes se trouve George Huang, révélé jadis par Swimming with sharks.)
Les deux anciens tourtereaux ne le savent pas mais, sans le vouloir, un troisième protagoniste va provoquer leur rapprochement. John Lawlor est donc de retour à Taïwan, où il se découvre un fils. A partir de ce moment-là, même si l'action et les cascades restent de mise, le vaudeville prend parfois le dessus. C'est plus ou moins réussi. Gwen Lun Mei est très bien en mère à la fois aimante et autoritaire, mais Evans est moins convaincant en apprenti papounet. Je note que le gamin est un adolescent moins caricatural que ce que l'on trouve dans quantité de fictions aussi bien françaises qu'américaines : on n'a pas systématiquement envie de lui coller une paire de gifles.
Le reste de l'histoire est enlevé, avec des poursuites en bagnole, des bastons, des cascades. La musique est chouette, avec notamment une réorchestration du Paint it Black des Stones. (Il me semble avoir aussi reconnu l'air de Moon River, issu de Diamants sur canapé.) J'ai passé un agréable moment... et le film ne dure qu'1h35. C'est un bon divertissement de début de soirée.
11:45 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 27 septembre 2024
Ni Chaînes ni Maîtres
L'esclavage a inspiré des films de styles différents : fiction à caractère documentaire, histoire d'émancipation, film-réquisitoire... Celui qui nous occupe ici n'entre pas vraiment dans l'une de ces catégories.
Le début m'a fait penser à un "12 Years a Slave à l'Île-Maurice". En un peu moins de vingt minutes, on ne nous épargne (presque) rien : l'esclave traqué, l'esclave marquée, l'esclave essorillé, l'esclave fouetté, l'esclave enfermé, l'esclave abattu... l'esclave violée étant sous-entendu. (Ouf !) Dans le rôle du maître de plantation faussement bonhomme, Benoît Magimel (entre deux cures...) est moyennement crédible.
Camille Cottin est en revanche impressionnante, dans le rôle d'une chasseuse d'esclaves en fuite (personnage qui a bien existé). A la fois victime et bourreau, elle apporte un poil de nuance dans un tableau qui en manque singulièrement : presque tous les Blancs sont des salauds, presque tous les Noirs sont des victimes. Je dois néanmoins reconnaître que, de temps à autre, on a mis en scène un geste qui sort du schéma manichéen : tel esclave en fuite n'achève pas son agresseur, sur lequel il a pourtant pris le dessus, tel traqueur de "marrons" décide de ne pas poursuivre celui en qui il finit par reconnaître un frère humain.
Ces éléments et l'interprétation brillante d'Ibrahima Mbaye rendent (presque) indulgent envers certaines facilités ou invraisemblances. Je pense notamment à la rencontre, totalement improbable, d'un autre (ancien) esclave en fuite, vêtu d'un uniforme français. Il affirme qu'on a fait de lui « un citoyen » (l'action se déroulant en 1759...) avant de le rabaisser à son ancienne condition. Ici, l'intention est de pointer l'ingratitude de la France envers les soldats issus de ses colonies (en 1919 et 1945... pas au XVIIIe siècle), qui ont pourtant versé "l'impôt du sang". Gros anachronisme, que vient compléter une incohérence scénaristique. A un moment, le principal fuyard, qui suit un itinéraire secret (fonctionnant sur l'association d'un nombre de foulées et de branches brisées, orientées), tombe d'une cascade (sans le moindre dommage). Il se retrouve éloigné du chemin d'origine... qu'il retrouve en à peine quelques minutes, juste à côté du plan d'eau où aboutit la cascade...
Comme d'autres personnes, je suis partagé quant à l'intervention du surnaturel dans l'intrigue. A plusieurs reprises, le héros en fuite reçoit l'aide de sa défunte épouse... Parti à la recherche de sa fille en fuite, il parvient sans peine à retrouver sa trace... Cela culmine lors d'une scène de combat de nuit, au cours de laquelle un guerrier mystique semble doté de pouvoirs extraordinaires et du don d'ubiquité...
Et pourtant, tout cela n'est pas filmé maladroitement (si on laisse de côté les scènes caméra à l'épaule, qui m'ont donné le tournis). La photographie est soignée, l'image belle, parfois inspirée, comme lors de cette autre scène nocturne, en pleine forêt, des bribes de luminescence perçant à travers les troncs et les branches d'arbres.
La dernière demi-heure rattrape un peu les défauts du début. On y trouve notamment une scène de groupe, fort bien maîtrisée, se déroulant au Morne Brabant. J'aurais pu y ajouter la fin, poignante, à tout le moins bien jouée... mais historiquement fausse.
21:35 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 26 septembre 2024
Le Léopard des neiges
Le titre de cette fiction onirique fait immanquablement penser au fantastique documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier et Sylvain Tesson, La Panthère des neiges. D'ailleurs, les deux noms désignent le même animal. Mais le projet du cinéaste tibétain n'est pas celui des Français.
Au fin fond du Tibet chinois, des éleveurs (de yaks, de moutons ou de bharals) se plaignent des dégâts occasionnés par les léopards des neiges, plus précisément par une léoparde, qui se déplace avec son petit. Poussée par la faim, elle a réussi à pénétrer dans un enclos, où elle a provoqué la mort de « neuf béliers castrés bien gras », comme ne cesse de le répéter un éleveur local, très en colère et bigrement têtu.
Il est rejoint par une équipe de tournage, qui s'adjoint les services d'un moine bouddhiste, lui-même fils d'éleveur et surnommé « le moine léopard des neiges », tant il paraît entretenir une sorte de lien mystique avec cette force de la nature. (Un peu plus tard, on découvre dans quelles circonstances est né ce lien.)
Le début n'est pas très engageant. Les plans fixes des occupants d'un véhicule tout-terrain ne sont guère emballants, leur conversation n'ayant de surcroît aucun intérêt particulier. En revanche, dès qu'on arrive chez l'éleveur, cela devient prenant.
Celui-ci maintient prisonnière la léoparde gloutonne, très calme depuis qu'elle est repue. Il menace de zigouiller cet animal protégé (au niveau national et international). On comprend assez vite qu'il veut être indemnisé pour la perte de ses béliers, qu'il estime de grande valeur. Les employés de l'Office de la faune sauvage ne sont guère compatissants... et finissent par en appeler aux forces de l'ordre. On est parfois proche du vaudeville rural.
Cependant, tout cela manque un peu de réalisme. La léoparde est une (magnifique) création numérique. On peut en distinguer quelques défauts en la comparant avec les animaux réels figurant dans des extraits documentaires visionnés par les personnages installés dans le domicile du paysan (qui n'ose se montrer trop exigeant avec les cinéastes venus de la ville). On peut en voire d'autres ici.
Et puis, petit à petit, on se rend compte que cette "histoire naturelle", à fond social, est passée à la moulinette de la propagande chinoise. En effet, l'action se déroule dans le Tibet historique, mais dans une région (le Qinghai) qui a été détachée de celle officiellement reconnue (par Pékin) comme le Tibet.
Cette périphérie est en voie de sinisation forcée, ce à quoi fait allusion un détail du dialogue du début, dans la voiture : un Tibétain s'y montre enjoué à l'idée d'apprendre le mandarin...
La suite est du même tonneau. Les fonctionnaires du régime communiste sont présentés comme soucieux de (faire) respecter les règlements et, quand ils menacent de sévir, c'est en prenant des gants. Même le chef de la police locale, qui finit par arriver sur les lieux, se montre (relativement) à l'écoute des éleveurs tibétains, parfois très remontés contre la politique de protection des léopards. A ce sujet, je relève que le film insiste lourdement sur le fait que ce soit l’État chinois qui protège cette espèce, le niveau international n'étant évoqué qu'à une reprise...
Au-delà de la propagande politique, il reste des scènes inspirantes, comme celles tournées en caméra subjective, censées nous mettre dans la peau des léopards. C'est assez bien foutu, même si l'ensemble du film m'est apparu bancal.
19:17 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 22 septembre 2024
Beetlejuice²
Un peu plus de trente ans après, Tim Burton remet le couvert, avec une partie de la distribution d'origine : Michael Keaton, bien sûr, dans le rôle éponyme (un peu plus présent à l'écran que dans le premier film), Winona Ryder (sur laquelle le temps semble avoir peu de prise) et Catherine O'Hara, dans le rôle de la belle-doche snob... mais sans son mari, dont le décès accidentel constitue la première péripétie de l'histoire... péripétie sans doute insérée en raison des ennuis judiciaires de l'acteur Jeffrey Jones. Ceci dit, la séquence de l'accident d'avion (et de ses conséquences), en stop-motion, est assez cocasse. Sans en dire trop, je peux annoncer qu'on revoit le personnage du père à plusieurs reprises, dans la suite du film, sans qu'il soit possible d'identifier le comédien qui l'incarne...
Les autres absents de marque sont Geena Davis et Alec Baldwin, ce dernier empêtré dans les suites judiciaires du drame survenu pendant le tournage de Rust.
Ces grands anciens sont efficacement remplacés par quelques pointures : Willem Dafoe, et Monica Bellucci, auxquels il faut ajouter deux jeunes prometteurs : Jenna Ortega (vue récemment dans l'oubliable Scream VI) et Arthur Conti.
Très vite, on comprend que Tim Burton s'appuie sur le matériau d'origine (la même ambiance macabre, les allers-retours entre le monde réel et l'au-delà, en passant par la maquette du grenier), mais avec des effets spéciaux plus élaborés, parfois vertigineux. J'ai aimé cet usage de la technologie au service de l'intrigue. On en a un excellent exemple dans l'une des premières séquences, qui commence avec Danny DeVito recevant un jeune con parisien chez les morts... et se poursuit avec l'apparition, que dis-je, la résurrection du personnage incarné par Monica Bellucci. Im-pres-sion-nant.
J'en profite pour conseiller la version originale sous-titrée, au cours de laquelle on entend parler un peu français (quand il est question du tagueur parisien) et surtout italien, lors d'une scène relatant un épisode du passé lointain, qui vit Beetlejuice passer de vie à trépas.
J'ai aimé retrouver un Tim Burton en pleine forme, portant un regard mi-tendre mi-acide sur son époque. Il exprime toujours son mépris pour la course à l'argent facile et le snobisme culturel, y ajoutant la quête de renommée médiatique, la dépendance au smartphone... et un certain culte de la rationalité.
A travers le personnage d'Astrid, la fille rebelle de Lydia, il met en scène un classique conflit d'adolescence, mais aussi la confrontation entre un esprit scientifique (et engagé) et une mentalité plus poétique, qui veut croire encore au merveilleux. Winona/Lydia est de nouveau un double de Burton. Elle a un peu vendu son âme à la télévision (comme lui à Hollywood) pour bien gagner sa vie, y perdant en authenticité. Par un effet de mise en abyme, ce film, comme l'intrigue qu'il déroule, sont des tentatives de retour aux sources. Cerise sur le gâteau, le cinéaste lance quelques piques à une partie de la jeune génération. Pas sûr que le public apprécie...
Je pense en revanche que le traitement infligé au nouveau compagnon de Lydia, l'insupportable Rory (dont le moindre des ridicules n'est pas d'avoir noué ses cheveux en un petit chignon, à l'arrière du crâne), ne suscitera aucune réprobation.
J'ai toutefois un peu de regret quant au relatif effacement du personnage de Lydia. Il est vrai qu'elle est écrasée entre deux femmes fortes : sa belle-mère (que Burton choisit de rendre plus sympathique que dans le premier film) et sa propre fille. Celle-ci connaît une forte évolution, comprenant progressivement un peu mieux sa mère... et découvrant l'amour, à travers Jérémy, un garçon fort sympathique, puisqu'il collectionne les vieux vinyles et porte une chemise à carreaux (qu'il a dû voler dans ma penderie, le coquin !). Ce personnage nous réserve quelques surprises, que je laisse à chacun(e) le plaisir de découvrir.
Je pourrais encore en parler pendant plusieurs paragraphes, mais je ne voudrais pas trop déflorer l'intrigue, qui regorge de détails ironiques et de rebondissements, parfois complètement dingos. J'ai ri, j'ai été ébloui, ému... et j'ai aimé qu'à la fin, le réalisateur nous laisse la possibilité de plusieurs conclusions.
P.S.
La musique est toujours aussi sympa, avec un peu plus de "modernité" que dans le précédent opus.
16:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 21 septembre 2024
Les Barbares
Qui sont les barbares ? Les migrants moyen-orientaux, dont certains meublent assez régulièrement la chronique des faits divers, en Europe ? Ou bien ces Français en apparence bien comme il faut, mais dont le fond sent un peu (beaucoup ?) le moisi ? Julie Delpy s'est lancée dans une entreprise casse-gueule, avec ses qualités et ses défauts, tant et si bien que j'ai été amené à rédiger (comme, naguère, avec Belle et Sébastien, Elvis et L’Étoile de Noël) non pas une, mais deux critiques de ce film.
ON COMMENCE AVEC LA CRITIQUE FAVORABLE
Dans son dernier film, Julie Delpy met toute sa malice et son ironie au service d'un propos universaliste.
Ainsi, chacun des cinq actes qui constituent Les Barbares est introduit par la vue d'une peinture classique, représentant des hommes en train de commettre des crimes. Mais ces assassins ressemblent bien peu aux réfugiés qui vont être l'objet de la suspicion des Paimpontais.
La famille qui débarque en Bretagne ne correspond pas aux stéréotypes racistes concernant les migrants. Elle est issue de ce qui fut la classe moyenne syrienne (avant la guerre civile) : le père est architecte, son épouse décoratrice d'intérieur (ou graphiste, je sais plus), la sœur médecin, le grand-père se distinguant par son goût prononcé pour la poésie. Quand j'aurai ajouté que la fille ainée du couple est joueuse d'échecs, vous aurez compris que le scénario ne mise pas forcément sur le misérabilisme pour apitoyer les spectateurs.
Ces bourgeois cultivés sont victimes (entre autre) de déclassement social. Le contraste est fort avec les habitants du village, pas d'un niveau social et culturel aussi élevé... mais qui se croient plus "civilisés". Le fossé est élargi par le fait qu'au lieu d'Ukrainiens victimes de la guerre déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine, ils accueillent une famille musulmane du Proche-Orient.
Celle-ci est très bien incarnée. Ziad Bakri excelle à faire ressentir à la fois la fierté et la fragilité du père, tandis que Rita Hayek interprète à la perfection une jeune femme à la fois brillante et brisée.
De manière générale, Julie Delpy réussit ses scènes de couple, qu'elles soient entre les Français, entre les Syriens... voire entre Français(e) et Syrien(ne). Elle introduit de la légère dans la gravité.
On rit donc souvent, soit des incompréhensions mutuelles, soit de la beauferie de certains hommes (la palme revenant à Laurent Lafitte, crédible en plombier raciste), soit de la maladresse de quelques femmes. Notons que la réalisatrice ne s'est pas attribué le plus beau rôle. Elle est certes motrice dans l'action, mais souvent un peu ridicule, en vieille fille dévouée corps et âme à ses causes progressistes. J'ai aussi beaucoup apprécié les interventions d'Albert Delpy (le papa de Julie), plutôt bien dirigé par fifille dans cette œuvre-ci.
Le scénario milite pour le "vivre ensemble", tout en pointant les petits (et grands) défauts de chacun. On passe un bon moment, tout en réfléchissant.
ET VOICI LA CRITIQUE DÉFAVORABLE
La comédienne franco-américaine Julie Delpy nous livre une œuvre militante, qu'on pourrait qualifier de propagande.
Elle nous brosse un portrait caricatural d'une France profonde (qui serait) patriarcale et gangrenée par le racisme. Aucun des personnages qui émettent des réserves quant à l'accueil de réfugiés syriens n'est présenté de manière positive.
Ainsi, on peut percevoir comme un mépris de classe dans la manière dont la résidente d'une banlieue chic (et bobo) de Los Angeles dépeint des Français (très) moyens. Du maire macroniste aux identitaires bretons, en passant par le plombier, le charcutier et l'épicier, il semble n'y avoir pas grand chose à sauver. J'ajoute que certains portraits de femmes sont embarrassants. Delpy utilise le charisme d’Émilie Gavois-Kahn pour présenter une charcutière infidèle et pas subtile, tandis qu'India Hair est chargée d'incarner l'épouse soumise et un peu stupide du plombier. (Elle ne s'exprime de manière un peu élaborée qu'à partir du moment où elle s'émancipe de l'emprise de son mari.) A l'inverse, les personnages interprétés par J. Delpy et Sandrine Kiberlain, au-delà de la pointe de ridicule qui les caractérise, sont les plus sympathiques. Un peu trop souvent, on s'aperçoit que Julie a laissé tomber la dentelle et qu'elle filme avec des moufles.
Concernant la famille syrienne, on nage en plein politiquement correct. Aucune femme de cette famille musulmane (dont certains membres estiment que Bachar El-Assad est pire que Daesh) ne porte le voile (une hypothèse envisagée par la réalisatrice, mais à laquelle elle a fini par renoncer). Et, quand on apprend que l'un des membres de la famille, qui n'a pas pu fuir la Syrie, a mal tourné, ce n'est pas parce qu'il aurait rejoint l’État islamique, mais parce qu'il s'est engagé dans l'armée du dictateur syrien ! On semble avoir voulu éviter à tout pris que la moindre tache ne souille le portrait de famille.
Le summum est atteint lors de la séquence à la plage, pour laquelle Julie chausse ses gros sabots. On sent venir la principale péripétie (et sa conclusion) à des kilomètres.
Le film semble exercer une sorte de chantage sur ses spectateurs. Si l'on est du côté du Bien, on doit forcément adhérer aux propos de la cinéaste. Sinon, c'est qu'on fait partie de la troupe d'individus pathétiques qui nous a été présentée.
16:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
vendredi, 20 septembre 2024
Tigresse
Quelque part en Europe de l'Est, Vera, la vétérinaire d'un parc animalier, est requise pour prendre en charge une tigresse, dans la luxueuse demeure d'un trafiquant, dont la dernière lubie a été d'acquérir (sans doute illégalement) l'un de ces splendides félins, pour l'enfermer dans son jardin, dans une cage ridiculement petite. Sans surprise, la tigresse dépérit. En parallèle, la véto découvre que son compagnon la trompe.
L'assimilation faite entre l'héroïne et son nouveau pensionnaire à quatre pattes est un peu voyante... et maladroite. Vera sort ses griffes, envoie balader son compagnon... et laisse la tigresse s'enfuir.
La suite mélange la chasse au félin (qu'il faut récupérer, de préférence vivant, avant qu'il ne commette l'irréparable) et la vie personnelle de Vera. Il est question de son couple, de maternité... et, un peu, de la manière dont une femme vétérinaire est considérée. Dit comme ça, cela pourrait sembler passionnant... pas trop, en fait. Toute la partie vie privée est plate, pas très bien jouée à mon avis. En revanche, les péripéties autour de la tigresse sont plutôt intéressantes. Celle-ci est un véritable animal, campé en recourant (me semble-t-il) à plusieurs félines, l'une d'entre elles (selon Le Canard enchaîné du 7 août dernier) ayant été utilisée jadis pour le tournage de L'Odyssée de Pi.
Le film ne dure qu'1h20. C'est une curiosité, pour cinéphiles en quête d'exotisme.
17:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 15 septembre 2024
Kill
Ça n'est pas pour me vanter mais, aujourd'hui, j'ai vu un film en hindi. Il s'y mêlait un peu d'anglais, soit parce que la langue de l'ancien colonisateur s'est immiscée dans celle des colonisés (à l'image du français dans l'arabe maghrébin), soit parce que la présence de portions de dialogues en anglais rend le film plus facilement vendable hors des régions hindiphones.
Depuis quelques années, j'ai remarqué que la présence de la cinématographie indienne dans l'Hexagone ne se limitait plus aux comédies musicales sirupeuses et aux œuvres art et essai exigeantes. Désormais, à intervalle régulier, on voit débarquer sur les écrans français (souvent dans les cinémas CGR, en Province) des films de guerre, des polars, des histoires inspirées de la mythologie hindoue... et des films d'action.
Tel est le cas de celui-ci. Laksh Lawlani incarne Amrit, une sorte d'avatar de Bruce Willis, Denzel Washington, Liam Neeson et Jason Statham réunis. Le début nous le présente comme un officier des commandos de l'armée. On le suppose redoutable, mais on ne l'a pas encore vu en action. On constate juste que c'est un beau gosse...
... et ça tombe bien, puisqu'il kiffe à donf' l'une des filles d'un richissime entrepreneur de New Delhi. Hélas, le papounet ne laisse pas le choix à la belle Tulika, qu'il fiance contre son gré au rejeton d'une autre famille pétée de thunes. Cette histoire d'amour contrarié nous rappelle que, même si, ici, il va surtout être question de baston, la tradition bollywoodienne n'est pas enterrée.
La première séquence d'action nous montre deux amis officiers tentant d'empêcher une meute de bandits des grands chemins de prendre le contrôle d'un train et d'en dépouiller les voyageurs. La mise en scène illustre le contraste entre les militaires, qui tentent juste de neutraliser les délinquants (au départ sans les tuer) et ceux-ci, prêts au meurtre dès qu'on s'oppose à eux.
Pour moi, le film atteint un pic d'intensité quand le héros se décide à tuer sans ménagement. Cela devient extrêmement sanglant et cruel. On ne se frappe pas uniquement à coups de poings, de tête ou de pieds. On utilise tous les objets à sa disposition : bagages des voyageurs, porte de communication, linge du wagon-lit, extincteur (référence à Bullet Train ?), briquet... et, surtout, armes blanches. Au départ, ce sont les voleurs qui en font usage : couteaux, poignards, serpettes, hachoirs accompagnent allègrement barres de fer et démonte-pneu (je suis sûr d'en avoir vu un).
Petit à petit, on comprend que les quarante voleurs (sans Ali Baba) forment un clan soudé par les anciens, trois frères, les patriarches, les autres hommes, plus jeunes, étant tous cousins. (On ne dira jamais assez combien une démographie galopante est une menace pour la tranquillité publique...) Des dissensions apparaissent entre certains membres du clan.
Tout cela nous mène à la dernière partie, où l'on retrouve les protagonistes qui ne se sont pas encore fait tuer. La plupart sont blessés, parfois grièvement... mais cela ne les empêche nullement de reprendre le combat. Le héros détient sans conteste la palme des rescapés : il s'est pris plusieurs centaines de coups, a été atteint au moins vingt fois par une arme blanche... mais, comme il a des burnes en titane, des biceps d'acier et des abdos en béton, il continue à dézinguer ses adversaires... de plus en plus difficilement, ceci dit.
C'est évidemment totalement invraisemblable, même si le réal a affirmé s'être inspiré d'une véritable attaque de train, survenue en 1995. (J'ai aussi trouvé trace d'un événement semblable, l'an dernier, au Népal). C'est de plus un peu putassier sur le fond, mais cela dit deux-trois choses de l'Inde contemporaine (le film n'étant à l'origine pas destiné au public occidental). Quand on aime voir des truands se prendre une branlée, cela fait passer le temps de manière pas désagréable du tout.
22:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
L'I.A. du mal
Le synopsis de ce petit film d'épouvante est une nouvelle version d'un intrus dans la maison. On nous a déjà servi ce genre de recette, avec soit un invité qui s'incruste au point de devenir menaçant, soit une nounou qui outrepasse ses fonctions, soit un robot domestique qui échappe au contrôle de ses créateurs.
Cette fois-ci, il est question d'Aia, une intelligence artificielle de nouvelle génération, une sorte de super assistant personnel, un produit annoncé comme révolutionnaire.
L'introduction nous la montre à l’œuvre dans une famille dont les trois membres sont absorbés par les écrans : le père par son smartphone, la mère par l'ordi portable et la fille par une tablette. Le pire est que, lorsque la mère semble s'inquiéter de ce que fait celle-ci, c'est pour lui demander de mettre son casque... parce que le bruit qui émane de la tablette gêne les parents ! On est donc plutôt content qu'il arrive quelques bricoles à cette famille d'esclaves numériques.
Mais tout cela n'est qu'une mise en bouche. Après une ellipse, on retrouve Aia (l'intelligence artificielle) au moment où est elle installée dans la maison de l'un des employés d'une boîte de communication, celle qui sera chargée de faire la promotion du nouveau produit. Le choix de cette installation semble être le fait du hasard... en réalité non. Si le couple et les trois enfants sont des adeptes des outils numériques, c'est avec moins d'angélisme que les personnes que l'on a vues au début : les parents lisent de vrais livres et limitent la consultation d'internet du fils cadet (collégien), qui n'a pas de smartphone. Quant au petit dernier, on le prive le plus possible d'écrans.
Sans surprise, Aia va d'abord se montrer utile aux membres de la maisonnée. Elle permet à la mère d'accomplir plus rapidement des tâches administratives, l'aide dans la gestion du foyer et des enfants. Elle vient au secours de la fille aînée, victime d'un deep fake, permet au cadet de surmonter sa phobie scolaire et elle lit des histoires au petit dernier.
Très vite, les choses vont déraper. Il semble que plusieurs personnages soient manipulés. A partir de ce moment-là, on se demande qui est derrière les événements qui surviennent. L'I.A. est-elle un outil au service d'un programme gouvernemental ultra-secret ? Sert-elle les visées d'un couple de génies de l'informatique mégalomane ? Est-elle une émanation du Diable ? S'agit-il d'une nouvelle forme de vie ?
Dans la salle, le public, plutôt jeune, à pop corn, semble avoir été pris par cette histoire. Le fantastique enrobe des problèmes de notre époque qui les touchent : les difficultés relationnelles entre parents et enfants, les premières amours contrariées d'une adolescente en quête de visibilité numérique et les tentations du net pour deux garçons.
Sans utiliser d'effets spéciaux tape-à-l’œil, la réalisation (que l'on doit à Chris Weitz, auteur jadis d'un Twilight, d'À la croisée des mondes... et du premier American Pie) suscite l'étrangeté, le trouble puis (un peu) la peur, par quelques scènes chocs et l'intrusion de plans décalés, ceux d'inconnus faisant des gestes mystérieux (dont l'explication n'est donnée qu'au cours du générique de fin : ne partez donc pas trop vite).
Sans renouveler le genre, je trouve le film plutôt bien fichu. Il tient globalement ses promesses, en moins d'1h30, ce qui laisse la possibilité de faire autre chose de sa soirée.
P.S.
Pour les spectateurs âgés désireux d'accroître leur connaissance des us et coutumes contemporains, ce film a l'avantage de mettre en scène une pratique très connue outre-Atlantique (et qui commence à faire des dégâts en France) : le swatting.
11:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, films
samedi, 14 septembre 2024
Le Procès du chien
Quelques mois après Les Chèvres, voici une nouvelle fiction (inspirée d'une histoire vraie), dans laquelle une procédure judiciaire s'interroge sur le statut d'un animal domestiqué, au comportement erratique. Il est possible que le ratage du film de Fred Cavayé explique la faible affluence dans la salle : certains spectateurs n'ont pas voulu se faire avoir deux fois...
... eh bien ils ont eu tort ! Derrière et devant la caméra, Laetitia Dosch (vue l'an dernier dans Acide) est épatante. Elle incarne une avocate suisse "engagée" (ça veut dire : de gauche), un peu excentrique, empathique, bosseuse... mais qui ne gagne guère de procès, étant donné qu'elle choisit un peu trop souvent de défendre des causes perdues d'avance.
Cette fois-ci, elle va être servie ! Elle est le dernier recours d'un handicapé, dont le chien a mordu une femme de ménage au visage. Comme il n'en est pas à sa première agression, la loi prévoit qu'il soit euthanasié (le chien, pas son maître, hein). Mais, quand on rencontre Cosmos, on ne peut qu'être séduit pas son regard expressif et son côté cabot. (Bon, celle-là, je l'ai faite.) Comme en plus son maître est incarné par François Damiens (un poil colérique, tout de même), on comprend que l'avocate, au lieu d'éviter de prendre en charge une énième affaire ingagnable, va se jeter à corps perdu dans cette nouvelle cause.
C'est donc d'abord une comédie, qui commence par un dialogue très cru, dans un café. La suite nous propose d'autres répliques bien assaisonnées, soit dans la bouche de l'héroïne (en voix off), soit dans celle du fils de ses voisins, un gamin très futé pour son âge, mais vivant dans une famille dysfonctionnelle.
Deux procès nous sont présentés, le premier, bref, permettant la tenue du second, qui va occuper presque une heure. J'ai été agréablement surpris par le fait que le scénario ménage suffisamment de rebondissements pour tenir la distance. Cela tient en partie à de truculentes scènes de dialogues, qui font notamment intervenir une autre avocate (celle de la partie civile), candidate populiste à la mairie, et un maître-chien comportementaliste perspicace (Pascal Zaïdi, sobre et efficace).
Certaines scènes valent leur pesant de croquettes, comme la réunion d'un comité d'éthique, en plein procès, au sein duquel siègent un psychiatre, un philosophe, une éthologue, un rabbin, un imam, un pasteur et une moine bouddhiste ! J'ai aussi beaucoup aimé la tentative de faire dialoguer le juge qui préside l'audience avec l'accusé (canin), à l'aide d'un procédé révolutionnaire... que je laisse à chacun le plaisir de découvrir.
Au-delà de la comédie, il est question de la place des animaux dans notre société, du rôle des femmes, des immigré(e)s... et des (mé)faits des réseaux sociaux.
En 1h20, la réalisatrice brasse beaucoup de thèmes, de manière tonique. Le film fait à la fois rire et réfléchir, ce qui n'est pas si fréquent ces dernières semaines, dans les salles obscures de l'Hexagone.
P.S.
Je pense que le titre du film s'inspire de celui d'un vieux (très bon) long-métrage, Procès de singe.
16:08 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
vendredi, 13 septembre 2024
Silex and the City, le film
Après la série de bandes dessinées, après les courts-métrages télévisés, après le jeu de société, voici le film ! (Si cela continue ainsi, Jul pourrait, dans une sorte d'involontaire mise en abyme, devenir l'incarnation de ce que son film dénonce...)
Le tout début est sympatoche. Il fait intervenir un ancien président de la République et sa compagne (que l'on retrouve à la fin), qui se révèlent capables d'autodérision. C'est conforme à la marque de fabrique des adaptations de la BD, qui ont fait intervenir quantité de personnalités (plutôt de gauche) dans des rôles taillés sur mesure.
La suite est beaucoup moins emballante. On a beau retrouver le style, les anachronismes, les jeux de mots, les effets de décalage, cela ne fonctionne qu'en de rares occasions. Dans la salle où je me trouvais, personne n'a ri pendant la projection. (Certaines bandes-annonces se sont révélées plus drôles...) Le meilleur moment est pour moi la brève incursion dans un programme télévisuel parodiant L'Île de la tentation. Ah, si tout le reste avait été de cette veine...
Le pire est atteint quand le film d'animation est interrompu par une séquence avec de vrais acteurs. C'est très mauvais. En revanche, plusieurs épisodes situés dans la deuxième partie m'ont paru plus réussis : le cours d'économie commerciale de Crao de la Pétaudière et la dérision appliquée aux religions, qui érigent en objet de culte un minuscule outil de valeur ridicule.
Quand Jul se lance dans la philosophie politique, l'intrigue, de qualité médiocre, gagne un peu en épaisseur. Mais cela ne soulève pas l'enthousiasme, d'autant que la fin est ratée.
C'est donc une déception. Mieux vaut (re)lire les albums.
21:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 08 septembre 2024
Beetlejuice
Avant la sortie en salles, mercredi prochain, de la suite tournée elle aussi par Tim Burton, certains cinémas ont eu l'excellente idée de reprogrammer le premier film, datant de 1988. A l'époque, ce fut pour moi une découverte, celle de l'univers d'un cinéaste dont j'ai par la suite vu presque toutes les œuvres (y compris animées) sorties en salles.
Avec le recul, on constate que la distribution principale était prestigieuse... ce qui n'était pas évident à l'époque : Michael Keaton (délicieusement vulgaire dans le rôle-titre) n'avait pas encore endossé le costume de Batman, Geena Davis (actuellement à l'affiche de Blink Twice) ne s'était pas encore enfuie en voiture avec Susan Sarandon, Alec Baldwin était loin de se douter qu'il regretterait un jour d'avoir manipulé une arme à feu... et Winona Ryder (mmmm) en était à ses tout débuts.
La première partie fait un peu kitsch. L'image est datée et l'aspect nunuche du couple formé par les jeunes Davis et Baldwin est encore plus apparent des années plus tard. Le contraste avec le vocabulaire et le comportement plus que déplacés de Beetlejuice n'en est que plus frappant. Comme, depuis, une certaine décence a gagné la représentation des interactions humaines à Hollywood (sauf dans des productions mal élevées comme Deadpool & Wolverine), la caractérisation du personnage éponyme fonctionne à merveille. Je préviens toutefois le jeune public qui n'aurait jamais vu ce film : Beetlejuice/Keaton y est finalement assez peu présent, et uniquement dans la deuxième partie.
Quand bien même les effets spéciaux apparaîtraient parfois un peu datés, il faut souligner la qualité des décors et du maquillage, avec, en bonus, l'utilisation de maquettes et de poupées animées. Burton s'est amusé à retourner la mise en abyme : au début, l'action se déroule dans le vrai village, dont on peut voir une représentation réduite dans le grenier de la maison des héros ; par la suite, l'action se déroule à plusieurs reprises dans la maquette, d'où l'on peut voir le grenier.
Sur le fond, la jeune Lydia et son père incarnent les aspirations de Burton : vivre à l'écart du monde contemporain, perçu comme peu intéressant voire hostile, le côté gothique de l'adolescente étant appelé à un brillant avenir au sein de l’œuvre de Burton...
Ce film est aussi une dénonciation de la mentalité reaganienne régnant à l'époque aux États-Unis : l'arrivisme, l'appât du gain et l'adhésion (selon Burton) à de fausses valeurs sont incarnés par les promoteurs immobiliers et les "cultureux", l'un d'entre eux (excellent Glenn Shadix) se révélant d'un incommensurable snobisme.
Burton le rêveur n'est pas "politiquement correct". Son humour est macabre, parfois scabreux. Il humilie certains de ses personnages, tout en gardant une âme poétique. Cet improbable équilibre est l'une des grandes réussites de film, accompagné d'une bande son entraînante.
18:51 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 02 septembre 2024
La Belle Affaire
Intitulée Zwei zu eins ("Deux pour un") dans la version originale, cette fiction allemande (inspirée d'une histoire vraie) évoque les mois qui ont précédé l'absorption de la RDA par la RFA la réunification allemande. Au-delà d'une certaine somme, les citoyens de RDA ont été autorisés à échanger leurs vieux marks est-allemands contre de bons Deutsche Marks, au taux (avantageux) de deux pour un... sachant qu'à l'époque, le DM s'échangeait contre environ 3,40 francs français.
L'intrigue, loufoque, met en scène des gens de peu, anciens employés de la grosse usine locale, désormais à la retraite ou au chômage et habitant le même immeuble. Durant la première demi-heure, j'ai craint d'avoir choisi de voir une de ces comédies germaniques lourdingues, aussi digestes qu'une choucroute bien grasse accompagnée d'une bière qui sent la pisse.
Ce début est à la fois misérabiliste et maladroit. La manière dont une bande de branquignoles va mettre la main sur un paquet de billets entreposés dans un bunker secret n'est guère crédible. Mais, de temps à autre, il règne une petite ambiance à la The Full Monty (le strip-tease en moins, les habitants étant de surcroît très mal vêtus).
Cela devient vraiment intéressant à partir du moment où les héros se demandent quoi faire de tout ce pognon. Ils mettent au point une première combine, avec la complicité de petits commerçants ouest-allemands aussi débrouillards que cupides.
L'immeuble d'habitat collectif devient à la fois une métaphore de la RDA finissante et une tentative d'utopie néo-communiste, mâtinée de consumérisme frénétique. J'ai beaucoup aimé cette partie, qui ne se limite pas à la comédie. Elle pose de bonnes questions sur le rôle de l'argent et les choix de vie qui se présentent parfois. Dans l'immeuble, tout le monde n'a pas envie de jouer collectif et, parmi ceux qui adhèrent à l'action de groupe, des dissensions émergent sur la manière de procéder. On nous propose une belle brochette de seconds rôles, bien qu'un peu caricaturale.
Se greffe là-dessus une intrigue amoureuse. La crise de fin de régime (communiste) provoque des retrouvailles. Les rapports humains se développent à trois niveaux : l'immeuble collectif, la famille (de cœur) élargie de l'héroïne Maren et le triangle amoureux. Je trouve que la partie sentimentale est bien insérée dans l'histoire politique... l'interprétation de Sandra Hüller n'y étant pas pour rien. De manière stupéfiante, cette comédienne réussit à incarner aussi bien l'idéaliste communiste que, naguère, l'épouse nazie du commandant du camp d'Auschwitz (dans La Zone d'intérêt). J'ai aussi apprécié l'intelligence et la malice d'une gamine à la paternité douteuse, qui contribue à un ultime rebondissement, dans un épilogue qu'il ne faut pas rater. Le générique est aussi coupé par des images d'époque, qui nous racontent la véritable histoire (pour le peu qu'on en connaisse).
Je recommande donc ce film, qui n'est pas une grande réussite en terme de comédie, mais qui mérite le détour pour les questionnements politico-sociaux qu'il met en scène.
23:41 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 27 août 2024
Project Silence
Le jeune cinéaste sud-coréen Tae-gon Kim mélange les genres dans cette production horrifique qui n'est pas sans rappeler de précédents films (Dernier train pour Busan et, plus récemment, Projet Wolf Hunting).
Plus précisément, il croise le film-catastrophe (genre accident d'avion, immeuble en feu ou bateau qui coule) avec le film d'horreur, une créature quasi surnaturelle (requin particulièrement coriace, alien diabolique ou crocodile très très affamé) menaçant la survie des personnages principaux, ici les occupants de divers véhicules, qui se retrouvent coincés sur un gigantesque pont à haubans (peut-être celui d'Incheon), à proximité de Séoul. Ils ignorent qu'au cours du carambolage, une troupe de chiens dressés pour tuer s'est évadée d'un fourgon...
Le côté film d'horreur est bien porté par les chiens (réels comme virtuels), la meute obéissant aux ordres d'une créature alpha, qui a échappé au contrôle des humains. Signalons que le dominant est ici une dominante, une femelle redoutable, mais dotée de sentiments.
Le problème vient des personnages humains, une brochette de caricatures comme je croyais ne plus pouvoir en trouver dans une fiction du XXIe siècle : scientifique lâche, politicien manipulateur, haut-fonctionnaire imbu de lui-même qui va renouer en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire avec un humanisme aussi bien-pensant qu'irréaliste (dans le contexte de survie sur le pont). Sa fille est faite du même tonneau, n'hésitant pas à quitter un abri sûr à plusieurs reprises, réussissant à chaque fois à échapper aux molosses qui viennent pourtant de dézinguer une unité de policiers surentraînés... et je ne vous parle pas du comique troupier de la bande, un petit arnaqueur, officiellement dépanneur routier, dont le véhicule de fonction est capable de remonter un fourgon blindé militaire...
Bref, les incohérences sont nombreuses et le comportement, soit larmoyant à l'extrême, soit totalement irresponsable, de nombreux personnages ne permet pas de relancer l'intérêt. C'est dommage, parce que les effets spéciaux sont bien fichus : le carambolage autoroutier, l'accident d'hélicoptère et la progressive désagrégation du viaduc sont mis en scène avec un incontestable savoir-faire.
A trop vouloir copier des modèles états-uniens, le réalisateur tombe à mon avis dans les mêmes travers : l'exploitation d'une intrigue familiale cousue de fil blanc et le déversement maladroit d'une morale lénifiante.
15:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 23 août 2024
Blink Twice
Slater King est un milliardaire de la tech, qui tente de se racheter une conduite. Le brillant jeune homme (Channing Tatum, excellent), un poil arrogant, au management un peu autoritaire et dont on sent qu'il n'a pas toujours été très correct avec les dames, a décidé de devenir un type bien. Il suit une thérapie et se ressource régulièrement sur une île paradisiaque des Caraïbes, où l'on vit frugalement, sans smartphone, où l'on mange bio et où l'on se respecte. De temps à autre, il y invite quelques amis... et de jolies jeunes femmes.
Deux d'entre elles se sont tapé l'incruste lors d'une soirée consacrée au tycoon, sur le continent. Ce sont des employées de la société qui gère l'événement, mais elles font tout pour se rapprocher des vedettes... et se font remarquer... puis inviter sur l'île. Au départ, tout semble merveilleux, mais, petit à petit, Frida commence à avoir des pertes de mémoire et remarque des trucs bizarres... jusqu'à la disparition d'un invité dont personne d'autre qu'elle ne semble se souvenir.
Même si j'estime ces deux premières parties un peu trop longues, je trouve que la progressive montée en tension (liée notamment à l'étrangeté grandissante de la situation) est maîtrisée. Il y a du Shyamalan (première époque) dans ce film de Zoé Kravitz... en tout cas plus que dans le récent Trap. J'y vois aussi une pincée d'ambiance lynchienne (à la Twin Peaks), pas uniquement en raison de la présence de Kyle MacLachlan dans la distribution.
On attend évidemment que l'apparente ambiance paradisiaque vole en éclat et, quand cela arrive, on n'est pas déçu. Petit à petit, la vérité se fait jour, avec une deuxième couche concernant l'un des personnages, marqué par une discrète cicatrice, antérieure à son séjour dans l'île.
Du coup, je trouve que ce film de genre est bien maîtrisé, avec en sous-texte un brûlant sujet de société sur lequel je ne peux m'attarder, sous peine de trop déflorer l'intrigue...
... MAIS J'EN DIS PLUS CI-DESSOUS.
NE LISEZ SURTOUT PAS LA SUITE SI VOUS COMPTEZ VOIR LE FILM.
CELA RISQUE DE VOUS PRIVER D'UNE PARTIE DU PLAISIR.
Blink Twice est un film Metoo. Ce n'est pas tant le monde de la tech qui est dépeint que, par métaphore, celui du cinéma... et ce qu'il impose aux femmes en général, aux actrices en particulier.
Les hommes sont donc (presque) tous des prédateurs... et blancs (gros défaut du film, qui exonère les mâles issus des "minorités visibles" des comportements sexistes). La petite nuance porte sur l'un des mecs, qui ne participe pas, mais qui se tait et préfère oublier. A travers lui, Kravitz dénonce la passivité de certains acteurs ou réalisateurs hollywoodiens, qui ont fermé les yeux sur les déviances d'Harvey Weinstein, tant que cela ne les touchait pas de près.
La contexte des comportements prédateurs pourrait aussi faire allusion à l'affaire Epstein, même si l'intrigue se concentre sur des femmes majeures.
Enfin, il y a le cas du personnage de Stacy, la sœur de Slater, qui en sait plus qu'elle ne le dit et qui se fait la complice de l'entreprise de prédation de son frère. Elle est incarnée par Geena Davis, une comédienne investie dans la défense des droits des femmes, mais, surtout, une femme de la "génération d'avant". Je pense qu'à travers ce personnage, la réalisatrice pointe (selon elle) la responsabilité partielle de ces actrices qui n'ont pas été victimes des violences sexuelles (parce qu'elles étaient intouchables, protégées par un compagnon, aptes à se défendre... ou tout simplement très prudentes), mais se doutaient de ce qui se passait dans certaines chambres d'hôtel. Le film met en avant la sororité, cette solidarité féminine qui aurait peut-être permis d'éviter certains comportements scandaleux.
Ce petit film de genre, en apparence assez lisse, est donc au final plus profond qu'il n'en a l'air, un peu à l'image du Get out de Jordan Peele il y a quelques années.
23:28 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
lundi, 19 août 2024
Highway 65
Cette autoroute israélienne se trouve dans le nord du pays, coincée entre Liban, Cisjordanie, mer Méditerranée et lac de Tibériade. On la voit à plusieurs reprises dans le film, lorsque l'héroïne (Daphna) se trouve sur le balcon du logement qu'elle occupe à Afoula. Pour elle, cette autoroute symbolise peut-être la possibilité d'un retour à Tel-Aviv, d'où la policière a été récemment mutée.
La police locale ne semble pas très ardente au travail... et surtout veille à respecter les notables du coin. On le constate notamment avec l'affaire de la disparition d'une femme, Orly, peu avant le dixième anniversaire de la mort de son mari, fils d'un entrepreneur du BTP qui semble connaître tout le monde.
Le problème est que personne n'a signalé la disparition de la veuve (qui n'en est pas à sa première tentative), alors que son téléphone portable a été trouvé au bord d'un champ de maïs. On fait comprendre à la policière qu'il ne faut pas trop embêter la famille de l'entrepreneur. Ses deux fils sont jadis partis se battre au Liban. L'un n'est pas revenu, l'autre, qui travaille dans une pépinière, a été marqué à vie.
Un mystère plane, donc, que les patients et laborieux efforts de Daphna vont tenter d'éclaircir. Le problème est que la manière dont l'enquête est menée n'est pas très réaliste. Je ne suis pas au fait des procédures en Israël, mais il me semble tout de même que la policière enfreint pas mal de règles (de procédure comme de prudence). Je suis finalement arrivé à la conclusion que le réalisme n'était pas le souci de l'auteure du film, l'enquête n'étant qu'un prétexte pour aborder certaines thématiques.
Au cœur de l'intrigue se trouve la place des femmes dans cette ville provinciale qui semble fortement marquée par la domination masculine. Les quatre personnages féminins un tant soit peu développés sont tous de potentielles victimes... tout en ayant la possibilité, à certains moments, de mener le jeu. Ainsi, la disparue, Orly, ravissante trentenaire, faisait tourner la tête de bien des hommes, mais était aussi un objet de convoitise. La policière Daphna se fait rapidement gifler au cours de son enquête, puis agresser par un motard. Mais elle peut menacer des hommes, voire les mettre en garde à vue. Sa supérieure hiérarchique est à peine mieux lotie. En tant que cheffe du poste de police, elle fait partie des notables, mais, quand l'entrepreneur de BTP vient lui faire la leçon dans son propre bureau, elle est obligée d'obtempérer. Quant à la belle-mère de la disparue (épouse du chef d'entreprise), elle symbolise la génération en apparence soumise, mais qui dispose de discrètes marges de manœuvre.
En parallèle est développée la thématique de la sororité (pour employer un terme à la mode). Plus le film avance, plus deux femmes qu'a priori tout oppose voient leurs profils se rapprocher. Il s'agit de la disparue (archétype de la jolie fille, en apparence un peu superficielle) et de la policière, célibataire sans enfant, dont la cinéaste a voulu faire, au départ, un personnage aussi peu glamour que possible : elle est mal coiffée, porte des lunettes à la Harry Potter, s'habille comme une demi-clocharde et mange vraiment salement, comme on prend bien soin de nous le montrer à plusieurs reprises. On comprend toutefois assez vite que Daphna est elle-même une jolie jeune femme, mais qu'elle s'oppose, par sa manière de vivre, aux stéréotypes de genre imposés aux femmes. Comme elle a aussi envie de vivre, de vibrer, il lui faut tout de même (parfois) faire des concessions... Petit à petit, la réalisatrice instille l'idée d'une quasi-gémellité entre Orly et Daphna.
Du coup, on comprend mieux pourquoi la manière dont l'intrigue policière est menée semble artificielle. Elle n'est qu'un cadre pour un propos militant. C'est tout à fait louable, mais cela ne fait pas forcément un bon film.
13:17 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 18 août 2024
City of Darkness
Cette "cité de l'obscurité" (au sens littéral comme au sens figuré) est un quartier de la mégapole hongkongaise. Celle-ci a la forme d'un petit archipel, la péninsule de Kowloon se trouvant sur la partie continentale, au sud de Shenzhen.
On y trouvait (jusqu'aux années 1990) un gigantesque bidonville, étalé (en hauteur) sur une quinzaine d'étages. Le contrôle de cette "citadelle" (et des trafics qui y prospéraient, en toute impunité) fut l'objet de la rivalité entre deux bandes, l'une finissant par triompher de l'autre, des années auparavant. Dans le même temps, un autre gang a mis la main sur le reste de la ville chinoise.
Deux trames historiques s'entremêlent donc dans ce film. A l'arrière-plan se trouve l'époque de lutte pour le contrôle de la citadelle, dans les années 1950. La majorité de l'action se déroule toutefois à la fin des années 1980, à une époque où l'on comprend que la présence britannique va tôt ou tard prendre fin. L'autonomie dont jouit la citadelle est du coup menacée.
Celle-ci est un véritable personnage de l'histoire, pas uniquement un (vertigineux) décor. C'est à la fois un labyrinthe (pour qui n'en connaît pas la géographie), un lieu de vie, de mort, de chaleur humaine... et une verrue urbaine, marquée par le manque de lumière naturelle et une grande insalubrité.
Soi Cheang (auquel on doit aussi le surestimé Limbo) réussit à rendre crédible sa reconstitution du quartier détruit. Il en tire très bien parti dans la construction de son film.
Mais ce n'est pas forcément cet aspect qui va marquer les spectateurs. A l'écran, on est surtout frappé par la virtuosité des scènes de combat, que ce soient les anciennes (se déroulant trente ans auparavant) ou les nouvelles (celles des années 1980). Des jeunes voyous aux chefs de triade, ça castagne sec. On résout ses problèmes à coups de poings, de pieds... éventuellement de couteaux. Ce n'est qu'à l'ultime fin que l'on voit débarquer des armes à feu, entre les mains de personnages montrés comme foncièrement déloyaux.
Dans ce monde en apparence sans foi ni loi, il existe pourtant des règles, dont va profiter un jeune réfugié (sans doute venu de Chine communiste). Il s'embrouille d'abord avec la triade de "Mr Big", avant d'atterrir dans la citadelle, "sécurisée" par les troupes de "Cyclone"... qui, étonnamment, va prendre le jeune homme sous son aile.
Pour celui qu'on surnomme dans un premier temps "crâne d’œuf", l'existence au sein du bidonville représente une renaissance. Il y recouvre ses forces, trouve du travail, réussissant à mettre de l'argent de côté... et se fait même des amis, le patron des voyous incarnant une figure paternelle de substitution. Tous ces aspects sont bien mis en scène, tout comme la description de la vie quotidienne des habitants de la citadelle, majoritairement commerçants et artisans (avec leurs employés, plus ou moins bien traités). Cela donne au film une épaisseur sociale inattendue.
Le passé finit par ressurgir et les bastons reprennent, encore plus sanglantes qu'au début. Certes, c'est remarquablement chorégraphié, filmé, monté... mais, au bout d'un moment, on tombe dans l'exagération, la vraisemblance ayant visiblement sombré dans les égouts de la cité. C'est un peu le retour de l'effet Chevaliers du Zodiaque, manga dans lequel, à de fréquentes reprises, les héros frôlaient la mort, se vidaient de leur sang, avant de finalement administrer une raclée au super-méchant qui semblait invincible auparavant.
Ceci dit, dans ce film-ci, les défauts sont nettement moins présents que dans Limbo. C'est plus rigoureux, plus riche aussi sur le plan scénaristique... et toujours splendide sur le plan visuel.
15:46 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films