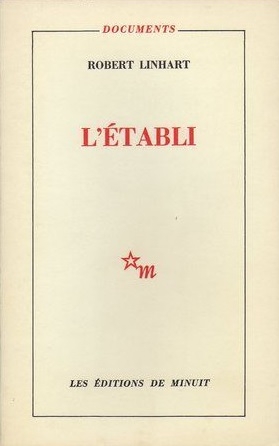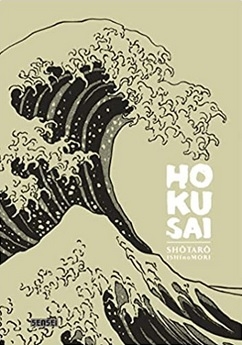lundi, 26 juin 2023
38°5 quai des orfèvres
Le titre, évidemment parodique, est une allusion au polar 36 Quai des orfèvres, d'Olivier Marchal, qui est passé à la moulinette potache, façon Hot Shots. A plusieurs reprises, on sent aussi des influences françaises : La Cité de la peur (des Nuls), Le Téléphone sonne toujours deux fois (des Inconnus), voire les films de la "bande à Lacheau" (notamment Super-héros malgré lui).
Toutes ces références sont cependant écrasantes. Ce film-ci n'arrive pas à la cheville de ses modèles, même si plusieurs gags sont réussis. Ainsi, il est plaisant de voir Artus (le médecin-légiste) dans ses œuvres : il manie le scalpel (et le flingue) à la perfection... et prend toujours soin de préciser, à propos d'un cadavre, « qu'il n'a pas subi d'agression sexuelle... du moins, pas encore ».
Eh oui, ce grand prix du dernier festival de l'Alpe d'Huez ne fait pas dans la dentelle. Mais je trouve qu'il manque de rythme. De plus, tous les interprètes ne sont pas du même niveau. Caroline Anglade (qui incarne la profileuse) est très professionnelle, de même que Thierry Desroses (le commissaire, dont la voix sera familière aux habitués des fictions américaines doublées en français). J'ai trouvé aussi Pascal Demolon très convaincant en tueur en série manipulateur (façon Hannibal Lecter, dans Le Silence des agneaux).
Le problème vient du principal interprète. Didier Bourdon en fait des caisses et n'est pas toujours crédible dans le rôle. Il aurait fallu quelqu'un de plus athlétique (ou le même acteur, avec le corps qu'il avait il y a trente ans...). Les autres policiers sont plus que caricaturaux. À ce niveau-là, on est moins proche de la parodie que de l'incompétence.
Je garde quand même en mémoire les flashs infos, faussement anodins, qui contiennent toujours quelques perles, soit dans le discours officiel (telle journaliste demandant au commissaire combien le double meurtre a fait de victimes...), soit dans ce qui est montré à l'écran (soyez attentifs à l'arrière-plan), soit dans le bandeau défilant au bas de l'écran (l'un d'entre eux signalant le vote d'une loi interdisant l'hiver, destinée à s'appliquer à partir d'août suivant).
Du coup, en moins d'1h20, je suis régulièrement passé du rire à l'accablement, désolé que les bonnes idées (comme ce que l'on découvre dans les pièces annexes d'un immeuble abandonné) soient gâchées par la paresse de la réalisation et le manque de rigueur dans la direction d'acteurs.
15:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 25 juin 2023
Elémentaire
Avec ce nouveau film d'animation, on soupçonne bigrement Disney-Pixar de tenter de nous refaire le coup de Vice Versa (un quasi-chef-d’œuvre, bien supérieur à presque tout ce qui lui a succédé, provenant de ce studio). Il faut dire qu'au début du moins, on a comme l'impression que Flam pourrait incarner la colère et Flack la timidité.
Mais, avant d'en arriver là (et à condition de ne pas rater le début de la séance), on a droit à un sympathique court-métrage, Le Rendez-vous de Carl, dans lequel on retrouve deux des personnages d'une autre grande réussite "pixarienne", Là-haut.
Je signale que j'ai vu l'ensemble en version française. Je pense que cela a son importance. Dans la version originale, la famille "Feu" (Lumen) est doublée par des acteurs d'origine asiatique, la famille "Eau" par des Blancs et des Afroaméricains. Dans la VF, Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulous doublent les deux personnages principaux, celle-ci s'en sortant (à mon avis) mieux que celui-là.
Fort heureusement, même dans la VF, l'image vient suppléer ce qui ne passe plus par le son : la famille Lumen est issue de l'immigration, comme le fait comprendre la première séquence, qui est une allusion transparente à l'arrivée à Ellis Island, longtemps porte d'entrée sur le territoire états-unien. La construction du film est suffisamment habile pour que des ressortissants de différentes vagues d'immigration (nord-européenne, juive d'Europe centrale et orientale, moyen-orientale, extrême-orientale...) puissent se reconnaître dans cette famille. En face, les "Aquatiques" (catégorie à laquelle appartient la famille Delamare) sont les plus nombreux à New York Element City. Ils représentent les natifs, soit blancs, soit noirs. L'arrière-plan sociétal est donc assez riche, même si l'histoire d'amour naissant entre Flam et Flack apparaîtra à beaucoup comme une resucée de Roméo & Juliette.
Cette histoire, mêlée à la question du respect des traditions familiales, baigne dans un graphisme splendide. On finit même par oublier la beauté des décors, tant on est captivé par l'inventivité de l'animation au niveau des personnages et de leurs évolutions. (Le réalisateur, Peter Sohn, est aussi l'auteur du Voyage d'Arlo.) Concernant les éléments, je regrette toutefois le peu de place pris par les "Terriens" et leur représentation essentiellement sous la forme d'arbres enracinés. Mais, pour les autres éléments (eau, feu et air), c'est remarquable.
Le film est emballant aussi parce qu'il est bourré d'humour, un plutôt destiné aux marmots (je pense notamment aux aisselles fleuries d'un petit personnage), un autre parlant davantage aux adultes. (Il convient d'être attentif aux nombreux jeux de mots.)
C'est peut-être le spectacle familial de l'été (en attendant le dernier Indy), grande réussite visuelle, assez classique sur le fond.
14:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 22 juin 2023
The Flash
Après Marvel, c'est autour de DC de se plonger dans le multivers, ici par l'intermédiaire d'un super-héros que l'on pourrait trouver secondaire, Barry Allen. On le découvre dans ses œuvres dès la première séquence, assez éblouissante, celle d'un début de matinée agrémenté du sauvetage des occupants d'un immeuble. Les effets spéciaux sont bluffants... et c'est pimenté d'humour, souvent potache. On évite l'héroïsation à l'excès et l'on se permet deux-trois trucs borderline, comme de placer un bébé que l'on veut sauver dans... un four à micro-ondes !
Cette séquence se conclut de manière encore plus savoureuse grâce à l'intervention de Wonder Woman (aaaaah, Gal Gadot !), dont le lasso fait des ravages... y compris chez ses alliés !
L'insertion du multivers se fait quand le jeune héros décide de tenter de sauver sa mère (et de faire innocenter son père). Dans des circonstances que je laisse à chacun le plaisir de découvrir, Barry se retrouve projeté dans un monde parallèle, où sa mère est vivante... mais où il doit cohabiter avec une version légèrement plus jeune que lui... et surtout plus immature !
Ezra Miller réussit pleinement à incarner les deux... et, même pour moi qui, en général, ne supporte pas les adolescents attardés, c'est très drôle ! Le deuxième Flash n'a pas encore acquis ses pouvoirs mais, quand il en fait l'expérience, il va de surprise en surprise...
... et nous aussi... parce que, dans cet univers alternatif, il ne semble pas y avoir autant de super-héros que chez nous. Pas de Wonder Woman ni de Superman à l'horizon... mais peut-être bien une « Supermeuf » ! Ah, mais si, il y en a un qui est présent dans les deux : Batman, sauf que, dans notre univers, il est incarné par Ben Affleck, tandis que dans l'univers parallèle, Flash va rencontrer... le VRAI Batman (pour les cinéphiles) !
Concernant le multivers, je trouve le scénario plutôt malin. Ce sont les tentatives de retour en arrière qui créent les univers parallèles, avec le redoutable effet papillon, la moindre modification du passé ayant des conséquences insoupçonnées.
Clin d’œil de la production, ce qui semble caractériser certains des univers parallèles est qu'on y retrouve les différentes incarnations cinématographiques ou télévisuelles des super-héros DC, notamment Superman (alors que dans le dernier Spider-Man, qui est un film d'animation, ce sont les différentes versions des comics qui colorent les facettes du multivers).
C'est parfois un peu long, mais je ne me suis pas ennuyé. Les scènes d'action, bourrées d'effets spéciaux, alternent avec les moments familiaux (avec une histoire de passage à l'âge adulte en sous-texte)... et les scènes de déconnade. On a tout de même droit à une version alternative de Flash qui parle de « bite » et de « scrotum » ! (Et pour cause : le costume, hyper-moulant, comprime l'entrecuisse...)
P.S. I
Visiblement, le film déçoit les amateurs de grandiloquence et de bastons sous stéroïdes, mais il ravira celles et ceux qui goûtent les plaisirs régressifs, qui ne se prennent pas trop au sérieux.
P.S. II
Au bout du bout du générique, on retrouve Barry, en compagnie d'un personnage habitué à manier une grande fourchette...
23:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
La Nuit du verre d'eau
Liban, 1958. Dans un village de la vallée sainte, une famille est réunie, à l'écart des troubles qui agitent le pays. Les patriarches locaux (chrétiens) sont préoccupés par trois sujets : l'agitation musulmane, qui soutient la toute nouvelle République arabe unie prônée par l’Égyptien Nasser (et qui voudrait voir le Liban la rejoindre), la perspective de nouvelles élections, auxquelles l'un des chefs de famille envisage de se présenter... et l'éventuel mariage de sa deuxième fille, Eva, dont il ignore qu'elle a un amoureux, le fils d'un de ses métayers.
L'héroïne de cette histoire est une autre fille de Cheikh Daoud, son aînée, Layla. Celle-ci semble être un modèle. Épouse d'un riche entrepreneur local, qui la vénère, elle a un fils adorable. Elle est belle, élégante et relativement indépendante : elle conduit sa propre voiture... mais, voilà, nous sommes en 1958, au Liban, et cette indépendance est toute relative. Layla n'a pas choisi son époux. En bonne fille de Cheikh Daoud, elle a accepté le mariage arrangé qu'il lui a concocté (comptant sans doute sur la fortune de son futur gendre pour financer ses ambitions électorales). Elle n'est pas heureuse en ménage. En public, elle arbore le masque de l'épouse comblée. En privé, le soir, au lit, elle essaie d'échapper au "devoir conjugal", ou bien elle simule, pendant l'acte. Une activité artistique (le dessin) lui permet de sublimer sa frustration.
Cette partie-là est très bien filmée, je trouve, en tout cas mieux que la période de trouble qui débute avec l'arrivée de deux Français, une veuve (interprétée par Nathalie Baye, impeccable) et son fils... que Leyla trouve très à son goût. La romance furtive qui naît entre ces deux-là est plaisante à voir, mais la mise en scène peine à faire surgir le désir, alors qu'elle peut s'appuyer sur un Roméo bien de sa personne (Pierre Rochefort, pas très expressif toutefois) et une Emma Bovary vraiment très séduisante. (Soyez attentifs aux lectures de ces demoiselles, en particulier la benjamine, Nada.) Dans le rôle, Marilyne Naaman "dégage" quelque chose. En elle se mélangent le charme oriental et une sorte de glamour à l'américaine.
Dans son genre, chacune des trois sœurs va mener sa petite révolte : l'aînée infidèle, la cadette qui refuse le mariage et la benjamine qui veut poursuivre ses études pour devenir avocate. L'une des qualités du film est de ne pas réduire les principaux personnages masculins à des caricatures. Le mari de Leyla est un brave type et le père aime ses trois filles. Mais tous deux fonctionnent dans un système patriarcal, qui ne laisse que peu de liberté aux femmes, fussent-elles issues de la classe moyenne aisée.
Les dialogues oscillent entre l'arabe et le français, de manière naturelle (bien mieux en tout cas que dans le récent Tel Aviv - Beyrouth). Ne vous fiez pas aux dénominations VO ou VF. Il n'y a qu'une version du film, mêlant les deux langues. Quant au titre français, une fois n'est pas coutume, je le trouve meilleur que celui d'origine (Terre d'illusion)... mais je laisse chacun(e) découvrir ce à quoi il fait allusion. Il faut attendre la fin pour comprendre... même si la dernière scène se prête à deux interprétations.
J'ajoute que les paysages sont magnifiques et la musique bien choisie. Elle tranche avec la douceur apparente et suggère les tourments intérieurs.
En dépit de quelques imperfections, je recommande donc ce film, qui ne manque pas de style.
11:50 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, femmes, femme, filles
mardi, 20 juin 2023
Transformers - Rise of the beasts
Dans ma jeunesse, je n'avais pas accroché à la série animée consacrée à ces étranges Autobots (des robots qui prennent la forme de véhicules : voitures, camions... voire avions). Des années plus tard, je ne m'étais donc pas précipité au cinéma quand les personnages avaient accédé au grand écran. J'ai tenté l'aventure de ce reboot, à une séance en version originale sous-titrée.
Ce dernier long-métrage reste dans la tradition de ce qui a fait le succès (de la plupart) des films : de très bons effets spéciaux, de l'aventure et des tranches d'humour d'une finesse contestable. Dans cet opus, c'est le personnage de Mirage qui joue le rôle d' « usine à vannes »... et, ma foi, il le fait bien. (Dans la V.O., il a la voix de Pete Davidson, un humoriste spécialiste du "seul en scène".)
Ses interactions avec son « humain de compagnie » (le latino noir Noah Diaz) sont bien mises en scène... et, des deux, c'est le personnage du robot qui est le plus farfelu. Le jeune humain a sans doute dû mûrir précocement, parce qu'il a en charge un frère handicapé. Toutefois, les relations entre les deux frangins, telles qu'elles nous sont montrées, collectionnent les clichés.
Mais c'est avec deux autres catégories de personnages que le film commence, dans un passé (futur ?) lointain : les Maximals (sorte de version améliorée des Autobots) et les Terrorcons (des robots dévoyés, passés au service d'une entité malfaisante, Unicron). Leur lutte a pour enjeu le contrôle d'un mystérieux objet, conférant de gigantesques pouvoirs... et qui finit caché quelque part, sur Terre.
C'est là que les humains entrent en jeu. Noah va former un improbable duo avec une jeune archéologue, Elena. Est-il nécessaire de préciser qu'elle est afro-américaine ? Peut-être, si l'on ajoute que les deux héros, issus des minorités visibles, nous sont montrés victimes de discriminations de la part de Blancs : la candidature de Noah à un emploi est rejetée de manière méprisante et Elena la stagiaire sert de faire-valoir à sa patronne. Ce manque de nuance est assez déplaisant, mais je pense qu'il vise à satisfaire le public états-unien visé : les jeunes issus d'au moins une minorité (ainsi aussi, sans doute, que les jeunes Blancs urbains qu'on culpabilise depuis des années avec le discours woke). J'ai tout de même apprécié qu'au début, lors de leur rencontre, les deux héros commencent par se méfier l'un de l'autre, chacun pensant d'abord à sa pomme quand le musée est pris d'assaut.
Sans surprise, ceux qui au départ ne s'apprécient guère vont finir par coopérer, pour pouvoir vaincre les méchants. Humains, Autobots et Maximals unissent leurs efforts, de manière spectaculaire, face à des ennemis qui paraissent d'abord invincibles. C'est une autre faiblesse du film (commune hélas à beaucoup de grosses productions, comme le dernier Gardiens de la galaxie) que de placer ses héros au bord du gouffre, face à un problème en apparence insoluble, avant de les faire triompher de ceux dont auparavant rien ne laissait supposer qu'ils pouvaient les vaincre.
La baston finale (presque entièrement numérique) mérite le détour, mais il vaut mieux avoir laissé sa rationalité au vestiaire. Les invincibles du début se font finalement un peu trop rapidement dézinguer, pendant que les humains échappent miraculeusement à la mort... et la Terre à la destruction.
Ceci dit, c'est bien mené. On ne s'ennuie pas et l'action est bien dosée : cela va moins vite que dans le dernier Spider-Man... mais c'est moins hilarant.
11:46 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 19 juin 2023
Sexygénaires
Cinq ans après La Finale, Robin Sykes nous propose une nouvelle "comédie sociétale" autour du troisième âge, là encore avec Thierry Lhermitte. L'ancien Popeye du Splendid porte beau et le scénario mise là-dessus pour nous plonger dans les difficultés d'un hôtel-restaurant de luxe (un peu vieillissant lui aussi)... et dans le monde du mannequinat aux tempes argentées.
Le début plante le décor de manière classique : Michel (T. Lhermitte) dirige son établissement varois avec passion, faisant passer sa vie personnelle au second plan. On est de tout cœur avec cet homme aimable, veuf inconsolable, qui met sa stabilité financière personnelle en jeu pour tenter de sauver son entreprise (et son personnel). On n'est pas vraiment surpris de découvrir que son vieil ami et associé, Denis, installé à Paris, est en fait un combinard de première. Mais c'est de cet ami que va peut-être venir la solution à ses problèmes.
Dans le rôle du raté sympathique (Denis), Patrick Timsit livre sans doute la prestation que l'on attendait de lui. Son personnage doit inspirer de la pitié... mais, surtout, agacer (objectif plus qu'atteint) et placer Michel dans des situations délicates.
Le duo fonctionne bien, parce qu'il est particulièrement contrasté... trop même. Michel n'a quasiment que des qualités et Denis en fait vraiment des caisses.
Heureusement qu'il y a la distribution féminine. Zineb Triki (vue récemment dans Vortex) est parfaite en agente ambitieuse, organisée, séduisante et... sans tabou. Marie Bunel offre un contrepoint intéressant aux deux principaux personnages masculins : elle est de la même génération, a réussi de son côté... et a de beaux restes, comme on dit. Sur le plan comique, il faut signaler la prestation de la toujours piquante Olivia Côte, en photographe allumée, qui n'hésite pas à bousculer ses modèles... et à se montrer délicieusement grossière. D'autres seconds rôles sont aussi bien campés.
Voilà. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est au final assez plaisant et cela dure à peine 1h20.
11:33 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
dimanche, 18 juin 2023
Sick of myself
Présenté à Cannes l'an dernier, dans la catégorie « Un certain regard », ce film norvégien n'est pas sans rapport avec une autre œuvre scandinave, la Palme d'or 2017, The Square, du Suédois Ruben Östlund (qui, lui, est reparti de l'édition 2022 avec une seconde palme, pour Sans filtre).
Dans les deux films il est question de l'art contemporain, de posture, de snobisme et de narcissisme. Mais, ici, le réalisateur ne s'intéresse pas tant à l'élite de l'art contemporain qu'à celles et ceux qui essaient de la rejoindre. Le couple de héros est formé d'un créateur qui commence à percer, un jeune homme plutôt bien de sa personne, habile et charmeur, qui a une haute opinion de lui et aime s'écouter parler. Sa compagne, Signe, une ravissante blonde, est... serveuse, mais a des prétentions artistiques. Surtout, elle a désespérément besoin qu'on s'intéresse à elle.
La première partie du film est un délice de mauvais esprit, à froid (à la scandinave). Les deux "héros" y apparaissent assez pathétiques. Les dialogues, ciselés, nous font vite comprendre à quel point le couple est asymétrique. J'ai particulièrement aimé certaines séquences, celle au cours de laquelle la serveuse sauve la vie d'une femme mordue par un chien et celle du dîner mondain, au cours duquel la jeune femme simule une allergie à la noix.
Elle est prête à tout pour devenir le centre de l'attention, y compris à devenir malade. Le personnage devient encore plus pathétique et déplaisant... mais c'est compensé par l'ironie qui irrigue la mise en scène des conséquences de son activisme. Là, il convient d'être particulièrement attentif : certaines scènes sont fantasmées, d'autres réelles. A plusieurs reprises, Signe imagine quel degré de célébrité elle pourrait atteindre (et comment).. ou quelles pourraient être les conséquences négatives de ses actes. Je crois ne pas trop en dévoiler en affirmant que la jeune femme arrive plus ou moins à son but. Cela la conduit à une agence "inclusive", dont la patronne promeut une mode et une communication "éthiques". On ne s'étonnera donc pas qu'elle ne travaille quasiment qu'avec des "minorités" dans tous les sens du terme : son assistante est aveugle, une autre employée est noire et sa précédente "pouliche" est un mannequin n'ayant qu'une main... C'est dire le potentiel qu'elle voit dans une jeune femme défigurée, victime supposée d'une maladie inconnue !
Avis aux âmes sensibles : le réalisateur Kristoffer Borgli pousse le bouchon vraiment très loin. J'ai pensé aux œuvres de David Cronenberg et au Rock'n Roll de Guillaume Canet. C'est donc plutôt à réserver à un public averti... même si je pense que les ados d'aujourd'hui tireraient le plus grand profit de la vision de ce film.
10:05 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
samedi, 17 juin 2023
Le Vrai du faux
Ce (vrai ? faux ?) documentaire commence par une situation qui hélas apparaîtra familière à certains : une usurpation d'identité, sur un célèbre réseau social. Mais elle se poursuit de manière assez inattendue : le réalisateur Armel Hostiou, victime de l'usurpation, se rend sur les lieux du crime, à Kinshasa (que ses habitants appellent « Kin »), en République Démocratique du Congo.
Depuis l'époque d'Hergé et de son Tintin au Congo, la ville a bien changé. C'est désormais une mégapole, sans doute plus peuplée que Paris... et donc la première ville francophone du monde, même si tous ses habitants ne maîtrisent pas la langue de Molière. Dans le film, on constate que presque tout le monde est au moins bilingue. Au vu du brassage de populations et de styles de vie, il est probable que des dizaines (centaines ?) de milliers d'habitants soient polyglottes. Le principal moyen de locomotion semble être le deux-roues (de plus en plus à moteur). Kinshasa a un petit air de métropole d'Asie du Sud-Est d'il y a vingt-trente ans.
Le film est donc autant une enquête sur l'arnaque dont le réalisateur a été victime que le portrait d'une cité. On voit à peine les zones sécurisées où s'entassent les plus riches. L'action se déroule entre la résidence d'artistes, quelques rues commerçantes, un ou deux quartiers précaires... et une périphérie lointaine, rurale, où vit un féticheur réputé.
La capitale de RDC vit entre tradition et modernité, mais toujours avec un fond d'arnaque. La classe politique vole le peuple, de faux marabouts dupent les esprits crédules... et une kyrielle de filous font miroiter la belle vie aux jolies jeunes femmes.
J'aime les deux trames de l'histoire (l'enquête et le tableau sociétal), même si tous les intervenants ne sont pas convaincants, Sarah en particulier... sauf quand elle prend les choses en main pour "harponner" l'auteur présumé de l'arnaque. Le réalisateur français n'est pas au bout de ses surprises, qui ne cessent pas quand il découvre qui est derrière l'escroquerie... Mais le film nous réserve d'autres coups de théâtre, puisqu'environ 20 minutes avant la fin, l'une des intervenantes émet une hypothèse, qui nous conduit à regarder la suite (et à repenser à ce qui a précédé) sous un autre jour. Jusqu'où le faux se substitue-t-il au vrai, dans l'histoire de l'arnaque comme dans la mise en scène du film ?
Notons aussi que, dans cette dernière partie, la vision devient plus africaine. On cherche à nous faire passer un autre type de message... mais, bon, faire porter quasi systématiquement la responsabilité des malheurs de l'Afrique aux méchants Occidentaux finit par lasser. (J'ai quand même apprécié ce jugement indirectement favorable à la démocratie française, quand l'un des arnaqueurs évoque les conséquences -très- différentes pour celui qui agresse un président, selon que celui-ci soit français ou congolais...)
Le film n'en demeure pas moins fort intéressant à suivre, assez malicieux, plein d'inventivité. Il propose plusieurs niveaux de lecture et dégage une assez belle énergie.
P.S.
Les spectateurs français relèveront bien entendu les noms donnés aux chiens : Macron et Trump, le premier étant tout doux, le second plutôt agressif.
P.S.
A lire, en plus de l'article du Monde auquel mène le lien situé au début du billet, un très beau photo-reportage publié en 2020 sur le site du quotidien suisse Le Temps.
17:52 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france
vendredi, 16 juin 2023
Marcel le coquillage
Sous ce titre un brin franchouillard se cache un drôle de film américain, mêlant prises de vue réelles et images de synthèse, une animation image par image de coquillages humanoïdes : l'ouverture de la coquille est occupée par un gros œil unique et, sous celle-là, deux grands pieds munis de baskets permettent aux personnages de se déplacer. J'ajoute qu'ils parlent comme des humains et qu'une bouche est dessinée sur leur coquille.
Marcel et sa grand-mère vivent dans une maison à moitié abandonnée. Le couple de propriétaires s'est séparé, mettant ensuite la demeure en location. Les occupants ne se bousculent pas et ne font guère attention à ces étranges coquillages, qui ont développé d'ingénieux stratagèmes pour se déplacer au quotidien dans la bâtisse (et à l'extérieur de celle-ci), sans éveiller les soupçons des humains de passage.
... jusqu'à ce que débarque Dean, cinéaste amateur qu'une douloureuse rupture a poussé à changer de domicile. Il s'intéresse à ce qui se trouve autour de lui et découvre les mini-squatteurs. Il décide d'en faire le sujet d'un reportage, et de le mettre en ligne.
Cela devient particulièrement cocasse, parce qu'à travers cette histoire, l'auteur pointe les travers de la société des médias et des réseaux sociaux, en particulier le culte du paraître et l'activisme faussement compassionnel de nombre d'utilisateurs compulsifs de la Toile.
L'histoire prend une épaisseur supplémentaire quand Dean se retrouve impliqué. Au départ, il souhaite rester en dehors du film (de l'image), n'étant qu'un témoin (supposé) impartial. Mais cette situation ne peut perdurer, d'abord parce que l'humain est parfois amené à aider les coquillages, ensuite parce qu'il interagit de plus en plus avec Marcel et sa grand-mère, se dévoilant peu à peu. Des deux côtés, les personnages se livrent. C'est assez émouvant.
L'intrigue ne se limite pas à la maison. Marcel et son humain de compagnie partent à l'aventure, une fois, pour tenter de retrouver la famille coquillages, embarquée par inadvertance par un ancien occupant des lieux. (On ne se méfie jamais assez des tiroirs à chaussettes...)
Pendant un instant, on pense que la communauté des internautes (plusieurs millions de visiteurs sur le site de Dean !) va permettre de retrouver le couple séparé. La solution viendra plutôt de... journalistes de l'émission 60 minutes, un célèbre magazine de reportages américain (l'équivalent de notre Envoyé spécial)... et, accessoirement, le programme télévisé préféré de Marcel et de sa grand-mère. (Où l'on découvre que les coquillages regardent la télévision !)
L'histoire n'est pas si originale que cela, mais l'animation est très ingénieuse, la maison regorgeant de recoins où les coquillages ont aménagé ce qui ressemble à de petites maisons de poupées. La réalisation a dû demander un travail de fou !
Comme c'est un film destiné aux enfants, on se dit que cela ne peut pas mal se terminer... et l'on a raison. En tant qu'adulte, on passe aussi un très bon moment, souvent drôle, parfois émouvant.
Je recommande plutôt la version originale sous-titrée (qui me semble meilleure, d'après les extraits que j'ai pu comparer), dans laquelle la voix de Marcel est celle de Jenny Slate, la cocréatrice du personnage, avec Dean Fleischer-Camp. (Ils se sont rencontrés sur le tournage du premier court métrage évoquant Marcel... et se sont séparés quelques années plus tard. Il n'est pas impossible que la rupture entre les propriétaires initiaux de la maison, au début de ce film, ne soit une allusion à cet épisode de la vie personnelle du réalisateur.)
P.S.
La version originale comporte quelques effets supplémentaires. Le personnage principal est désigné avec une expression comportant une assonance : « Marcel the Shell ». Parmi les jeux de mots, je relève celui en rapport avec la chambre du coquillage : bedroom devient breadroom, Marcel se couchant entre deux tranches de pain de mie...
17:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 12 juin 2023
Spider-Man : across the spider-verse
Quatre ans et demi après New Generation (visible pendant encore quelques jours sur MyTF1), la suite des aventures animées du jeune Spider-Man afro-américain nous est proposée... sauf que l'histoire commence dans l'univers (alternatif) de (la délicieuse) Spider-Gwen... et c'est excellent. (La rencontre avec un drôle de Léonard de Vinci vaut son pesant de plumes de vautour...) Bien évidemment, par la suite, on va retrouver Miles Morales, dans un univers new-yorkais teinté de graff et de rap...
Visuellement, c'est encore plus impressionnant que dans le premier film. On retrouve, magnifiée, la texture des différentes versions des comics, avec, des incrustations (souvent cocasses), un rythme de fou et des plans très imaginatifs. On retombe aussi sur le même défaut de forme : la représentation un peu brouillée, voire floue, d'une partie des décors situés à l'arrière-plan. Peut-être faut-il y voir le signe que le personnage principal de la scène ne se trouve pas dans son univers.
Dans ce domaine, scénaristes et réalisateurs ont poussé le bouchon très loin : il est matériellement impossible à un spectateur de compter le nombre de versions différentes de Spider-Man que l'on croise dans ce film. Il y a bien sûr celles qui étaient présentes dans le précédent opus, mais aussi quantité d'autres : le leader du multivers, Miguel, une Spider-Woman motarde et enceinte, un Spider-Punk (anarchiste), un Spider-Papa, un Spider-Robot, un Spider hindou (hallucinante séquence dans Mumbattan, version indienne d'un Manhattan tropical), des Spiders obèses, une autre islamiste... et même un Spider-Cat et un Spider-Dino ! Cela devient parfois complètement dingue... et j'aime ça !
L'intrigue est pleine de rebondissements, les gags fusent à intervalle régulier. On ne s'ennuie pas un instant, même si le spectacle me semble plutôt destiné à des adolescents. Le jeune héros (15 ans) est particulièrement mis en valeur. Il est désormais capable de battre tout le monde et c'est lui qui semble avoir raison contre tous les adultes. (Là, on sombre dans la démagogie.) De la même manière, les rapports parents-enfants sont quasi systématiquement présentés du point de vue des personnages adolescents.
C'est l'une des rares limites de ce long-métrage fou fou fou... qui s'achève sur un coup de théâtre... et donc un cliffhanger : à l'image de ce qu'on a pu voir récemment dans Fast & Furious X, Les Trois Mousquetaires... et bientôt dans Mission impossible, l'histoire a été découpée en deux parties. J'ai hâte de voir la suite.
20:17 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
L'Ile rouge
Cette île est Madagascar, en 1972. Le rouge y est la couleur d'une partie des terres... mais c'est aussi celle du sang et de la colère, qui couve dans les familles d'expatriés comme chez les Malgaches.
A partir de ses souvenirs familiaux (il est l'un des fils d'un sous-officier de l'armée française en poste en Afrique du Nord puis à Madagascar), Robin Campillo a tenté de construire une fiction entremêlant l'histoire familiale et celle, politique et sociale, de l'ancienne colonie française (indépendante depuis 1960).
Par les yeux de Thomas, dernier enfant d'un couple formé d'un adjudant et de son épouse, mère au foyer, nous découvrons les relations entre les adultes, français entre eux ou français et malgaches. L'esprit de l'enfance baigne cette partie de l'histoire : Thomas aime se cacher dans une petite cabane en bois, où personne ne fait attention avec lui. Il aime aussi jouer par terre... et lire les aventures de Fantômette, qu'il partage avec une camarade de classe sans doute d'origine indochinoise. Je me suis (en partie) retrouvé dans ce portrait d'enfant rêveur, qui ne comprend pas comment fonctionne le monde des adultes.
En sous-texte, on nous suggère que cette période a influé sur l'identité du garçon. La justicière masquée devient son modèle. L'un des moments-clés est celui au cours duquel sa mère (bien interprétée par Nadia Tereszkiewicz) lui remet une paire de collants noirs, pour que son déguisement soit plus conforme au personnage. La musique souligne un peu trop cet épisode, pour qu'on comprenne bien qu'à partir de ce moment-là, Thomas ne sera plus le même petit garçon. La mise en scène insiste aussi lourdement sur le fait que presque tous les couples hétérosexuels que Thomas observe sont des échecs, soit en raison de la mésentente, soit en raison des circonstances, qui finissent par séparer celles et ceux qui se sont aimés ou qui croient s'aimer.
Ce n'est de plus pas toujours bien joué. Certains dialogues manquent de naturel ou sont trop littéraires (notamment quand les enfants s'expriment). Certaines scènes m'ont paru bancales... peut-être les acteurs ont-ils été mal dirigés. Je pense en particulier à une soirée dansante, au cours de laquelle les messieurs vont se déhancher (voire plus) avec d'autres femmes que leurs épouses. La scène a évidemment pour but d'illustrer le fossé qui se creuse au sein du couple formé par les parents du héros. Mais Dieu que tout cela semble artificiel ! J'ai eu la même impression au cours d'une des scènes de la dernière partie, au mess des officiers, la nuit.
C'est pourtant au cours de cette même séquence que le film rebondit... et prend une nouvelle direction. Alors que, jusqu'à présent, il était centré sur la base militaire et les tensions familiales, il passe désormais du côté malgache, les comédiens s'exprimant dans leur langue maternelle. Au début, j'ai trouvé cela très bon. Le dialogue entre le soldat responsable du mess et l'employée chargée des parachutes est rafraîchissant, incisif, mais il arrive bien tard. La fin du film verse dans le militantisme sans nuance. Pour bien la comprendre, il faut se rappeler que l'année 1972-1973 fut une période de tension, qui aboutit à un changement de gouvernement et à la renégociation des accords de coopération entre la France et Madagascar. Les troupes françaises perdent la base de Diego-Suarez et sont obligées de quitter le pays. Tout ce contexte ne nous est pas clairement expliqué. On a juste droit au rappel du passé colonial (notamment celui des massacres de 1947), mais cela arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et l'on a clairement l'impression de ne plus être dans le même film.
01:13 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 11 juin 2023
L'Improbable Voyage d'Harold Fry
Harold Fry est à la retraite, habitant une banlieue de classe moyenne dans le Devon, le sud-ouest de l'Angleterre. Ancien employé modèle d'une brasserie, il s'emmerde, sans trop savoir quoi faire de ses journées, entre son épouse Maureen, obsédée par la propreté, et ses voisins entretenant méticuleusement leur jardin. Un jour, il reçoit une lettre d'une ancienne collègue de travail, Queenie, qu'il n'a pas vue depuis des années. Elle est atteinte d'un cancer, en phase terminale. Elle est seule dans un établissement de soin. Sur un coup de tête, il décide d'aller la voir, à pieds, en le lui faisant savoir, pour qu'elle tienne le coup jusqu'à son arrivée.
Le problème est que l'hôpital où Queenie est soignée se trouve à Berwick-upon-Tweed, à la frontière écossaise... C'est donc à un périple de plus de 800 kilomètres qu'Harold se condamne, lui qui, au quotidien, marche très peu. De surcroît, s'il a avec lui ses papiers d'identité et ses cartes de crédit, il n'a pas pensé à se munir de chaussures adéquates. On pense qu'il a voulu éviter de retourner à son domicile et d'y croiser son épouse avant de partir, pensant (à raison) que celle-ci aurait tout fait pour l'en empêcher.
En voyant ce film, on ne peut pas ne pas penser à Sur les chemins noirs et à cette tout aussi improbable traversée de la France métropolitaine par Sylvain Tesson. Dans les deux cas, c'est un homme diminué qui tente d'accomplir cet exploit pédestre. Dans les deux cas, la démarche individuelle s'accompagne de la (re)découverte de la campagne locale et d'une réflexion philosophique, voire spirituelle. Ce n'est pas pour rien que, dans la version anglaise, le film contient le mot pèlerinage (pilgrimage). Même si Harold se dit non-croyant (surtout au début), la lumière qu'il découvre petit à petit, dans la nature comme chez nombre d'humains, semble le rapprocher d'une forme de mysticisme.
Mais, au quotidien, ce sont d'abord les difficultés du héros que l'on remarque. Entre les problèmes d'alimentation, d'hygiène, de santé (celle de ses pieds en particulier), la vie n'est pas rose pour notre néo-randonneur. Heureusement pour lui, il tombe régulièrement sur de bons samaritains (une doctoresse slovaque, un jeune en recherche, des jardiniers qui laissent une partie de leur production à disposition des passants...) et même un chien errant.
Cette marche est aussi l'occasion pour Harold de gamberger. C'est d'abord une méthode pour soutenir et supporter l'effort, sur une longue distance. Dans un premier temps, il essaie des ritournelles, notamment pour garder le rythme. Assez vite, ses pensées intimes l'assaillent. Tout ce qu'il refoulait depuis des années revient à la surface. (C'est d'ailleurs l'un des intérêts d'une marche longue : laisser son esprit dériver et se purger progressivement de tout ce qui nous mine.)
On découvre que ce qui semblait être au départ une belle histoire, un peu folle, a un arrière-plan moins reluisant. Harold n'a pas été un époux exemplaire et il ne s'est pas bien occupé de son fils. On finit aussi par apprendre quelle était la nature de sa relation avec cette Queenie et pourquoi il s'est vraiment lancé dans cette entreprise.
Dans le rôle principal, Jim Broadbent (vu l'an dernier dans The Duke) est une fois de plus formidable. Il faut aussi saluer la composition de Penelope Wilton (vue notamment dans Downton Abbey), qui a la rude tâche d'incarner l'épouse, présentée d'abord plutôt comme la gêneuse, l'ennuyeuse, avant que l'on ne voie les choses un peu plus de son point de vue. (Cela donnera peut-être lieu à un autre film, puisque Rachel Joyce, auteure du roman qu'elle a adaptée pour ce long-métrage, a aussi écrit les pérégrinations de Maureen.)
C'est d'abord drôle, puis rafraîchissant, inspirant, enfin surtout émouvant. Je recommande vivement... et je signale à celles et ceux qui ont lu le roman que, d'après certaines spectatrices de la salle où je me trouvais, la fin a été modifiée.
09:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 10 juin 2023
Les Gardiens de la galaxie 3
Six ans après la sortie du deuxième volet des aventures de la plus barjot des équipes de super-héros marvelliens, Disney se décide à conclure la franchise, en en gardant toutefois un peu sous le coude. (La seconde scène post-générique, placée au bout du bout, nous informe que l'un des personnages principaux sera de retour sur nos écrans.)
Les ingrédients sont les mêmes : de la bonne zique, des effets spéciaux bluffants et des traits d'humour qui ne visent pas la plus grande subtilité... pour mon plus grand plaisir. (Outre les querelles de gamins entre les protagonistes, je recommande tout particulièrement la discussion qui porte sur les images, les métaphores... et qui se conclut de manière inattendue.)
La grande nouveauté de cet opus est l'entremêlement de deux histoires, celle qui se déroule sous nos yeux et celle qui a eu lieu des années auparavant : la jeunesse de Rocket, le putois blaireau supporteur de foot raton-laveur. A l'écran, l'animation est superbe. Mais c'est surtout poignant avec, en sous-texte, la dénonciation de la vivisection.
L'humour et la gloriole sont plutôt réservés à la trame contemporaine. C'est éblouissant, parfois excessif, avec pas mal d'invraisemblances : certains protagonistes devraient mourir à plusieurs reprises et le super-méchant, invincible au départ, finit quand même par être défait, de manière presque anecdotique. (Les scénaristes ont peut-être voulu suggérer qu'il a surtout été vaincu par sa démesure, son hybris.)
Sur le fond, il est toujours question de famille, celle que forme une bande de potes (on en voit plusieurs dans ce film-ci)... et celle que des adultes peuvent créer avec des enfants qui ne sont pas les leurs. C'est beau, à ceci près que les gamins qu'on emmène voir ce film (si l'on accepte de les soumettre à quantité d'actes violents et de morts brutales) n'auront aucune idée de la manière dont, dans la vraie vie, les bébés naissent. La plupart des enfants du film sont des créatures de laboratoire (préfiguration de qui attend nos lointains descendants ?). La pudibonderie de Disney (qui bannit, dans ses productions grand public, tout ce qui peut renvoyer au sexe) rencontre ici l'esprit "éveillé" et évite de faire la promotion de la famille traditionnelle, fondée par un couple hétérosexuel : les deux histoires d'amour cisgenre qui pourraient trouver ici leur conclusion heureuse sont détournées de leur trop prévisible destin. (En revanche, j'ai bien aimé la blague que fait la télépathe Mantis à cette grosse brute de Drax.)
C'est aussi l'occasion de souligner que cette superproduction nous propose de beaux personnages féminins : Mantis bien sûr, mais surtout Gamora et Nebula. J'ajoute que, dans ce volet comme dans les précédents, on a inséré quelques invités-surprises, comme Nathan Fillion (eh oui, Castle !) et Sylvester Stallone (de retour).
J'ai passé un très bon moment.
15:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Dernière nuit à Milan
On dirait que la saison des polars estivaux est un peu en avance, cette année... et, cette fois-ci, au lieu de l'Espagne ou du Moyen-Orient, c'est l'Italie qui s'y colle.
Cela commence par de superbes vues nocturnes de la ville. Milan est dotée d'un beau patrimoine architectural, mais c'est aussi une métropole, avec ses gratte-ciel. Du coup, l'impression est ambiguë : c'est beau et labyrinthique à la fois... et chacun sait qu'au cœur d'un labyrinthe se cache une menace mortelle.
La musique, un brin glaçante, contribue elle aussi à planter le décor, alors que, pourtant, l'ambiance est plutôt à la fête, ce soir-là : un policier chevronné est sur le point de partir à la retraite (à 53 ans) ; sa jeune épouse et ses amis lui préparent une fête surprise... mais il est en retard. Il convient d'être très attentif à ce début, puisqu'à l'issue d'un petit retour en arrière, on va revoir les principaux plans de cette séquence, mais sous un autre angle. C'est assez brillant.
La partie "truandesque" est elle aussi bien troussée. Les personnes qui l'ignorent découvriront qu'il existe une mafia chinoise à Milan... et qu'elle a une concurrente philippine ! (Qui osera dire après cela que les immigrés extra-européens rechignent à adopter les coutumes de leur pays d'accueil ?) Quelques-uns des personnages, certes caricaturaux, sont vraiment hauts en couleurs.
La situation va déraper parce qu'une "commission" sans risque, qui devait ne durer qu'une heure, va évidemment mal tourner. Elle va mal se passer pour les policiers, pour les employés du mafieux... mais aussi pour les auteurs de l'arnaque. La situation devient délicieusement inextricable. On se demande comment le héros va pouvoir s'en sortir. Je laisse à chacun le loisir de découvrir comment l'auteur (scénariste et réalisateur) Andrea di Stefano a bouclé son histoire.
Je dois toutefois mettre un bémol à mon enthousiasme. Je trouve que l'un des personnages principaux, celui de l'épouse du policier, est caricatural au possible. Le cinéaste prétend avoir choisi Linda Caridi en raison de sa capacité à improviser. A l'écran on remarque surtout son physique impeccable. Elle est chargée d'incarner la seconde épouse du héros (divorcé de la première). Elle semble à peine plus âgée que la fille du policier... et assez superficielle. Elle est attirée par tout ce qui brille (de belles fringues, un bel appartement, un gros diamant...) et est au comble du bonheur quand son compagnon lui dit qu'elle est belle. Pour caractériser une Italienne du XXIe siècle, on pourrait s'attendre à un peu plus de fond... (Mais c'est conforme à une certaine vision traditionnelle -machiste- des polars.)
Cette (grosse) réserve émise, je recommande le film, tout en tension et émotions, une plongée de deux heures quasiment sans temps mort.
09:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 22 mai 2023
Umami
Je n'avais jamais entendu parler de cette supposée cinquième saveur (avec le sucré, le salé, l'acide et l'amer), propre à la cuisine nippone. Par curiosité, j'ai donc tenté l'aventure de ce film franco-japonais, servi par une distribution prestigieuse : outre Gérard Depardieu, on croise Sandrine Bonnaire (qui incarne la seconde épouse du chef étoilé), Bastien Bouillon (le fils aîné), Antoine Duléry (l'amant), Zinedine Soualem (le commis de cuisine) et Pierre Richard (le meilleur ami, parrain du deuxième fils).
Le début n'est pas très engageant. A une brève scène japonaise succède un retour en arrière dans lequel on découvre un chef cuisinier reconnu mais déprimé, qui a perdu goût à la cuisine comme à la vie. Il se montre odieux pour son entourage. Dans le rôle, on se demande si Depardieu n'est pas dirigé de manière à suggérer le décalque autobiographique : derrière le cuisinier se cache le comédien de renom, qui a connu la gloire, l'amour et l'argent, mais a perdu l'entrain de sa jeunesse. Depardieu fait du Depardieu, mais il est mieux dirigé que dans les films de la bande à Groland auxquels il a participé. Néanmoins, on se lasse vite de cette énième représentation de l'acteur massif, grossier personnage, enfant gâté.
Fort heureusement, cela rebondit avec le séjour au Japon (ou ce que l'on croit être le séjour au Japon... soyez attentif à la toute fin de l'histoire, assez malicieuse). La mise en scène prend une certaine ampleur, que ce soit dans la gare de province, dans l'hôtel-capsule (une particularité locale) ou, plus tard, dans la campagne enneigée.
Dès que le personnage principal entre dans le modeste restaurant où travaille son concurrent de jadis, cela devient passionnant. Les acteurs japonais sont très bons. On se prend d'intérêt pour cette TPE familiale, où le cuistot de père travaille avec filles et petites-filles, les hommes plus jeunes semblant étrangement absents.
Cela nous guide vers l'un des thèmes majeurs de ce film : la dislocation des liens familiaux, en France comme au Japon. La préparation et la consommation des repas sont ainsi vus comme des moyens de (re)créer des liens.
C'est beau et parfois cocasse. Depardieu s'est prêté de bonne grâce au jeu du tricycle sur neige, du bain chaud en zone montagneuse, de peignoir en kimono.
J'ai trouvé ce film sans prétention assez revigorant.
P.S.
Les spectateurs aveyronnais seront sensibles à deux détails. A plusieurs reprises, dans le film, on peut voir un petit tableau dont le style fait bigrement penser à celui de feu le maître de l'outrenoir. Quant à Rufus, le meilleur ami du chef étoilé, il ouvre les huîtres qu'il a pêchées à l'aide d'un couteau laguiole.
PS. II
L'une des meilleures séquences fait intervenir une éleveuse de porcs, vraiment atypique. Dans la caractérisation de ce personnage (qui joue du rock pour ses cochons !), je vois comme un clin d’œil à l'image d’Épinal couramment véhiculée à propos des bœufs de Kobé.
22:19 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 20 mai 2023
Sept hivers à Téhéran
Ces sept hivers sont ceux passés en prison par une jeune Iranienne, Reyhaneh Jabbari, avant d'être exécutée pour meurtre. Cette histoire vraie nous est racontée par un documentaire allemand, qui utilise différents types d'images. Certaines sont de notre époque. Ce sont des extraits d'entretiens avec des membres de la famille, d'anciennes codétenues de Reyhaneh et son avocat.
D'autres images ont été tournées au moment de l'affaire (souvent clandestinement), de l'arrestation à la nuit de l'exécution, en passant par le procès. S'y ajoutent des extraits audios (des entretiens téléphoniques entre la jeune femme et sa mère, principalement), des textes lus (ceux des lettres de Reyhaneh) et des films familiaux, datant des années 2000. On y découvre une famille de classe moyenne, pas très religieuse.
Cela nous amène aux deux aspects de l'affaire. D'un côté, il y a l'acte extrême, celui d'une jeune adulte victime d'une agression sexuelle de la part d'un médecin âgé, marié, de bonne réputation. Pour échapper au viol, Reyhaneh poignarde son agresseur, qui meurt de sa blessure. Le problème est que celui-ci est proche des Gardiens de la Révolution, alors que la jeune femme est issue d'une famille jugée trop occidentalisée par les fanatiques du régime.
La première partie du film nous relate les circonstances de l'agression, puis l'arrestation et la première détention de Reyhaneh, soumise à d'énormes pressions de la part de la police. Sans qu'aucune image de violence ne soit montrée, on est submergé par l'indignation, tant ce que subit la jeune femme est injuste.
La deuxième partie raconte le procès, au cours duquel l'accusée espère faire entendre sa version des faits. Malheureusement pour elle, le président du tribunal, islamiste certes par attaché au respect des règles juridiques, est remplacé par un affidé du régime.
La troisième partie évoque le gros de la détention de Reyhaneh et les efforts désespérés de ses proches pour obtenir le pardon de la famille du violeur, seule possibilité pour lui éviter la pendaison. La mise en scène des échanges téléphoniques et de textos est glaçante. On sent le poids des conventions qui pèsent aussi bien sur la famille de la condamnée que sur celle de la victime du coup de couteau. C'est aussi le moment où, dans les témoignages, on fait intervenir d'autres femmes. Celles-ci évoquent le quotidien de la prison et leur propre histoire, qui révèle l'ampleur des violences que subissent certaines femmes iraniennes. J'ai encore la nausée rien qu'en repensant à celle que son père a laissée entre les mains d'un ami, pour qu'il abuse d'elle dans sa propre chambre... (Cette partie m'a rappelé un autre formidable documentaire carcéral, Des Rêves sans étoiles, sorti en 2017.)
C'est un film très fort, que j'ai trouvé particulièrement dur à supporter dans sa première demi-heure. Mais il nous permet de découvrir, a posteriori, le tempérament d'une jeune femme intelligente, indépendante, dont la vie a été écourtée par un régime barbare.
23:25 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, femmes, femme
vendredi, 19 mai 2023
Vroum Vroum X
Et c'est parti pour une séance pop-corn... avec toutefois peu de sucreries au maïs dans la salle, puisque la projection était en v.o. sous-titrée. (Je me suis laissé dire qu'après une séance de ce film en VF, la salle avait besoin d'un copieux nettoyage...)
Deux ans après ce que j'ose à peine nommer le "neuvième opus", revoilà donc la "famille" Toretto à l’œuvre, mettant en pratique les cinq B : Bagnoles, Barbecues, Bastons, Biceps et Bimbos.
Côté bagnoles, on est servi, avec une ribambelle de cascades, hélas de plus en plus chargées d'effets numériques. Les dizaines de cascadeurs sont salués (assez tôt) au générique, mais on comprend que les sociétés de FX ont pris le dessus.
Une fois qu'on a laissé son cerveau au vestiaire (indispensable pour ne pas être irrité par l'indigence des dialogues, l'invraisemblance de certaines situations et la médiocrité du jeu de nombreux acteurs), on peut, dans une grande salle, profiter du spectacle. En quelque 2h20, on en a pour son argent.
Cela commence par une attaque de banque, une version remaniée de ce qui a été vu dans FF V. L'action se situe donc dans le passé (ce qui permet de montrer la source de la vengeance). Franchement, les tribulations du coffre et la conclusion sur le pont sont assez ébouriffantes. Un peu plus tard, on est aussi cueilli par un autre retour en arrière, qui permet de comprendre pourquoi une méchante des précédents épisodes (Charlize Theron... mmm) apporte son aide à Dom. La baston qui oppose la redoutable donzelle à une bande de soudards vaut son pesant de coups de pied dans les roubignoles.
Mais la meilleure séquence est, pour moi, celle de Rome, une véritable tuerie, qui s'achève elle aussi sur un pont. Le montage est nerveux, la succession des péripéties pas très crédible, mais c'est mis en scène avec un certain panache. Il faudra attendre la dernière partie du film et la séquence au Portugal pour retrouver ce talent, notamment dans une poursuite sur autoroute. (Mais les amateurs de plaisirs interdits goûteront particulièrement une lutte acharnée entre deux teigneuses bien roulées.)
Entre temps, il faut se fader des dialogues insipides, un jeu très stéréotypé et une apologie de certaines valeurs traditionnelles... eh oui, derrière un rutilant habillage pseudo-rebelle se cache une mentalité très traditionnelle. C'est donc un film d'action à conseiller à tous les réacs, d'autant que son bilan carbone doit être désastreux !
Du côté des acteurs, rien de nouveau sous le soleil. Vin Diesel parle peu, mais ce peu est déjà trop. Les vrais acteurs qui l'entourent ne sont guère meilleurs, soit que leurs répliques soient pourries, soit qu'ils en fassent des tonnes. Il ne suffit pas d'avoir un bon dentiste et d'avoir passé des centaines d'heures sur un banc de musculation pour être crédible. L'introduction de Jason Momoa (entre deux séances d'aquagym) est décevante. Le comédien s'est visiblement éclaté dans son rôle de psychopathe, mais c'est tellement outré que ça devient pathétique.
Avis aux amateurs : la fin n'est pas la conclusion de l'histoire. On nous a annoncé que, pour terminer la franchise, trois films seront nécessaires. La scène qui interrompt le générique de fin nous informe du retour de Hobbes (Dwayne Johnson, plus musclé que jamais), tandis que le dernier quart de l'intrigue voyait débarquer Shaw (Jason Statham, qui fait du Statham). Helen Mirren et Gal Gadot font un petit coucou.
Au-delà des performances physiques et techniques, l'histoire manque globalement d'humour. Les deux associés afro-américains de Dom sont censés introduire des moments de détente, la plupart du temps ratés (car surjoués). Un seul m'a fait sourire : quand Roman, pour expliquer un acte intelligent de sa part, signale qu'il a beaucoup réfléchi, son compère déclare comprendre pourquoi cela sentait le grillé...
Si l'on a déjà goûté à ce genre de meringue, on peut apprécier. Sinon, il vaut mieux passer son chemin.
23:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 17 mai 2023
Jeanne du Barry
Opération casse-gueule pour Maïwenn, qui s'est lancée dans un film en costumes, avec un comédien anglophone dans le rôle de Louis XV. Elle sait sans doute que les haineux du net (ainsi que certains « cultureux ») l'attendent au tournant, qu'elle se soit plantée ou pas.
Le début m'a fait un peu peur, avec cette voix-off trop présente. (Cela se calme par la suite.) Toutefois, l'actrice qui incarne la jeune Jeanne Bécu est convaincante (à tel point que je me suis demandé s'il n'aurait pas été possible de la garder pour tout le film), la ressemblance avec Maïwenn étant frappante.
Celle-ci (en tant que réalisatrice) évite plusieurs écueils, comme la tentation de la reconstitution historique plate (même si certaines scènes n'en sont pas loin) et le film militant (féministe) anachronique. Cela n'empêche pas la réalisatrice de glisser, ici ou là, quelques remarques sur la situation des femmes dans cette société patriarcale. Pour sortir de sa condition, Jeanne est devenue pute de luxe courtisane... Sa grande beauté, ajoutée à son habileté à mettre en action les bourses d'hommes riches et puissants, va lui procurer une forme d'ascension sociale.
Le film se concentre sur la liaison entre Jeanne et un Louis XV vieillissant. Je nourrissais quelques craintes concernant l'interprétation de Johnny Depp. Je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, tout comme Maïwenn. Elle est évidemment trop âgée pour le rôle (celui d'une femme de 25-30 ans) et elle est d'une beauté moins classique que l'authentique comtesse du Barry. Mais elle a l'énergie nécessaire à son personnage et m'est apparue totalement crédible dans le rôle d'une maîtresse attachée au roi, à son page Zamor, ainsi qu'aux arts et lettres.
Parmi les seconds rôles, je distingue Benjamin Lavernhe, piquant et distingué en Laborde, le premier valet de chambre du roi. Ses interactions avec la du Barry sont pleines de sous-entendus. On sent les deux comédiens complices. En revanche, je regrette le choix d'un acteur "beau gosse", doté d'une chevelure digne d'un étudiant en philo, pour incarner le futur Louis XVI.
Au niveau de la mise en scène, c'est inégal. Des scènes plan-plan alternent avec d'autres, plus enlevées. J'ai particulièrement aimé celles qui décrivent l'arrière-cour de Versailles, de l'examen gynécologique de la future favorite aux relations avec la dauphine (Marie-Antoinette).
Du coup, je recommande plutôt. Sur un plan strictement cinématographique, c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais et les scènes tournées à Versailles même sont assez jolies.
21:30 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, france
samedi, 13 mai 2023
Mad God
Réalisé image par image, ce film d'animation est un vieux projet de Phil Tippett, un spécialiste des effets spéciaux qui a œuvré à ceux de la deuxième trilogie de Star Wars, de Jurassic Park et de Starship Troopers, entre autres.
En à peine 1h20, il nous propose sa vision d'un monde post-apocalyptique (sans doute victime d'explosions atomiques), d'où les humains tels que nous les connaissons ont presque disparu, la planète étant majoritairement peuplée de monstres, soit créés par les radiations nucléaires, soit issus d'étranges machines.
La découverte de ces mondes (car il y en a plusieurs, tels les cercles de l'Enfer de Dante) nous est proposée à travers le parcours d'un étrange soldat, soigneusement carapaçonné, et qui semblerait voué à une mission d'observateur s'il ne tenait pas tant à une étrange mallette, dont le contenu reste longtemps mystérieux.
Envoyé de la strate supérieure, le soldat plonge au cœur des mondes souterrains, où les créatures de base vivent une existence brève, victimes d'un prédateur ou tout simplement du fonctionnement industriel de leur société. C'est sombre, sale et parfois saignant. On y vomit, on y chie, on s'y nourrit... certains fluides corporels semblant interchangeables. (J'ai souvent pensé à l'excellent Junk Head, que j'ai trouvé moins crade.)
Derrière ce tableau peu réjouissant perce une critique de notre société, partagée entre dominants et dominés, ces derniers menant une vie brève et surtout peu enthousiasmante.
Le film prend une tournure surprenante quand l'infiltré devient à son tour une proie. A l'écran, cela devient encore plus macabre, alors qu'on nous livre des explications supplémentaires sur le monde dont vient le soldat. Il serait dirigé par le "dernier homme", un savant fou qui envoie ses créatures explorer le monde d'en-bas, qu'il a contribué à détruire.
La troisième partie prend une nouvelle direction. On quitte le personnel médical indigne, qui triture ses patients, pour suivre un étrange duo, composé d'un être supposément féminin, à demi éthéré, et d'une sorte de Quasimodo, son homme monstre à tout faire. On met du temps à comprendre ce à quoi un bébé est destiné. La fin semble peut-être indiquer que ce que la Terre est devenue n'est pas digne de ce qu'une civilisation extra-terrestre avait projeté d'en faire, à l'origine...
... mais je conseille de ne pas chercher à tout relier de manière rationnelle. Au bout du bout, le cinéaste nous fait comprendre qu'il se fout un peu de notre gueule !
Le spectacle qu'il propose n'en est pas moins étonnant, avec de superbes décors, un gros travail sur le son et des personnages animés "faits main" très expressifs.
22:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 02 mai 2023
Ma Langue au chat
Un groupe d'adultes se réunit dans une maison de campagne, dans le Sud de la France. On est sur le point de fêter l'anniversaire du maître de maison, un universitaire parisien quinquagénaire, époux d'une "mère à son chat". Sont présents le frère de celle-ci (et son épouse), un ami de la famille (motard), un couple formé d'un écrivain et d'une commerciale geek et l'unique employée de la "mère à son chat"... sans oublier la voisine, masseuse new age.
Potentiellement, les éléments de comédie sont nombreux. Le début n'est pas mal, avec la présence du chat, très docile... et fureteur. Mais l'on comprend très vite que la caractérisation des personnages ne va pas jouer sur la subtilité. Ils sont tous antipathiques, à des degrés divers. Ils se mentent entre eux et se mentent à eux-mêmes.
On comprend sans peine que la disparition du chat sert de catalyseur aux mensonges et aux frustrations. La belle unité de façade va rapidement voler en éclat. Dans le lot, il y a bien quelques scènes réussies, comme celle qui voit l'époux renoncer à dénoncer le tueur présumé du chat, celui-ci lui faisant comprendre, à l'aide d'un miko, qu'il a de quoi lui pourrir la vie... J'ai aussi bien aimé quand cela part un (tout petit) peu en vrille, dans le dernier tiers de l'histoire.
Sinon, l'ensemble est globalement décevant. Je ne me suis pas attaché aux personnages. J'ai eu l'impression de voir un énième film choral (à la Canet).
Ce n'est pas la pire comédie française actuellement sur les écrans, mais elle est tout aussi dispensable que les autres.
13:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 01 mai 2023
Misanthrope
- Dis donc, mon Riton...
- Oui, très chère ?
- Tu ne me ferais pas une petite crise existentielle ?
- Comment cela ?
- Eh bien, récemment, tu n'es pas parvenu à réellement trancher à propos du film L’Établi, tu m'as semblé sensible à la tentation de la fuite dans Sur les chemins noirs, tu es nostalgique des "vieux" épisodes de NCIS... et voilà que tu es sur le point d'écrire l'éloge d'un film dont au moins deux des personnages principaux sont asociaux, l'un d'eux se révélant même criminel !
- C'est pas faux... même si sur L’Établi, j'ai quand même tranché ! Dans Misanthrope, c'est plus l'ambiance que les personnages que j'ai appréciée.
- Comment cela ?
- C'est un thriller un peu poisseux, sombre, bien réalisé (par Damián Szifron, l'auteur des Nouveaux Sauvages), bien photographié... et qui dit deux-trois choses intéressantes sur notre époque... enfin, sur le monde des citadins d'une grande ville d'un pays développé (Baltimore, aux States).
- Ne me dit pas que tu n'as pas été sensible au charme de Shailene Woodley (Divergente) !
- Elle n'est pas désagréable à regarder, de surcroît dans un style assez sobre. Son rôle (celui d'une policière de base, refusée par le FBI, célibataire, ex-droguée...) est plutôt cérébral.
- Avoue que tu as bien aimé son côté asocial !
- Oui, mais, quand on a vu quantité de films, notamment des polars, on ne trouve plus cela très original... d'autant qu'autour d'elle la production a bâti un univers très "politiquement correct" : des policiers (de base comme gradés) afro-américains, un enquêteur homosexuel, la dénonciation des suprémacistes blancs... le tout mené par une petite bonne femme qui vit avec son chat ! Serait-ce le premier thriller woke ?
- Ben alors, pourquoi tu as aimé ?
- Je l'ai déjà dit : c'est bien foutu sur le plan visuel ; le scénario est intrigant (Qui est ce tueur hyper-doué et pourquoi tue-t-il ?), les dialogues percutants (vu en V.O. sous-titrée) et les comédiens presque tous bons. Faut juste aimer le genre.
- OK. Mais la prochaine fois, tu nous parles d'une comédie !
22:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 30 avril 2023
Sur les chemins noirs
Presque sept ans après Dans les forêts de Sibérie, un autre livre de Sylvain Tesson fait l'objet d'une adaptation cinématographique. J'ai un peu tardé à me risquer dans une salle obscure pour le voir en raison d'une erreur de base concernant la zone qu'il a parcourue à pieds. En effet, dès le début, on nous parle de la « diagonale du vide », une partie de la France métropolitaine à faible densité de population (et où, souvent, elle a tendance à diminuer), qui s'étend de la frontière belge à la frontière espagnole. (Elle est grossièrement délimitée par les traits verts ci-dessous.)
Or, dans le film, le parcours effectué par Pierre (le double de fiction de Tesson) va grosso modo du Mercantour (dans les Alpes) à la pointe du Cotentin, en Normandie. (Il est représenté en tiretés noirs ci-dessus.) Ça plus la tendance au narcissisme de Tesson m'avaient dans un premier temps dissuadé. Mais, comme le bouche-à-oreille est bon et que le parcours passe par la Lozère et le Cantal, voisins de l'Aveyron, j'ai fini par me laisser tenter.
On a beaucoup critiqué l'abus de retours en arrière. Ceux-ci sont surtout présents dans la première moitié du film, dont la trame principale suit l'extraordinaire marche réalisée par Pierre. Je pense que la fréquence de ces flash-back a du sens. Au début, le héros est encore imprégné de sa vie urbaine et des conséquences de son accident, qui lui reviennent souvent en mémoire. Mais, plus il avance, plus il se détache de ce passé récent. Les retours en arrière s'espacent, signe que, peut-être, à la fin de son périple, il ne va pas reprendre sa vie d'avant, ou du moins pas exactement la même. On note que les derniers flashs évoquent des événements cruciaux (la "rupture douce" avec son amie et la chute qui aurait pu être mortelle).
Mais là n'est pas le plus important. Le plus important est ce que l'on voit à l'écran, un homme à demi brisé, orgueilleux, qui reprend goût à la vie dans un cadre superbe, mais parfois rude, celui d'une France rurale, souvent montagneuse, où les sons sont en général ceux de la nature. Dujardin s'impose sans peine à l'écran (même s'il est sans doute physiquement un peu trop empâté pour le rôle). Il a une présence folle et sa belle voix grave (en off) passe très bien. On n'est cependant pas obligé de toujours souscrire au commentaire. (Je pense notamment à l'évocation du loup, au tout début, typique du citadin qui redécouvre la nature. Cela s'améliore par la suite.)
Pierre n'est pas tout le temps seul dans son périple. Il croise des habitants du coin qu'il traverse (une jeune éleveuse, le client d'un café...), un autre marcheur (un djeunse dont il semble très éloigné au départ, mais avec lequel des liens vont se tisser)... et des proches : sa tante (incarnée par Anny Duperey), son meilleur ami (qui l'a rejoint, brièvement) et l'une de ses sœurs (Izïa Higelin, formidable), dans l'une des meilleures séquences du film.
Le marcheur que je suis (bien que moins intensément qu'autrefois) a apprécié le cheminement, souvent difficile, parfois exaltant, du principal personnage. J'ai aussi trouvé plutôt bien mis en scène les moments d'écriture, au fil de la route, sous le coup de l'inspiration.
Il faut voir cela sur grand écran, pour jouir des paysages et s'imprégner de cette marche rurale, qui nous fait prendre un bon bol d'air, loin de la technologie (le héros utilise de classiques cartes IGN). On sort de là apaisé et revigoré.
10:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, france
samedi, 29 avril 2023
L'Etabli
Adapté du livre éponyme du philosophe Robert Linhart, ce film militant nous replonge dans les Trente Glorieuses, juste après les "événements" de Mai 68. L'essentiel de l'action se déroule au sein d'une usine secondaire du groupe Citroën (en plein Paris). Quelques scènes "de respiration" ont pour cadre un appartement bourgeois et un café.
Ce film engagé suscitant des réactions contrastées, j'ai choisi d'en rédiger deux critiques, une de gauche et une de droite.
LA CRITIQUE DE GAUCHE
Mathias Gokalp, brillant cinéaste au talent mésestimé (remarqué jadis pour Rien de personnel), réussit le pari de l'adaptation d'un livre réputé inadaptable. Sa mise en scène habile et percutante ressuscite l'ambiance d'une chaîne de montage et des différents ateliers de l'usine Citroën. S'appuyant sur des comédiens (connus ou inconnus) investis dans leur rôle, il nous embarque dans cette palpitante aventure ouvrière, qui est une aventure humaine, en révolte contre le capitalisme arrogant.
L'intrigue nous fait découvrir de manière assez fouillée le travail manuel en usine, à cette époque. Elle détaille aussi les tensions et les contradictions au sein de la classe ouvrière, entre Français et étrangers, entre immigrés anciens et ceux de fraîche date, entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux. Face à eux, le patronat apparaît dans toute sa vulgarité et sa misogynie, exploitant sans vergogne les classes populaires, mettant en œuvre un racisme systémique dans le monde du travail.
Les scènes de famille (absentes du livre) apportent un utile contrepoint aux péripéties de l'usine. Le réalisateur n'esquive pas le problème du statut de « l'infiltré », évitant de surcroît de faire du héros un homme parfait. Ses doutes et ses faiblesses nous sont présentés sans détour, parfois avec humour. La solidarité dont font preuve certains ouvriers leur permet de contester le joug capitaliste, sans que cela débouche toutefois sur une victoire totale. Mais l'essentiel était bien d'initier le mouvement.
C'est un grand film de société, à projeter dans toutes les écoles pour transmettre à notre jeunesse une vision objective du monde du travail qui les attend.
Comme ce qui est écrit ci-dessus ne correspond que partiellement à ce que j'ai vu sur l'écran, je me dois de compléter ce billet. Voici donc...
LA CRITIQUE DE DROITE
Mathias Gokalp, cinéaste médiocre qui n'est pas parvenu à percer, s'est jeté sur un livre culte de la gauche intellectuelle française pour tenter de relancer sa carrière. De L’Établi, il a modifié la structure et certains éléments clés pour servir un propos outrancier, dont on sent bien qu'il se rapporte plus à la France de 2022 qu'à celle de 1968 ou 1978.
Tout d'abord, parmi la série d'ateliers auxquels le héros a été affecté (d'après le livre), il en est un où l'on ne voit jamais Robert évoluer dans le film : la soudure. En revanche, il travaille au boulonnage/rivetage, à la sellerie et aux balancelles. Cela pourrait se justifier par la volonté d'écourter le film (qui dure déjà deux bonnes heures...) et, peut-être, par la difficulté de filmer un atelier de soudure, surtout avec des comédiens novices en la matière. D'un autre côté, cela conduit le cinéaste à nous présenter l'usine d'abord sous l'aspect du travail à la chaîne, le boulonnage évoquant immanquablement (chez le public cultivé) Les Temps modernes de Chaplin (où le rythme était cependant beaucoup plus élevé que chez Citroën).
Dans tous les cas, il est un détail d'importance qui a été modifié dans le film : la présence de gants. Dans le livre, à presque chaque poste l'ouvrier en bénéficie, alors que, dans le film, leur absence est un motif de revendication... et l'occasion de faire de belles images de « la momie », surnom donné à Robert à partir du moment où on le voit travailler les mains enveloppées dans des bandelettes de tissu.
D'autres éléments ont été tordus quasi systématiquement pour dénigrer un "camp" ou pour en survaloriser un autre. Ainsi, avant de tenter de revenir sur les concessions faites aux syndicats en mai 1968 (en faisant travailler les ouvriers trois quarts d'heure de plus chaque jour, sans augmentation de salaire), la direction de l'usine avait commencé par... réduire le temps de travail, la durée quotidienne passant de 10h à 9h15. (Mais de cela les spectateurs ne sont pas informés.)
La manière dont sont traités les immigrés, certes injuste, est bien plus dégueulasse dans le long-métrage. Le personnage d'un collègue noir de Robert (à la sellerie) est développé pour le film, uniquement pour pour mettre en scène le racisme (supposé) des cadres de l'usine. (Ceux-ci sont d'ailleurs présentés de manière plus nuancée dans le bouquin, même si certains d'entre eux ont droit à des qualificatifs injurieux.) La même tactique est utilisée pour décrire le renvoi de certains de ces immigrés des foyers où ils logeaient, pour briser leur participation à la grève. Dans le livre, ces ouvriers découvrent leurs valises faites à l'entrée, lorsqu'ils retournent au foyer, alors que, dans le film, leurs affaires sont balancées sans ménagement sur le sol, à la sortie de l'usine.
On pourrait aussi discuter de la nécessité de transformer un trio d'ouvriers masculins (yougoslaves) en trio féminin. Certes, cela permet d'introduire des questions intéressantes, mais celles-ci sont presque absentes du livre. (Le réalisateur aurait cependant pu introduire une scène concernant une ouvrière mère de famille, qui se fait bien voir de l'un des cadres. Dans le livre, Robert se montre compréhensif, à l'inverse de certains ouvriers.) Plus grave : pour éviter de nuire à l'image de certains ouvriers africains, le livre passe sous silence l'épisode au cours duquel l'un d'entre eux fait étalage de ses préjugés antisémites devant le héros.
Au final, l'adaptation du livre se rapproche plus d'une fiction de propagande que de la fidèle représentation d'une époque révolue.
vendredi, 28 avril 2023
Désordres
Une vallée située dans le canton de Berne semble être, dans les années 1870-1880, un centre de développement de l'idéologie anarchiste (à travers la Fédération jurassienne). On y croise des Russes, des Français, des Italiens, des Allemands... et, bien sûr, des Suisses, qui travaillent soit dans l'agriculture soit dans l'horlogerie, dominée par une grande entreprise familiale, qui semble quasi omnipotente dans le canton.
Les revendications politiques sont fortes, les tensions sociales intenses... mais tout cela s'exprime de manière feutrée. Ainsi, c'est courtoisement que le policier municipal demande à des militants au drapeau rouge de s'éloigner. C'est avec courtoisie qu'un duo de promeneurs désobéit à un autre policier. C'est tout aussi courtoisement qu'un groupe de militantes chante sa détestation du capitalisme et des patrons âpres au gain. La courtoisie n'est pas moindre quand un chef du personnel annonce leur licenciement à quatre ouvrières en horlogerie... et c'est sans faire de grabuge qu'elles quittent les lieux, après avoir reçu leurs indemnités.
Cela donne un tour quasi surréaliste à certaines scènes, d'une indéniable violence symbolique, mais très policées dans la forme.
... du moins c'est ainsi que je l'ai perçu. Une autre personne présente dans la salle a trouvé que les acteurs jouaient mal, toujours sur le même ton, avec un inconvénient supplémentaire : les scènes de groupe étant filmées en plan large, il faut en général un petit moment pour distinguer parmi les personnages présents quels sont ceux dont on est en train d'entendre le dialogue. Cela a le mérite de forcer les spectateurs à être attentifs à chaque plan. C'est donc un film qui se mérite.
Au centre de l'intrigue se trouvent les montres. La fabrication et la fixation de leurs rouages font l'objet de plans passionnants, tandis que le maintien de la "bonne" heure est l'obsession d'une partie de la population... d'autant que, dans la vallée, selon l'endroit où l'on se trouve, on est soit à l'heure de la gare (et du télégraphe), soit à celle de la fabrique (d'horlogerie), soit à celle de l'église... Il y a plusieurs minutes d'écart entre ces repères, ce qui n'est pas sans conséquence sur le temps de travail des ouvrières... et leur paie !
A l'arrière-plan se trouve le progrès technologique : la mesure du temps se précise et prend une place grandissante dans la vie quotidienne des Suisses, tout comme la photographie, le chemin de fer... et la cartographie. C'est l'activité qu'exerce Pierre Kropotkine, futur idéologue de l'anarchisme, qui découvre la région.
Le film est à la fois passionnant et déroutant, ressemblant parfois à du théâtre filmé.
22:06 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Donjons et dragons
Il y a longtemps, très longtemps, lorsque j'étais plus jeune (et vaillant) qu'aujourd'hui, je me suis risqué dans une salle obscure pour voir la première adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo. J'en suis ressorti fort marri. Porté par un bouche-à-oreille très favorable, j'ai retenté l'expérience, avec une séance en version originale sous-titrée.
Dès le début, j'ai été emballé. Il s'agit de l'arrivée d'un détenu ultra-dangereux dans une prison forteresse. J'ai bien entendu apprécié l'ambiance faite de mélange de Moyen-Age et de science-fiction. J'ai de surcroît été agréablement surpris par le souci du détail, par exemple au niveau de l'emboîtement de la cellule roulante et de la porte d'entrée. A plusieurs reprises, plus loin dans le film, on retrouve ce travail méticuleux au niveau des décors, mais je crois que c'est au tout début que c'est le plus impressionnant.
La suite n'est pas mal non plus, grâce notamment à des effets spéciaux bluffants. On s'y attend à propos des pouvoirs magiques de plusieurs personnages (la sorcière rouge, le jeune magicien et la fée polymorphe) et des animaux fantastiques (dont un dragon obèse, aussi pathétique que redoutable...)... mais ça ne se limite pas à cela.
Les amateurs d'heroic fantasy sont en terrain connu. On ne peut pas ne pas penser au Seigneur des anneaux, mais aussi à Hunger Games, voire à Harry Potter. Au niveau de l'intrigue, on ne s'ennuie pas. Entre les complots, les trahisons, les stratagèmes, les coups de théâtre et les retournements de situation, il y a de quoi occuper l'esprit.
Les acteurs sont plutôt bons, mais le casting est tout de même inégal. Chris Bite Pine cabotine un peu trop à mon goût, tout comme Hugh Grant, mais ils sont bien dans leurs rôles. Quelques autres se prennent trop au sérieux, ou doivent s'adapter à un personnage taillé à la hache. C'est du côté féminin que viennent les bonnes surprises : Michelle Rodriguez, entre deux Fast & Furious, vient jouer la walkyrie de contrebande, Daisy Head est parfaite en sorcière maléfique et la jeune Sophia Lillis est adorable en fée mutante.
Une autre qualité est l'humour dont regorge l'histoire. Quasiment chaque scène est marquée par un trait d'esprit, ou un gag, ou une chute. J'aime que cette grosse meringue numérique ne se prenne pas trop au sérieux. Mention spéciale à la séquence du cimetière.
Notons qu'on a soigné la diversité ethnique de la distribution : la moitié des protagonistes ne sont pas blancs. Ajoutons que l'intrigue regorge de femmes fortes (et mignonnes, faut pas déconner non plus)... avec un peu trop d'hommes faiblards à mon goût. Mon petit doigt me dit que c'est pour complaire au public masculin visé...
Au final, c'est divertissant. J'ai passé un très bon moment.
00:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 26 avril 2023
Hokusai
Le célèbre peintre japonais a enfin droit à son biopic, qui sort chez nous dans un format raccourci (1h30, au lieu d'un peu plus de deux heures dans la version d'origine).
Le film met l'accent sur deux époques : les années 1780, qui voient le futur Hokusai (c'est un pseudonyme) commencer à se faire connaître, et les années 1840, les dernières d'une vie remplie de peintures.
Quelle que soit l'époque, les artistes et les écrivains ont dû composer avec la censure rigoureuse du gouvernement shogunal. On ne s'étonnera donc pas que l'histoire débute par la mise à sac de la boutique du plus célèbre marchand d'estampes tokyoïte de l'époque, celui qui, par la suite (après quelques péripéties), va lancer la carrière d'Hokusai.
Cette introduction a le grand mérite de nous présenter le quartier des peintres et l'organisation de cette confrérie en écoles, chacune soumise à un maître. Le futur Hokusai se fait renvoyer de l'une d'entre elles, pour une raison que je ne dévoilerai pas ici.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas grand chose de la vie du peintre, ce début comporte une part de mystère, puisqu'il n'est, au départ, désigné que sous sa véritable identité : lequel de ces jeunes peintres ambitieux est le futur Hokusai ?
Un autre mérite de ce film est de nous montrer des artistes au travail, au pinceau, en noir et blanc, en couleurs. Dans la seconde partie, on voit même fonctionner en détail un atelier d'impression. C'est instructif et beau à la fois, la mise en scène s'efforçant de s'élever au niveau de son sujet. Certains plans sont de véritables tableaux.
Les spectateurs(trices) du XXIe siècle seront aussi attentifs à la description d'une société patriarcale, où les femmes (adultes) sont soit des épouses soumises soit des prostituées. Je vous laisse imaginer desquelles les peintres se sentent les plus proches...
L'une des exceptions à la règle est la propre fille d'Hokusai, que l'on découvre dans la seconde moitié du film. Bien qu'elle ait déjà eu l'honneur d'un long-métrage animé (Miss Hokusai) il y a quelques années, il est regrettable que son personnage occupe si peu de place.
Dans la seconde partie (plus courte que la première), on retrouve le peintre très âgé, veuf, vivant avec sa fille et conservant des disciples. En dépit de ses problèmes de santé, il continue à peintre. C'est sa raison de vivre.
L'histoire se conclut par un beau parallèle pictural.
P.S.
Dans mon cinéma CGR (à Rodez), j'ai reçu avec mon ticket d'entrée une reproduction de la célèbre Vague :
P.S. II
A celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur la vie du peintre, je conseille la lecture d'un (gros) manga, de Shôtarô Ichinomori :
Toute la vie du peintre y est racontée, sans rien négliger, ni de son caractère, ni de ses difficultés, ni de son goût pour les belles jeunes femmes...
21:10 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (3)
mardi, 25 avril 2023
Les Complices
Le titre de cette comédie macabre franco-belge fait penser aux Compères, de Francis Veber, qui mettait en scène le duo Gérard Depardieu - Pierre Richard. En voyant évoluer François Damiens et William Lebghil (tous deux très bons), on ne peut pas ne pas penser à d'autres associations entre un dominant, plutôt violent (outre Depardieu, il faudrait citer Lino Ventura et Gérard Lanvin) et un dominé, plutôt peureux ou inconscient (comme Jacques Brel, Francis Perrin, Benoît Poelvoorde...).
La nouveauté consiste en la présence d'un troisième élément, une femme, Stéphanie, la compagne de Karim, incarnée avec fougue par Laura Felpin (une découverte pour moi). Ce couple travaille dans une société de télémarketing en immobilier, sous la houlette d'une patronne acariâtre et de cadres méprisants.
De son côté Max (F. Damiens) ne peut plus exercer sa lucrative activité comme auparavant : il est tueur à gages, mais devient allergique à... la vue du sang. A la source de cette pathologie (d'après son médecin) se trouve un événement traumatique... mais pas l'un des assassinats qu'il a perpétrés, non : le fait que son épouse le quitte.
Cela donne le ton de cette comédie sans filtre, bien interprétée. D'un côté, Max doit échapper aux sicaires de la Loutre, l'organisation qu'il veut quitter. De l'autre, les employés téléconseilleurs ont une revanche à prendre sur la société et sont prêts à donner un coup de main au tueur, pour lequel ils se prennent de sympathie... et c'est réciproque.
Nous voilà embarqués dans un drôle de périple, au cours duquel on croise quelques invités, comme Vanessa Paradis (l'épouse) et Bruno Podalydès (l'homme à tout faire de la Loutre, qui réserve quelques surprises).
Cela dure à peine plus d'1h30 et l'on sort de là assez content, d'autant que la scénariste-réalisatrice (Cécilia Rouaud) conclut sur un clin d’œil sympathique.
12:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 24 avril 2023
La Conférence
Le titre de ce film allemand fait évidemment allusion à la Conférence de Wannsee, qui s'est tenue le 20 janvier 1942. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans la banlieue chic de Berlin, une brochette de cadres nazis discute de la déportation et de l'extermination des juifs, prudemment désignées par l'expression « Solution finale ».
Tous les participants sont des nazis convaincus, et ce depuis des années. Mais le film s'attache à montrer que deux profils se détachent : les SS (au premier rang desquels l'organisateur de la conférence, Reinhard Heydrich) et les "secrétaires", membres du gouvernement (et du NSDAP, le parti nazi), qui représentent un ministère, dont ils sont en général le numéro 2. Au contraire de certains SS et des gouverneurs des territoires envahis par le IIIe Reich, ces hauts fonctionnaires sont très diplômés : ils sont allés jusqu'à la thèse, ce qui fait qu'on se donne fréquemment du "Doktor" (ce qui équivaudrait à "Professeur", en français). Il est toutefois nécessaire de préciser que tout ce petit monde a achevé ses études secondaires et que presque tous ces hommes possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur, sans être forcément allés jusqu'à la thèse. De ce fait, ils appartiennent à une "élite" (moins de 5% de la population), et une élite plutôt jeune, qui témoigne de l'adhésion massive des (anciens) étudiants allemands des années 1920-1930 aux idées nazies.
Les dialogues comme les interprètes excellent à nous faire sentir la morgue de ces nazis issus de l'université, à la fois arc-boutés sur les prérogatives de leur ministère et peu désireux de passer sous le commandement de ces brutes de SS, fût-ce pour se débarrasser des juifs. Par rapport au film, j'apporterai toutefois une nuance. Peut-être pour éviter de trop plomber l'ambiance, les scénaristes ont choisi de faire émerger un ou deux profils un peu plus « humanistes » (tout est relatif) que les autres. Je pense au contraire que tous les participants à cette réunion étaient des antisémites forcenés (plus ou moins policés dans leur manière de s'exprimer), que le sort des juifs n'émouvait aucunement.
Cette réunion a donc un fort enjeu de pouvoir. A qui revient de gérer « l'évacuation » et le « traitement spécial » des juifs ? (On notera l'utilisation d'euphémismes quasiment tout au long de la conférence.) L'ambitieux Heydrich (dont il est légitime de penser qu'il espérait succéder un jour à Hitler) veut que la SS (plus précisément le RSHA, l'Office central de la sûreté du Reich) soit maître d’œuvre dans cette opération. Il faut qu'il en convainque les autres participants, en maniant l'efficacité, la flatterie et, éventuellement, la menace. Ce n'est pas pour rien qu'il a à ses côtés son principal adjoint, le chef de la Gestapo, Heinrich Müller (très bien interprété par Jakob Diehl).
Au niveau des arguments "techniques", c'est un autre subordonné d'Heydrich, Adolf Eichmann (dont le rôle a été réévalué par les historiens) qui intervient. Je trouve que le comédien Johannes Allmayer réussit parfaitement à faire ressortir le mélange de technocratie et d'inhumanité qui caractérisait le personnage :
En face, du côté des "secrétaires", c'est le représentant du ministère de l'Intérieur qui se révèle le plus coriace. Ce n'est pas n'importe qui. Wilhelm Stuckart (Godehard Giese, excellent) est l'un des rédacteurs des lois de Nuremberg et, à l'époque du film, il est un peu considéré comme un ministre-bis, que Heydrich ne peut pas se permettre de traiter comme du menu fretin.
Il me reste à dire deux mots de l'interprète principal. Philipp Hochmair est chargé d'incarner le principal protagoniste (Heydrich), à une époque où il devient très puissant, mais quelques mois à peine avant qu'il ne se fasse assassiner. (Merci la résistance tchèque !)
Le film nous montre un manager du nazisme. Le régime, bien que pyramidal (avec Hitler à sa tête) et dictatorial, mettait en concurrence différents centres du pouvoir. Pour mener à bien son projet (l'extermination des juifs d'Europe), Heydrich a besoin de coordonner leur action. Pour assouvir son ambition, il doit les convaincre de le laisser diriger cette entreprise. L'acteur est convaincant dans le rôle du manager charismatique, mais il rend presque son personnage sympathique. Il n'apparaît pas assez impitoyable à mon goût. Bien que s'exprimant dans une autre langue que l'allemand, Jason Clarke m'a semblé plus percutant dans HHhH.
10:04 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 23 avril 2023
Earwig
Ambiance sombre et crasseuse pour ce nouveau film de Lucile Hadzihalilovic. Quelques indications nous permettent de comprendre que l'action se déroule dans les années 1950, mais les vêtements comme le mobilier pourraient situer l'intrigue dans l'Entre-deux-guerres. Il y a une part d'intemporel dans cette histoire, qui ressemble parfois à un conte.
Il met en scène un homme entre deux âges et une petite fille (Mia), qui pourrait être la sienne, ou une orpheline qu'il a recueillie... ou bien un otage qu'il détient. En tout cas, Albert en prend grand soin, la nourrit convenablement et change régulièrement son étrange appareil dentaire, fixé autour du visage : Mia n'a pas de dents, ou plutôt l'appareil lui permet d'en avoir, en glace.
Les deux personnages échangent peu de mots. Leurs relations sont faites de rituels, plus ou moins bien acceptés. Le moindre petit changement prend la forme d'un événement. La réalisatrice est donc soucieuse du moindre détail, au niveau des vêtements comme du décor. Un grand soin a été apporté aux petits bruits du quotidien, à l'éclairage et aux jeux de lumière (avec les verres de l'armoire d'Albert, avec les nouvelles dents de Mia...).
Albert reçoit des ordres par téléphone. Il doit préparer Mia à un voyage. Il commence donc à l'habituer au monde extérieur. Attention toutefois : les scènes ne nous sont pas montrées dans un ordre strictement chronologique. Cela conduit d'ailleurs à se demander s'il n'y a pas eu deux enfants enfermés dans la maison.
Cela donne une œuvre parfois déroutante, mais qui (dans mon cas) captive. On cherche des réponses aux nombreuses questions qui se posent, tout en savourant la construction de certains plans. La fin ne répond pas à tout, mais on aura passé un moment hors du temps dans un univers particulier.
11:14 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 20 avril 2023
C'est mon homme
J'ai longtemps hésité avoir d'aller voir ce film. Pourtant, le sujet (celui d'un poilu revenu amnésique de la Première Guerre mondiale) m'intéressait, mais je ne lisais et n'entendais que des critiques mitigées.
J'ai fini par tenter ma chance... et je ne le regrette pas.
Le film nous prend dès le début par une scène en apparence anodine (un couple qui vient se faire photographier chez une professionnelle), mais dont le sel n'apparaît que lorsque les amoureux se déplacent. Le dialogue précédent prend alors une autre saveur.
J'aime l'ambiguïté créée autour du passé du "héros". Le réalisateur nous fait d'abord suivre l'épouse photographe (Leïla Bekhti, très bien), avant que ne débarque l'épouse danseuse de cabaret (Louise Bourgoin, tout aussi convaincante dans un autre registre). On penche tour à tour pour telle ou telle... tout comme l'amnésique, un peu timide au départ, mais qui se laisse ensuite volontiers séduire par les deux !
Je sais que certains spectateurs sont sortis de la salle sans avoir tranché entre les deux épouses, alors qu'à mon avis, la mise en scène et le montage font pencher la balance d'un côté. L'ambiguïté persiste peut-être en raison du jeu de Karim Leklou, sobre, qui paraît presque étranger à sa propre vie.
J'ai aussi apprécié que l'intrigue joue avec les "valeurs" de l'époque. On s'attend à ce que le soldat, recouvrant peu à peu la mémoire, choisisse forcément de retourner auprès de sa légitime épouse. Mais la raison de son choix peut être tout autre : l'intérêt personnel (Quelle vie lui semble la plus intéressante : celle avec la photographe ou celle avec la danseuse ?)... ou l'amour inattendu, celui qui naît entre deux étrangers qui, sans la guerre, ne se seraient pas rencontrés.
J'ai été pris par cette histoire, pas flamboyante certes, mais qui, par petites touches, dit beaucoup de choses de l'humanité.
23:50 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire