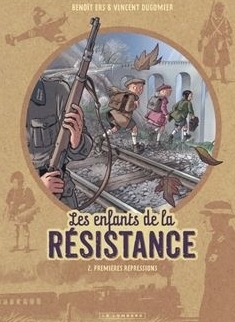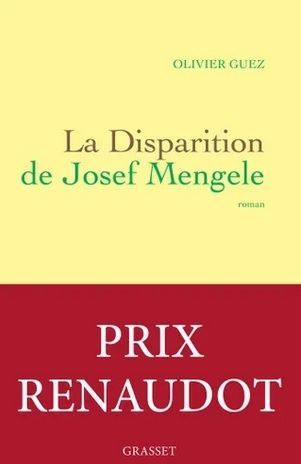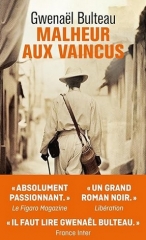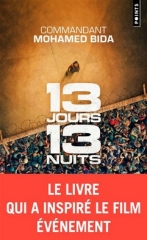vendredi, 06 mars 2026
Les Enfants de la Résistance
J'ai vu l'adaptation de la bande dessinée à succès, centrée sur les deux premiers tomes, Premières actions...
... et Premières répressions :
Les scénaristes n'en ont gardé que la trame générale et la caractérisation de certains personnages. Si, de prime abord, l'on saisit qu'il fallait un peu "élaguer" dans les quatre-vingt-dix pages de la BD pour faire tenir l'histoire en 1h40, on comprend un peu moins quand on voit ce qui a été rajouté à la place...
Au niveau des acteurs, les adultes s'en sortent bien, en général. Artus est une bonne surprise en père ancien combattant, Jugnot fait le job en curé de campagne (très différent de celui de la BD mais cela passe) et ceux qui incarnent les nazis sont très bien (c'est-à-dire de parfaits salauds). Côté allemand, on a eu l'élégance d'introduire de la nuance : certains soldats n'ont rien d'extrémiste, ils sont simplement pris dans le flux de l'Histoire.
Mais tous les enfoirés de service ne sont pas aussi bien joués. Julien Arruti tente de casser son image en jouant un cafetier collabo, mais il n'est pas terrible. J'ai eu l'impression de me trouver devant une mauvaise copie de ce que j'avais vu ailleurs, il y a bien longtemps (par exemple dans Uranus ou Au bon beurre).
Les autres déceptions, au niveau de l'interprétation, sont les enfants. Leurs dialogues sont mal écrits (ils parlent un peu trop comme des adultes) et les acteurs sont souvent approximatifs. J'ai aussi été horripilé par l'un des changements introduits (par rapport à la BD) : la tension (factice) qui s'instaure entre l'un des garçons et la petite réfugiée, dont on comprend dès le départ qu'ils vont finir par s'adorer. C'est du niveau d'un téléfilm de France Télévisions...
C'est dommage, parce que l'histoire est belle et que le matériau de départ (les bandes dessinées) était de qualité. Je ne saurais donc trop recommander de lire les différents tomes, bien plus subtils que le film, et accompagnés (en fin de chaque volume) par un petit dossier historique. Si ce film médiocre incite des jeunes à s'intéresser (de manière un peu plus rigoureuse) à cette époque trouble, il aura servi à quelque chose.
19:36 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 21 février 2026
Marty Supreme
Le titre de ce faux biopic (concentré sur une année de la vie présumée du pongiste Marty Reisman) fait allusion à la marque de balles de ping pong que le héros tente de lancer, grâce à l'argent apporté par une connaissance, un gosse de riches tombé dans ses filets.
Ainsi, Timothée Chalamet sort de sa zone de confort pour interpréter un type pas très sympathique (égocentrique, menteur, arrogant, voleur et magouilleur... entre autres), mais qui vit une histoire somme toute très américaine : d'origine modeste, il va vaincre l'adversité pour réaliser son rêve : devenir champion de tennis de table... et gagner sa vie avec.
Il y a donc des passages assez convenus dans l'intrigue, qui n'est pas sans rappeler celle de deux des Rocky : le premier pour l'ascension d'un outsider sous-estimé, le quatrième pour la lutte du pot de terre contre le pot de fer, l'antagoniste soviétique étant cette fois-ci remplacé par un adversaire japonais.
Ceci dit, les rares échanges sportifs qui sont présentés à l'écran sont très correctement mis en scène. On sait que Chalamet s'est longuement entraîné pour être crédible dans le rôle. Son principal concurrent est un authentique pongiste. S'ajoutent à cela d'abondants effets spéciaux (voir le générique de fin). Je note toutefois que, lors de l'ultime combat, particulièrement âpre, si le front de Marty se garnit de perles de sueur, sa chemise demeure impeccable... (Cette remarque est faite par celui qui fut, dans un lointain passé, un médiocre pongiste amateur.)
C'est malgré tout un bon spectacle, d'autant que Josh Safdie ne se montre pas maladroit dans le cœur du film : la mise en scène des heurs et malheurs du héros (et de celles et ceux qu'il embarque), entre réussites improbables et fiascos monumentaux. Parmi les moments mémorables, je note une scène de baignoire (dans un hôtel miteux), les aventures avec un chien nommé Moïse (Moses dans la version originale) et une monumentale fessée, administrée dans des circonstances que je me garderai de divulguer.
Sur le fond, le scénario essaie de contenter tout le monde. Les États-Unis des années 1950 sont décrits comme un pays d'inégalités gigantesques, où les riches exploitent les pauvres. (Ça, c'est pour la gauche.) D'un autre côté, c'est aussi le pays des opportunités, où un p'tit gars talentueux et opiniâtre peut espérer (s'il ne respecte pas trop les règles) faire son trou. Comme, en plus, le Marty est un patriote, il y a de quoi contenter la droite. (J'ai aussi relevé le fait qu'on nous conte l'histoire d'un juif pauvre exploité par de riches protestants, une audace louable en ces temps d'antisémitisme rampant.)
En revanche, du côté des personnages féminins, c'est assez stéréotypé. La mère du héros, sa maîtresse comme sa compagne (interprétée par Odessa A'zion, vue récemment dans Until Dawn) n'agissent qu'en relation avec Marty. Tout tourne autour de lui. Le film ne passe donc sans doute pas le test de Bechdel-Wallace... mais, comme le personnage principal est interprété par Timothée Chalamet (et pas par Gerard Butler, Liam Neeson ou Bruce Willis), c'est cool et l'on s'extasie sans peine. Il me semble que les scénaristes (et peut-être l'un des coproducteurs, un certain... T. Chalamet) ont ressenti de la gêne, puisque la conclusion du film replace le héros dans le "droit chemin".
21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 14 février 2026
Le Gâteau du président
Dans l'Irak dirigé d'une main de fer par le dictateur Saddam Hussein, la coutume veut qu'on offre des présents le jour de son anniversaire (le 28 avril). Dans chaque école primaire, plusieurs élèves sont mis à contribution. Cette fois-ci, le sort désigne la petite Lamia pour préparer le "gâteau du président", qui sera dégusté en son nom par... l'instituteur. Au cas où cette gastronomique tradition ne serait pas dignement respectée, l'enseignant menace de dénoncer les parents des enfants au gouvernement. (On savait tenir les gamins à l'école, en ce temps-là !)
Pour Lamia, la confection de cette simple pâtisserie relève du parcours du combattant. Orpheline, sans doute de confession chiite, elle a été recueillie par sa grand-mère, qui vit dans une sorte de cabane en roseaux, le long d'un cours d'eau qui pourrait être le Chatt al-Arab. Cela donne de forts jolis plans aquatiques, les ruraux de la région se déplaçant de préférence sur de petites embarcations.
La suite est un périple urbain, celui de la gamine, pour se procurer, de manière plus ou moins légale, les ingrédients nécessaires à la confection dudit gâteau. (On pense immédiatement à Une Enfance allemande, sorti il y a un peu moins de deux mois.) Dans sa recherche, elle est aidée par Saeed, son unique ami, un as de la débrouille qu'il met en général au service de son père handicapé. Complète ce duo un... coq, étrangement docile, qui joue le rôle d'animal de compagnie de l'héroïne.
Bien entendu, ces pérégrinations (parfois peu réalistes) ont pour but de nous faire découvrir différents aspects de l'Irak urbain à la fin du règne de Saddam Hussein. Entre sanctions occidentales, bombardements et persécutions du régime, la population de base peine à joindre les deux bouts. Le plus souvent, c'est un peu chacun pour soi. Dans ce cadre, les efforts déployés par les gamins apparaissent presque pathétiques. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de misérabilisme dans la manière de les filmer... mais la présence à l'écran de Baneen Ahmad Nayyef emporte l'adhésion. Cette jeune actrice est formidable de justesse et d'émotion. A plusieurs reprises, on a furieusement envie de se lever pour lui donner un coup de main, ou la prendre dans ses bras, pour la consoler.
Une autre qualité du film est l'introduction de pointes comiques dans une intrigue le plus souvent sombre. Cela m'a rappelé les comédies italiennes d'après-guerre, qui montraient un pays appauvri, dans lequel les citoyens ordinaires essayaient de survivre comme ils pouvaient, sans perdre leur sens de l'humour.
Du coup, en dépit de quelques invraisemblances et maladresses, ce film est une petite pépite à ne pas rater (même s'il a été quelque peu survendu par la critique).
21:08 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 12 février 2026
Le Mage du Kremlin
Le nouveau film d'Olivier Assayas s'inspire d'un roman primé et de l'histoire de la Russie de ces trente-quarante dernières années. Il ne s'agit donc pas d'une biographie de Vladimir Poutine, même si son parcours politique est décrypté à l'aune du regard d'une "éminence grise", celle-ci n'ayant au départ aucun lien avec la politique.
La première partie (du film comme du livre, d'ailleurs) se déroule donc sans Poutine, mais elle permet de comprendre les circonstances qui ont permis son accession au pouvoir et le renforcement de son contrôle sur la société russe. C'est sans doute ici qu'Assayas dispose du plus de liberté cinématographique. Ce n'est pas pour moi la partie la plus convaincante, mais elle permet de resituer l'émergence de Poutine dans un contexte de chaos.
Quand celui-ci débarque à l'écran, sous les traits de Jude Law, c'est un choc. A l'origine, je rechignais à aller voir ce film, parce que je pensais que le choix de cet acteur (fort estimable au demeurant) n'était pas le bon. Je dois reconnaître que je me suis trompé. Law fait un Poutine très convaincant, ne tombant pas trop dans le mimétisme tout en restant crédible. Chapeau.
La suite est des plus passionnantes. Ayant été spectateur de ces événements, consultant divers journaux pour tenter de comprendre ce qui se passait en Russie, j'ai retrouvé l'ambiance de l'époque, de la décrépitude de Boris Eltsine aux premières exécutions d'opposants, en passant par la guerre en Tchétchénie et la tragédie du Koursk.
La distribution est bonne, qu'elle concerne les personnages réels (outre Poutine, Boris Berezovsky et Igor Setchine) que les personnages fictifs : celui du "mage" (certes inspiré de Vladislav Sourkov, mais à l'évidence résultat d'un mélange plus subtil), de sa compagne (dans la peau de laquelle j'ai eu du mal à reconnaître Alicia Vikander !) ou de l'interlocuteur états-unien. Plus ambigu est le statut de Dimitri Sidorov, décalque évident de Mikhail Khodorkovsky... et qui dans le roman se prénomme bien Mikhail. Pourquoi diable avoir modifié son identité pour le film ? Serait-ce pour épargner cet ancien oligarque, dont le passé sulfureux semble avoir été effacé de la mémoire collective depuis qu'il a subi les foudres du Kremlin ? C'est dommage, parce que son ambiguïté à lui aurait pu contribuer à mieux mettre en évidence celle du "Tsar".
Les commentateurs officiels ont souvent regretté la trop grande place laissée par le film aux arguments de Poutine, qu'ils sortent de sa bouche ou de celle de son conseiller officieux. Certes, le propos aurait pu être plus grinçant à leur égard, mais je trouve qu'Assayas et Carrère réussissent dans leur entreprise de rendre plus intelligibles les motivations de Poutine et de ceux qui le soutiennent.
A cela s'ajoute une interprétation tout en sobriété du "Mage", par Paul Dano, un excellent choix à double titre, puisque celui qui longtemps fit figure d'acteur de deuxième rang incarne un personnage qui semble de prime abord secondaire, avant que l'importance de son action n'apparaisse au grand jour. Je trouve cette mise en abyme très pertinente, les aspects moins reluisants du "héros" ressortant lors de ses rencontres avec la "femme de sa vie".
C'est donc un film exigeant, plutôt destiné à celles et ceux que la politique internationale intéresse, mais il m'a tenu en haleine du début à la fin.
21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 06 février 2026
Nuremberg
Ce n'est pas la première fois que le procès des principaux dirigeants nazis capturés par les Alliés fait l'objet d'une fiction (télévisuelle ou cinématographique). L'originalité de celle-ci est de présenter l'intrigue sous l'angle de la relation entre Hermann Göring et l'un des deux psychiatres états-uniens chargés de suivre les détenus.
Au départ, je nourrissais quelques appréhensions concernant l'interprétation de Russell Crowe en Göring. En fait, je l'ai trouvé très bien, à la fois sobre et ambigu dans son jeu. La déception est venue de là où je ne l'attendais pas : Rami Malek surjoue horriblement en psychiatre humaniste et sûr de sa science, dont on comprend immédiatement qu'il va se faire manipuler.
Heureusement, les personnages secondaires sont mieux campés, à commencer par le procureur Jackson (par Michael Shannon), mais aussi son homologue britannique Maxwell-Fyfe (par Richard E. Grant), le colonel Andrus (par John Slattery) et le sergent Triest (par Leo Woodall), ce dernier réservant de belles surprises, bien intégrées à l'histoire.
L'aspect filmique est donc réussi... plus que l'aspect historique. Je veux bien que, pour créer une intéressante dramaturgie, scénaristes comme réalisateurs soient amenés à prendre des libertés avec la réalité des faits, mais je commence à en avoir marre de constater les énormes déformations opérées dans des œuvres destinées à un grand public, et présentées par leurs auteurs comme fiables sur le plan historique.
Ainsi, je trouve que la genèse comme les enjeux du procès ne sont pas bien restitués. Le film donne l'impression que tout commence en 1945, alors que c'est dès 1942 que les Alliés ont songé à traduire en justice les dirigeants nazis. D'autre part, obtenir les aveux des accusés n'était pas une priorité pour tout le monde, puisque les preuves réunies étaient accablantes. A ce sujet, le colossal travail de documentation réalisé en amont n'est quasiment pas montré. Enfin, parmi les chefs d'accusation, les auteurs du film ont choisi d'insister sur celui qui a sans doute été le moins évoqué durant le procès : les crimes contre l'humanité. En effet, les Américains voulaient mettre en avant les notions de complot et de crime contre la paix, l'ensemble des Alliés étant d'accord pour pointer d'abord les crimes de guerre, dont ont été notamment victimes les civils des pays envahis par l'armée allemande ainsi que les prisonniers de guerre. (Les Soviétiques ont été les plus nombreux à mourir dans d'atroces souffrances et les Britanniques ont mis l'accent sur l'exécution de certains de leurs soldats.)
Le sort des juifs a bien été évoqué durant le procès, mais assez brièvement. C'est une déformation du XXIe siècle que de lui accorder une place centrale dans l'accusation. D'ailleurs, celle-ci n'avait pas retenu la toute récente notion de génocide.
Il y donc du trop-dit... et des non-dits, concernant principalement l'allié soviétique. On ne voit quasiment pas intervenir le procureur nommé par Staline, alors qu'il a pourtant ardemment participé au contre-interrogatoire de Göring. De plus, les crimes du régime communiste ne sont (vaguement) abordés qu'une seule fois, dans la bouche du second d'Hitler. Pourtant, de 1928 à 1945, des millions de personnes sont mortes sous la botte de Staline et de ses affidés, ce qui posait tout de même un sacré problème moral, auquel peut-être une vague allusion est faite, à un moment, dans l'une des interventions de Jackson.
Le film n'en demeure pas moins intéressant, bien conçu sur la forme et disant des choses importantes, mais avec tellement d'approximations...
P.S.
Avant de voir ce film, je connaissais le rôle des médecins dans le procès à travers l'action du psychologue Gustave Gilbert, présenté de manière particulièrement caricaturale dans le film. On le fait passer pour le grand incompétent, en comparaison du héros incarné par Malek. Une rivalité a bien opposé les deux hommes, mais Gilbert (qui parlait allemand) a lui aussi mené de nombreux entretiens avec les prisonniers. Il avait gagné la confiance de nombre d'entre eux (tant qu'il ne leur avait pas révélé qu'il était juif). C'est lui qui avait conseillé à l'accusation de miser sur l'orgueil de Göring... Dans le film, il est interprété par Colin Hanks (fils de...), vu récemment dans Nobody 2.
22:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 31 janvier 2026
Furcy, né libre
Onze ans après Qu'Allah bénisse la France, le rappeur Abd Al Malik est de retour derrière la caméra, avec un film "engagé", consacré à un personnage réel de notre histoire, Furcy Madeleine, en général présenté comme esclave réunionnais, mais qui, en réalité, était né libre... sans le savoir. Sur un sujet fort, le réalisateur a construit une œuvre divisée grosso modo en trois parties, qu'on peut se contenter d'analyser sur un plan strictement cinématographique, mais dont je pense qu'il faut aussi présenter les faiblesses historiques.
La première partie évoque la période 1816-1817 quand, après avoir découvert l'affranchissement ancien de sa mère, Furcy décide de se faire rendre justice. Les méchants de l'histoire sont en général bien campés : Vincent Macaigne incarne une petite ordure de colon esclavagiste et Micha Lescot nous ravit en avocat fielleux et méprisant. Du côté des gentils, Makita Samba est sobre dans le rôle principal, tandis que Romain Duris et Frédéric Pierrot sont chargés d'incarner les juristes humanistes. Ils le font avec conviction... et, parfois, avec maladresse. Les scènes sont souvent très courtes. Je pense que le montage a eu pour but de masquer certaines faiblesses.
La deuxième partie est consacrée au (long) séjour de Furcy sur l'Île Maurice (ex-Île de France), d'abord comme esclave, puis comme employé de commerce. Cette partie contient un peu plus de cinéma, avec les scènes de case et de plantation. On nous y montre la volonté de briser un homme, pour qui survivre, c'est résister. Makita Samba est toujours aussi sobre et digne, un peu comme jadis Alfred Dreyfus à Cayenne. Il supporte ce qu'il subit, dans l'espoir que ses droits finissent par être reconnus. J'ai aussi apprécié le fait que, pour les esclaves (mais pas que), l'émancipation passe par la lecture et l'écriture.
Je n'ai pas été choqué par la comparaison visuelle qui est faite (par allusion) entre l'entrée de la file d'esclaves sur la propriété esclavagiste et l'arrivée des déportés de jadis dans les camps nazis. Dans les deux cas, on est face à un crime contre l'humanité et il est question de travail forcé. (Mais, les esclaves ne sont pas victimes d'extermination, ce qui constitue la limite de la comparaison.)
A travers la séquence mauricienne, on a l'impression qu'Abd Al Malik a voulu faire son 12 Years a Slave... en moins bien. Le moment qui voit le héros s'investir dans la confiserie est toutefois correctement mis en scène, même s'il comporte des zones d'ombre et des déformations (dont je parlerai plus loin).
La troisième partie se joue en France métropolitaine. C'est le retour du film de procès. On y entend de belles plaidoiries, de belles déclarations de principes, mais c'est gâché par la volonté de faire de l'avocat de Furcy (l'ancien procureur du début, interprété par Romain Duris) un homme malade, à la toux aussi aléatoire qu'envahissante, sauf quand il nous livre sa grande tirade, curieusement pas interrompue par le moindre soubresaut. (Au passage, je signale que ledit ex-procureur, reconverti en avocat, était absent du procès en Cassation... Peut-être a-t-on estimé qu'il était regrettable de se passer des services de Romain Duris pour cet épisode capital de l'intrigue.)
Le film se conclut sur l'évocation, par des incrustations, des suites judiciaires (l'obtention de réparations) et de la fin de la vie de Furcy. Là encore, on ne nous donne que des informations incomplètes, ce qui m'amène à évoquer les faiblesses historiques du film, qui ne sont pas petites.
Le premier problème est posé par le choix du comédien principal, non pas en raison de son talent (je trouve qu'il fait plutôt bien le job), mais à cause de son apparence physique. Le véritable Furcy n'était pas africain, mais né d'une mère indienne (ce qui figure d'ailleurs dans les dialogues) et d'un père colon français de Bourbon. Dans les textes de l'époque (par exemple le testament de la tante de l'esclavagiste Lory), il est qualifié de "Malabar", pas de "Cafre" (terme utilisé pour désigner les personnes originaires de l'Afrique intertropicale). Il ne devait donc pas ressembler à ceci :
... mais plutôt à cela :
(Ces deux tentatives de représentation figurent dans une exposition datant de 2019, dont on peut télécharger la version numérique ici. Les auteurs du film auraient dû la consulter et s'en inspirer.)
A ce problème d'incarnation s'ajoutent les choix opérés à propos de la représentation des femmes. Dans le film, Furcy entretient une liaison amoureuse avec une femme blanche (bien incarnée par Ana Girardot). Dans la réalité, Furcy a eu des relations avec des femmes "libres de couleur", sur l'île Bourbon comme sur l'île Maurice. Il a même eu des enfants avec. Cela aurait pu constituer un versant intéressant de l'intrigue, que les scénaristes ont préféré remplacer par une relation interethnique (pourquoi pas après tout). Peut-être aussi s'agissait-il d'ajouter un nom connu à la distribution (pourtant déjà riche). On ressent toutefois un certain malaise quand, dans la troisième partie de l'histoire, cette petite amie blanche suggère au héros de se soumettre... On se demande ce qui peut bien justifier cette insertion totalement fictive, tout comme une autre, un peu avant : quand Furcy débarque sur l'île Maurice, il est presque immédiatement maltraité par une parente de Lory, une femme blanche, à cheval, qui le frappe. Or, d'après l'essai biographique qui a été consacré à Furcy (voir ci-dessous), c'est le frère aîné de Lory qui le moleste.
(Vous noterez que l'éditeur de la version de poche n'a pas été très inspiré dans le choix de l'illustration de couverture (qui est censée représenter... Othello, personnage de Shakespeare). J'ajoute que, très souvent, j'ai lu et entendu, à propos de ce livre, qu'il était un roman, ce qui n'est pas le cas. C'est au moins l'indice que ces personnes ne l'ont pas lu.)
Mais le personnage féminin le plus maltraité du film (au sens propre comme au sens figuré) est sans conteste Constance, la sœur de Furcy. Elle aussi est dotée d'une apparence qui n'a pas grand chose à voir avec la réalité. (Issue du même métissage que son frère, elle était jadis décrite comme ayant la peau claire et pouvant passer pour une Européenne de l'époque.) Surtout, dans le film, bien que rebelle, elle est essentiellement présentée comme une victime, un personnage secondaire, alors qu'elle savait lire et était à l'origine de la procédure juridique en faveur de son frère, qu'elle a tout fait pour sortir de l'esclavage. Enfin cerise sur le gâteau, la séquence de "pressions" exercées sur elle chez les planteurs blancs est en grande partie inventée. Certes, certains esclavagistes de Bourbon l'ont menacée pour qu'elle change sa version des faits, mais dans tout ce que j'ai lu, il n'est pas question du viol suggéré par le film, un viol qui aurait été perpétré par Brabant, le sbire noir de Lory... qui, en réalité, avait déjà quitté son service à l'époque. (Il avait acheté son affranchissement.) Il a bien rencontré Constance, mais, dans la rue, et cela s'est limité à une discussion... Je précise que je tire la plupart de ces détails du livre de Mohammed Aïssaoui, qui est pourtant présenté par la production comme ayant inspiré le film !
Je ne vais pas m'éterniser, mais je tiens à terminer par un dernier élément, que je juge très important, et que les auteurs du film ont pris soin de passer sous silence. Une fois sa liberté obtenue à Maurice, Furcy est devenu commerçant indépendant (pas simple employé, comme montré dans le film). Il s'est enrichi et a même acheté... deux esclaves ! Du coup, son combat semble quelque peu perdre sa vocation universaliste, pour devenir celui d'un homme talentueux, soucieux d'obtenir la place qu'il estime mériter dans une société inégalitaire qu'il ne souhaite pas chambouler.
17:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
lundi, 19 janvier 2026
L'Affaire Bojarski
Trois ans après La Syndicaliste, Jean-Paul Salomé nous revient avec un biopic sur celui qui fut peut-être le plus brillant fabricant de fausse monnaie que la France ait subi connu. Le défunt Ceslaw Bojarski (1912-2003) bénéficie actuellement d'une importante couverture médiatique, mais il n'était pas méconnu pour autant. Les années qui ont suivi son décès avaient vu un premier regain de notoriété.
Le film rend hommage au talent de celui qui fut à la fois un artisan et un artiste, d'une méticulosité maladive, ayant plutôt tendance à travailler en solo. Le projecteur est placé sur trois périodes de son existence : ses premiers pas dans la fausse monnaie, au sein d'un groupe criminel, sa longue carrière en solo et la fin de son parcours, en duo. J'ai trouvé passionnante la description du travail du faussaire, de la création des matrices à la fabrication du papier-monnaie, le tout dans une discrétion absolue, même si, parfois, le film sous-entend que Bojarski a dû son salut à la stupidité de certains policiers.
C'est là d'ailleurs l'une des faiblesses de l'intrigue, avec la présence régulière d'invraisemblances. Dès le premier retour en arrière (qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale), on est un peu atterré de voir la facilité avec laquelle l'apprenti-faussaire (qui fabrique à l'époque de faux papiers d'identité) échappe à une patrouille allemande, qui ne prend pas la peine de pénétrer dans un atelier pourtant éclairé après le couvre-feu... Plus tard, c'est la rencontre fortuite entre deux protagonistes, à l'hôtel, autour d'un bon verre, qui pique les yeux... d'autant qu'elle n'a pas existé. Et que dire de certaines maladresses, comme celle qui voit deux personnages se rencontrer dans un parloir et esquisser le geste hyper bateau de faire se toucher leurs mains de part et d'autre de la grille de séparation... alors qu'il existe une (petite) ouverture, juste au-dessous... ouverture qui va d'ailleurs être utilisée dans la suite de la scène !
Je pourrais en citer quelques autres comme cela, mais je n'ai pas envie de m'acharner. L'histoire m'a tout de même emporté, malgré l'interprétation un poil décevante. On a vu Reda Kateb bien meilleur ailleurs. Je trouve que Bastien Bouillon et Pierre Lottin s'en sortent un peu mieux, sans faire d'étincelles. Quant à Sara Giraudeau, elle pourrait presque porter plainte vu ce qu'on lui fait jouer. (Aux amateurs d'info pipole, je signale qu'une comédienne incarnant un personnage secondaire a parfois une moue qui rappelle furieusement celle de sa mère - elle fait carrière sous le nom de son père.)
Cerise sur le gâteau, l'un des traits caractéristiques du "héros" est construit à partir de mensonges. Bojarski était bien ingénieur de formation, et il avait un côté bricoleur. Mais, non :
- il n'a pas inventé le stylo-bille
- il n'a pas inventé le rasoir à lame jetable
- il n'a pas inventé la brosse à dents électrique
- il n'a pas créé la première machine à café à dosettes
Au départ, ce côté Géo Trouvetou est plutôt sympa, d'autant qu'il est nimbé de comique, mais, quand on se rend compte que (presque) tout est faux, cela nuit globalement à la crédibilité de l'intrigue. (Si j'étais médisant, je dirais que c'est volontaire de la part des scénaristes, qui font œuvre de propagande, tendant de démontrer que c'est parce que la vilaine société française de l'après-guerre était xénophobe qu'un talentueux ingénieur s'est tourné vers le crime...)
Si l'on supporte les maladresses et les invraisemblances, on peut suivre cette vie extraordinaire, celle d'un délinquant qui a longtemps réussi à passer sous les radars en évitant d'être flambeur.
P.S.
Les images d'époque diffusées en début de générique de fin sont issues d'une reconstitution. On y voit Bojarski mimer les gestes qu'il accomplissait autrefois.
22:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 18 janvier 2026
La bite de Mars
Cet après-midi, en voiture, j'écoutais la radio quand je suis tombé sur l'émission Allons-y voir !, animée par l'historien Patrick Boucheron, sur France Culture. Je ne suis pas particulièrement fan de ce programme (dont je trouve le présentateur un peu pontifiant), mais, sur la radio publique, il est encadré par Une Histoire particulière et Les Grandes Traversées, dont je recommande l'écoute (le second débutant une série sur Al Capone).
Aujourd'hui, Patrick Boucheron a consacré une partie de son émission à l'analyse d'un tableau de Jacques-Louis David, Mars désarmé par Vénus (conservé au Musée des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles, ville où le peintre est mort, en exil).
Cette œuvre fait partie de celles (de divers auteurs) qui évoquent la relation tumultueuse entre le dieu de la guerre et la déesse de l'amour physique et de la beauté. Le problème était de représenter cette "intensité physique" en respectant les codes moraux de l'époque...
Ainsi, alors que Mars est en train de se faire déshabiller (et désarmer), par Vénus, des nymphes et ce petit coquin de Cupidon, la déesse l'entreprend et l'on remarque qu'elle a posé sa main gauche sur le haut de la cuisse droite du dieu guerrier. Tout individu de sexe masculin est conscient que cette proximité entre la main (présumée) douce et le pénis divin, ajoutée à la nudité sublime de la déesse, provoque sans doute une "vive émotion" chez Mars, émotion masquée par la présence de l'une deux colombes, placée pile au bon endroit.
Pour dire les choses plus clairement, ce cher Mars a sans doute le gourdin, une situation évoquée métaphoriquement par deux objets inclus sur le tableau : la grande lance, que le dieu tient levée, bien droite... et le gros tube qui pend le long du corps de Cupidon, masquant l'entrecuisse de celui-ci.
Ah, qu'il est bon de se cultiver !
20:48 Publié dans Histoire, Loisirs, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, arts, peinture, tableau, art
dimanche, 11 janvier 2026
Meurtre à l'ambassade
Fort heureusement, ce titre n'annonce pas un énième épisode de la médiocre collection diffusée le samedi soir sur France 3, mais un nouveau volet d'une série américano-britannique, « La Reine du crime présente ».
Il y a un an et demi, nous avions découvert Miranda Green, fleuriste hypermnésique (et passionnée d'intrigues policières) dans Invitation à un meurtre. Cette fois-ci, la jeune femme est conviée en Égypte, toujours en 1934.
Le tout début de l'histoire nous indique qu'il ne sera pas question d'un, mais de deux meurtres, le lien entre les deux demeurant longtemps obscur. C'est l'un des intérêts de ce téléfilm : son intrigue mystérieuse, qui baigne dans une ambiance géopolitique. En effet, à cette époque, l’Égypte est officiellement indépendante, mais encore sous la coupe du Royaume-Uni. Les auteurs d'OSS 117 diraient que Le Caire semble être un vrai « nid d'espions »... On peut même y croiser des nazis (Hitler étant chancelier d'Allemagne depuis janvier 1933).
Le principal point faible de ce téléfilm est l'interprétation de certains personnages secondaires : de la première victime à l'un des employés de l'ambassade, les maladresses d'interprétation ne manquent pas, même s'il faut reconnaître que Mischa Barton s'en sort très bien dans la peau du personnage principal.
J'ai donc été séduit par cette ambiance à la Agatha Christie, qui fait écho à plusieurs de ses romans (Mort sur le Nil, bien sûr, mais aussi Meurtre en Mésopotamie et Rendez-vous avec la mort). La photographie est très soignée et plusieurs scènes rappellent visuellement l'adaptation en série télévisée des enquêtes d'Hercule Poirot. Je recommande de voir cet épisode plutôt en version originale sous-titrée.
15:02 Publié dans Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actu, actualite, actualites, actualité, actualités, télévision, télé, médias
mardi, 30 décembre 2025
La Disparition de Josef Mengele
Ce film de Kirill Serebrennikov adapte le roman historique (très documenté) d'Olivier Guez (dont je recommande vivement la lecture). Il en suit grosso modo la trame, les retouches ne trahissant pas l’œuvre d'origine.
Le cinéaste entrecroise plusieurs périodes, chacune filmée différemment. La principale traite de la cavale de Mengele, de son arrivée en Argentine à son décès présumé, au Brésil. Elle est complétée par des retours en arrière (abordant certains aspects de son action à Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale) et une séquence contemporaine, celle de l'analyse d'un squelette, censée mettre fin à une polémique.
C'est à la fois atroce et passionnant.
Sans surprise, les scènes du camp sont dures, mais plus par ce qu'elles suggèrent que par ce qu'elles montrent. Elles sont néanmoins nécessaires pour comprendre pourquoi certaines personnes, ont, plus tard, jugé indispensable de traquer le criminel de guerre.
Plus inédites sont les séquences latino-américaines. Dans un premier temps, on découvre les difficultés de certains fugitifs nazis, principalement en Argentine, avant qu'on nous montre une société plus friquée, où se mêlent aux nazis les descendants d'une immigration allemande plus ancienne. A la fin des années 1940, beaucoup sont dans le déni (concernant les crimes du régime hitlérien), tandis que ceux qui savent (et qui ont vécu en Europe) hésitent entre la revendication de titres de gloire et la nécessaire discrétion à adopter sur certains sujets...
Mengele ne regrette rien et fait partie de ceux qui ont compris qu'il vaut mieux faire profil bas. Il est même limite paranoïaque, au point de devenir désagréable aux yeux mêmes de ceux qui veulent l'aider. L'ancien médecin a une très haute opinion de lui-même et reste un nazi fervent, partisan d'une "hygiène raciale". August Diehl, physiquement méconnaissable, est excellent dans le rôle.
Un autre intérêt du film est de montrer que, durant la majorité de sa longue cavale, Mengele n'a pas eu la vie facile. Les soutiens venus de sa famille ne suffisent pas à rendre sa vie quotidienne aussi douce que ce à quoi il aspirait. Ses relations avec les personnes qui l'hébergent sont complexes (plus encore dans le livre que dans le film). Bref, même s'il n'a jamais été jugé, il en quand même un peu chié.
Serebrennikov brosse un portrait presque pathétique de l'ancienne étoile montante du nazisme, devenu un vieil homme aigri. Il évite de tomber dans le piège de l'héroïsation du "grand criminel". En dépit de sa bonne éducation et de ses brillants diplômes, Mengele n'était qu'un pauvre type égocentrique, sadique et méprisant. Ce film mérite vraiment d'être vu.
P.S.
Je signale que le bouquin de Guez a été adapté au théâtre... ainsi qu'en bande dessinée (cosignée par l'écrivain) :
21:29 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 27 décembre 2025
Une Enfance allemande
L'action débute en avril 1945, alors que le IIIe Reich est sur le point de s'effondrer. Dans l'extrême nord de l'Allemagne, sur l'île d'Amrum (reliée au continent, à marée basse, par un cordon de sable), officiellement, tout le monde soutient le gouvernement d'Hitler, mais l'on comprend très vite qu'en réalité, les sentiments de la population sont partagés, y compris dans chaque famille.
Nanning vit avec sa mère, sa tante et ses frères et sœurs, dans l'antique maison de ce qui fut d'abord une famille de pêcheurs et de chasseurs de baleine. On est très fier de sa lignée, censée être "purement" germanique... et l'on cache que l'un des oncles, parti vivre aux États-Unis, a épousé une juive...
La mère de Nanning, Hille, est une connasse nazie convaincue, dont l'époux, sans doute haut placé, est absent du foyer. Elle se désole de la décrépitude du régime... et des pénuries qui frappent désormais la population locale, qui commence à subir, certes modestement, les conditions de vie imposées par l'armée allemande aux civils des pays envahis.
Malgré les temps difficiles, Hille aimerait manger du pain blanc, avec du beurre et du miel. Voilà une mission pour Nanning, qui porte l'uniforme des Pimpfs (les 10-14 ans dans les Jeunesses hitlériennes). Ce sera le fil rouge de l'histoire, le gamin devant déployer des trésors d'ingéniosité pour se procurer les ingrédients (farine de blé, beurre... et sucre, à échanger contre du miel), ainsi qu'un peu d'argent.
Ce sont les pérégrinations de Nanning qui nous font découvrir les autres habitants de l'île, ainsi que quelques-uns du "continent". La première à nous être présentée est une agricultrice, grande pourvoyeuse de pommes de terre (et de lait) sur la commune, qu'elle produit avec sa mère et une main-d’œuvre juvénile. Cette femme tenace, qui n'a pas la langue dans sa poche, est incarnée par la délicieuse Diane Kruger, déjà dirigée par Fatih Akin dans In The Fade.
Nanning croise aussi quelques grands-pères (dont un pêcheur), un de ses oncles (lui aussi nazi), un boulanger manchot (blessé de guerre), une apicultrice... et une flopée d'enfants, entre lesquels surgissent des tensions.
C'est l'occasion de préciser que, dans ce coin reculé de l'Allemagne, on parle un dialecte certes germanique, mais légèrement différent de l'allemand standard, ce qui, pour quelqu'un qui connaît un petit peu la langue d'Angela Merkel, s'entend assez facilement. (Certains personnages s'expriment en revanche dans un allemand courant.)
Ainsi, Nanning et sa famille, arrivés de Hambourg, sont perçus comme des semi-étrangers... moins toutefois que les réfugiés qui débarquent de l'est de l'Allemagne, courtoisement surnommés "les Polaks"...
Une partie de l'action se déroule à proximité de la plage de sable. Cela donne naissance à des plans souvent superbes, de jour comme de nuit.
On est pris par les efforts (parfois pathétiques) déployés par le garçon courageux. Au départ, il ne peut pas concevoir que ses parents puissent être du côté des "méchants". Il ferait tout pour sa "Mutti". Dans le rôle, le jeune Jasper Billerbeck est convaincant, touchant même. Les comédiens adultes sont impeccables (les enfants, un peu moins bons). Mine de rien, ce petit film dit beaucoup de choses sur la nature humaine.
09:32 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 26 décembre 2025
Lady Nazca
Cette fiction à caractère documentaire est le premier long-métrage du Français Damien Dorsaz, qui s'intéresse à la personne de Maria Reiche depuis au moins une vingtaine d'années. (Il lui a jadis consacré un documentaire d'une quarantaine de minutes.)
Lady Nazca est le surnom qui a parfois été donné à celle-ci... mais, à l'époque, on l'appelait aussi "la folle", tant on trouvait stupéfiant qu'une fille de la bonne bourgeoisie allemande soit venue "balayer le désert", toute seule, échafaudant des théories jugées au départ farfelues sur l'origine des gigantesques figures dessinées dans cette région du Pérou. (On continue à en découvrir, au XXIe siècle !)
Elle est jeune, elle est belle, intelligente. Elle pourrait se contenter d'une vie de patachon(ne), en compagnie de sa riche petite amie, qui loge à Lima. Elle pourrait aussi regagner le giron familial, se trouver un mari et procréer une ribambelle d'enfants blonds aux yeux bleus, comme le voudrait le régime en place à l'époque, en 1936.
Enseignante dans le primaire, elle accepte un boulot de traductrice pour un archéologue français. Un jour, sur le terrain, tous deux découvrent d'étranges lignes dans le désert. Lui retourne assez vite à ses fouilles, à ses poteries et à ses momies, mais Maria devient obsédée à la fois par la précision des dessins et par l'ambiance du désert. C'est d'ailleurs l'une des grandes réussites du film que de nous faire sentir le côté apaisant, inspirant même, de cette région au relief minéral. On pense un peu au Nostalgie de la lumière, de Patricio Guzmán, mais aussi à toutes les oeuvres tournées du côté de la Mongolie, comme La Femme des steppes, le flic et l’œuf.
Il faut aussi signaler la performance de l'actrice principale, Devrim Lingnau (une illustre inconnue, pour moi), presque aussi à l'aise en espagnol et en français qu'en allemand et en anglais. Elle réussit à nous faire toucher du doigt la passion de Maria, dans ce qu'elle a d'authentique et, parfois, de démesuré.
La première partie montre l'éclosion de l'archéologue amatrice. Au départ, les dieux semblent être à ses côtés : elle file le parfait amour avec Amy, le chercheur français la soutient et elle progresse dans sa découverte des géoglyphes. Mais des difficultés vont surgir : l'équipe d'archéologues français a d'autres centres d'intérêt, sa petite amie s'estime délaissée et, localement, une puissante famille lui met des bâtons dans les roues.
On retombe sur l'éternelle lutte du pot de terre contre le pot de fer... sauf que Maria a de la ressource, de l'énergie... et quelques précieux soutiens, qu'il convient toutefois de remotiver. La conclusion est belle, à l'image d'un film lumineux, où il n'y a rien à jeter.
20:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 20 décembre 2025
L'Agent secret
Cet agent secret est Marcelo... ou bien Armando, un "réfugié"... ou bien un policier... ou alors un universitaire... à moins que ce ne soit un militant révolutionnaire, communiste ou anarchiste. (Sauf erreur de ma part, c'est aussi le titre sous lequel le film Le Magnifique -avec JP Belmondo- est sorti au Brésil.) L'incertitude subsiste durant la première partie de ce polar politique, parce que le réalisateur, Kleber Mendonça Filho (auteur, entre autres, des Bruits de Recife), ne dit rien ouvertement, mais suggère, notamment à travers les dialogues. C'est l'un des intérêts de ce film, que d'inciter les spectateurs à se creuser la cervelle... du moins, dans un premier temps, la dernière heure étant plus explicite.
Trois temporalités s'entremêlent. L'intrigue principale se déroule en 1977, en pleine dictature militaire brésilienne, avec des retours en arrière nous présentant la situation trois-quatre ans plus tôt. S'intercalent aussi des scènes de notre époque, celle-ci finissant par prendre le dessus, dans la séquence conclusive.
La majorité des personnages évoluent à Recife (ville chère au réalisateur), État du Pernambouc, dans le Nordeste à l'époque si pauvre. Certains des protagonistes ont un lien avec le Sudeste, notamment la région de Rio. Cet ancrage local permet au cinéaste de camper les effarantes inégalités sociales, qui pèsent jusque sur le devenir familial des enfants.
Dans ce Brésil dictatorial, les forces de l'ordre jouent un rôle crucial. Le début de l'histoire nous fait découvrir la police militaire, dont l'intégrité ne semble pas être la qualité principale. La suite met surtout en scène la police civile, en particulier une brigade criminelle... vraiment criminelle. S'ajoutent à cela des "intervenants illégaux", parfois anciens militaires, qui aident les ripoux dans leurs sales besognes.
Cette ambiance sombre est parsemée de rayons de soleil : les relations entre les "gentils" de l'histoire, en particulier ceux hébergés dans une étrange résidence, tenue par une vieille dame à la langue bien pendue, mais capable de garder certains secrets. J'ai aussi aimé l'insertion des requins dans l'histoire, ceux de fiction (des Dents de la mer) comme ceux de la réalité (vraiment gloutons).
On s'approcherait du chef-d’œuvre s'il n'y avait pas quelques imperfections, comme l'indolence de la réalisation, qui fait partie du style de Mendonça. J'ai donc trouvé cela un peu long... et pas toujours très bien joué, au niveau des seconds rôles. Heureusement, Wagner Moura et Sebastiana de Medeiros (qui incarne la mamie révolutionnaire) sont formidables.
17:42 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 12 décembre 2025
Deux Procureurs
Il était une fois, au royaume merveilleux du Marteau et de la Faucille, un jeune homme, éperdu de Droit et de Justice. Armé de son courage et de sa serviette en cuir, il partit à l'assaut des ennemis du peuple, tout en songeant à sauver les innocents malencontreusement accusés. Hélas, hélas, trois fois hélas ! Dans sa quête, il rencontra maintes figures malfaisantes, que sa persévérance pourrait ne pas suffire à contourner. Son salut va-t-il venir du Prince à la Moustache ou de l'un de ses plus zélés serviteurs ? Mystère...
Trois ans après le passionnant Babi Yar. Contexte, Sergei Loznitsa revient avec un autre tableau de système totalitaire, le stalinisme succédant au nazisme, auquel, parfois, il ressembla tant.
Comme le réalisateur n'est pas un manche, il suggère plus qu'il ne montre. Le résultat n'en est pas moins implacable. De l'extension de la prison aux conséquences des tortures infligées par le NKVD (ancêtre du KGB), en passant par le côtoiement de figures taiseuses, mais ô combien patibulaires, les procédés de mise en scène excellent à nous faire ressentir ce qu'était ce régime oppresseur, faussement émancipateur.
Les sous-entendus sont nombreux dans les scènes de dialogues, entre le jeune procureur et, successivement, le directeur-adjoint de la prison, le directeur, le "détenu spécial" (qu'il connaît), le procureur général Vychinski et, enfin, ce duo d'ingénieurs rencontré dans le train, dont les plus avisés des spectateurs comprendront très vite quel rôle ils jouent.
C'est clairement un film de décorateur et d'acteurs (en plus de metteur en scène). Tout ce petit monde est excellent. On regrettera juste quelques lenteurs et, pour le vieux cinéphile (et amateur d'histoire du XXe siècle) que je suis, une certaine prévisibilité.
Cela reste une remarquable fiction sur un monde totalitaire, qu'on espère ne plus jamais revoir en fonction.
P.S.
En complément, on peut (re)voir L'Ombre de Staline, d'Agnieszka Holland.
21:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 09 décembre 2025
Touch - Nos étreintes passées
Séance de rattrapage pour moi, qui avais raté ce film à sa sortie, l'été dernier. Fort heureusement, il bénéficie d'un très bon bouche-à-oreille, à tel point que certains cinémas ont eu la bonne idée de le reprogrammer. Je l'ai donc découvert récemment, à l'occasion d'un déplacement... et je n'étais pas le seul à avoir eu cette idée, puisque la petite salle était copieusement garnie (plutôt de "tempes argentées", l'auteur de ces lignes faisant office de gamin dans cette auguste assemblée).
Tout commence lors d'un enterrement, en Islande. L'ambiance n'est pas à la gaudriole, d'autant que le personnage principal, Kristófer, apprend qu'il est gravement malade. Peut-être à cause de cela, il se replonge dans son passé et repense à sa période estudiantine, à Londres, en 1969-1970. Alors féru d'économie, il s'était découvert une passion pour la cuisine... et la fille d'un restaurateur japonais. Au départ, on ne sait pas comment a fini cet amour de jeunesse. Les scènes de 2020 (en plein Covid) alternent avec les retours en arrière, que j'ai trouvés splendides et d'une grande subtilité. On aurait pu intituler ce film La Délicatesse des sentiments. A la mise en scène se trouve Baltasar Kormákur, auquel on doit plusieurs épisodes d'une excellente série policière islandaise : Trapped ainsi que le polar Jar City.
La suite prend la forme d'une enquête biographique. Kristófer part à la recherche de son ancien amour, d'abord à Londres, puis au Japon. Le restaurateur ferme son établissement, évite de répondre à sa belle-fille au téléphone, mais noue de précieuses relations à chaque étape de son voyage. C'est l'un des bonheurs de cette histoire, pétrie d'humanité, qui montre ce vieil homme malade, animé par un feu aussi ancien qu'ardent, mener sa quête. L'une des plus belles séquences le voit rencontrer un autre veuf, au Japon.
Dans les scènes du passé, rien n'est à jeter. De la naissance d'un amour improbable à la transmission d'un art culinaire (en passant par les questionnements concernant l'exil au Royaume-Uni de cette famille japonaise incomplète), tout est amené avec subtilité, douceur, le tout servi par une photographie superbe.
C'est incontestablement l'un des plus beaux films de l'année 2025, qui fut pourtant riche en bonheurs cinématographiques... et n'est pas encore terminée !
21:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 05 décembre 2025
Pompéi, sous les nuages...
C'est la traduction, en français, du titre italien Sotto le Nuvole, à prendre au sens propre comme au sens figuré.
Pourquoi aller voir ce documentaire ? D'abord pour en apprendre un peu plus sur le site de fouilles de l'une des plus célèbres catastrophes naturelles. Ensuite parce que c'est réalisé par Gianfranco Rosi, dont le Fuocoammare m'avait favorablement impressionné, il y a une dizaine d'années. Enfin, parce que c'est tourné en noir et blanc... et, franchement, c'est superbe.
Seule une partie du sous-sol de Pompéi a été fouillée, sans doute faute de moyens, pour mener les recherches... et sauvegarder ce qui a été mis à jour. Le film nous propose plusieurs aperçus des réserves, riches en œuvres d'art (notamment des sculptures)... et en figures statufiées, les fameux moulages réalisés jadis, qui nous montrent humains comme animaux face à une mort brutale. On ne peut pas ne pas être ému devant ce couple avec un enfant en bas âge, ce chat esseulé ou ces chiens piégés dans les cendres durcies, pour l'éternité.
Les chercheurs (italiens, anglo-saxons et même japonais) ne sont pas les seules personnes intéressées par ces vestiges. Depuis des années, des individus peu scrupuleux (et bien organisés) réalisent des fouilles clandestines (dont la cartographie présentée à l'écran montre l'ampleur des ravages...)... ou bien s'introduisent sur des sites officiels, pour les piller. Saisissante est la découverte des tunnels, parfois creusés sur des dizaines de mètres... et dotés de l'éclairage (voire d'un moyen de communication sommaire). Cela n'atteint pas l'ampleur des aménagements réalisés par le Hamas (sous Gaza et une partie d'Israël et de l’Égypte), mais c'est tout de même impressionnant.
Pour les habitants actuels de la région de Naples, même si le Vésuve semble un peu endormi, la menace demeure présente, perceptible dans les petites secousses qui surviennent assez fréquemment, provoquant un afflux d'appels téléphoniques au centre de secours des pompiers. La caméra s'attarde dans ces locaux, où les appels les plus nombreux concernent les actes de délinquance, dans une ville où une partie de la population est paupérisée, sans parler de l'influence subreptice de la Camorra (sur laquelle le film demeure allusif, peut-être par prudence).
On est donc très surpris d'entendre les marins syriens d'un navire-cargo se féliciter du calme et de la sécurité qui règnent à Naples... en comparaison de leur pays d'origine... et de l'Ukraine, où ils se sont arrêtés auparavant pour charger une cargaison de blé.
Risi profite de la moindre occasion pour nous offrir des portraits de Napolitains, qu'ils soient des résidents anciens ou de passage. J'ai beaucoup aimé les scènes avec le retraité entouré de livres, qui propose du soutien scolaire à des enfants des quartiers pauvres. A l'occasion de ces scènes, on entendra parler de la France, celle de la Révolution, de Napoléon... et de Victor Hugo.
Même si c'est, à mon avis, un poil trop long (1h50), j'ai été passionné, transporté par cette tranche de vie, qui traverse le temps et les classes sociales pour nous proposer un portrait de ville qui n'a rien de fumeux.
samedi, 29 novembre 2025
Eleanor the Great
Eleanor Morgenstein a 94 ans. Elle vit une retraite paisible en Floride, où elle cohabite, depuis une dizaine d'années, avec sa meilleure amie Bessie, veuve comme elle. Celle-ci a parfois des nuits agitées, troublées par des souvenirs enfouis, ceux de son enfance en Pologne : Bessie est une rescapée de la Shoah, tandis qu'Eleanor, juive aussi, est née aux États-Unis.
La première partie nous fait suivre la vie quotidienne de ces deux mamies, l'une timide, l'autre plutôt grande gueule : c'est Eleanor, qui "harponne" l'employé peu zélé d'une supérette pour qu'il aille chercher dans les stocks le produit qui a disparu des rayons. Elle ose davantage que son amie, qui est ravie de suivre son sillage. La vivacité de la nonagénaire n'épargne pas sa famille (sa fille et son petit-fils) que son retour à New York (dans des conditions que je laisse à chacun le soin de découvrir) n'enchante pas trop.
C'est là que la situation dérape : se sentant seule et ne parvenant pas à faire son deuil, Eleanor va se laisser entraîner dans une série de mensonges... ou plutôt de demi-mensonges : les souvenirs qu'elle raconte ne sont pas faux, mais ce sont ceux de Bessie, pas les siens. Tout cela est mis en scène avec délicatesse, de la subtilité, des non-dits. Pour sa première réalisation, Scarlett Johansson fait preuve d'une incontestable maîtrise.
Une relation prend de plus en plus de place, celle nouée entre Eleanor et Nina, une étudiante, fille d'un présentateur vedette de la télévision, qui vient de perdre sa mère et ne trouve personne à qui parler. De surcroît, cette mère était juive (contrairement à son père), ce qui accroît le nombre de questions que se pose la jeune femme.
Dans ce film, les hommes sont au second plan... et ce n'est pas un problème, tant les relations entre les personnages féminins sont riches. Il y a bien sûr celle entre Eleanor et Bessie, mais aussi celles entre Eleanor et sa fille Lisa, entre Eleanor et Nina, entre Eleanor et April (une authentique rescapée des camps)...
Si les mensonges d'Eleanor suscitent le malaise (un peu à l'image de ce qu'on ressent en regardant Marco, l'énigme d'une vie), la réalisatrice ne juge pas, elle donne sa chance à chaque personnage, avec ses qualités et ses défauts. Cela va même un peu trop loin à mon goût, puisque, dans le dernier quart d'heure, on sent la volonté de réconcilier tout le monde. Cela n'en demeure pas moins une histoire forte, servie par de très bons interprètes.
21:49 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 20 novembre 2025
La Bonne Etoile
A travers cette improbable épopée familiale, en pleine Seconde Guerre mondiale, Pascal Elbé a le projet de dénoncer les préjugés antisémites, par l'absurde : c'est parce qu'il pense (à tort) que les "Israélites" sont mieux traités que les autres que le catholique Jean Chevalin fait faire des faux papiers juifs pour toute sa famille.
Si la scène chez l'horloger-faussaire est plutôt bien troussée, en revanche, ce qui se déroule avant n'est pas très engageant. On découvre Chevalin pendant la Débâcle de 1940 (avec une confusion chronologique entre l'invasion de la Pologne de septembre 1939 et celle de la France en mai-juin 1940). Ce n'est pas bien joué, mais c'est une séquence nécessaire pour comprendre l'un des fils rouges de l'intrigue : Chevalin a le cul bordé de nouilles, puisqu'il réchappe d'un bombardement de l'armée allemande, récupère divers biens, se fait passer pour un résistant et survit à un accident de camion. Et pourtant, il en fait des conneries... La faconde et l'engagement de Poelvoorde ne suffisent pas à rendre le personnage crédible, contrairement à celui de son épouse, très bien incarnée par Audrey Lamy.
Je n'ai pas envie de m'acharner, d'autant que certains gags sont réussis, mais c'est quand même globalement mal foutu, pas très crédible, monté à l'arrache. Les intentions ont beau être généreuses, je n'ai pas accroché.
11:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 19 octobre 2025
Jour J
Cette pantalonnade signée Claude Zidi Junior mêle des éléments authentiquement historiques, d'autres fictionnels mais plausibles, d'autres encore totalement grotesques.
Du côté de la réalité se trouve l'Opération Fortitude, une entreprise de désinformation qui avait pour but de faire croire aux Allemands que le premier débarquement de 1944 allait se produire non pas en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais. Il y a donc bien eu des chars gonflables, entre autres, pour leurrer les avions espions. Mais, à ma connaissance, c'étaient des soldats américains et britanniques qui œuvraient dans ce domaine, pas des Français.
C'est là que les ennuis commencent. Kev Adams et Brahim Bouhlel ont beau avoir un certain talent à jouer les imbéciles, quand l'histoire est mauvaise et les dialogues mal écrits, ça ne le fait pas.
Il y a bien quelques moments piquants, comme lorsque les deux trouducs débarquent, tout seuls, en Normandie, et se retrouvent dans un bar qui affiche les portraits d'Hitler et de Pétain (la suite réservant quelques surprises). J'ai aussi aimé les (rares) interventions de Chantal Ladesous. Dans les rôles secondaires, Didier Bourdon (en officier nazi) et Jonathan Lambert (en curé très très ouvert) font un boulot qui n'est pas déshonorant. Mais l'on sent bien que pas grand monde n'y croit. Trop de situations sont invraisemblables, ce que ne compense pas la loufoquerie assumée. (Je déconseille particulièrement ce film aux gaullistes fervents, en raison de la vision du Général qui y est proposée.)
Le scénario est donc faiblard. Il comportait pourtant un élément intéressant, faisant intervenir une arme secrète (fictive) des nazis. Ici, on s'inspire plutôt des aventures de Blake et Mortimer (première mouture), quand les auteurs faisaient se rencontrer histoire et science-fiction. Hélas, le site du phare est sous-exploité par le réalisateur.
Ce pathétique long-métrage aurait pu être pour moi une nouvelle occasion de partir avant la fin... et cela aurait été une erreur (hélas commise par les deux autres seuls spectateurs de la séance). Le générique de fin est entrecoupé d'un bêtisier... et c'est le meilleur moment du film !
P.S.
Papy fait de la résistance va bientôt ressortir en salles... et la comparaison risque d'être sévère pour Jour J, qui se place dans la continuité de La Grande Vadrouille, mais ne lui arrive pas à la cheville.
09:45 Publié dans Chine, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mercredi, 15 octobre 2025
Le pire portrait ?
L'hebdomadaire états-unien Time Magazine a fait sa dernière Une avec le président des Etats-Unis, pris en contreplongée :
Cela peut être perçu à la fois comme une glorification et une critique... et c'est ainsi que Donald Trump lui-même l'a compris, qualifiant (avec le sens de la mesure qui le caractérise) cette photographie de « pire de tous les temps » (worst of all time). En effet, l'angle de la prise de vue ne permet pas d'ignorer le cou de poulet du président des Etats-Unis, ainsi représenté en vieillard (certes puissant). De plus, ses cheveux (désormais blancs) sont à peine visibles.
En réalité, la critique la plus mordante ne porte sans doute pas sur l'âge du capitaine (79 ans depuis juin dernier), mais sur sa posture martiale, qui, à celles et ceux qui ont déjà vu de vieilles images de propagande, fait immanquablement penser à un ancien dirigeant européen :
Ce célèbre tableau d'Alfredo Ambrosi glorifie Benito Mussolini, en 1930. Dans la même veine (fasciste), on trouve plusieurs affiches, comme celle-ci de 1932 :
... ou celle-ci, datant de 1941 :
Mussolini se faisait très souvent représenter le menton levé, en contreplongée. Aujourd'hui, les postures du dictateur italien nous semblent bravaches, souvent ridicules, mais à l'époque, cela ne faisait pas rire.
Je n'ai rien lu ni entendu concernant cette Une de Time la rattachant à cette iconographie. Pourtant, je suis persuadé que, du côté des journalistes, plus d'une personne a songé à ce rapprochement.
22:35 Publié dans Histoire, Politique, Politique étrangère, Presse | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, presse, journalisme, histoire, politique internationale, états-unis
samedi, 11 octobre 2025
Cervantes avant Don Quichotte
Le critique a été sévère pour ce film d'Alejandro Amenábar, à la diffusion restreinte. Il évoque pourtant une partie de la jeunesse du grand écrivain espagnol, en y instillant des éléments qui montrent la progressive naissance d'un (talentueux) raconteur d'histoires.
L'épisode (réel) de la captivité de Miguel de Cervantes est évoqué, de manière allusive, dans l'une de ses Nouvelles exemplaires, celle qui est intitulée « L'Espagnole anglaise ».
Le scénario a aussi puisé dans un récit ultérieur, officiellement rédigé par un moine, mais qui pourrait avoir été coécrit par Cervantes lui-même. Amenábar y a ajouté quelques inventions de son cru, ce qui lui a été reproché.
J'ai trouvé l'entame plutôt emballante. On nous y montre les débuts de la captivité d'un groupe d'Espagnols, vendus aux enchères comme esclaves à Alger, où ils ont été livrés par des pirates à la solde des Ottomans (turcs). Signalons que le film a été tourné dans le sud de l'Espagne, où subsiste une abondante architecture de l'époque musulmane. De superbes décors ont été ajoutés, conçus en partie par un Français. Le résultat est assez bluffant.
La suite est tout aussi passionnante. Les captifs jugés "de valeur" sont extraits de la vente aux enchères. Le pacha d'Alger Hassan Veneziano (un Italien converti) veut en tirer un bon prix, grâce à la rançon payée par les familles. A ceux pour qui le temps passe trop lentement, ou qui n'ont plus de perspective de libération par rachat, on propose la conversion (publique), qui permet de sortir de la captivité (mais pas de quitter l'Algérie).
Les plus courageux (inconscients ?) n'envisagent qu'une sortie honorable : l'évasion. Au départ, Cervantes fait partie de ceux-ci. Le film n'évoque qu'une de ses quatre tentatives... en fait plusieurs, puisque, pour rendre plus agréable la vie de ses camarades de détention, le jeune Espagnol se met à leur raconter des histoires, tantôt inspirées de la réalité, tantôt complètement imaginées. C'est l'un des attraits de ce film que de mêler habilement les deux, sollicitant la sagacité des spectateurs.
La réputation de conteur de Cervantes atteint les oreilles du pacha, avec lequel le captif va nouer une bien étrange relation. Ici, le film se teinte d'homo-érotisme, ce qui a provoqué quelques réactions outrées en Espagne : les spécialistes de l'écrivain réfutent l'existence d'un penchant homosexuel chez Cervantes. Dans le film, Amenábar introduit le sujet avec une certaine délicatesse... mais, bon, ce n'est pas vraiment ma came. Certaines scènes témoignent toutefois d'un incontestable savoir-faire, bien servies il est vrai par le talent de l'interprète du pacha, Alessandro Borghi. (Chez nos voisins transalpins, il est connu pour avoir récemment joué dans la mini-série Supersex, où il incarne un certain Rocco Siffredi...)
D'autres comédiens m'ont marqué, comme Fernando Tejero (qui incarne un religieux aussi fanatique que fourbe), Miguel Rellán (qui interprète l'autre écrivain de cette histoire) et César Sarachu, alias frère Juan Gil, l'un des deux Trinitaires chargés de racheter les captifs. La première apparition des deux religieux dans l'enceinte fortifiée dirigée par le pacha ne manque pas de sel :
En dépit de quelques entailles à la réalité historique, j'ai été captivé par cette histoire, qui dénonce tous les extrémismes, de la cruauté des barbaresques musulmans au fanatisme d'une partie de l’Église catholique espagnole. Un grand appétit de vivre et un humanisme sincère émergent de cette petite épopée, qui se distingue des productions actuellement en salles.
23:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 08 août 2025
Malheur aux vaincus
Contrairement à ce que le titre du billet pourrait sous-entendre, il ne va pas être question ici des exploits du Gaulois Brennus dans la Rome antique, mais d'un roman contemporain, de Gwenaël Bulteau, dont je me suis procuré l'édition de poche.
L'action principale se déroule à Alger, en 1900, mais une seconde trame est entremêlée à la première, celle de la mission Voulet-Chanoine, qui a sinistrement fait parler d'elle l'année précédente. Les chapitres évoquant celle-ci sont rédigés en caractères italiques. Ils alternent avec la trame principale, elle-même composée d'un kaléidoscope colonial. Il faut un petit moment pour comprendre quels sont les liens entre les deux trames et quels personnages de 1899 sont présents à Alger en 1900.
A cette époque, cette ville est en plein trouble politique. Elle vit ce qu'on pourrait qualifier son "moment antisémite", notamment sous l'impulsion de l'ancien maire Max Régis. En paroles et en actes, la haine des juifs exprimée par ces colons (qui s'appuient parfois sur la population musulmane, que pourtant ils méprisent) apparaît grande, mais je crois pouvoir dire que, sauf à la toute fin, elle est atténuée par rapport à ce qu'elle fut.
Il y a donc des personnages réels dans cette intrigue, qui croisent ceux de fiction, parfois inspirés d'authentiques personnes. Dans la ville coloniale se croisent colons de diverses origines (italienne, espagnole, alsacienne, nordiste, gardoise...), "indigènes" musulmans et juifs locaux, devenus citoyens français de plein droit depuis le Décret Crémieux de 1870, qui insupporte aussi bien les colons antisémites qu'une partie de la population musulmane.
Un massacre commis dans une belle propriété coloniale suscite beaucoup d'interrogations. Les victimes sont au nombre de six (quatre hommes et deux femmes), assassinées de différentes manières. Deux armes à feu sont notamment en cause, l'une d'entre elles d'origine inconnue. Un lieutenant philanthrope est chargé de l'enquête, puisque l'une des victimes est un officier de l'armée française, trois autres étant des soldats africains présents sur place.
Colonialisme, racisme, antisémitisme, misère sociale sont au programme de l'intrigue, qui évoque aussi les bagnes militaires. Ces aspects macabres sont atténués par deux histoires d'amour (une dans chaque trame du récit) et une relation particulière qui se noue entre une commerçante d'origine alsacienne et des enfants des rues, débrouillards mais soumis à diverses violences.
C'est bien écrit, documenté, passionnant. Il vaut mieux connaître un peu l'histoire de cette époque avant d'en commencer la lecture.
14:08 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livre, livres, lecture, roman, littérature, littérature française
jeudi, 31 juillet 2025
Au secours du Titanic
En furetant dans une librairie de centre-ville, j'ai récemment découvert un petit ouvrage passionnant, dont je recommande vivement la lecture :
L'auteur est un journaliste plutôt spécialiste de l'histoire de l'aviation, mais, il y a quelques années de cela, il s'est pris de passion pour l'histoire du célèbre paquebot (présumé) insubmersible. Dans cet ouvrage, il s'est concentré sur le capitaine du navire de secours, le Carpathia, mais il aborde bien d'autres aspects.
Je vais commencer par la seule limite à mon enthousiasme : les faibles développements consacrés à la vie antérieure d'Arthur Rostron (le capitaine). Celles et ceux avides d'en savoir davantage sur lui peuvent se ruer sur la fiche qui lui est consacrée (en anglais) sur le site de l'Encyclopédie Titanic.
Pour le reste, c'est passionnant, nourri de détails, d'anecdotes, de la vie du Titanic avant son voyage inaugural (et le scepticisme de Rostron quant à son insubmersibilité) aux commissions d'enquête créées, aux États-Unis puis au Royaume-Uni, dans la foulée du naufrage.
On apprend notamment combien de navires se trouvaient à relative proximité du Titanic, ce soir-là, l'identité de l'un d'entre eux (un bateau de pêche norvégien) n'ayant été découverte que plus tard. L'ouvrage explique en détail le fonctionnement des radios de bord, ainsi que l'usage des signaux lumineux, ceux-ci n'ayant pas toujours été correctement interprétés. Il en profite pour brosser le portrait de certains acteurs, notamment l'unique responsable radio du Carpathia, qui a vécu plusieurs journées homériques... et très peu dormi.
Le cœur de l'ouvrage est constitué par le sauvetage des 706 rescapés du naufrage (712 selon l'encyclopédie en ligne), de la prise de décision du capitaine (qui a consulté auparavant ses officiers) à l'arrivée du Carpathia à New York. (Ce navire devait relier la côte Atlantique des États-Unis au sud de l'Europe, mais il a fait demi-tour pour ramener les rescapés aux États-Unis, avant d'ensuite reprendre le trajet initial, le capitaine ne voulant pas manquer à son devoir.) Celle-ci a d'ailleurs été brièvement filmée à l'époque.
L'ouvrage revient aussi sur le destin de plusieurs rescapés, parfois anonymes, parfois connus, comme Bruce Imay, le président de la White Star Line (propriétaire du Titanic), le Carpathia appartenant lui à une concurrente, la Cunard Line.
La fin de l'ouvrage est en partie consacrée au rôle des médias. A l'époque, les communications ne sont pas aussi rapides (et fiables) qu'aujourd'hui. Du coup, beaucoup de rumeurs et de fausses nouvelles ont circulé, avant que le Carpathia ne puisse transmettre des informations fiables. L'auteur pointe notamment l'action néfaste (selon lui) de William Randolph Hearst (Citizen Kane) et des organes de presse qu'il contrôlait.
C'est bien écrit, découpé en petits chapitres. J'ai dévoré le bouquin en une soirée. Il donne envie de revoir le film de James Cameron.
17:42 Publié dans Histoire, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : histoire, culture, livre, livres, société
samedi, 12 juillet 2025
Buffalo Kids
Cette animation espagnole a été réalisée par l'équipe à laquelle on doit Sacrées Momies. Les héros sont des enfants irlandais, qui débarquent à New York en octobre 1886, en pleine inauguration de la Statue de la Liberté. De là, ils doivent rejoindre la Californie, où vit leur oncle. Leur périple ne sera pas de tout repos...
Le film est tout public, mais touchera sans doute davantage les jeunes que les adultes. Ceux-ci peuvent agrémenter la projection en essayant de repérer les allusions qui leur sont destinées. Ainsi, la rouquinissime Mary (qui, dans la version originale, est jouée par une actrice irlandaise), en approchant de New York, se prend pour Jack dans Titanic. Plus tard dans l'histoire, un personnage indien se la joue De Niro dans Taxi Driver.
Hélas, ce double niveau de lecture est rarement présent dans le film. C'est très souvent premier degré, mais avec du fond. La principale originalité est d'avoir composé un trio de héros incluant un garçon gravement handicapé. On est prié de croire qu'il va survivre à toutes les épreuves rencontrées dans un Far-West ô combien dangereux. Toutefois, on a peu atténué les difficultés de sa vie quotidienne et, comme le film doit être vu par un jeune public, je trouve que c'est une belle leçon à lui transmettre.
La volonté de bien faire est néanmoins trop voyante, pour un(e) adulte. Ainsi, les héros se retrouvent embarqués (clandestinement) dans un train (à destination de la Californie) en compagnie d'une troupe d'orphelins, où Blancs et Afro-américains sont mélangés sans distinction. Certes, depuis 1865, les hommes de toutes les couleurs sont censés avoir les mêmes droits aux États-Unis, mais la fin du XIXe siècle voit la mise en place de la ségrégation, dans les États du Sud. On présume donc que ce train les évite et qu'il relie New York à Sacramento en passant par Chicago et Omaha (en noir ci-dessous) :
(cliquer sur la carte pour l'agrandir)
Le ligne transcontinentale, achevée peu après la Guerre de Sécession, évite soigneusement les anciens États esclavagistes et les (futurs) États ségrégationnistes (marqués d'un disque rouge à croix noire, ci-dessus).
Je me demande tout de même s'il est vraisemblable qu'en 1886, le contrôleur de tous les passagers du train soit afro-américain.
Les mêmes intentions sont à l’œuvre lors de la rencontre d'Indiens Cheyennes (qui, à l'époque où est censée se dérouler l'intrigue, ont déjà été soumis, voire massacrés. Sur la carte qui figure plus haut dans ce billet, leur territoire est grosso modo délimité avec un tireté vert.) J'ai trouvé cet épisode très réussi. On s'y moque gentiment des enfants d'origine européenne, de leurs préjugés, et l'échange pacifique prend le dessus sur le risque de confrontation.
Peu avant ce passage on voit apparaître des bisons (buffalo, dans la langue de William Cody). C'est un moment assez touchant et c'est aussi pour moi l'occasion de signaler que les animaux sont, de manière générale, très bien dessinés et animés. Outre les bisons, on voit des chevaux et... un chien, plus précisément un chiot abandonné, dont Mary refuse de se séparer. Il est la source de quelques gags.
La suite est moins drôle, lorsqu'intervient une bande de braqueurs de trains, accessoirement chercheurs d'or. Ces types odieux vont en faire voir de toutes les couleurs à nos héros... mais ceux-ci ne manquent pas de ressource. Le jeune public sera sans doute conquis par le stratagème "caca-prout" imaginé par Mary pour échapper à ces tristes sires.
Voilà. Pour un(e) adulte, c'est plaisant, sans plus. Pour les petits, le film allie divertissement à leçons de morale.
13:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 08 juillet 2025
13 jours 13 nuits
Environ deux ans après les entraînants D'Artagnan et Milady, Martin Bourboulon nous replonge dans une histoire prenante, cette fois-ci pas adaptée d'un célèbre roman, mais d'un livre autobiographique (dont je reparlerai plus loin). Les scénaristes ont choisi de concentrer l'intrigue sur l'évacuation des civils de l'ambassade de France à Kaboul, en 2021, faisant de ce film un thriller géopolitique assez captivant.
Je n'ai quasiment que des compliments à formuler : l'image est soignée, certains plans sont inventifs, la musique est parfaitement adaptée et la plupart des acteurs sont très bons, notamment Roschdy Zem et Lina Khoudry. Ils sont entourés d'une pléiade de seconds rôles le plus souvent convaincants, qu'ils incarnent des policiers, des civils ou des taliban.
Je suis un peu moins emballé par la prestation de Sidse Babett Knudsen, qui incarne une journaliste anglo-saxonne qui ressemble plutôt à une travailleuse humanitaire... un personnage qui d'ailleurs ne figure pas dans le livre de Mohamed Bida (interprété par Roschdy Zem).
J'ai aussi été gêné par le mélo créé artificiellement autour du personnage de l'interprète (jouée par Lina Khoudry) et de sa mère. On a ajouté d'inutiles péripéties et un côté larmoyant dont le sujet n'avait pas besoin, tellement il est fort. (De surcroît, dans le livre, le commandant français n'a que des hommes pour lui servir d'interprètes avec les taliban, dont je doute qu'ils aient accepté de passer par une femme, fût-elle voilée.)
Cela m'amène donc au bouquin, qui vient d'être réédité en collection de poche :
La relation de ses deux dernières semaines à Kaboul est entrecoupée de fragments d'un récit autobiographique, celui d'un fils de harki, dont les parents, réfugiés d'Algérie, sont passés par les camps de Rivesaltes et du Larzac. Ce fils d'immigrés a connu le racisme, dans son quartier et dans la police, qu'il a intégrée un peu par hasard.
En lisant le texte, on comprend qu'on a affaire à un type tenace, habitué à surmonter d'énormes difficultés depuis le plus jeune âge ce qui, sans qu'il le sache par avance, l'a sans doute préparé à l'incroyable mission de sauvetage de Kaboul.
Le livre est d'une lecture aisée et il complète formidablement le film. Je recommande donc vivement les deux.
15:39 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 21 juin 2025
Les Mots qu'elles eurent un jour
... mais qui ont été perdus. C'est ainsi qu'on pourrait compléter le titre de ce documentaire consacré à une vingtaine de "moudjahidate", des indépendantistes algériennes qui avaient été emprisonnées, durant la Guerre d'Algérie (1954-1962) .
Elles avaient été filmées en 1962, à leur sortie de prison, mais les bobines avaient disparu. Certaines ont été retrouvées par hasard, formant un corpus d'environ 40 minutes, mais sans le son (enregistré à part, à l'époque). Depuis une douzaine d'années, le documentariste Raphaël Pillosio mène l'enquête, dont le déroulement et les résultats sont présentés dans ce film.
Les extraits du matériau de 1962 alternent avec d'autres images d'archives (notamment d'actualités anciennes) et des entretiens réalisés au XXIe siècle.
Ces femmes (en 1962) sont jeunes, toutes vêtues "à l'occidentale", mais d'origines et de cultures différentes : arabes, berbères, pieds-noirs, musulmanes, chrétiennes, juives, athées. Celles qui ont été retrouvées, des années après, et qui ont accepté de témoigner, disent avoir voulu "faire la révolution" ou tout simplement se battre contre la domination française. Certaines d'entre elles évoquent l'aspect féministe de leur engagement, le point sur lequel "l'Algérie nouvelle" (indépendante) les a sans doute le plus déçues, puisque les mecs qui sont arrivés au pouvoir ont vu d'un mauvais œil l'activisme de celles qui étaient pour eux d'abord des compagnes et des (futures) femmes au foyer.
Vous aurez d'ailleurs peut-être remarqué, sur la photographie qui illustre ce billet, la présence de deux hommes (le troisième étant sans doute un technicien), qui ne s'expriment jamais, mais semblent surveiller ce qu'il se passe pendant ce tournage militant. (On finit par apprendre que toute l'équipe est constituée de sympathisants de la cause algérienne, sans doute marxistes.) Ils avaient été envoyés par le nouveau pouvoir algérien, pour rapatrier au plus vite les prisonnières de métropole. Le réalisateur raconte comment il a tenté de retrouver l'un des deux hommes.
N'étant pas parvenu à mettre la main sur la bande son, il a pensé pouvoir compter sur les souvenirs des participantes. Mais, 50 à 60 ans plus tard, ils se sont le plus souvent effilochés. Du coup, il a eu recours à des spécialistes de lecture labiale, avec des résultats mitigés. (En tout cas, les échanges filmés se sont tenus en français.)
Certains moments sont poignants, comme l'évocation qu'une séance de torture (par des militaires français). On regrette d'autant plus que ces femmes n'aient pas été davantage interrogées sur les conséquences de leurs actes. Je crois qu'environ la moitié de celles qui s'expriment ont, à un moment ou à un autre, été des porteuses/poseuses de bombes. C'est la principale limite de ce documentaire au demeurant fort intéressant.
Peut-être qu'un jour, le recours à une intelligence artificielle permettra de décrypter intégralement les conversations de 1962, ces bobines constituant une matière brute de grand intérêt.
12:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 01 juin 2025
Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé
... pour Nicolae Ceausescu, puisqu'il a été exécuté à la Noël 1989. Mais, ça, les Roumains ordinaires comme les serviteurs de la dictature communiste ne pouvaient pas le savoir à l'avance. Cette comédie politique nous présente donc les destins croisés d'une quinzaine de personnages, aux origines, aux métiers et aux opinions diverses. Dans les jours qui précèdent le 25 décembre 1989, ils vont se croiser, parfois interagir et leur vie va en être (souvent) bouleversée.
Le procédé rappelle celui mis en œuvre par Robert Altman dans Short Cuts (sorti en 1994... Mon Dieu comme le temps passe). Ici, les protagonistes sont :
- un agent de la Securitate et sa mère
- un employé d'une entreprise d’État, sa femme et son fils (qui a écrit au Père Noël)
- une quasi-voisine, actrice de théâtre, recrutée pour une émission de propagande
- le metteur en scène, accessoirement son amant
- le réalisateur de l'émission de propagande, son épouse et son fils rebelle
- le meilleur ami de ce fils rebelle, qui rêve de quitter la Roumanie
L'action se déroule donc juste avant celle du récent Libertate. La manière dont la terrible police politique espionne, contrôle et brutalise la population est très bien mise en scène. On pense aussi à la Stasi et à ce qu'en montrait La Vie des autres.
Le fond est donc dur, mais aussi bourré d'humour, noir de préférence. Ainsi, l'ouvrier commence à perdre les pédales quand il découvre ce qu'a demandé son fils au Père Noël. Les agents de la Securitate ne savent pas comment faire pour effacer des écrans la principale intervenante de l'émission de propagande (déjà enregistrée pour Noël)... qui a fui le pays. L'équipe de télévision vit sous leur pression et déploie des trésors d'imagination. Le réalisateur lui-même se demande jusqu'où il doit aller pour prouver sa fidélité au régime... sans insulter l'avenir, les nouvelles du reste de la Roumanie tendant à montrer que le régime vacille...
C'est donc passionnant : on ne sait pas ce qu'il va arriver à chaque personnage ; on ne sait pas à l'avance qui va croiser qui et l'on est plongé dans la Roumanie des années 1980, où circulent de vieilles Renault, dont les fameuses R12, produites par une entreprise qui, par la suite, a pris le nom de Dacia.
Les 2h15 passent très facilement. Je recommande vivement.
20:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 29 mai 2025
Les grands-parents du Pape
Il y a trois semaines, je me suis un peu emballé concernant les origines du nouveau pape. Un mystère subsistait à propos de sa grand-mère paternelle, Suzanne Louise Marie, à laquelle plusieurs documents d'archives attribuaient le patronyme Fabre.
En réalité, comme le démontre un article de Geneanet, Fabre semble n'avoir été qu'un nom d'emprunt. La grand-mère paternelle du futur Léon XIV est née Fontaine, au Havre, comme le confirme son acte de naissance. Son père s'appelait donc Ernest Auguste Fontaine et sa mère Jeanne Eugénie... Prévost !
Or, ce nom est celui sous lequel fut enregistré Jean, son futur mari, aux États-Unis ! Il s'appelait en réalité Giovanni Riggitano, ce qui est plus conforme avec sa naissance en Italie, à Milan. (Mais le nom Prevosto était présent dans le nord de ce pays.) Une trace en est restée dans l'identité finalement adoptée par le grand-père paternel du Pape : John (Jean/Giovanni) R Prevost, le R n'étant pas l'initiale d'un deuxième prénom, mais celui de son nom de famille d'origine.
Pourquoi tant de mystères ? Parce que le grand-père du Pape avait... deux épouses ! Arrivé aux États-Unis en 1905, il a perdu sa première compagne, puis s'était marié avec une certaine Daisy Hughes, en 1914, mais il semble l'avoir rapidement trompée avec Suzanne, arrivée aux États-Unis en 1916. Un premier fils était né de cette liaison, Jean, en 1917, suivi de Louis (le père du Pape) en 1920.
Le grand-père ne semble pas avoir divorcé de Daisy, morte en 1939. A partir de 1940, sur les documents officiels, Jean/John et Suzanne se déclarent mari et femme... mais le coquin pourrait très bien avoir été bigame.
L'ascendance maternelle de Léon XIV réserve elle aussi quelques surprises, rapportées par TF1. Les parents de Mildred Martinez (génitrice de Robert/Léon) venaient de La Nouvelle Orléans. En remontant l'arbre généalogique, on trouve, outre la branche Martinez, la famille Baquié, dont l'origine serait... guadeloupéenne ! Si l'on ajoute à cela une arrière-grand-mère dénommée Eugénie Grambois, on peut conclure que, parmi les ancêtres du nouveau Pape, les Français figurent en bonne place.
16:17 Publié dans Histoire, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique internationale, église, religion, christianisme, catholicisme
dimanche, 25 mai 2025
La Chambre de Mariana
Mariana est une prostituée ukrainienne, à Czernowitz (Cernauti), en Bucovine, une région à l'histoire tourmentée et à la population particulièrement mélangée, ancienne province austro-hongroise, tiraillée ensuite entre la Roumanie et l'URSS. En 1943, elle est repassée sous domination roumano-allemande et l'extermination de son importante population juive est entamée depuis plus d'un an. Voilà pourquoi la mère du jeune Hugo décide de le confier à une personne de confiance... une prostituée ! (Bien plus tard, on finit par découvrir le lien entre les deux femmes.) Le gamin se retrouve dans un hôtel de passe, dissimulé la plupart du temps dans un cagibi. De là, il perçoit les sons du bordel et, par de petits trous, observe tantôt la rue, tantôt la chambre où Mariana reçoit ses clients.
L'idée de mettre (un peu) les spectateurs dans la peau de l'observateur confiné est très bonne, et bien mise en scène, par Emmanuel Finkiel, dont j'avais déjà apprécié Voyages et Je ne suis pas un salaud (en revanche, La Douleur...). Plusieurs types de scènes nous sont proposés : les souvenirs d'Hugo s'entremêlent de fantasmes (notamment celui de la présence de ses proches, disparus) et d'éléments de la réalité, qu'il a du mal à accepter.
Le film repose aussi beaucoup sur les (gracieuses) épaules de Mélanie Thierry, très convaincante en ukrainophone (mais je me demande ce qu'en pensent les locuteurs naturels de cette langue). Je trouve en revanche moins réussies les interactions avec le gamin (surtout dans la première partie).
L'intrigue nous propose un double basculement progressif, dans la relation Mariana-Hugo. Au début, celui-ci est perçu comme un enfant et la prostituée devient une sorte de mère de substitution. Le dernier tiers de l'histoire voit le garçon devenir adolescent (il est passé de 12 à 14 ans) et son regard changer sur sa protectrice, pour laquelle il ressent des sentiments nouveaux. Dans le même temps, l'ancien protégé devient le protecteur (parfois excessif) de la jeune femme. Son activité de prostituée lui a permis de survivre sous l'occupation roumano-allemande, mais le retour des troupes soviétiques (déjà présentes dans la région en 1940-1941, quand le pacte germano-soviétique s'appliquait) la met en position difficile.
J'ai trouvé l'histoire assez belle, forte, même si je n'ai pas trop aimé le dernier quart d'heure. Ce fut aussi un peu long (voire languissant) à mon goût. J'attendais peut-être un peu trop de ce film, qui bénéficie de critiques favorables et d'un bon bouche-à-oreille. J'ai été un peu déçu.
10:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 24 mai 2025
Libertate
C'était le mot d'ordre des Roumains qui, en décembre 1989, manifestaient contre la dictature communiste de Nicolae Ceausescu, qui s'est rapidement effondrée. Mais ce ne fut pas sans dégâts : environ 1 000 morts au total, dont une centaine dans la ville de province de Sibiu, située au centre du pays.
Plus de trente ans après les événements, beaucoup d'incertitudes subsistent quant à l'origine des premiers tirs... et des suivants, personne ne revendiquant la responsabilité de la centaine de victimes, sauf quand ce furent des agents du régime communiste lynchés par la foule, ou exécutés par des révolutionnaires autoproclamés.
La première partie, le plus souvent caméra à l'épaule, est donc obscure, brouillonne, même quand on connaît un peu l'histoire de cette époque. On perçoit bien la fébrilité des fonctionnaires du régime, divisés quant à l'utilisation des armes à feu... et qui attendent des ordres clairs pour se couvrir... ordres qui n'arrivent pas... ou qui sont contradictoires. De surcroît, les différentes forces armées du régime ne sont pas synchronisées, ni en phase quant à la gestion des manifestations. Ajoutez à cela quantité de fausses informations qui circulent, soit involontairement (en raison des délires d'une population habituée à croire au pire), soit volontairement, par des personnes qui cherchent soit à sauver leur peau, soit à tirer les marrons du feu... et vous obtenez une situation explosive. J'ai trouvé cette première partie intéressante sur le fond, mais pénible à suivre sur la forme.
Heureusement, la deuxième partie est plus emballante. Les soutiens présumés du régime, capturés par les "révolutionnaires" et l'armée (qui a lâché le régime... après avoir sans doute tiré sur la foule...), sont emprisonnés dans la piscine municipale vidée de son eau (celle que l'on voit au tout début, ainsi qu'à la fin). Ils croient leur dernière heure venue... mais leurs geôliers ne savent pas trop quoi en faire. La situation met plusieurs semaines à se décanter.
Le réalisateur Tudor Giurgiu met en scène un gigantesque panier de crabes, où se côtoient policiers "classiques", miliciens, gendarmes, membres (autant haïs que redoutés) de la Securitate (souvent comparée à la Stasi est-allemande, et qui semble tout aussi proche de la Gestapo de sinistre mémoire)... ainsi que des enquêteurs de la Brigade des affaires économiques ! Mais qui est qui ? Certains n'auraient-ils pas une double casquette ? Dans ce bassin asséché où s'entassent des dizaines d'hommes blessés, affamés et assoiffés, on ne peut pas faire confiance à grand monde... sans parler des troufions qui n'hésitent pas à pointer leur mitrailleuse du haut des plots de départ. Du coup, ce sont ces présumés agents du communisme (qualifiés de "terroristes") qui se mettent à leur tour à crier "Libertate" !
Cette deuxième partie est vraiment passionnante. Petit à petit, on comprend mieux les fonctions de chacun, même si plusieurs mystères persistent. La situation évolue quand il s'avère que les gradés de l'armée qui soutiennent le "nouveau" régime (réussissant par là à évacuer la question de leur action sous Ceausescu...) n'ont pas l'intention de faire exécuter leurs prisonniers... d'autant que, dans le lot, certains sont des manifestants anti-communistes, arrêtés et tabassés par erreur, parfois à l'initiative des habitants d'un quartier, complètement paranoïaques.
J'ai aussi trouvé intéressante la manière de traiter cet arrière-plan, qui fait écho à notre époque. Des personnes ordinaires propagent avec une extraordinaire conviction des informations bidons et la violence des anonymes se déchaîne la plupart du temps sans raison. C'est donc bien plus qu'une œuvre à caractère historique qui nous est proposée. C'est aussi une réflexion sur le temps présent, qui ne prête guère à réjouissance. Il y a une vingtaine d'années, 12h08 à l'est de Bucarest abordait la même période, mais avec plus d'humour.
17:11 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire