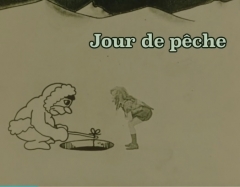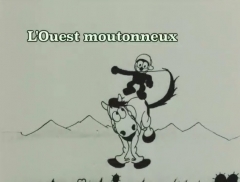mercredi, 18 avril 2018
L'Ile aux chiens
Il a fallu attendre quatre ans (une éternité, dans le monde du cinéma) pour voir sortir le nouveau long-métrage de Wes Anderson. On l'avait quitté en 2014 avec un chef-d’œuvre (The Grand Budapest Hotel), on le retrouve avec... un film d'animation, genre dans lequel il s'est déjà illustré, avec Fantastic Mr Fox.
Accusés de véhiculer une maladie incurable, les chiens sont déportés sur une île poubelle, au large du Japon. Un homme politique populiste en profite pour renforcer son pouvoir et éliminer toute concurrence. Au-delà du divertissement (et de la prouesse technique que constitue l'animation image par image), il s'agit d'une fable politique, qui puise dans notre histoire commune (l'extermination des juifs et des Tsiganes) et traite de sujets ultra-contemporains (la montée des "démocratures").
Dans sa version originale, le film est bilingue anglais-japonais. Cela renforce la vraisemblance des situations (l'action se déroule au Japon) et donne à certaines scènes une saveur inattendue : les personnages ne se comprennent pas toujours. Pourtant, les chiens parlent (anglais) ! Ils sont d'une incroyable vérité et ce alors que l'animation est conçue de manière légèrement saccadée. Cela donne un aspect quelque peu mécanique aux déplacements des personnages... et c'est souvent cocasse.
J'ai adoré entendre parler les canidés. On leur a attribué des voix chaudes, onctueuses, qui contrastent évidemment avec l'état physique des chiens, qui peinent à survivre. Certains d'entre eux sont obsédés par l'idée de voter avant de prendre toute décision : c'est l'un des running-gags du film. Il y a aussi un côté cartoon dans certaines scènes, dont le déroulement n'est pas vraisemblable... sauf si l'on admet que l'on se trouve dans une sorte de dessin animé. Anderson est arrivé à marier les deux niveaux de lecture, le sérieux et le futile. Attention toutefois : c'est un peu compliqué (et parfois dur) pour les plus petits. L'intrigue est nourrie de retours en arrière, qui permettent de mieux comprendre la psychologie de tel personnage... ou de démasquer un complot.
C'est peut-être le film le plus puissant que j'aie vu en 2018 (avec 3 Billboards) et, incontestablement, un chef-d’œuvre d'animation, servi par une réalisation millimétrée, géométrique, l'image de ce que sait faire Wes Anderson.
12:33 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 17 avril 2018
La Tête à l'envers
C'est celle de Georg, critique musical vieillissant d'un prestigieux journal viennois, qui ne s'accommode pas de la domination de la "culture pop"... et qui voudrait éviter de devenir père, contrairement aux souhaits de sa compagne, plus jeune d'une dizaine d'années et qui cherche par tous les moyens à tomber enceinte. Le héros va péter les plombs à cause de son licenciement... surtout quand il s'aperçoit que c'est à sa jeune collègue inculte qu'on a confié sa rubrique, de surcroît en "oubliant" d'en retirer sa signature !
Il s'agit d'une comédie sociétale, à l'autrichienne, donc basée sur un humour à froid. Il y a tout d'abord la vie quotidienne du couple bobo formé par le journaliste et sa psychiatre d'épouse (elle-même en pleine crise existentielle). En matière sexuelle, c'est madame qui mène le bal, décidant de la "bonne" position, surtout quand son homme est sur le point d'éjaculer... ce qui rend les scènes d'amour furieusement romantiques... Qui plus est, quand Johanna sent qu'elle est en période d'ovulation, elle se montre particulièrement insistante pour que Georg vienne remplir son devoir conjugal... On sent la dame prête à tout... et elle pourrait se permettre des incartades, vu qu'à 43 ans elle est encore super bien gaulée et qu'elle éveille l'appétit sexuel d'hommes plus jeunes...
L'autre versant de l'intrigue est la vengeance que Georg veut mener contre son ancien employeur. Au début, il se contente de rayer la carrosserie de sa superbe voiture. (Lui roule en Renault...) Puis il décide de déchirer le toit amovible de la décapotable... avant de songer à s'attaquer au domicile du gars. Il finit même par se procurer une arme... grâce, indirectement, à l'indulgence d'un officier de police, qui "laisse couler" un soir qu'il est arrêté, lui permettant de garder un casier judiciaire vierge. Un pic est atteint lors d'un séjour à la neige, qui ne va pas se dérouler comme prévu, d'un côté comme de l'autre. En tout cas, cela nous vaut une impressionnante poursuite à pieds, sur des pentes occupées par un bon mètre de neige... (Je vous laisse imaginer le tableau.)
Le film suscite des réactions contrastées. Certains, croyant peut-être qu'ils allaient avoir affaire à une sorte de Tarantino, n'aiment pas du tout. De mon côté, j'ai beaucoup aimé. Les dix premières minutes donnent une bonne idée de ce que va être le film. On a droit à un joli plan-séquence, où il est question (d'absence) de culture musicale (d'Anton Brückner aux White Stripes). Le dialogue qui suit est nourri d'ambiguïtés : le héros aurait dû comprendre ce qui lui pendait au nez. Quant à l'entretien avec le patron, il se déroule sur un ton de politesse de bon aloi, avec des sous-entendus. Cela m'a un peu rappelé l'attachement des Japonais à cette courtoisie de façade, qui fait qu'on ne dit pas frontalement les choses, sans que les interlocuteurs ignorent de quoi il retourne.
Il y a aussi tous ces détails cocasses, comme la collection de pavés qu'une immigrée roumaine (avec laquelle le héros parvient à communiquer... en italien) constitue, petit à petit, ou encore les réactions que suscitent les chroniques de Georg, réelles ou fictives, passées ou présentes. Conclusion : méfiez-vous des cuistots qui regardent les clients avec insistance !
23:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 15 avril 2018
Kings
Ces "rois" sont les enfants dont l'héroïne Millie s'occupe au quotidien, en plus des siens. C'est une vraie mère poule, qui ne rechigne pas à accueillir la misère du monde chez elle. Ces Kings sont aussi tous les Noirs du ghetto de Los Angeles, susceptibles d'être victimes de brutalités policières, à l'image du plus célèbre d'entre eux : Rodney King, sévèrement battu en 1991 et dont les agresseurs ont été, dans un premier temps, acquittés par un jury majoritairement blanc.
Cette fiction se veut documentaire (le personnage de Millie est inspiré d'une femme que la réalisatrice a rencontrée). Des images d'archives (télévisées) alternent avec celles de la fiction. Au départ, on nous montre la vie quotidienne des héros comme un joyeux bordel, pas très relaxant certes, mais source de bonheur. La suite va être encore plus agitée, mais sur fond de drame.
Parmi les mérites de ce film, je note le souci d'exposer un assez large panel de situations. On nous rappelle bien qu'avant le tabassage de King, les tensions intercommunautaires étaient déjà grandes... mais entre Afroaméricains et Coréens. Ceux-ci (très présents dans le quartier qui jouxte South Central, rebaptisé plus tard South Los Angeles) ont d'ailleurs été les principales victimes économiques des émeutes. Ceci dit, si le film évoque ces tensions, c'est surtout pour mettre en scène la paranoïa des commerçants coréens. Dans les face-à-face, les Noirs sont quasi systématiquement présentés comme des victimes.
C'est dans les interrelations entre Afroaméricains que la réalisatrice ose nuancer, montrant notamment la violence dont sont capables certains hommes. On la sent très empathique avec les jeunes, pourtant narcissiques, désobéissants... et déjà bouffés par la société de consommation. Quant aux policiers blancs, ils sont dépeints avec une étonnante sobriété de détails. Il faut vraiment faire attention à eux pour se rendre compte que tous ne sont pas des mordus de la gâchette.
Il reste le duo de vedettes, Halle Berry (Millie) et Daniel Craig (le voisin irascible). Au départ, on ne sent que de l'hostilité entre eux. Obie, le célibataire endurci, nous est présenté comme un beauf alcoolique, très attaché à son fusil et prêt à en faire usage pour défendre son pré-carré. C'est pourtant le seul Blanc à être resté dans le quartier. Evidemment, on va découvrir qu'il a bon fond. Mais Dieu que le retournement est brutal ! Il vient à peine d'insulter sa voisine et ses gosses qu'il reçoit trois d'entre eux chez lui et s'évertue à les nourrir correctement !
Il n'en faut pas plus pour que la mère-en-série ne commence à fantasmer sur lui. Il faut dire qu'il n'est pas courant, quand on habite dans un ghetto noir, d'avoir pour voisin l'incarnation de James Bond ! Le summum est atteint dans une scène pas totalement ratée, celle du lampadaire auxquels les deux héros se retrouvent menottés. En deux temps trois mouvements, voilà Obie qui bricole une super corde à noeuds... à l'aide de morceaux arrachés à son blue jeans ainsi qu'à celui de sa voisine ! Non mais quel talent ! Le pire est que cette corde approximative supporte sans problème le poids de Craig (qui doit avoisiner le quintal, tout de même), alors que le lampadaire rouillé est sur le point de céder... La scène n'est toutefois pas sans charme, grâce notamment à l'abattage de Craig, qui semble s'être pleinement investi dans son rôle.
Je pourrais aussi parler du fils de Millie, qui s'éprend d'une adolescente au comportement autodestructeur. Tout ce qui touche à ce faux couple est hyper prévisible. Mais je reconnais que la jeune actrice qui incarne Nicole (Rachel Hilson) ne manque pas de talent.
Voilà. Je suis sorti de là assez mitigé. J'avais raté à sa sortie le précédent film de Denize Gamze Ergüven (Mustang), plébiscité par la critique. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui ne m'a pas donné envie d'en savoir plus.
23:31 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 14 avril 2018
Taxi 5
Je n'appartiens pas à la catégorie des inconditionnels de la série de films produite par Luc Besson. Je n'aimais pas le duo d'interprètes principaux (Samy Naceri et Frédéric Diefentahl), mais je reconnais que certains des ingrédients de la recette n'étaient pas mauvais : les poursuites en voiture (sur de la musique entraînante), les personnages secondaires gratinés et la présence au générique de quelques actrices bien roulées carrossées.
C'est la bande-annonce qui m'a incité à tenter ma chance avec ce nouvel opus. Aux manettes désormais se trouve Franck Gastambide (auquel on doit Les Kaïra). Il va former un improbable duo avec Malik Bentalha (passé par le Jamel Comedy Club), qu'on a pu apercevoir dans La Vache, dont l'interprète principal, Fatsah Bouyahmed, est le héros de l'une des deux séquences introductives, celle située en Afrique du Nord.
On est mis dans de bonnes dispositions par la première poursuite automobile, à Paris. Un peu à l'inverse de ce qu'il se passe dans Bienvenue chez les Ch'tis, le flic parigot (censé habiter le VIIIe arrondissement... pas crédible, les gars) se retrouve muté dans le Sud... qui plus est dans la police municipale, la grosse lose, quoi ! (C'est surtout totalement invraisemblable, les deux polices -nationale et municipale- ne dépendant pas des mêmes autorités.)
L'une des réussites de cette comédie un peu bas-de-plafond est la composition de la brigade municipale, sous la houlette du maire frappadingue (Bernard Farcy en pleine forme... mais qui en fait trop). On nous offre une belle galerie de bras cassés, composée du fayot de service, d'un psychopathe, d'une amoureuse boulimique et obèse, d'un nain homme de petite taille, d'un gros dégueulasse etc. On est dans la caricature bien épaisse... et ça marche (parfois).
Evidemment, on attend avec impatience que les méchants (des truands italiens... qu'on entend en version originale !... Cool !) débarquent. Cela donne une première poursuite endiablée dans les rues de Marseille, sur une musique que presque tout le monde reconnaîtra. Dans une grande salle, ça dépote, tout comme la dernière scène d'action, avec un hélicoptère... et un vol plané qui a des conséquences inattendues.
Du côté des gags, on a visiblement cherché à faire efficace. Je me suis réjoui de l'apparition du vomi (à deux reprises)... et du caca, dans une séquence pleine de préjugés concernant les élites parisiennes. Au niveau des dialogues, ça ne vole pas haut, mais j'ai bien aimé toutes les scènes qui font intervenir Sabrina Ouazani (révélée jadis par L'Esquive, de Kechiche, et vue récemment dans L'Outsider). Du côté des invités, on peut signaler Ramzi (un restaurateur dont on découvre progressivement l'étendue des activités...), François Levantal (présent dans Raid dingue et La Finale), Soprano et Charlotte Gabris (vue dans Babysitting).
Ce n'est pas la comédie du siècle, mais c'est très correctement filmé et on passe un bon moment, sans prise de tête.
09:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 13 avril 2018
Sherlock Gnomes
Ce film d'animation se place dans la continuité de Gnomeo et Juliette (sorti en 2011)... mais il n'est pas nécessaire d'avoir vu celui-ci pour profiter du spectacle. C'est d'ailleurs mon cas. J'ai donc découvert comme tant d'autres ces attachants personnages de nains de jardin en porcelaine (avec de bons effets sonores).
C'est évidemment la transposition des aventures du plus célèbre détective britannique qui m'a intéressé. Dans la version française, il a la voix de Bruno Choël, acteur de doublage chevronné, qui a su donner toute l'emphase et l'arrogance qu'il fallait à son personnage brillant mais agaçant.
Toutefois cette animation, centrée sur de petits héros, a pour objectif de mettre en valeur des gens modestes. Gnomeo et Juliette incarnent des citoyens ordinaires, mais au tempérament affirmé. De son côté, Watson se révèle plus indispensable que jamais à son associé pas toujours conscient de ses mérites.
L'intrigue est émaillée d'humour (ah, la propulsion au cachet d'aspirine...)... et de clins d’œil, en particulier à la série britannique Sherlock, à laquelle elle emprunte sans doute la version d'un Moriarty nombriliste et délirant, obsédé par sa rivalité avec Holmes. Il est aussi possible que certains éléments fassent référence à l'autre série, l'américaine (Elementary). Mais, pour en être sûr, il faudrait que je revoie des épisodes de celle-ci.
Après une introduction trépidante, nous voilà embarqués dans un jeu de pistes, à la recherche des kidnappeurs de nains. Mon épisode préféré est celui qui met en scène les chats-bibelots chinois, vraiment très drôle. Assez vite, les adultes comprendront quel retournement le scénario réserve aux spectateurs. Les scènes se succèdent à un rythme rapide, trop peut-être, avec une musique assez criarde (pour l'essentiel, des "tubes" d'Elton John plus ou moins remis au goût du jour). Faut aimer...
Mais, pour peu qu'on apprécie le décalage entre la modestie des personnages et l'immensité de leurs exploits, on passe un bon moment, avec une morale pas si fréquente que cela dans les productions anglo-saxonnes : l'amitié, la famille et l'amour sont plus importants que le travail.
14:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 11 avril 2018
Red Sparrow
Ce moineau (rouge) fut d'abord un cygne, une danseuse au Bolchoï. Sa carrière brisée (dans des circonstances que je laisse à chacun le loisir de découvrir en détail), avec une mère très malade à charge, l'héroïne Dominika (Jennifer Lawrence, ensevelie sous des tonnes de maquillage) se voit proposer d'intégrer une formation très spéciale, au service de la Patrie. Dans le même temps, la CIA essaie de protéger une source de haut niveau au sein même des services secrets russes.
Même si la Russie de Vladimir Poutine (dont les ressortissants, dans la version originale, parlent tous anglais...) fait un antagoniste très crédible, c'est évidemment à la période soviétique que le film (et le roman dont il est inspiré, écrit par un ancien de la CIA) emprunte.
Dominika va être traitée à la dure, notamment par la sorte de mère maquerelle des espionnes, incarnée avec conviction par Charlotte Rampling. Une autre relation très ambiguë s'instaure entre l'héroïne et son jeune oncle (le frère cadet de son défunt père), très bien interprété par Matthias Schoenaerts. Mais c'est le lien avec l'agent de la CIA (joué par Joel Edgerton) qui fait l'objet du plus de suppositions.
De nature, Dominka est plutôt discrète. Les vicissitudes qu'elle endure vont la conduire à être de plus en plus dissimulatrice, à tel point qu'on finit par se demander où se niche la moindre parcelle de sincérité. Même quand elle dit la vérité, c'est dans un but bien précis. C'est le principal intérêt de ce film que de tenter de deviner les pensées profondes de la talentueuse espionne. L'autre énigme porte sur l'identité de la taupe de la CIA. Il y a toujours au moins une manipulation dans la manipulation, si bien qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. Cela donne un bon suspens, émaillé de scènes marquantes, parfois très violentes.
L'interprétation est inégale. Ce n'est pas la première fois que je remarque les limites de J. Lawrence. Elle dispose d'une palette de jeu assez limitée. On s'en rend particulièrement compte quand son personnage doit se faire passer pour une victime afin d'apitoyer sa cible, à l'entrée de l'immeuble où il habite. La scène qui la montre en train d'adopter son "rôle" est brève et peu convaincante... mais cela suffit visiblement pour l'homme situé à l'autre bout de l'interphone.
Les mâles libidineux se consoleront en reluquant le joli corps de l'actrice principale (qui a pour habitude d'en dévoiler beaucoup, comme dans Passengers). Mais j'ai surtout apprécié l'ambiance de Guerre froide. C'est une production de commande assez bien faite, mais pas emballante... et il semblerait qu'il y ait une suite...
20:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 10 avril 2018
Croc-Blanc
Cette coproduction franco-luxembourgeoise adapte le célèbre roman de Jack London, qui m'a fait chialer quand j'étais môme. J'y suis allé par nostalgie et par curiosité, avec l'envie de voir le rendu en images de synthèse. Autant le dire tout de suite : le principal intérêt ne réside pas dans la qualité visuelle. C'est du travail propre, mais pas éblouissant :
Par contre, les mouvements des animaux sont rendus avec un sens du réalisme épatant, auquel il faut ajouter les sons, parfaitement superposés aux images. On a vraiment l'impression d'entendre des loups ou des chiens !
L'histoire est prenante parce que le film dénonce la bêtise et la cupidité de certains hommes, ainsi que les mauvais traitements que subissent les canidés. C'est fait pour susciter l'indignation... et c'est réussi ! Par contre, je regrette le manichéisme des choix graphiques : les méchants sont tous laids et les gentils ont une belle apparence. Dans la vraie vie, cela ne se passe ainsi....
D'autre éléments ont retenu mon attention. On a pris soin de représenter une majorité de loups dangereux, prédateurs impitoyables. Il est bon que nos chères têtes blondes aient cela à l'esprit. J'ai aussi apprécié la mise en scène de la domestication de Croc-Blanc par le grand-père indien puis par le couple qui l'a recueilli. C'est touchant et, comme je le craignais, à la fin, j'ai été vachement émouvé... Saletés de poussières dans l'oeil !
21:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 07 avril 2018
Pierre Lapin
Ce film mélange prises de vue réelles et images de synthèse, celles des animaux qui peuplent ce coin de la campagne anglaise. Au blaireau (forcément stupide), au hérisson (évidemment piquant), au renard (indubitablement menaçant) s'ajoutent les oiseaux (qui chantent... pas pour le meilleur, hélas), un cerf (captivé par les phares des voitures), un cochon philosophe (qui dit suivre un régime...) et surtout les lapins.
J'ai essayé de trouver une image qui rende justice à la qualité de l'animation. Ce sont d'adorables peluches vivantes, aux visages extrêmement expressifs. Un gros boulot a été fait pour donner vie aux oreilles, aux museaux... et aux sourcils ! C'est à la fois réaliste (on retrouve la manière de se déplacer des lapins) et surréaliste, en raison de l'anthropomorphisme des personnages : les lapins peuvent être perçus comme des substituts d'humains.
Ceux-ci sont néanmoins présents dans l'histoire. On rencontre d'abord le premier propriétaire du jardin dans lequel les lagomorphes viennent allègrement prélever de quoi se sustenter. C'est un vieil homme opiniâtre (incarné par Sam Neill), mais qui n'est pas tout à fait de taille à lutter avec ses facétieux voisins à grandes oreilles. Dans des circonstances que je me garderai de révéler, il va être remplacé par un jeune homme, auparavant employé modèle d'Harrod's, à Londres. Domhnall Gleeson (vu récemment dans Barry Seal) donne toute son énergie à ce personnage maniaque à l'extrême, qui débarque alors que les animaux sont en train de mener une bringue d'enfer dans sa maison !
On suit plus particulièrement un quintet de lapins : le héros Pierre, le meneur, débrouillard et gouailleur, son meilleur ami un peu pataud et ses trois petites soeurs, aux tempéraments très différents : l'une d'entre elle ne cesse de rappeler son statut d'aînée... pour seize secondes ; la seconde voudrait prendre sa place, mais elle manque d'assurance (et a un cheveu sur la langue) ; la benjamine est un peu fofolle, prête à tout casser. (Je l'adore.)
Ah, j'oubliais : nos amis aux impressionnantes pattes arrière jouissent de l'affection et de la protection de l'une des habitantes du village, Béa (Rose Byrne, connue chez nous pour avoir incarné Moira Mac Taggert dans plusieurs X-Men). Mais voilà qu'elle se met à trouver le nouvel arrivant très à son goût. L'intrigue prend alors le chemin du vaudeville, les lapins se montrant particulièrement jaloux du nouveau propriétaire du jardin potager, celui-ci se mettant à haïr les bestioles.
Cela donne au final une excellente comédie, pas toujours "politiquement correcte", mais jamais vulgaire. Les auteurs ont eu aussi la très bonne idée d'inclure des reproductions des aquarelles de Beatrix Potter (l'auteure du livre pour enfants d'origine), qu'ils ont animées. Cela donne une touche "vintage" à certaines scènes et contribue à faire de ce film un divertissement de qualité.
10:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 06 avril 2018
Ready Player One
A peine plus d'un mois après avoir pu savourer Pentagon Papers, le public français se voit proposer une nouvelle friandise spielbergienne. Celle-ci est d'un style très différent, mais assez conforme à tout un pan de l'œuvre du réalisateur américain.
Le film est en entrelacement de deux types de séquences : celles tournées en prises de vue réelles et celles, bourrées d'effets numériques, qui reposent sur la capture de mouvements. Elles nous plongent dans un monde virtuel éblouissant (pas autant toutefois que celui du Valérian de Luc Besson). Par contre, l'intrigue est particulièrement riche avec, au cœur de l'histoire, une sorte de chasse au trésor, un point nodal commun à certaines œuvres de Spielberg et à nombre de jeux vidéo.
C'est pour moi une des limites de ce film. Même si, graphiquement parlant, la représentation du monde virtuel ludique est plus réussie que dans Final Fantasy, elle a un côté artificiel qui a un peu gâché mon plaisir. Cela donne quand même naissance à la séquence la plus éblouissante, celle de la course de voitures (pour la quête de la première clé). C'est censé se passer dans les rues de New York... et c'est délirant, d'une grande richesse visuelle. Notons que, pour l'emporter, point n'est besoin d'être le plus fort. Il vaut mieux être astucieux-se et doté-e d'une solide culture pop.
Cela nous mène aux nombreux clins d'œil dont les scènes sont émaillées. Si Spielberg fait principalement référence aux années 1980 (avec Retour vers le futur, Akira, War Games... et surtout Shining), il embrasse une époque allant de la fin des années 1970 (avec La Fièvre du samedi soir) aux années 1990 (Jurassic Park, bien sûr) et même 2000 (Le Seigneur des anneaux). Il est impossible de tout citer. De surcroît, j'ai dû passer à côté d'une partie des références. C'est la même chose au niveau des incrustations à l'écran. Certains plans numériques foisonnent de trouvailles, mais, quand on est pris dans l'intrigue, on n'a pas le temps de profiter de la totalité. Paradoxalement, ce long film bâcle parfois certains scènes.
C'est donc à la fois une œuvre avant-gardiste (sur l'immersion dans le monde virtuel) et traditionnelle, typique des productions de Spielberg. De surcroît, je pense qu'il n'est pas exagéré de voir en James Halliday (Mark Rylance, deux de tension) un double du réalisateur, qui doit se sentir tout aussi décalé que lui par rapport au monde dans lequel il vit.
Le déroulement est assez classique. Le gamin asocial mais doué va finir par se trouver un clan... et tomber amoureux. Certains des aspects comiques de l'histoire sont liés à l'écart qui existe (ou pourrait exister...) entre l'apparence prise par les héros dans le monde virtuel et leur véritable corps. Mais, bon, sans trop en dire, on peut quand même révéler que celle que le héros kiffe est (presque) aussi bandante dans la vraie vie que dans l'Oasis. (On a beau avoir enlaidi l'actrice en question, n'importe quel œil exercé remarquera que c'est un petit canon.)
La première heure passe comme un rêve. La suite m'est apparue un peu laborieuse, avec quelques invraisemblances (qui permettent aux héros de se sortir de situations quasi inextricables). Mais le pire arrive dans les vingt dernières minutes, avec la seconde poursuite automobile (dans le monde réel cette fois). Spielberg utilise cet artifice pour accentuer inutilement la tension autour de l'utilisation des trois clés par l'un des personnages. Il retombe dans les travers de nombre de réalisateurs hollywoodiens avec l'abus de juste-à-temps... et il insère une pincée de spiritualité, avec une incarnation totalement invraisemblable... qu'il laisse à chaque spectateur le soin d'expliquer à sa guise.
C'est un bon divertissement, mais plutôt destiné à un public adolescent ou jeune adulte gamer.
21:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 05 avril 2018
Le Collier rouge
Le centenaire du premier conflit mondial contribue à la sortie de nombreux films qui ont pour cadre cette guerre. Celui qui nous occupe est adapté du roman de Jean-Christophe Rufin (que je n'ai pas lu). Les spectateurs se retrouvent dans les pas du juge militaire (François Cluzet, correct, sans plus) chargé d'enquêter sur un mystérieux crime ("une connerie", disent certains personnages), celui commis par Morlac, soldat décoré au tempérament révolutionnaire.
Le scénario est suffisamment bien construit pour que l'on suive la majorité du film sans savoir exactement ce que l'on reproche à l'ancien poilu. On se doute que c'est lié à son chien (qui l'a accompagné à la guerre et veille sur lui de l'extérieur de la prison), mais on ignore exactement pourquoi. Dans le rôle du prisonnier, Nicolas Duvauchelle (dont on a déjà pu apprécier le talent dans Je ne suis pas un salaud) est très bon... même s'il n'est pas très crédible en faucheur, dans la scène qui nous le montre aux foins.
Lantier (Cluzet) mène l'enquête. Le profil psychologique de l'accusé l'intrigue. En 1919, les élites françaises se méfient comme de la peste de tout ce qui peut ressembler à un Bolchevique. Mais le gars est aussi un héros de guerre. L'officier va recevoir l'aide d'un gendarme débonnaire (incarné par Patrick Descamps).
Pour résoudre cette énigme, Lantier doit rencontrer Valentine (Sophie Verbeeck), l'ancienne compagne de Morlac (séparée de lui pour on ne sait quelle raison), ainsi qu'une vieille dame aveugle qui prend soin du chien. De son côté, le gendarme va recueillir de précieuses informations auprès du simplet du village, qui a vu des choses mais n'est pas facile à trouver... et à coincer.
A cela s'ajoute le récit de Morlac qui, du fond de sa cellule, va commencer à parler avec Lantier, dont il sent qu'il n'est pas aussi obtus que la majorité des officiers de son rang. Cela nous vaut quelques retours en arrière, dans les tranchées, notamment dans l'est de la France métropolitaine. La meilleure séquence est à mon avis celle qui se déroule dans les Balkans (Morlac ayant été reversé dans l'armée d'Orient). L'histoire de la fraternisation avec les Bulgares, en présence des Russes, est bien mise en scène.
En dépit de toutes ces qualités, je n'ai pas été emballé. Il y a quelques maladresses. Certaines scènes de dialogue auraient dû être retournées. Et puis il y a ce penchant un peu prononcé... C'est une forme de "politiquement correct" de gauche. La guerre, c'est pas bien, les puissants sont des salauds, le patriotisme c'est de la merde... C'est tout de même un peu simpliste. Mais ça se laisse regarder sans déplaisir, d'autant plus que le chien (deux chiens en réalité, des beaucerons) est épatant !
15:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 01 avril 2018
La Prière
Ces dernières années, le cinéma français s'est emparé de divers thèmes sociétaux, parmi lesquels on trouve la quête religieuse. On pense évidemment à Des Hommes et des dieux, de Xavier Beauvois (auquel ce film ressemble, par certains aspects). On pense aussi à L'Apparition (de Xavier Giannoli), plus récent et tout aussi excellent.
Ici, on suit le parcours de Thomas (Anthony Bajon, très bien), drogué sujet à des crises de violence, qui atterrit dans un étrange centre de désintoxication, géré par des religieux (catholiques) assistés d'anciens toxicos. Il va être question de rédemption par la foi : les directeurs du centre font le pari que la vie communautaire, le travail et la prière peuvent venir à bout de tous les démons. Ils tentent de remplir le vide des existences de jeunes déboussolés avec la foi plutôt qu'avec un dérivé de l'opium.
Je n'ai pas trouvé le personnage principal très sympathique... et c'est très bien. Cédric Kahn n'est pas tombé dans l'hagiographie. Au départ, le jeune homme va rejeter la ferme bienveillance dont il est l'objet. De même, on nous suggère que, parmi les repentis, certains sont habités par le doute... et l'on finit par apprendre que le centre a connu quelques graves échecs et des rechutes.
La sobriété de la mise en scène répond à la frugalité de la vie quotidienne de ces jeunes hommes (et femmes, qui vivent un peu plus loin). La caméra est assez près des corps, pas pour suggérer la sensualité, mais pour saisir le trouble intérieur.
Tous les acteurs, hommes, femmes, jeunes, adultes, sont bons. (J'ai retrouvé avec plaisir Alex Brendemühl, vu dans Django, Insensibles et Le Médecin de famille.) Je mettrais toutefois deux limites à mon enthousiasme : le rythme est lent, voire très lent, sans que cela se justifie toujours. On sent que le réalisateur a voulu nous montrer que le cheminement spirituel suit des voies parfois détournées, mais, à mon avis, il en fait trop. Et puis, à partir du moment où un personnage féminin apparaît à l'écran, certaines péripéties sont très prévisibles, jusqu'à la conclusion de l'histoire, très belle mais assez attendue.
22:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
samedi, 31 mars 2018
Blue
A peine plus de six mois après la sortie de Nés en Chine, Disneynature nous propose un nouveau documentaire, celui-ci consacré au monde sous-marin. On commence par suivre ceux qui vont être le fil rouge de l'histoire, les dauphins (qui ont donné son titre au film dans la version d'origine). On en découvre une petite bande en train de s'amuser dans les vagues, façon surfeurs. Cool, la life !
Blue (Echo dans la version originale) est le surnom donné à un jeune mâle, que sa mère doit dans un premier temps protéger, avant de lui apprendre à chasser. Cela nous vaut des scènes parfois stupéfiantes. Blue s'exerce d'abord à l'écholocalisation, pour mettre la main le bec (le rostre, en fait) sur des proies cachées dans le sable, qui sortent dès que leur prédateur s'éloigne... pour disparaître à nouveau à la moindre menace !
Il semble avoir été relativement facile de filmer ce mammifère marin, curieux de nature, qui n'hésite pas à s'approcher des humains. Attention toutefois : les individus de cette espèce ne sont pas forcément pacifiques. L'une des séquences montre deux bandes s'affronter, pour on ne sait quelle raison, d'ailleurs.
De son côté, maman dauphin montre à son petit comment piéger des poissons le long d'une côte, ou comment enfermer des proies dans un cercle de sable et de boue, formé à l'aide d'un intense mouvement circulaire. Les preneurs de vues ont réussi à capter le moment où certains poissons, tentant de s'enfuir par les airs, sont avalés par leurs prédateurs. Impressionnant.
L'autre relation mère-enfant (on est chez Disney, ne l'oubliez pas) est celle qui lie deux baleines à bosse. Je ne trouve pas ces animaux particulièrement beaux. Par contre, malgré leur poids, qu'est-ce qu'ils sont gracieux ! Le documentaire (avec un commentaire pour une fois pertinent) nous en apprend sur la communication entre ces cétacés, indispensable s'ils veulent échapper aux attaques d'orques, par exemple. L'épisode sur la compétition entre les mâles est aussi passionnant.
Fort heureusement, le film ne se limite pas aux grosses bêtes. Autour de récifs coralliens, on découvre une vie foisonnante, souvent faite de dangers... mais aussi de surprenantes solidarités.
Ainsi ces poissons-perroquets à bosse, en apparence immobiles... font la queue devant une sorte de station-service sous-marine, où des poissons-nettoyeurs vont s'alimenter tout en les décrassant, l'un après l'autre. Je ne sais pas ce qui m'a le plus surpris : l'autodiscipline des animaux où le parcours des petits nettoyeurs, qui circulent librement dans le corps de leur "client".
Tous les habitants des mers n'ont pas cette patience... comme les tortues... eh, oui ! Ce sont les reines du resquillage, qui vont jusqu'à se battre entre elles pour passer la première !
Le documentaire est d'ailleurs émaillé de scènes de lutte. Ce sont soit de simples rixes, pour des raisons de préséance, sans doute, soit des combats pour la vie (et la nourriture). Toute la faune est concernée, des grands mammifères marins aux petits crustacés. L'un d'entre eux bénéficie d'une large exposition dans le film : la squille multicolore, souvent filmée en très gros plan, à tel point que l'on pourrait penser qu'il s'agit d'un monstre gigantesque. Mais, purée, quelle qualité d'image !
Dans un genre approchant, je recommande aussi la seiche caméléon, redoutable prédateur des mers, qui, grâce à de savants changements de couleurs et de luminosité, réussit à fasciner ses proies (en plus des spectateurs). Mais c'est tout le massif corallien qui peut prendre des couleurs chatoyantes, le jour, mais aussi la nuit.
Vous sentez que j'ai été emballé. C'est un plaisir des yeux et l'on apprend des choses sur la faune... et sur la flore (par exemple la plante sur laquelle les dauphins se frottent pour se soigner). Cela ne dure qu'1h10... et ne partez pas trop vite : le générique de fin débute par une sorte de making-of, où l'on voit notamment un plongeur subitement entouré d'une meute de requins !
P.S.
Tout autant que des requins et des orques, les dauphins doivent se méfier des hommes, ceux qui se trouvent sur les bateaux de pêche... et qui ne font pas de sentiment.
16:03 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 28 mars 2018
La Finale
Cette comédie familiale grand public prend appui sur un fait de société : l'augmentation du nombre de personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer. C'est le cas du héros de l'histoire, Roland, patron d'un restaurant qui, à l'âge de la retraite, découvre qu'il a des pertes de mémoire. Devenu veuf (dans des circonstances qu'on ne découvre en détail que très tard), il part s'installer chez sa fille, mariée à un médecin et mère d'une fille et d'un garçon, celui-ci passionné de basket-ball. La cohabitation ne se passe pas sans anicroche...
Dès le début, j'ai marché parce que Thierry Lhermitte joue bien. Je trouve que l'ancien comique beau gosse a fait prendre un virage intéressant à sa carrière, avec la série Les Témoins et, au cinéma, les films Quai d'Orsay et surtout La Nouvelle Vie de Paul Sneijder. A lui seul il porte la dualité de cette histoire, faite de moments de franche comédie et de passages plus sombres, où perce l'émotion.
Autour de lui se débattent des comédiens plus ou moins à l'aise. Contrairement à d'autres, je n'ai pas été horripilé par la prestation de Rayane Bensetti (un illustre inconnu pour moi... mais pas pour les adolescentes présentes dans la salle). Certes, il incarne un fils de bourges très grossier, qui se la joue rebelle avec son langage approximatif et son goût pour les "musiques urbaines". Mais il est crédible dans le rôle, celui d'un ado un peu mal dans sa peau, pas méchant au fond.
Comme l'axe de la comédie est constitué du grand-père et du petit-fils, les parents servent de repoussoir. Ils envisagent de se débarrasser du papy et réprouvent la passion de leur gamin pour le basket... à tel point qu'ils ne sont jamais allés le voir jouer ! Cela ne me paraît pas très crédible... mais c'est nécessaire au déroulement de l'intrigue, puisque les géniteurs trouvent parfaitement normal que leur fils sacrifie sa participation à la finale des championnats juniors de basket pour s'occuper d'un grand-père qu'il n'a presque jamais vu... et qui est, de prime abord, assez réactionnaire et plutôt raciste.
Évidemment, le périple que l'ancien et le jeune vont accomplir ensemble va les rapprocher et les montrer sous un autre jour. La séquence avec les passagers très particuliers d'un bus est délicieuse, tout comme l'autre partie du voyage... dans une Porsche ! Des spectateurs seront peut-être rebutés par certains éléments de l'histoire : l'apologie de la vitesse en bagnole, l'amour des hamburgers industriels et la passion pour le sport spectacle (basket et football). Notons que la séquence du match est bien filmée.
Bref, j'ai passé un petit moment sympathique, sans plus, ni moins.
23:05 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 24 mars 2018
Tout le monde debout
Jocelyn (Franck Dubosc, fidèle à lui-même) est un connard. Il aime à étaler son fric, saute sur tout ce qui bouge (avec un joli cul ou une belle paire de seins) et ment de manière pathologique. Ah, j'oubliais : dans les rapports humains, il est d'une lâcheté épouvantable. (Je pense que, pour une partie du public masculin, il incarne une sorte d'idéal...) Ce sont deux de ses défauts principaux qui vont l'entraîner dans un improbable imbroglio (lié à un fauteuil pour handicapé), dont il va sortir changé.
Présentée comme cela, l'intrigue n'a pas l'air particulièrement alléchante. Je dois dire c'est une partie de la bande-annonce (celle où il est question de coloscopie) qui m'a incité à aller voir ce film. Dubosc s'appuie sur une excellente distribution, notamment féminine, avec une Alexandra Lamy pétillante et lumineuse et une Elsa Zylberstein certes caricaturale, mais ô combien efficace dans le rôle de la secrétaire amoureuse, un peu tarte... mais qui parfois "se lâche". Aux côtés du héros on rencontre son médecin et ami Max (Gérard Darmon, qui cachetonne tranquillou). Il va aussi croiser la charmante Julie, interprétée par Caroline Anglade. Deux autres présences, plus ponctuelles, sont à signaler : François-Xavier Demaison, qui surprend en curé de Lourdes, et Claude Brasseur... tout en décontraction.
Pour moi (et le public présent dans la salle où j'ai vu le film), la mayonnaise a pris. Même arrogant, le personnage principal est drôle. La suite, qui le montre de plus en plus empêtré dans ses mensonges, est encore plus intéressante. C'est dans la seconde moitié que j'ai le plus ri, à partir du séjour à Prague (du quiproquo à l'hôtel à l'usage périlleux d'un fauteuil électrique...). Plus loin, les deux scènes de dîner (au restaurant en présence de la secrétaire pompette et au domicile du héros, "sur" la piscine) sont des moments revigorants.
Cette seconde partie est aussi la plus chargée en émotion. Ce connard patenté, tombé amoureux, change d'attitude vis-à-vis du handicap... et de tout son entourage. Il devient plus humain. Certes, les ambitions de cette comédie populaire sont mesurées, mais cette touche sensible, très éloignée de la vulgarité qui règne dans certaines productions à grand succès, est la bienvenue.
11:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 23 mars 2018
Tomb Raider
La nouvelle Lara Croft n'a ni les lèvres pulpeuses ni la poitrine opulente d'Angelina Jolie. Au départ, on nous la présente un peu comme une girl next door, travailleuse précaire (pour une boîte du genre Deliveroo) qui vit dans un quartier populaire londonien, où elle côtoie des minorités ethniques.
Très vite, on réalise qu'en réalité un somptueux héritage l'attend et qu'elle a reçu une éducation soignée, dans un cadre privilégié. Elle est de surcroît incarnée par la délicieuse Alicia Vikander, qu'on a beaucoup vue ces dernières années, notamment dans Royal Affair, Anna Karenine, Ex-Machina et Agents très spéciaux.
Plus affûtée que jamais, l'actrice nous entraîne dans deux courses-poursuites, l'une au centre de Londres, l'autre à Hong Kong. C'est animé, bien filmé, parfois inattendu... et attention : la dame sait se défendre. Faut pas faire chier Lara Croft.
Les heures passées par l'intérimaire à pédaler sur un VTT, tout comme les séries de pains qu'elle s'est pris dans la figure au club de boxe (entre deux clés de bas) vont être d'une grande utilité à la jeune héritière partie à la recherche de son père, disparu depuis sept ans, considéré comme mort.
Pour arriver à ses fins, elle va devoir surmonter une incroyable série d'obstacles, comme un (impressionnant) naufrage nocturne au sud du Japon, des rapides suivis d'une gigantesque chute d'eau (encombrée d'une imposante carcasse d'avion... mention spéciale aux décors)... et une brochette de méchants plus vilains les uns que les autres, interprétés cependant par des acteurs sans saveur. La remarque s'applique d'ailleurs aussi aux "gentils". Tous les personnages masculins sont totalement éclipsés par Croft/Vikander, qui irradie littéralement. (Je ne suis peut-être pas totalement objectif...)
Il faut dire que Lara semble dotée de qualités exceptionnelles : elle nique sa race à un mercenaire musculeux lors d'un combat nocturne achevé dans la boue... alors que, quelques heures auparavant, elle a ôté de son charmant abdomen un horrible morceau de métal qui s'y était fiché. Le lendemain, soignée par un mystérieux personnage, elle semble complètement remise sur pieds, prête à se taper un marathon en pleine jungle !
Vous l'avez compris : il ne faut pas se montrer trop exigeant quant à la cohérence scénaristique. C'est un Indiana Jones au féminin (en moins drôle), qui mélange archéologie et ésotérisme... mais avec une résolution de l'énigme qui s'appuie sur la science (comme ça, tout le monde est content).
L'avant-dernière séquence (celle de la grotte) voit l'héroïne exercer l'ensemble de ses talents sportifs, du tir à l'arc au cross country, en passant par le saut en longueur, l'escalade, la boxe et la lutte gréco-romaine. Cet heptathlon atypique tient en haleine jusqu'à la conclusion de l'histoire, qui réserve une demi-surprise... et annonce, bien évidemment, une suite.
23:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 11 mars 2018
Hurricane
Cet ouragan gigantesque est à la fois l'occasion, pour un groupe de petits malins, d'organiser le casse du siècle, et la catastrophe qui peut tout faire foirer si le moindre grain de sable enraye la mécanique du complot. La première séquence est censée nous faire comprendre la psychologie de deux des principaux personnages masculins, deux frères qui, dans leur enfance, ont déjà connu de l'intérieur un méga ouragan. Bien qu'assez prévisibles, ces scènes sont bien tournées et donnent lieu à la plus spectaculaire catastrophe du film.
On retrouve les deux frangins 25 ans plus tard. Ils habitent une ville où se trouve un centre ultra-sécurisé de déchiquetage de billets de banque usagés. C'est l'occasion de découvrir l'héroïne Casey (Maggie Grace, révélée notamment par le rôle de Kim dans la série des Taken), qui elle aussi cache une grande fêlure intérieure... à propos de laquelle on ne saura pas grand chose.
Il est vrai que la caractérisation des personnages n'est pas d'une grande subtilité. Ce sont souvent des caricatures, de surcroît interprétées par des acteurs pas extrêmement brillants, sans doute recrutés sur leur carrure et la blancheur de leur sourire. La petite Maggie surnage dans ce flot de mecs burnés peu recommandables, dotés (dans la version française) de grosses voix caverneuses...
C'est d'ailleurs à travers elle qu'on voit l'évolution de ce type de film : du côté des gentils, c'est la dame qui est une pro des flingues. C'est aussi elle qui est capable de sortir un gros camion d'une situation délicate. (La scène de l'embouteillage est un délice pour tous ceux qui se sont déjà retrouvés piégés dans une masse de bagnoles à cause du comportement incivique de quelques abrutis.)
Comme les dialogues sont globalement à chier, il faut reporter son attention sur les scènes d'action. Et là, franchement, ça dépote. Je pense même que la version 3D doit valoir le coup, à partir du moment où l'ouragan fait voltiger un tas d'objets un peu partout.
Dans une grande salle, bien calé dans mon fauteuil, j'ai savouré le démontage de la tour émettrice, mais aussi toute la séquence du centre commercial, avec notamment d'éblouissants vols planés et un impressionnant tsunami dans une jardinerie. Le tout culmine dans une exaltante poursuite en camions.
Voilà. Un peu à l'image de 24H Limit, The Passenger ou du plus ancien Deep Water (celui-ci mieux interprété, toutefois), ce film un peu bourrin (à voir sur grand écran), truffé d'invraisemblances, ne vise qu'à faire passer un bon moment.
23:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 09 mars 2018
La Forme de l'eau
Une fois n'est pas coutume, le titre de ce film américain est bien traduit... alors, ne boudons pas notre plaisir. Je ne fais toutefois pas partie des inconditionnels du réalisateur (Guillermo del Toro), mais j'ai été attiré par l'histoire... et la possibilité de voir le film en version originale sous-titrée, au CGR de Rodez (trop timide à mon goût au niveau de la diffusion des œuvres dans leur langue d'origine).
On a parlé ici ou là des "emprunts" que le réalisateur aurait pratiqués chez d'illustres devanciers (Jean-Pierre Jeunet et Terry Gilliam notamment). Plus que du plagiat, j'y vois des hommages, ou tout simplement des sources d'inspiration. Il est néanmoins évident qu'au début, la présentation d’Élisa, l'héroïne muette, célibataire asociale réglée comme une pendule (Sally Hawkins formidable), n'est pas sans rappeler celle de l'Amélie Poulain de Jeunet.
Immédiatement, on baigne donc dans un univers décalé, dans des tons superbes. Les États-Unis du début des années 1960, en pleine Guerre froide, semblent presque surnaturels. Les interactions entre les personnages nous font cependant vite comprendre dans quel genre de monde ils vivent : dominé par des mâles blancs hétéronormés, attachés à leur domination des femmes et à la ségrégation raciale.
Les deux héros attirent immédiatement la sympathie, pour des raisons semblables en dépit de leurs apparences différentes. Élisa comme "le sujet" sont à la fois des victimes et dotés d'une grande force intérieure. Leur rencontre, très poétique, donne naissance à une histoire d'amour furieusement romantique.
Toute bonne histoire s'appuie sur un "méchant" réussi. Tel est le cas ici, avec un Michael Shannon (déjà excellent dans Elvis & Nixon) bien dégueulasse... et dépeint comme une certaine incarnation du modèle américain. (Par bien des côtés, le film est susceptible de prendre à rebrousse-poil le public bas-du-plafond.) Des moments de comédie sont introduits par le personnage de Zelda, bien interprétée par Octavia Spencer (ce qui lui a valu une deuxième nomination de suite à l'Oscar du meilleur second rôle, un an après sa performance dans Les Figures de l'ombre). Je crois que Richard Jenkins, qui incarne Giles, le voisin et fantasque ami d’Élisa, est aussi censé provoquer les rires ou, à défaut, les sourires du public... mais j'avoue que j'ai trouvé son personnage plutôt horripilant, extrêmement convenu et prévisible.
Fort heureusement, la romance prend de l'épaisseur quand une évasion se produit. Là-dessus se greffe une vraie-fausse histoire d'espionnage, qui perturbe encore plus les lignes.
J'ai passé un excellent moment, plein de beauté et d'émotion.
21:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 03 mars 2018
Mary et la fleur de la sorcière
Le réalisateur Hiromasa Yonebayashi est un ancien des studios Ghibli. Il a travaillé sous la houlette du célèbre Hayao Miyazaki. Il a commencé à se faire connaître avec des films comme Arrietty et (surtout) Souvenirs de Marnie. D'ailleurs, comme celui-ci, Mary est adapté d'un roman britannique destiné à la jeunesse.
La première séquence se déroule dans le passé. On n'en comprend que progressivement tout le sens. Sachez seulement qu'il y est question d'une cité mystérieuse, de balais et d'étranges graines luminescentes (superbement rendues par l'animation).
Des années plus tard, la jeune Mary, que ses parents ont placée chez sa tante pour les vacances scolaires, s'ennuie. Même le chien de la maison ne suit pas la gamine débordant d'énergie. Il y aurait bien Peter, le jeune facteur, mais celui-ci se moque sans cesse de ses cheveux roux. Finalement, c'est peut-être un chat qui va se révéler le compagnon le plus fidèle... ainsi qu'un drôle de balai.
Notre héroïne fait une découverte, au coeur de la forêt, découverte qui va la mettre en contact avec un monde magique... mais dangereux. Les cinéphiles penseront immanquablement à Kiki, la petite sorcière, au Voyage de Chihiro et à Princesse Mononoké (entre autres).
Visuellement, c'est très réussi, mêlant dessin traditionnel et images numériques. Les fleurs sont magnifiques et les effets de magie splendides. Ce n'est toutefois pas aussi brillant que les meilleures oeuvres de Miyazaki. Au niveau du scénario, c'est assez élaboré. L'histoire tient bien en haleine, avec de multiples rebondissements. C'est toutefois destiné à un jeune public. Les adultes ne s'y retrouvent pas toujours, notamment au niveau des dialogues, pas démentiels.
Les papas, mamans, pépés, mémés, tontons et tatas se sentiront davantage concernés par le sous-texte. Le film contient une vigoureuse dénonciation des expérimentations animales et, au second degré, je pense qu'il s'oppose au nucléaire civil. Voici pourquoi. La magie est comparée à plusieurs reprises à l'électricité. Or, la source la plus puissante de magie est un élément naturel (que je ne vais pas révéler), dont l'exploitation peut produire des prodiges comme des catastrophes.
Au-delà de son apparence un peu enfantine et innocente, c'est donc une oeuvre complexe, qui offre plusieurs niveaux de lecture.
00:47 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 01 mars 2018
Wajib
Le titre est un mot arabe renvoyant à une tradition palestinienne, celle de distribuer en personne les invitations à un mariage. Ici, c'est le père et le frère de la future mariée qui s'en chargent. La particularité de ce film est de se dérouler à Nazareth, en Israël donc, mais dans une ville arabe, dont plus du tiers de la population est chrétienne (de rite orthodoxe).
Ces "Arabes israéliens" (ou Palestiniens citoyens d'Israël) sont assez souvent représentés au cinéma, (l'an dernier dans Je danserai si je veux). Mais ici, alors que la ville est peuplée majoritairement de musulmans, la réalisatrice Annemarie Jacir a choisi de ne parler que des chrétiens, plutôt issus de la classe moyenne... et occidentalisés. Du coup, à part dans le coin d'un plan très bref (pris de l'intérieur d'une voiture), on ne voit jamais de femme voilée. Tous les personnages féminins sont, à des degrés divers, des femmes belles et indépendantes.
Cela limite un peu la portée du film. D'un côté, c'est une peinture très intéressante d'une communauté méconnue. De l'autre, cela passe sous silence une donnée du problème (la vie des femmes dans le monde musulman actuel). Mais cela a le mérite de sortir la religion du débat. C'est d'abord le contrôle du territoire qui est au coeur du conflit israélo-palestinien. On s'en rend compte régulièrement quand on suit les pérégrinations des deux hommes en voiture. Tel rond-point est décoré d'un grand drapeau israélien, tel autre d'une gigantesque étoile de David sculptée. Quant au père, instituteur, il dépend d'une autorité israélienne pour sa promotion au poste de directeur d'école.
Mais ce n'est que l'arrière-plan du film. L'essentiel est constitué d'une comédie de moeurs, fort bien menée. Le père, interprété par Mohammad Bakri, a les yeux qui pétillent de malice (et un téléphone portable dont la sonnerie reproduit les notes de Vive le vent !). Bien que quitté par son épouse (partie vivre aux Etats-Unis), il garde espoir de la retrouver à l'occasion du mariage de leur fille. Bien que malade, il continue à fumer en cachette, tel un adolescent frondeur et, quand il en a l'occasion, il s'offre une pâtisserie qui risque de faire souffrir ses artères...
Le fils, architecte, vit en Italie. Il est interprété par Saleh Bakri (le propre fils de Mohammad !), qu'on a pu voir il y a quatre ans dans Girafada. Bien qu'il ait une petite amie palestinienne en Italie (fille d'un ancien dirigeant de l'OLP en exil) le père ne cesse d'attirer l'attention de son fils sur les superbes créatures qu'ils croisent au cours de leur mission de distribution des faire-part. Il y a la fille d'un ami de la famille, absolument ravissante, indépendante financièrement... et célibataire. Il y a cette automobiliste, tout aussi ravissante, rencontrée en plein embouteillage. Il y a encore la cousine, si mignonne, à tel point que le père regrette que la mode ne soit plus aux unions de proximité. Et puis il y a l'ex du fils, qu'il a connue il y a des années et qui, visiblement, éprouve encore des sentiments pour lui...
Certaines scènes sont de l'ordre du vaudeville. C'est vraiment drôle, y compris lorsque le père tombe sur une ancienne camarade de classe, qui le trouve très à son goût...
L'histoire est aussi celle de la confrontation des modes de vie et des opinions des Palestiniens de l'extérieur et de ceux de l'intérieur. Le fils s'est beaucoup occidentalisé, en particulier au niveau de son apparence physique. Par contre, il fait preuve d'une grande intransigeance vis-à-vis des Israéliens juifs.
Le père, quant à lui, est resté plus traditionnel dans son mode de vie. (Il est possible que les réticences qu'il éprouve vis-à-vis de la petite amie de son fils soient liées au fait qu'elle est sans doute musulmane. Elle se prénomme Nada et le père l'appelle tout le temps Selma.) Il s'est aussi accommodé de la présence israélienne, au point d'avoir fait ami-ami avec un fonctionnaire qui renseigne les services secrets israéliens (appelés Shabak dans la version originale). On finit par découvrir la part d'ouverture d'esprit, celle d'ambition et celle de crainte dans les motivations du père.
En dépit des quelques réserves émises, ce film est une bonne comédie, qui permet de découvrir un aspect méconnu du conflit israélo-palestinien. C'est de surcroît plutôt bien mis en scène, se concluant par un superbe plan sur un balcon.
13:43 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 28 février 2018
La Juste Route
Ce film en noir et blanc a pour cadre la Hongrie de l'immédiat après-guerre. En 1945, un bourg est en fête : l'épicier local marie enfin son fils, avec une fille de paysans (auparavant entichée d'un gars parti rejoindre la résistance communiste). Au village, tout le monde (ou presque) s'y prépare. Dans le même temps, à la gare ferroviaire voisine, descendent deux rescapés de la Shoah, qui transportent avec eux deux mystérieuses caisses, qui contiendraient des parfums ou des articles d'hygiène.
Très vite, la nouvelle se répand dans le village. L'intrigue se déploie alors sur deux plans : on suit le parcours des juifs (à pieds) et des deux caisses (sur un chariot), de la gare jusqu'au centre du village. On ne sait pas trop où ils vont exactement ni ce qu'ils viennent faire ici... d'autant que les deux hommes (un âgé, l'autre jeune adulte) sont quasiment mutiques.
Au sein de la population du village, trois familles semblent en savoir plus. La venue de ces juifs ne les arrange pas du tout et réveille des souvenirs que l'on voudrait bien voir rester enfouis. C'est un peu comme si un battement d'ailes de papillon était sur le point de provoquer la naissance d'un cyclone dans ce village.
Le plus gratiné est l'épicier, qui est aussi secrétaire de mairie. Dans l'arrière-boutique, il conserve un étrange album de famille. Quant au coffre de la mairie, il renferme quelques documents compromettants. Plusieurs des adultes du village sont prêts à en découdre avec les arrivants, bien que ceux-ci ne formulent a priori aucune revendication ni menace. D'un autre côté, certains habitants ne supportent plus cette ambiance délétère, ni le poids de la culpabilité.
C'est tout l'intérêt de ce film que de montrer les différentes attitudes des habitants et les conséquences de leur choix sur leur vie de tous les jours. Il convient aussi d'éclaircir le mystère de la présence de ces voyageurs, qui ne sont pas du village, mais sont peut-être apparentés à certains des habitants.
C'est un petit film bien ficelé, bien filmé, qui joue beaucoup sur le non-dit. Dans sa conclusion, il est assez ambigu, mais à nous, Français, dont le pays a aussi connu une période d'occupation allemande (et un gouvernement collaborateur), il évoque bien des choses.
22:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 25 février 2018
Alice comedies 2
Il y a un peu plus d'un an, j'avais signalé la sortie du premier volet des aventures de la gamine de chez Disney au pays des images animées. On nous propose quatre autres courts-métrages, dans lesquels l'héroïne est interprétée par trois actrices différentes. Ma préférée reste Virginia Davis, cette adorable choupinette (certes trop maquillée et court-vêtue), au visage expressif, qui correspond parfaitement à ce rôle d'enfant faussement sage... et diablement entreprenante :
Pour en savoir plus sur elle (et sur les films de la série), je recommande la lecture du dépliant et du dossier pédagogique que l'on peut télécharger sur le site de Malavida films.
La petite Virginia apparaît dès la première histoire, intitulée "Jour de pêche" :
Alice, qui a envie de sortir avec ses amis, fait croire à sa mère qu'elle joue du piano. Pour ce faire, elle recourt aux services... de son chien ! Elle s'éclipse, rejoint la bande de garçons et les aide à se faire prendre en stop. S'en suit une courte balade en voiture. (Rappelons que tout ceci se passe au milieu des années 1920.) La séance de pêche ne démarre qu'après... dans un endroit interdit, bien entendu. Histoire de se faire mousser un peu, la gamine raconte à ses amis comment elle a sauvé les Esquimaux. La voici plongée dans ses souvenirs... et en pleine animation. Elle se fait aider de Julius, un chat devenu son acolyte de prédilection dans les films. Les poissons faisant la "grève de la pêche" (!), elle trouve un moyen astucieux pour les rapprocher des Esquimaux...
Dans la deuxième histoire, "La Magie du cirque", c'est Lois Hardwick (qui épousa bien plus tard un certain Donald Sutherland) qui incarne Alice. C'est une séquence essentiellement animée, composée de mouvements répétitifs. Le clou du spectacle est le numéro de dresseur de fauves. C'est assez surréaliste et pas du tout aseptisé : à l'image de ce que l'on voit dans les autres films, on n'hésitait pas, à l'époque, à représenter la mort ou des démembrements... sur un mode humoristique, bien sûr.
Dans la troisième histoire, "L'Ouest moutonneux", Alice est jouée par Margie Gay, qui n'a pas tellement marqué les esprits, alors que c'est elle qui a interprété l'héroïne dans le plus grand nombre de films. (Disney s'était visiblement fâché avec les parents de Virginia Davis, peut-être devenus trop gourmands...) L'intrigue oppose de méchants voleurs de grand chemin à deux justiciers, Julius le chat et Alice, qui vont faire rendre gorge à ces voyous. La forme est encore plus déjantée que dans le précédent... et le fond est aussi plus violent. Je me contenterai de dire que la justice est rendue de manière expéditive...
On retrouve Virginia Davis en compagnie de Julius dans la dernière histoire, "Alice, joueuse de flûte", qui voit les deux héros tenter de gagner ce qu'ils croient être une grosse somme d'argent en débarrassant une maison de tous les rats qui la peuplent. C'est moins sombre que le précédent film et tout aussi inventif. Je signale aux aficionados que la musique d'accompagnement est de Manu Chao.
Voilà. Cela dure environ trois quarts d'heure et c'est visible par les petits comme par les grands.
23:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Moi, Tonya
Craig Gillespie s'est fait connaître comme réalisateur de films d'action (notamment The Finest Hours). Ici, il change de registre, avec ce biopic anticonformiste et "politiquement incorrect", à l'origine duquel se trouve la rivalité qui a opposé, il y a une vingtaine d'années, deux patineuses états-uniennes, Nancy Kerrigan et Tonya Harding.
La première est la petite fille modèle, sans aspérité apparente, bien dans le moule. Margot Robbie (vue dans Le Loup de Wall Street, Suite française et surtout Tarzan) incarne la seconde, la sale gosse, la teigneuse, la volcanique. Elle n'est pas née dans la soie. Le père, alcoolique, a fini par quitter le foyer, laissant une mère serveuse s'occuper seule de l'éducation de leur fille.
Le coup de génie des auteurs est de construire le film autour de la relation d'amour-haine entre les deux femmes, la mère et la fille, toutes deux incarnées par des actrices formidables (Allison Janney pour la mère), toutes deux nommées aux Oscar d'ailleurs. LaVona Harding ne peut pas être qualifiée de mère indigne : elle sacrifie sa vie privée et ses économies pour que sa fille unique puisse vivre sa passion pour le patinage... et peut-être permette à sa génitrice de prendre (par procuration) sa revanche sur la société. Mais cette mère est insortable, fumant clope sur clope, même (surtout) là où c'est interdit, buvant de l'alcool sans retenue et jurant en public comme en privé, quitte à traiter de "connasse" une mère qui la reprend à la patinoire. On atteint un sommet de poésie quand elle déclare à une autre personne Lick my ass ! ("Lèche-moi le cul !"), que les sous-titreurs ont improprement traduit par "Va te faire foutre !" Sa fille a bien retenu la leçon : des années plus tard, elle lance à un membre de jury très guindé un vibrant Suck my dick ! (qui m'a plongé dans un abyme de perplexité anatomique).
Bref, dans le monde de Tonya Harding, celui des petits Blancs du Nord-Ouest des Etats-Unis, on parle cru et on a parfois la main lourde. La mère n'hésite pas à cogner sa fille (au besoin avec tout ce qui lui passe sous la main) et, plus tard, c'est au tour du petit ami de celle-ci d'exprimer ses sentiments à coups de torgnoles. C'est un miracle qu'avec autant de handicaps dans la vie, la jeune femme ait pu devenir l'une des plus brillantes patineuses de sa génération. Notons que les scènes de patinage sont très bien filmées et mises en musique.
Autour de Tonya gravitent plusieurs personnages douteux : son petit ami bien sûr, mais aussi le meilleur ami de celui-ci, un Tanguy qui se prend pour un caïd de banlieue... sans parler des deux branquignols qu'il va recruter pour effectuer un petit boulot bien sordide... La jeune patineuse est sauvée par quelques bonnes fées, en particulier ses entraîneuses successives, l'une d'entre elles étant interprétée par Julianne Nicholson, qui s'illustra jadis dans la série New York, section criminelle. (Franchement, quel casting féminin !)
Même si le fond de l'histoire est assez noir, on rit souvent. Je trouve que les procédés utilisés par le réalisateur fonctionnent bien : certains personnages s'adressent directement à la caméra et, parfois, les images contredisent leurs propos, pour notre plus grand plaisir. C'est aussi un film sur la société américaine et la quasi ségrégation sociale qui était à l'oeuvre dans le patinage artistique, une chasse-gardée de la bourgeoisie bien-pensante qui n'a pas apprécié de voir débarquer cette talentueuse prolétaire.
P.S.
Au cas où vous trouveriez le trait trop appuyé, restez pendant le générique de fin, qui montre plusieurs des vrais personnages (aussi gratinés dans la vie qu'à l'écran). On y découvre aussi les images de l'exploit (le triple axel, en compétition) réussi par Tonya Harding.
00:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 24 février 2018
Pentagon Papers
Le titre "français" du dernier film de Steven Spielberg est une nouvelle illustration du snobisme de certains distributeurs, qui remplacent le titre d'origine (en anglais), non pas par un équivalent en français, mais par... un autre titre anglais ! (On a récemment vu le même procédé à l'œuvre pour The Passenger et 24H Limit.)
The Post (dans la version originale, dont nous avons d'ailleurs pu bénéficier au CGR de Rodez... un mois après la sortie du film) raconte comment un rapport secret, faisant le bilan de la politique américaine au Vietnam, a fini par être publié, au début des années 1970, d'abord par le The New York Times (pas très content de la manière dont cette histoire est contée par Spielberg), puis par The Washington Post.
Ce film est donc une ode à la liberté de la presse (démocrate), une dénonciation de l'unilatéralisme du pouvoir présidentiel (incarné ici par Richard Nixon, dont les coups de fil du soir sont sans doute une allusion aux tweets nocturnes de son lointain épigone) et l'histoire de l'affirmation professionnelle d'une femme, Katharine Graham (magistralement interprétée par Meryl Streep).
C'est tourné comme un film d'espionnage, avec ses rendez-vous secrets, ses documents ultra-confidentiels, ses coups fourrés et ses (petites et grandes) trahisons. Fidèle à son style, Spielberg a aussi voulu rendre hommage et faire œuvre d'historien. Certaines scènes ont donc un but strictement documentaire, comme celles qui montrent la machinerie d'une entreprise de presse, de la conception à l'impression et la distribution des journaux.
Les comédiens ont dû se fondre dans leur rôle, d'autant plus que nombre d'acteurs de l'époque sont encore vivants, ou du moins très présents dans les mémoires, outre-Atlantique. Voilà donc Meryl Streep et Tom Hanks (excellent en rédac' chef roublard) dotés de coiffures aussi originales que démodées :
Deux personnages se trouvent au centre de l'intrigue. Il y a tout d'abord le (premier) lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, qui va être la source primaire du Times puis du Post. A travers lui, Spielberg veut rendre hommage à ses lointains successeurs, comme Bradley Manning et Edward Snowden (qui, lui, a déjà eu les honneurs d'un documentaire et d'une fiction signée Oliver Stone)... persécutés sous une administration démocrate (celle d'Obama).
Il y a surtout cette "Kay" Graham, l'héritière du Washington Post, qui a dû succéder en catastrophe à son mari infidèle (et suicidaire). C'était il y a plus de quarante ans. A l'époque, la presse était dirigée et rédigée par des hommes, qui ne concevaient pas qu'un esprit en jupon puisse rivaliser avec eux. De surcroît, bien que connaissant parfaitement ce milieu, Kay Graham passait au départ pour une simple rentière. La mise en scène de Spielberg (bien aidée par l'interprétation de M. Streep) se charge de nous faire comprendre quelle était la pression qui pesait sur les épaules de cette femme. Au début, elle tâtonne, intimidée malgré sa connaissance des dossiers. Le film montre sa progressive montée en puissance, jusqu'à cette très belle scène, un soir de réception, dans un salon où, face à une troupe de vieux mecs en costume, Kay va tenir bon. C'est le grand talent de Spielberg que d'avoir réussi à créer quelques-uns de ces moments jubilatoires qui font passionnément aimer le cinéma.
21:46 Publié dans Cinéma, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, histoire
vendredi, 23 février 2018
L'Apparition
Xavier Giannoli s'embarque dans une enquête canonique, dont le but est de déterminer si la jeune Anna a bien eu les visions qu'elle raconte ou si c'est une affabulatrice, utilisée par le prêtre local pour accroître la renommée du lieu... et en tirer des revenus.
Si l'équipe constituée à l'instigation du Vatican est composée de religieux et de laïques croyants, l'enquête va être menée par Jacques, un journaliste réputé mais agnostique, auquel Vincent Lindon prête ses traits. Cela devient une banalité à force de le dire, mais il faut le répéter : c'est un formidable acteur, qui nous entraîne dans ses failles et dans ses doutes. Le début de l'histoire présente ce grand reporter blessé en Syrie, où il a perdu son meilleur ami. La participation à l'enquête canonique est pour lui un moyen de changer d'air... et peut-être de trouver la réponse à certaines questions.
Le deuxième pilier sur lequel repose l'histoire est le personnage d'Anna, incarnée à la perfection par Galatea Bellugi. Cette jeune actrice est stupéfiante de fraîcheur et de sincérité, à tel point que cela en devient troublant. A certains moments, j'ai eu l'impression de me trouver devant une Jeanne d'Arc de Provence. Le film vaut aussi par la description du mouvement que la visionnaire suscite. Dans la France laïcisée du XXIe siècle, on n'est plus habitué à ces scènes de dévotion, qui décrivent une réalité peu représentée par les médias dominants.
L'intrigue prend la forme d'un polar. Plusieurs mystères entourent la personnalité d'Anna, enfant abandonnée, passée de familles d'accueil en foyers. Et si la réponse se trouvait dans son passé ? Jacques se lance à la recherche de tous ceux qui ont connu la (future) visionnaire. Ses convictions évoluent au cours de l'enquête : il soupçonne une supercherie, mais il est de plus en plus touché par Anna. Et puis, un jour, il découvre un objet qui le ramène à son travail en Syrie. Comment se fait-il que cette enquête canonique le propulse dans son passé journalistique ?
Giannoli déroule le fil de l'intrigue en chapitres, la conclusion étant relativement ouverte. Chacun y trouvera matière à réflexion, même si l'enquête a permis de décrypter certaines énigmes. C'est un très bon film, de "qualité française", visible par les croyants comme par les non-croyants.
10:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 21 février 2018
24H Limit
Le titre d'origine ("24 hours to live") est plus explicite. Tué au cours d'une mission, Travis Conrad (Kevin Bacon, tout plein de muscles et de fêlures) revient à la vie grâce à un programme expérimental, auquel il n'était pas censé survivre. A partir de là, il lui reste moins d'une journée pour tenter de réparer les dégâts qu'il a contribué à créer et (peut-être) sauver la femme dont il est tombé amoureux.
Ce film d'action un peu bourrin entremêle plusieurs genres. Le polar est mâtiné de science-fiction et d'un brin de romantisme, le tout sur fond d'histoire(s) familiale(s) et d'alcoolisme prononcé. Au niveau de l'ambiance, on n'est pas très loin d'œuvres comme Source Code et Looper.
Honnêtement, les scènes d'action "dépotent". On est d'ailleurs cueilli dès le début par une séquence où s'illustre l'héroïne, Lin, une policière chinoise d'Interpol (est-il besoin de préciser que le film est une coproduction sino-américaine ?) qui réussit à contrer (partiellement) l'attaque d'un groupe d'horribles mercenaires. Mais ce n'est qu'ensuite qu'on comprend les tenants et aboutissants de cette séquence. Au premier regard, les "bons" pourraient passer pour les "méchants" et vice-versa.
La suite immédiate m'a déçu. On découvre le héros sur une plage de Floride, en compagnie d'un homme plus âgé (incarné par un rescapé de Blade Runner !). Les images sont jolies mais les dialogues creux, accumulant les poncifs.
Cela redevient intéressant quand les deux personnages principaux "font connaissance". Auparavant, on aura compris à quel point Travis peut être redoutable, puisqu'il lui suffit d'un manche à balai et d'un bidon de détergent pour mettre hors d'état de nuire les deux meilleurs agents de son (ancien) employeur. La scène est vraiment cool, bien orchestrée.
A partir du moment où Travis et Lin allient leurs forces contre les méchants et les très très méchants (eh, oui : il y a différents degrés de "méchantitude"), l'histoire est sur d'excellents rails. Je recommande tout particulièrement la séquence du bidonville sud-africain, qui prend un tour inattendu... et très frappadingue.
L'action culmine dans l'assaut du QG de l'entreprise de mercenaires. Si l'on fait abstraction de quelques incohérences (qui permettent au héros de déjouer presque tous les pièges au prix de quelques égratignures), on peut profiter pleinement d'une baston bien mise en scène.
22:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Wonder Wheel
Cette grande "roue des merveilles" est l'une des attractions du parc de Coney Island (à New York), où se déroule l'action du dernier film de Woody Allen. Métaphoriquement, c'est aussi la roue du Destin, celui des quatre personnages principaux, qui va connaître des soubresauts.
Justin Timberlake incarne Mickey, le maître-nageur-sauveteur qui nous raconte l'histoire. C'est un beau gosse insouciant, mais qui a l'ambition de devenir auteur de théâtre. C'est le petit élément qui grippe un peu l'intrigue : autant Justin Timberlake (déjà remarqué dans The Social Network) n'a aucun mal à rendre crédible le personnage de maître-nageur, autant je ne le vois pas écrire une pièce. Ceci dit, l'histoire qu'il vit va contribuer à le faire mûrir : lui qui est attiré par les destins tragiques va être servi !
James Belushi interprète Humpty, l'exact opposé de Mickey : il est âgé, il est obèse, il s'habille mal et exerce un métier pas très valorisant (il entretient l'un des manèges du parc d'attraction). Mais c'est un brave type, qui a renoncé à l'alcool pour que la femme qu'il aime passionnément reste avec lui.
Cette femme est Ginny, une actrice ratée devenue serveuse, ancienne beauté fatale qui a encore de (très) beaux restes. Elle a le corps et la voix de Kate Winslet, qui nous livre là une composition formidable (qui aurait mérité une nomination aux Oscar). C'est le grand mérite de ce film que de mettre sous les projecteurs le personnage d'une femme ordinaire, prise dans les tourments de l'amour et des difficultés matérielles. Pourtant, quand l'histoire commence, elle mène sa petite vie tranquille, tout en planifiant un changement radical. C'est l'arrivée de sa nièce belle-fille qui va tout foutre en l'air.
Celle-ci est jouée par Juno Temple. De prime abord, c'est une sorte de poupée Barbie, un peu sotte, mais qui va se révéler plus intelligente que prévu. Sa beauté est particulièrement mise en valeur par le metteur en scène... et le chef-opérateur, comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus. Après Café Society, c'est la deuxième fois que Woody Allen travaille avec Vittorio Storaro. Force est de constater que, sur le plan visuel, c'est de nouveau une grande réussite.
Une fois les personnages mis en place, la roue du Destin peut se mettre à tourner. Elle peut aussi bien permettre à Ginny de tromper facilement Humpty que mettre sa nièce belle-fille sur son chemin. Celle-ci peut, sur un coup du sort, échapper aux truands qui la recherchent et tomber sur son futur amoureux dans le parc. L'intrigue est construite autour de ces croisements.
C'est toutefois un film un peu verbeux. On va me dire : quoi de plus normal, pour un Woody Allen ? C'est juste. Mais, d'habitude, la logorrhée est au service de la comédie. Or, ici, même si l'histoire est parsemée de pointes d'humour, c'est le drame sentimental qui est au cœur des dialogues. Cela nous vaut quand même quelques morceaux de bravoure, James Belushi et Kate Winslet ayant dû parfois ingurgiter des pages de texte pour une seule scène. Je recommande tout particulièrement celle (vers la fin) qui voit Ginny, revêtue d'une tenue de gala, exprimer toute sa détresse.
C'est donc un bon Woody, assez inattendu de sa part.
12:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 20 février 2018
L'Etrange Forêt de Bert et Joséphine
Elle n'est pas très connue du grand public, mais l'école d'animation tchèque produit, à intervalle régulier, de petits films (en général) destinés aux enfants, mais aussi visibles par les parents. (Dans un genre plus "sérieux", on a pu voir, il y a six ans, l'excellent Aloïs Nebel.)
C'est animé image par image. A l'écran, les décors sont faits de tissus, papiers divers. Les personnages sont des sortes de marionnettes. Dit comme cela, cela donne l'impression d'être un peu vieux jeu et ordinaire. En réalité, le rendu est superbe, notamment parce que les animateurs ont veillé à ce que tout le cadre s'anime, et pas seulement les personnages principaux.
Ce moyen-métrage (qui dure environ 45 minutes) est découpé en sept historiettes. La première (la plus longue) nous présente le frère et la soeur (Bert et Joséphine), ainsi que les chanteuses de la forêt. Les enfants, qui entretiennent celle-ci et réparent au quotidien les dégâts qu'elle subit, vont se retrouver confrontés à une étrange voleuse, qui va finir par trouver sa voie. (Soyez bien attentifs aux micros et haut-parleurs !)
La deuxième histoire se passe un matin, après d'importantes chutes de neige. Il s'agit d'abord de faire sortir Bert de son lit. Sa soeur et ses amis vont déployer des trésors d'inventivité...
La troisième histoire est empreinte de mystère. Les personnages réunis dans la petite maison des enfants vont tenter de faire venir à eux un puissant esprit. Sans trop en dire, je peux révéler que le résultat va beaucoup les surprendre !
La quatrième histoire est celle d'une errance dans la forêt embrumée. Selon la légende, un être maléfique y vit, terré. Bert et Joséphine parviendront-ils à surmonter cette terrible épreuve ?
La cinquième histoire met en scène un nouveau personnage, "type-taupe", un animal sympathique mais maladroit... et un peu sale. Comment les enfants vont-ils se comporter avec lui ?
La sixième histoire est l'aboutissement des précédentes, au cours desquelles on voit les héros préparer le futur repas de Noël. C'est le moment que choisit un écureuil pour taper l'incruste... et se comporter comme un goujat. Bert et Joséphine vont tenter de découvrir l'emplacement de son refuge...
La septième histoire est une sorte de conclusion. Comme elle met en scène la naissance d'une fée, on pourrait y voir des réminiscences chrétiennes : elle suit immédiatement le repas de Noël et se produit le septième jour. Mais cela passe au-dessus de la tête des enfants. Dans la salle où je me trouvais, ils ont été étonnamment attentifs. Avant la séance, il y a avait une petite ambiance de cour de récré... ce qui n'a pas manqué de m'inquiéter. Eh bien, dès que la première histoire a débuté, ils se sont tus.
A la qualité (et l'originalité) de l'animation s'ajoute le fond : ce sont de petits contes moraux. Bert apprend à dominer sa peur du noir... et à ne pas rester trop longtemps au lit. Lui et sa soeur découvrent qu'une apparence disgracieuse, une mauvaise réputation ou un comportement maladroit ne doivent pas les dissuader de se faire de nouveaux amis.
P.S.
Des bonus sont accessibles sur le site internet dédié.
13:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 19 février 2018
Sugarland
Cet étonnant documentaire australien se place dans la lignée de Supersize me, de Morgan Spurlock, sorti il y a déjà une quinzaine d'années. Ici, au lieu de s'alimenter uniquement dans une chaîne de restauration rapide, l'auteur-interprète (Damon Gameau) choisit de faire l'expérience d'une alimentation sucrée, en excluant toutefois les produits les plus évidents : bonbons, chocolat, gâteaux, glaces... En théorie, il consomme de "bons" aliments, achetés (en général) en grande surface. On se rend rapidement compte qu'ils regorgent de sucres cachés.
Comme Damon Gameau a le sens de l'humour, il se met en scène de manière comique, comparant le développement de son embonpoint abdominal à la progression de la grossesse de sa compagne. En deux mois, il aura pris plus de huit kilos... sans consommer davantage de calories (autour de 2 300 par jour) ! Il a pourtant pris soin de ne pas changer de rythme de vie, continuant à pratiquer du sport à intervalle régulier. Pour valider son expérience, il se fait suivre par quatre spécialistes, auxquels il donne des surnoms de super-héros.
Le documentaire se veut pédagogique. Il explique quels sont les différents types de sucre. Il a aussi recours à des experts, dont les interventions apparaissent souvent en incrustation, sur les étiquettes des produits que consomme Gameau. On a même droit à quelques animations anatomiques, notamment pour découvrir le fonctionnement du foie.
La première partie du film se déroule en Australie. En moyenne, ses habitants consommeraient l'équivalent de quarante cuillerées de sucre par jour ! Le "régime" auquel s'astreint Gameau le conduit à ingurgiter la chose à travers des aliments transformés. Un des exemples marquants est la comparaison entre la consommation de quatre pommes et celle du volume de jus de fruits correspondant. La différence est, qu'au bout de deux voire trois pommes, le sentiment de satiété se fait sentir, alors qu'avoir bu tout le jus ne suffit pas à couper la faim.
Une des séquences les plus fortes se déroule dans un territoire aborigène. Les jeunes générations ont complètement rompu avec le modèle ancestral, d'où la consommation de sucre était absente. C'est arrivé à un point que les magasins de la région sont considérés par les plus profitables du monde par les vendeurs de sodas. Un homme a essayé de réagir face à cette situation de dépendance et à ses conséquences (en particulier l'obésité). Le film montre comment il est parvenu (avec d'autres), dans sa communauté, à faire en sorte que les gens reprennent goût à une alimentation saine. Hélas, son association a perdu ses subventions...
La deuxième partie du film se déroule aux Etats-Unis, siège de la plupart des multinationales de l'agroalimentaire qui dominent le secteur. Sans avoir le talent d'un Michael Moore, Gameau dénonce l'influence néfaste de ce lobby et découvre jusqu'où les transformateurs vont fourrer le sucre (par exemple l'équivalent de quatre cuillerées dans un plat cuisiné à base de poulet !). Ne reculant devant aucun sacrifice, il va, sur une journée, jusqu'à remplacer les plats cuisinés par l'équivalent en sucre réel... à vous dégoûter d'en manger ! (C'est le but, d'ailleurs.)
Ce séjour états-unien est aussi l'occasion de montrer les méfaits d'une consommation intensive et régulière de produits sucrés. Gameau suit un dentiste qui intervient (bénévolement semble-t-il) dans l'est du Kentucky, une région où le taux de pauvreté est élevé. Je pense qu'aucun des spectateurs de la salle n'oubliera le cas de ce jeune homme, dont toutes les dents sont pourries (et rongées), à cause de sa dépendance à un soda particulièrement sucré créé par Pepsi. (Coca n'est pas la seule boîte à vendre de la m...). Le pire est que le jeune homme n'envisage pas de changer de mode alimentaire, tant celui-ci est ancré en lui... peut-être depuis la plus tendre enfance, certaines mères de famille de la région n'hésitant pas à remplir le biberon de soda !
Il y aurait encore plein de choses à dire à propos de ce documentaire, parfois un peu surjoué par son auteur, mais vraiment passionnant (et drôle). C'est à voir si vous en avez l'occasion.
20:03 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
dimanche, 18 février 2018
Agatha, ma voisine détective
Cette animation danoise a pour héroïne une certaine Agatha Christine, une gamine imaginative, intuitive et entêtée, qui se rêve détective privée, telle une nouvelle Miss Marple (avec beaucoup beaucoup moins de rides).
Son quotidien n'est pas des plus emballants : sa mère vient de décider de déménager en compagnie de toute sa petite famille (sauf le papa, curieusement absent de cette histoire de femmes). La voilà obligée de se faire de nouveaux amis, coincée qu'elle est entre une mère très protectrice (on comprend plus tard pourquoi), une grande soeur en pleine crise d'adolescence et un petit frère qui parle à peine, mais sait très bien dire "caca !"
Avis aux inconditionnels des productions Disney-Pixar : le graphisme n'est pas très élaboré. Il permet toutefois de distinguer deux types de scènes : celles de la réalité et celles issues de l'imagination de l'enquêtrice en jupe courte (et imperméable).
Agatha est certaine d'avoir identifié l'auteur des vols à l'épicerie du quartier. Elle propose au patron de celle-ci de l'engager. Elle est pleine de bonne volonté et très bricoleuse : elle conçoit des outils pour piéger l'odieux délinquant. Mais, hélas, à intervalle régulier, quelque chose vient enrayer la marche glorieuse de la justicière au service de l'intérêt général.
Au quotidien, Agatha dialogue surtout avec un étrange lézard, qui grandit au fur et à mesure qu'elle se rapproche de la vérité. Je suis quelque peu perplexe quant à son interprétation symbolique. Cela n'a pas perturbé les bambins de la salle : l'intrigue se suit sans problème, lentement... trop à mon goût d'adulte. Mais l'histoire parle beaucoup aux jeunes : il est question des relations avec les parents, les frères et les soeurs, de l'amitié et du fait de posséder un animal domestique. On comprend aussi pourquoi des éléments anodins aux yeux des adultes peuvent prendre des proportions gigantesques aux yeux des enfants. Quant à ceux-ci, ils réalisent que de petites imprudences peuvent avoir des conséquences graves.
Sans être un chef-d'oeuvre, ce film s'appuie sur une bonne connaissance de l'univers enfantin et instille, ici et là, quelques leçons de vie.
P.S.
Le site internet dédié est sympatoche.
23:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Oh Lucy !
C'est l'histoire d'une Japonaise célibataire, un peu coincée, qui va prendre des cours d'anglais auprès d'un jeune (et séduisant) enseignant américain. Quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Il faut d'abord préciser que c'est à l'initiative de sa nièce que Setsuko/Lucy (Shinobu Terajima, excellente) va se lancer dans l'apprentissage de la langue de Donald Trump. Cela nous vaut plusieurs scènes savoureuses, susceptibles de décomplexer les Français quant à l'acquisition des langues étrangères. (Et je ne parle pas du lieu dans lequel se tiennent les cours, qui prête à bien des suppositions...)
Il faut dire qu'en plus d'être charmant, John (incarné par Josh Hartnett, mesdames) sait y faire. Ses méthodes d'enseignement semblent assez originales. De plus, il est très... tactile. Visiblement, les dames (et même les messieurs) adorent. Setsuko, qui s'ennuie dans un emploi rébarbatif (quoique rémunérateur), aux côtés de collègues hypocrites, y voit l'occasion de changer de vie.
La deuxième partie nous transporte aux Etats-Unis, plus précisément en Californie, où (pour des raisons que je me garderai de révéler) nous retrouvons notre petit monde, à savoir John, Setsuko, mais aussi sa ravissante nièce Mika et Ayako, la mère de celle-ci (et donc la soeur de Setsuko, si vous avez bien suivi). On comprend vite qu'entre les deux frangines existe un sacré contentieux, dont on va finir par découvrir la cause.
D'ailleurs, Cet événement ancien a sans doute des répercussions sur l'évolution de la situation actuelle, en particulier sur le comportement de Setsuko/Lucy, qui commence à kiffer la vie à la californienne. On rit presque autant que dans la première partie, même si, petit à petit, l'émotion prend le dessus.
Au-delà des apparences (et des convenances), chaque personnage cache au moins une faille, que cette aventure va faire émerger. C'est traité avec délicatesse par la réalisatrice Atsuko Hirayanagi. Ce film est l'une des excellentes surprises de ce début 2018.
23:14 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films