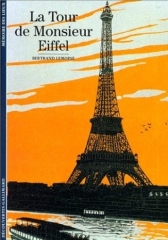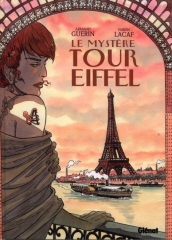dimanche, 19 décembre 2021
Spider-Man : no way home
Plutôt que "pas de retour à la maison", il aurait mieux valu intituler ce film "Spider-Man et le multivers", ce qui aurait été plus classe et (surtout) plus conforme au contenu... même si (sans trahir un secret d'État) je peux annoncer qu'à la fin, la situation du héros n'est plus celle du début. Il ne va pas retrouver l'exact monde dont il est parti.
En attendant cette conclusion, l'histoire commence sur le mode comique. Une fois son identité secrète révélée, Peter Parker doit affronter le harcèlement des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu. S'en suit une folle échappée avec sa M-J. C'est franchement emballant et drôle. Les deux tourtereaux forment un joli couple.
Cela se gâte quand le héros retrouve Docteur Strange. Autant j'ai eu plaisir à voir débarquer Benedict Cumberbatch, autant le tour pris par la caractérisation du personnage de Parker m'a agacé. Clairement, les scénaristes ont misé sur le côté adolescent, un peu immature et capricieux. (Fort heureusement, tous les ados ne le sont pas.) Évidemment, Parker va faire une grosse bêtise... mais une bêtise que, dans un premier temps, il contribue à réparer. (Superbe séquence de combat autour d'un pont à la clé.) C'était compter sans cette bonne vieille tante May qui, dans cette version des aventures, a les traits de Marisa Tomei. Elle est un peu "bobo gaucho", la tante May. Elle met de drôles d'idées dans la tête du jeune homme, du genre que même un criminel endurci peut être "soigné" et que donc ô grand jamais il ne faut l'envoyer à la mort, même si c'est celle qu'il a connue dans le passé.
Ici, le propos se fait politique. Le film se place clairement sous la bannière progressiste (multiculturaliste), de surcroît adversaire de la peine de mort. Même si d'autres idées ont voix au chapitre dans l'intrigue (surtout quand on constate les dégâts provoqués par le choix de Parker), au final, la "ligne politique" est tenue.
Cette incursion dans un débat sensible aux États-Unis est d'autant plus surprenante que l'écrasante majorité des quelque 150 minutes que dure le film est plutôt consensuelle. Entre amours adolescentes (chastes), amitié fidèle et espoir de réussite par les études, on ne peut pas dire que l'anticonformisme soit de mise.
Au niveau du jeu des acteurs, sans surprise, c'est stéréotypé. Pas facile de faire éclater son talent devant un fond vert. Dans ce domaine, j'ai trouvé deux des vieux routiers assez convaincants : Alfred Molina (qui semble avoir vraiment aimé incarner Docteur Octopus) et Willem Dafoe, le plus ambigu de tous en Norman Osborne / Bouffon Vert.
En parlant de vieux routiers... il ne faudrait pas que j'oublie les prestigieux anciens. Sachez, chers (potentiels) spectateurs, que, pour le prix d'un billet, vos aurez droit non pas à un, ni même à deux, mais à trois Spider-Man ! Cette improbable rencontre est chouette à voir, bien mise en scène et elle débouche sur une époustouflante séquence de combat final autour de la Statue de la Liberté.
Même si je commence à me faire un peu vieux pour ce genre de "marvelleries", j'ai apprécié le spectacle.
P.S. I
Comme de coutume, il convient de ne pas quitter la salle trop tôt. Le générique de fin est interrompu par une scène faisant allusion à Venom 2. Il se confirme que Spider-Man va avoir un nouvel antagoniste...
P.S. II
Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Au bout du bout, ces coquins de producteurs ont demandé aux monteurs de glisser une assez longue séquence finale, qui indique que le prochain Docteur Strange est déjà tourné. (Sa sortie est programmée pour mai 2022.)
14:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 18 décembre 2021
Madres Paralelas
Ces "mères parallèles" sont Janis et Ana, une photographe quadragénaire et une adolescente déscolarisée, toutes deux enceintes au début de l'histoire. L'intrigue les fait se rencontrer, s'éloigner puis se rapprocher à nouveau, pour des raisons qu'il vaut mieux ne pas révéler ici. Penelope Cruz (pour laquelle le film a sans doute été écrit) est excellente. J'ai quand même été plus emballé par les scènes qui voient surgir l'éternelle Rossy de Palma, qui a toujours autant de présence à l'écran.
Cette intrigue essentiellement mélo est insérée dans une histoire au long cours, celle des fosses communes de la Guerre civile espagnole. La mémoire de la fin des années 1930 resurgit à travers d'autres mères, elles-mêmes filles, petites-filles voire arrière-petites filles de républicains espagnols, fusillés par les phalangistes (les miliciens franquistes). Cette histoire-là est passionnante, à tel point qu'on regrette qu'elle ait été (principalement) cantonnée au début et à la fin du film.
De son côté, le mélo (mal relié à l'autre intrigue) n'est pas toujours bien écrit ni joué, en particulier au début (j'ai vu le film en version originale sous-titrée). C'est très prévisible. Sans avoir quasiment rien lu sur le scénario, j'étais certain de ce qui allait se passer à la maternité, quand bien même on ne le découvre que bien plus tard. Penelope Cruz a beau tirer son épingle du jeu, c'est cousu de fil blanc (tout comme l'était Julieta, d'ailleurs).
En creusant bien, on peut quand même relever de beaux portraits de femmes, les hommes étant le plus souvent absents... et, en général, au vu du peu que l'on sait d'eux, cela vaut mieux.
C'est un film plutôt destiné aux fans indulgent(e)s.
17:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 17 décembre 2021
Clifford
Ce titre improbable est dû au nom qu'un adorable petit chien rouge reçoit d'une jeune fille solitaire, un peu à l'écart des autres gamines de son âge. De par son statut social, elle fait déjà tache dans ce quartier ultra-chicos de New York : fille de mère célibataire (avocate, tout de même), elle vit dans un appartement à loyer plafonné. Elle bénéficie sans doute d'une bourse pour fréquenter un prestigieux collège privé, où elle devient le souffre-douleur d'une sale petite pétasse privilégiée et de sa bande de grosses bourges... et voilà que je réalise -ô, surprise- que cette comédie fantastique, destinée à un public familial, est de gôche !
L'histoire commence sous les meilleurs auspices, avec une jolie vue plongeante de Manhattan, façon aquarelle. Dans un parc, un mystérieux et malicieux vieil homme (Coucou, John Cleese !) a planté sa tente, un étonnant abri qui, vu de l'extérieur, doit occuper une quinzaine de mètres carrés et qui, vu de l'intérieur, semble plus étendu qu'un hall de gare parisien. La jeune Emily Elisabeth y découvre un chiot à nul autre pareil... qui lui réserve bien des surprises !
Pour l'héroïne, les ennuis commencent quand l'animal acquiert une taille gigantesque... avec les conséquences prévisibles pour le mobilier de l'appartement ! Une fois dehors, le clébard géant se fait remarquer... et il nous fait rire : il remue la queue, joue à la (grosse) baballe, lèche goulûment, éternue, urine (façon Gargantua)... et pète ! (Quiconque n'a jamais senti la petite flatulence foireuse d'un chien ou d'un chat domestique ne peut mesurer toute la puissance de ce gag en milieu confiné.)
Dans le même temps, Emily gagne la sympathie de la population multiculturelle du quartier, qui prend fait et cause pour elle contre le méchant tycoon pété de thunes, dont la philanthropie ostentatoire masque difficilement la volonté de puissance.
On est évidemment dans la caricature et l'éloge lourdingue du "vivrensemble"... mais l'histoire est rythmée, avec de bons gags à intervalle régulier. Dans la salle, on rit de 7 à 77 ans.
En revanche, la fin est particulièrement lénifiante. Cette avalanche de bons sentiments m'a presque écœuré. Dommage, car cela a (un peu) gâché le réel plaisir que j'ai eu à voir cette gentille petite comédie.
21:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 09 décembre 2021
Où est Anne Frank !
J'appartiens à une génération à laquelle on a peu enseigné l'extermination des juifs. Au collège, c'était au programme de la fin de Troisième... et mon prof d'histoire de l'époque s'est davantage investi dans le récit de ses plongées sous-marines (au large de la Grèce) que dans l'étude du génocide... Rebelote en Première : la Seconde Guerre mondiale était le dernier chapitre d'histoire de l'année, que mon prof (passionnant) a tout fait pour boucler, calant cependant avant la Shoah. Je dois ma connaissance de cette époque à la télévision, au cinéma et à mes lectures. Parmi celles-ci figure le Journal d'Anne Frank.
D'Ari Folman, on connaît les œuvres d'animation Le Congrès et surtout Valse avec Bachir. Elles sont marquées par un incontestable raffinement sur le plan visuel et la volonté d'utiliser les images pour faire passer des idées.
Ce n'est donc pas à une simple illustration du célèbre Journal qu'il faut s'attendre ici. L'histoire croise deux trames temporelles : celle des années 1942-1944 (principalement passées dans l'Annexe -ou pièce secrète- du lieu de travail d'Otto Frank, le père d'Anne) et celle des années 2010, à Amsterdam (dans le bâtiment devenu musée et dans un squat) mais aussi plus à l'est, en Allemagne et en Pologne.
Folman a choisi de donner vie à Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank, à qui elle se confiait en rédigeant son journal. La séquence qui montre la "naissance" de ce personnage est particulièrement réussie, à l'image de tout le film d'ailleurs, marqué par l'inventivité visuelle et un certain brio au niveau de la mise en scène.
Kitty prend forme dans les années 2010, mais, au début du film, elle ignore ce qui s'est passé dans la suite du Journal (à peine commencé dans la trame temporelle parallèle), ainsi qu'après que celui-ci s'est interrompu. On voit donc ce personnage effectuer des allers-retours entre la Seconde Guerre mondiale (où il joue le rôle de confidente d'Anne) et l'époque contemporaine, où Kitty tente de mener sa propre vie... parfois de manière rock'n'roll ! Elle y tombe amoureuse d'un gentil pickpocket, prénommé Peter, comme l'amoureux d'Anne Frank. C'est bien entendu volontaire, le réalisateur utilisant les années de guerre pour tendre un miroir à notre époque. (C'est selon moi le procédé le moins réussi du film.)
Kitty s'étonne que dans l'Amsterdam des années 2010 autant de lieux portent le nom de son amie, une personne totalement anonyme dans les années 1940. Elle va finir par découvrir pourquoi, tout en contribuant à ressusciter, à l'écran, les événements du passé.
Les dialogues comme la mise en scène rendent justice à l'humour (parfois piquant) et à l'esprit frondeur de la petite adolescente juive. Certains plans, quasiment oniriques, sont un hommage à son imagination débordante.
On est en revanche consterné par la bêtise d'une partie des lycéens que leurs profs ont emmenés au théâtre, voir une pièce tirée du Journal. Pendant la séance, ces petits blaireaux préfèrent se plonger dans leur smartphone, sans la moindre considération pour leurs voisins... et sans susciter de réaction des enseignants, qui ne s'inquiètent que quand une intruse conteste ce qui est représenté sur scène...
Sans surprise, la séquence la plus émouvante est celle au cours de laquelle Kitty découvre ce qui s'est passé après l'arrestation des occupants de l'Annexe. J'ai beau connaître cette partie de l'histoire, j'ai encore été ému.
Je suis moins convaincu par la conclusion "immigrationniste", mais le film, dans son ensemble, m'a souvent captivé.
23:22 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 07 décembre 2021
Le Calendrier
Cette coproduction franco-belge verse dans le film de genre, d'épouvante plus précisément. Les amateurs avertis percevront le croisement de deux schémas narratifs connus : le détournement d'une fête traditionnelle (ici, la période précédant Noël), un peu à l'image d'Halloween ou de Mortelle Saint-Valentin, et la réalisation de rêves inaccessibles, quel qu'en soit le prix, comme dans I Wish.
Ici, l'héroïne n'est pas persécutée à l'école, ni victime de tourments familiaux, mais mal considérée au travail. Cette sportive (fort bien gaulée), nageuse forcenée, est une ancienne danseuse, qui a perdu l'usage de ses membres inférieurs dans un accident de voiture dont on mettra du temps à connaître tous les ressorts. Elle est incarnée avec beaucoup de talent par Eugénie Derouan, que les téléspectateurs français ont peut-être repérée dans certaines fictions policières. À la fois faible et fort, implacable et empathique, le personnage d'Eva est porté par une interprétation très inspirée.
Cette fois-ci, l'objet par lequel le surnaturel pénètre dans la vie de gens ordinaires n'est pas un livre ou une boîte à musique, mais un calendrier de l'Avent... un peu spécial. Tout d'abord, il semble dater de plusieurs siècles, au moins. Mais, surtout, quand minuit vient, il se met en marche tout seul, s'adresse à sa propriétaire... et semble capable de réaliser ses vœux.
Ne vous y fiez pas, braves gens ! Cette tentation est l’œuvre du Malin. Sous prétexte d'améliorer la vie de ses proies, il étend sans cesse son empire. Jusqu'où sa nouvelle cible est-elle prête à aller pour recouvrer l'usage de ses jambes ? Mystère...
C'est bien réalisé, sans effet de manche, avec relativement peu d'effets spéciaux... et quelques clins d’œil sympathiques, comme cette mini-boucle temporelle, en écho à un passage d'Interstellar...
20:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 03 décembre 2021
Les Choses humaines
Yvan Attal est de retour derrière la caméra, avec l'adaptation d'un roman qu'il a tirée vers une peinture de notre époque et de ses travers. Au cœur de l'intrigue se trouve la "relation" d'un soir entre deux jeunes gens, relation que le garçon estime consentie, tandis que l'adolescente dénonce un viol.
Avant d'en arriver là, on nous présente les protagonistes, avec d'un côté la famille de grands bourgeois intellectuels, habitant en centre-ville, de l'autre, une classe moyenne moins friquée, vivant dans des appartements de taille plus modeste, plutôt en périphérie. (Les deux sont de culture juive, laïque d'un côté, religieuse de l'autre.)
Viennent ensuite les deux versions de l'histoire, un peu comme dans Le Dernier Duel, de Ridley Scott. Ce n'est pas filmé en caméra subjective mais l'on comprend qu'on nous propose successivement la vision de la jeune femme puis celle du jeune homme. Le réalisateur n'a pas forcément fait un cadeau en confiant ce rôle à son fils Ben. Celui-ci a visiblement été chargé (avec succès) d'entretenir l'ambiguïté quant à son personnage, qui n'apparaît jamais ni complètement coupable, ni complètement innocent. Mais la véritable révélation de ce film est Suzanne Jouannet, que j'ai trouvée bouleversante. Voilà un nom à suivre.
Une fois les hostilités judiciaires déclarées, le film pratique l'ellipse. On ne voit que le début de l'enquête, mais pas la suite de l'instruction. On se retrouve projetés au début du procès, deux ans et demi plus tard. C'est l'une des grandes réussites de ce film, d'un (trop ?) grand classicisme : son souci de la pédagogie, faisant toucher du doigt ce qu'est une garde à vue, une mise en examen et un procès aux Assises pour viol.
Cela constitue le dernier tiers de l'histoire. La tension (et une certaine virtuosité) culminent au moment des plaidoiries, celle de l'avocate de la Partie civile (Judith Chemla, mordante à souhait) et celle de la Défense (Benjamin Lavernhe, excellent). En revanche, le réquisitoire du procureur, pour intéressant qu'il soit sur le fond, est débité de manière maladroite.
Outre l'aspect judiciaire, le film aborde des thèmes comme la médiatisation des affaires criminelles, le harcèlement sur les réseaux sociaux, la division des féministes en chapelles et, bien entendu, la domination masculine. Celle-ci est mise en scène à travers le personnage du père de l'accusé, incarné par un Pierre Arditi qui singe (avec talent) un mélange de Michel Drucker et de Thierry Ardisson. Derrière une apparente bienveillance (envers les femmes), ce "vieux beau" cache un tempérament manipulateur. À l'opposé (en terme d'âge), les jeunes loups, anciens du lycée Henri IV, sont de petits prédateurs dans leur genre. On notera toutefois que l'histoire ne s'est pas attachée à dénoncer les pires, plutôt à pointer les manquements d'individus que l'éducation, les fréquentations et la culture auraient dû prémunir contre des comportements malsains.
Certaines femmes en prennent aussi pour leur grade, à travers le débat entre féministes (pas très bien joué ni mis en scène, ceci dit) et (surtout) à travers la dénonciation sous-jacente de l'attitude de plusieurs personnages, comme la directrice des programmes, présentée comme une adepte de la "promotion canapé", ou la jeune stagiaire qui tombe enceinte d'un type qui pourrait être son grand-père. Toutefois, plus qu'un jugement moral, le film propose un portrait du désordre amoureux contemporain, entre familles recomposées, couples dissemblables et coups d'un soir.
J'ai lu (et entendu) ici et là qu'à force de vouloir peser le pour et le contre, d'adopter tous les points de vue, le réalisateur finissait par tout mettre sur le même plan, refusant de trancher sur le fond de son histoire. C'est inexact. Certes, la séquence du procès se conclut par un morceau de bravoure, celui de l'avocat de la défense... mais c'est conforme à la procédure française. Lui succède une des scènes de retour en arrière. Elle n'apporte pas de révélation extraordinaire, mais elle s'achève sur une image qui ne laisse planer aucun doute.
Dans la salle où j'ai vu le film, le public a été captivé du début à la fin.
21:43 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
dimanche, 28 novembre 2021
On est fait pour s'entendre
De et avec Pascal Elbé, cette comédie romantique s'appuie sur un fait de société : les problèmes d'audition d'une part non négligeable de la population adulte (non retraitée). Antoine, prof d'histoire-géo dans un lycée de l'agglomération parisienne, finit par découvrir qu'il entend de moins en moins ce que ses interlocuteurs (élèves compris) lui disent et qu'il ne perçoit quasiment plus les bruits périphériques, de l'alarme du lycée à la sonnerie de son réveil-matin, en passant par les hurlements de la fille de la voisine du dessous. C'est à la fois un avantage et un inconvénient : il n'est plus perturbé par les conversations insipides et l'incivisme sonore d'une partie de ses contemporains, mais son handicap caché est source de quiproquos, souvent savoureux.
La rencontre avec Claire (Sandrine Kiberlain, épatante comme d'hab'), l'occupante (temporaire) de l'appartement du dessous, est volcanique et délicieuse. Bon, dès le début, on sent que ces deux-là vont finir par s'apprivoiser, surtout si une gamine mutique en quête de père se met de la partie.
Au-delà de la romance prévisible, l'intrigue évoque le deuil, la maladie, la solitude et l'incommunicabilité. Tout cela est traité avec douceur, délicatesse... et humour. Je recommande tout particulièrement la scène du restaurant, qui commence comme un gros ratage, avant de se déployer avec ravissement. À signaler aussi le duo de sœurs (incarnées par S. Kiberlain et V. Donzelli), qui fonctionne à merveille... ainsi que le faux couple formé par le héros et sa sœur éruptive (très bien interprétée par Emmanuelle Devos). Je ne peux pas conclure sur la distribution sans citer la participation de Marthe Villalonga et François Berléand, qui donnent une saveur supplémentaire à l'histoire.
J'ai passé un très bon moment. Je suis sorti de la séance de fort bonne humeur.
18:17 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Oranges sanguines
Jean-Christophe Meurisse et sa petite troupe nous proposent une "comédie justicière", sardonique et moralisante. La forme mélange deux modèles. Il s'agit d'abord d'un entrecroisement de trois histoires. La première a pour cadre un concours de danse rock, auquel participe un couple de retraités. La seconde tourne autour de politiques ambitieux et sans scrupule. La troisième est centrée sur une adolescente vierge, sur le point de faire "le grand saut".
Ces trois histoires, de prime abord séparées, sont liées. L'un des politiques ambitieux est le fils des danseurs. Comme il est aussi avocat de profession, il va entrer en contact avec l'adolescente, dans des circonstances que, selon la formule consacrée, je me garderai de révéler. D'autres liens sont insérés dans l'intrigue, si bien que son déroulé prend parfois la forme d'un "marabout de ficelle".
Cependant, bien plus que la construction intellectuelle, c'est l'humour grinçant, vachard, qui attire l'attention. Les auteurs utilisent le film pour dénoncer certains travers du monde contemporain et pour exercer une sorte de vengeance immanente à l'égard de leurs têtes de Turc.
Ainsi, le public rit beaucoup en suivant la préparation du concours de danse. L'organisation de ce micro-événement local prend des proportions insoupçonnées à cause des préjugés des uns des autres, au cours d'une réunion où le "politiquement correct" est de mise. La caméra tourne autour du groupe de personnages, chacun débitant un texte écrit ciselé tout en donnant l'impression d'improviser. Ce début est un brin tarantinesque, sans la violence "sauce tomate" dont on sent qu'elle pourrait gicler. (Pour cela, il faut attendre la deuxième partie.)
Du concours de danse on passe aux employés de banque (odieux avec les retraités), au ministre menteur (inspiré visiblement de Jérôme Cahuzac), à l'avocat arrogant et à l'adolescente inquiète, dans une séquence tordante où la gynécologue est incarnée par Blanche Gardin. J'adore !
Un personnage atypique, extérieur aux groupes de départ, va faire déraper l'intrigue. Un indice : ce monsieur d'apparence anodine nourrit affectueusement un cochon domestique, très poilu et très docile, dans son salon...
À partir de là, l'outrance l'emporte, de manière calculée... et un peu putassière. Ainsi, le portrait du ministre devient encore plus chargé (au niveau de sa vie privée), histoire de nous faire avaler ce qu'il va subir. Il faut ensuite se taper un viol et la punition de celui-ci, avant de déboucher sur un suicide. Derrière ces scènes outrancières, il y a la supposée volonté de dénoncer le mensonge et le manque d'humanité en politique, les souffrances imposées aux femmes et la persécution des petites gens (à travers le couple de retraités).
Toutes ces causes sont louables et la mise en scène des punitions (tous les "méchants" finissent par déguster, y compris le chauffeur de taxi) est souvent savoureuse. Mais cela manque de subtilité, de nuance. Ainsi, ce serait tellement simple si les politiques étaient tels que le film les dénonce. Quant aux retraités dont la maison risque d'être saisie, ils ne sont pas pauvres. Ils ont eu les moyens d'acheter leur résidence, mais se sont endettés sans doute parce qu'ils dépensent sans compter (70 000 euros tout de même). On est loin des "vrais pauvres" de leur âge, qui, eux, ne sont pas propriétaires de leur logement. De ce point de vue, le film véhicule un parfum de "gilets jaunes". (Ce n'est pas un compliment.) Même la séquence "féministe" (ou supposée telle) repose sur des bases douteuses : la jeune femme est enlevée puis violée la nuit même où elle fait pour la première fois l'amour (acte durant lequel elle fait preuve d'un remarquable sens de l'initiative). Le rapprochement entre les deux événements pourrait n'être que le résultat d'une facilité scénaristique. Mais il pue quand même un peu de la gueule.
Voilà. Je suis sorti de là assez content, réjoui par la vision de séquences tordantes, mais réservé quant au fond.
00:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
vendredi, 26 novembre 2021
L'Événement
Je n'ai pas lu le roman d'Annie Ernaux, mais le sujet du film m'a incité à tenter l'expérience. Derrière la caméra se trouve Audrey Diwan, scénariste de Cédric Jimenez (et, accessoirement, sa compagne).
Anne est étudiante, sans doute en propédeutique Lettres. (Aux jeunes qui liraient ce billet, je signale qu'il y a bien longtemps, pour les étudiants se destinant à la fac, il existait une année de transition entre la terminale et le début de la licence à proprement parler.) Elle est belle, intelligente et indépendante. Elle a envie de tout vivre : ses études, son amour de la littérature, les sorties rock'n'roll... et les garçons. Hélas pour elle, nous sommes en 1963, au début de la Ve République, sous le premier mandat de Charles de Gaulle. Contraception comme avortement sont illégaux. Quant à l'enseignement des "choses de la vie", il s'effectue plutôt par l'intermédiaire des revues de charme...
La première partie est saisissante. La caméra suit l'héroïne (incarnée par Anamaria Vartolomei, déjà remarquée dans L'Échange des princesses et La Bonne Épouse), de dos, de face, de côté, du dessus. Je rassure les cinéphiles qui auraient le mal de mer, on n'est pas chez les Dardenne grande époque. Ces mouvements de caméra sont parfaitement justifiés. Ils instillent du mystère autour de la personnalité de cette jeune femme, assez mutique. Ils nous font aussi comprendre quel poids pèse sur ses épaules : celui du patriarcat, de la pesanteur sociale, du conservatisme religieux et de la chosification des jeunes femmes, surtout si elles sont jolies.
Autour d'Anamaria gravite une brochette de comédiens de talent. Sandrine Bonnaire interprète une mère traditionnelle, besogneuse et aimant sa fille, qu'elle a de plus en plus de mal à comprendre. Pio Marmai prête son physique avantageux à un prof de fac qui a repéré l'étincelle de talent chez Anne. (Bien que je doute que le film rencontre un grand succès public, il pourrait néanmoins contribuer à l'augmentation du nombre d'inscriptions de lycéennes en fac de Lettres. Une cruelle déception les y attend...)
J'ai trouvé que la deuxième partie patinait un peu. Enceinte, l'héroïne ne sait trop comment s'en sortir. Petit à petit, elle se coupe de toutes les personnes qui pourraient l'aider.
Fort heureusement, l'intérêt rebondit dans la troisième partie, qui prend quasiment la forme d'un thriller. Anne se rend chez une "faiseuse d'anges", qui a la voix rocailleuse d'Anna Mouglalis. La séquence est extraordinaire d'intensité, avec une étonnante économie de moyens. À partir de ce moment-là, la tension ne retombe plus, portée par une actrice formidable... jusqu'à une conclusion que je ne révèlerai pas.
Je recommande vivement ce film coup-de-poing, bourré de talents.
lundi, 15 novembre 2021
Eiffel
C'est l'un des films (avec Mourir peut attendre, Bac Nord et Venom 2) qui ont très bien marché ce mois dernier, au cinéma de Rodez. Il sera d'ailleurs toujours à l'affiche la semaine prochaine (tout comme deux des trois autres gros succès locaux). J'y suis allé pour le sujet (la construction de la célèbre tour) et parce j'avais bien aimé les précédents longs-métrages de Martin Bourboulon, les deux Papa ou maman.
Côté positif, il y a l'interprétation de Romain Duris, crédible quand il allonge les arguments techniques de l'ingénieur et quand il fait montre de son audace entrepreneuriale. J'ai aussi apprécié les détails concernant le projet de la tour puis les étapes de sa construction. Je trouve l'ambiance bien restituée : on a oublié aujourd'hui à quel point ce projet fou a suscité l'hostilité, à l'époque. C'est (en partie) parce qu'il a été "pistonné" par certains dirigeants républicains qu'Eiffel a pu surmonter toutes les difficultés qu'il a rencontrées.
Mais que vient faire l'improbable histoire d'amour là-dedans ? Certes, dans sa jeunesse, le véritable Gustave Eiffel a (un peu) fréquenté la jeune Adrienne Bourgès, qu'il a songé à épouser. Mais c'était surtout pour "se poser" dans la société. Faire de leur micro-histoire une romance au long cours, avec resurgissement de la lave des sentiments vingt ans plus tard, est ridicule... moins toutefois que de faire de la dame l'inspiratrice de la Tour.
Du coup, même si c'est bien joué, même si certains plans du Paris fin XIXe siècle sont superbes, cela a gâché mon plaisir.
P.S.
Sur le sujet, je recommande plusieurs lectures.
Ce roman graphique, publié en 2015, a été réédité à l'occasion de la sortie du film. C'est une bonne biographie grand public de Gustave Eiffel, même si le dessin ne m'a pas enthousiasmé.
Publié dans la collection "Découvertes Gallimard", ce petit livre abondamment illustré se dévore avec grand plaisir. Il est truffé d'anecdotes.
Je termine par une fiction, en bandes dessinées. Les auteurs situent l'action dans le Paris des années 1880, alors que la IIIe République est fragile et que les mouvements anarchistes font régner la violence. Dans ce polar historique, on croise nombre de personnages connus... mais l'on suit surtout un (quasi-)anonyme, Antoine Vigier, un p'tit gars de la campagne cantalienne qui "monte" à Paris, à l'image de tant de bougnats de l'époque. C'est totalement fictif mais bien fichu.
23:46 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 13 novembre 2021
Mon Légionnaire
La réalisatrice Rachel Lang a fait partie de l'armée française.. Elle en connaît donc les codes et les mentalités. Cela lui a été utile pour mettre en scène cette fiction, qui tourne autour du 2e REP de la Légion, basé à Calvi, en Haute-Corse.
Il ne faut donc pas s'attendre à un brûlot antimilitariste... pas plus qu'à une œuvre épique, à la gloire du combat. Le propos de la réalisatrice est autre. Elle plonge dans le quotidien à la fois des soldats en opération et des épouses restées au camp. C'est ce groupe-ci qui semble le plus hétérogène : entre la petite amie qui a tout plaqué pour rejoindre son jules, l'avocate qui effectue des allers-retours entre la Corse et Paris et les "tradis" (cathos bourgeoises qui perpétuent la lignée), l'écart est grand.
Dans le rôle de l'avocate, issue d'un milieu de gauche, qui soutient l'engagement de son époux, Camille Cottin est épatante. Elle incarne à la fois la femme indépendante (qui gère sa carrière de main de maître) et l'amoureuse, qui se languit de l'absence de Maxime.
Un peu à ma surprise, celui-ci est très bien interprété par Louis Garrel. Physiquement, il a acquis l'épaisseur (musculaire) du rôle. Il est aussi vrai que, sans sa tignasse (et quand il est rasé de près), les traits anguleux de son visage ressortent mieux. Sa mâchoire proéminente "fait" bien soldat.
Autour de lui gravitent d'authentiques acteurs ainsi que, me semble-t-il d'anciens (?) militaires. Cela donne un parfum de vérité aux scènes d'entraînement, de vie de camp (dans le Sahara, présume-t-on) et d'escarmouches. C'est l'occasion pour les profanes de découvrir les procédures militaires... ainsi que le perfectionnement des véhicules blindés, notamment en moyens de communication.
Attention, je le répète, quand bien même l'on voit à deux ou trois reprises les légionnaires évoluer en milieu hostile, il s'agit d'abord d'un film d'ambiance. La tension est omniprésente, en raison d'une étrangeté : plus que le départ en OP, les militaires redoutent le retour en Corse, en famille (pour ceux qui en ont une). Ils ne peuvent (et ne veulent) pas tout dire à leur conjointe (et surtout aux enfants). On sent même qu'il y a comme un regret d'avoir quitté la zone de combat et l'ambiance très particulière qui y règne entre les hommes (et les quelques femmes qui portent l'uniforme).
J'ai été touché par cette histoire, même si le film comporte quelques longueurs.
10:48 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
vendredi, 12 novembre 2021
Les Eternels
Quand, enfant, je lisais des comics américains, j'étais surtout intéressé par les X-Men, un peu aussi par Spiderman et Iron Man. Les Éternels font partie des séries auxquelles je n'ai pas accroché, à l'époque. Voir le film m'a rappelé pourquoi : j'avais été un peu agacé de constater le "recyclage" dont nombre de personnages importants sont révélateurs : Ikaris est un mélange de Cyclope et de Superman (dont il se moque... Tiens, prends ça dans les dents, DC !), Makkari possède les mêmes aptitudes que Vif-Argent, Phaestos, en plus d'être le décalque d'un dieu grec (comme d'autres personnages), exerce ses talents avec une dextérité qui n'est pas sans rappeler celle de Docteur Strange...
J'ai tenté le coup parce que j'avais envie de voir ce que donnait la réalisatrice Chloé Zhao (dont j'ai adoré le Nomadland) dans ce genre de production.
Visiblement, on a mis le paquet sur les effets spéciaux. Sur un très grand écran, c'est impressionnant... mais, quand on y réfléchit un peu, pour les acteurs, c'est le degré zéro de l'acte de jouer. (Mais cela doit rapporter gros...) Trop de fonds verts tuent le fond vert... On aurait d'ailleurs été bien inspiré de mettre un peu plus d'argent sur les aspects techniques des scènes "classiques", parce que, parfois, j'ai eu l'impression que ce n'était pas très bien éclairé. Il aurait aussi fallu revoir un peu le montage : à deux ou trois reprises, on nous balance un retour en arrière en pleine poire, sans raccord. C'est vraiment maladroit.
Bon, je fais la fine bouche mais, quand un film a bénéficié d'un financement de deux cents millions de dollars, on est en droit d'attendre un produit d'une qualité technique irréprochable.
Ceci dit, en un peu plus de 2h30, on a de quoi trouver son bonheur. Contrairement à d'autres spectateurs, je n'ai pas été irrité par la volonté de construire une équipe de super-héros aussi internationale, polyglotte que multiculturelle. Si l'on ajoute à cela la féminisation de certains personnages et la valorisation des minorités sexuelles, on obtient peut-être le film commercial le plus woke de l'histoire du cinéma. Mais, comme ces retouches "politiquement correctes" n'ont pas été faites à la truelle, cela passe sans problème... surtout grâce à l'humour. En fait, c'est ça qui sauve le film. À l'image de ce que l'on a pu voir dans les divers Avengers, les héros se chambrent entre eux. Le supplément apporté par ce film est que certains traits d'humour cassent l'aspect grandiloquent de ces quasi-divinités. Cela donne une grande respiration à l'intrigue, qui s'appuie aussi sur des scènes intimes moins bâclées que dans d'autres superproductions.
P.S.
La salle où je me trouvais n'était pas remplie que d'habitués des films Marvel : la moitié de l'assistance est sortie dès le début du générique. (Mais peut-être en avaient-ils tout simplement marre...) Ils ont donc raté deux scènes supplémentaires. La première annonce sans doute la suite des aventures. La seconde nous apprend ce qu'un des personnages de l'histoire n'a pas eu le temps de révéler à la femme qu'il aime. On entend aussi une grosse voix, signe qu'une vieille connaissance pourrait bientôt faire son retour dans les salles obscures.
00:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 11 novembre 2021
30 degrés en février
Cette mini-série suédo-thaïlandaise s'appuie sur un fait de société : la présence à l'année d'une petite communauté suédoise en Thaïlande, à laquelle venaient se joindre (avant le covid) des centaines de milliers de touristes de même origine, chaque année.
C'est une nouvelle pépite mise en ligne par la chaîne Arte. Les deux saisons (vingt épisodes au total) sont accessibles jusqu'en septembre 2022. Quatre histoires principales s'entremêlent (plus ou moins), avec un séjour en Thaïlande comme point commun.
L'un des couples est constitué d'un pilote d'avion à la retraite (devenu handicapé) et de son épouse timide et dévouée. Le mec (Bengt) est puant au possible, plein de mépris pour une femme qu'il a déjà trompée et quittée (du temps où il était bel homme... et valide), mais dont il a désormais bigrement besoin. Leur venue en Thaïlande pourrait être l'occasion pour le couple de se rabibocher. Majlis (l'épouse) va connaître une lente mais spectaculaire évolution. Les deux acteurs sont formidables... et connus des amateurs de séries nordiques. Kjell Bergvist s'est récemment illustré dans Commandant Bäckström. Quant à Lotta Tejle, elle a incarné la voisine taciturne et pique-assiette du policier héros de Meurtres à Sandhamn.
Un autre couple est en fait un duo père-fils, formé de Chan et Pong. Le premier est un Thaïlandais expatrié en Suède, de retour au pays pour relancer une affaire locale... et tenter de renouer avec son ancienne compagne. Le fils est en pleine dérive. Le jeune acteur qui l'incarne est crédible aussi bien en drogué quasi délinquant qu'en moine bouddhiste ou barman amoureux.
Ce duo va entrer (à nouveau) en contact avec une famille incomplète, composée d'une mère et de ses deux filles. (Le père les a quittées quelques années auparavant.) Kajsa (la mère) est une brillante architecte qui tente de refaire sa vie en Thaïlande, où elle est déjà allée en vacances. Sa fille aînée (Joy) est en pleine crise d'adolescence, tandis que la cadette (Wilda) réclame beaucoup d'attention de la part des deux autres.
L'équipe de départ ne serait pas complète sans Glenn, un célibataire d'une quarantaine d'années, à l'abri du besoin sur le plan financier mais désespérément seul... et obèse. Il se rend en Thaïlande en pensant y rencontrer la femme de sa vie. Le pauvre garçon va aller de déconvenue en déconvenue... jusqu'à ce qu'il rencontre Oh, une masseuse au grand coeur... mais qui cache un gros secret.
Parti pour ne voir qu'un épisode ou deux, je me suis laissé prendre par ces personnages fouillés (aussi bien du côté suédois que du côté thaïlandais), remarquablement interprétés. J'ai même poussé le vice jusqu'à enchaîner avec la saison 2. L'histoire reprend après une catastrophe climatique, qui a un peu redistribué les cartes. Presque tous les personnages de la première saison sont présents, auxquels s'ajoutent quelques nouveaux.
Majlis acquiert de plus en plus d'autonomie et fait même preuve d'une audace surprenante pour une femme de son âge, compte tenu surtout de l'éducation qu'elle a reçue. Le (beau) personnage de Joy (l'adolescente) reste majeur, mais les scénaristes ont choisi de davantage développer celui de sa petite sœur... et je n'ai pas été convaincu. Soit elle m'agace, soit je m'irrite des grosses ficelles utilisées : c'est un personnage qui, régulièrement, soit commet des gaffes, soit subit une contrariété. J'ai (de loin) préféré le personnage (nouveau) de Teng, une orpheline thaï dont Majlis va s'enticher.
De son côté, Glenn, un peu moins obèse, est toujours aussi sympathique... et maladroit. On le voit retourner en Suède... mais avec la Thaïlande au coeur.
C'est bien filmé, accompagné d'une musique agréable. Je note que les scénaristes n'ont accablé aucun de leurs personnages : tous ont leurs bons et leurs mauvais côtés, si bien qu'ils finissent (presque) tous par m'agacer à un moment ou à un autre, y compris quand l'intrigue leur permet de se "racheter". C'est un peu la limite de cette série, un peu trop inclusive à mon goût et qui semble soutenir l'idée qu'il n'existe pas de méchante personne, juste des gens ordinaires qui, parfois ont dérivé.
15:48 Publié dans Cinéma, Société, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, télévision
dimanche, 07 novembre 2021
Manhunt : sur la piste du tueur
Pour une raison qui m'est inconnue, ce dimanche soir, France 3 a remplacé l'excellente McDonald & Dodds par une autre série britannique, d'anthologie celle-là. Les trois épisodes de la première saison de Manhunt traitent d'une seule affaire criminelle.
Cette affaire n'est pas fictive, mais bien réelle. Le scénario est inspiré du récit qu'en a fait le principal enquêteur de l'époque : Colin Sutton, au centre sur l'image ci-dessus. Mais la traque du criminel fut une œuvre collective, qui impliqua des dizaines de policiers.
C'est à leur travail ingrat que cette mini-série rend hommage. Ici, vous ne verrez pas de poursuite en voiture, pas d'analyse ADN effectuée dans la journée ou de gadget électronique facilitant de travail des enquêteurs. Nous sommes au début des années 2000. Si les principaux personnages sont rivés à leurs téléphones portables, aucun de ceux-ci n'est "intelligent".
La série ne fait pas dans le clinquant. Le chef de groupe (remarquablement interprété par Martin Clunes) est du genre bonnet de nuit, mais il se donne à fond dans son travail... ce qui lui pose quelques problèmes dans sa vie privée (classique). On notera aussi le souci de réalisme, jusque dans la mise en scène des petites tensions entre services de police et même au sein d'un service.
Plusieurs pistes sont proposées aux téléspectateurs, avant qu'une sorte du lot. Mais avoir la certitude de la culpabilité d'un individu est une chose, pouvoir la prouver en est une autre. L'obstination des enquêteurs est-elle venue à bout de la ruse du criminel ? Je laisse à chacun le soin de le découvrir.
18:47 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision
lundi, 01 novembre 2021
Eugénie Grandet
Séance de rattrapage ce week-end prolongé, avec l'autre adaptation de Balzac encore sur nos écrans, celle-ci moins clinquante et moins populiste qu'Illusions perdues.
Ce fut aussi l'occasion pour moi de me replonger dans un roman que j'avais découvert à l'adolescence. (François Mitterrand était président de la République... c'est vous dire si ça date !) Le film de Marc Dugain (dont j'avais bien aimé L'Échange des princesses) n'est pas une adaptation fidèle, plutôt une adaptation-transposition, avec une connotation féministe prononcée.
C'est l'un des débats nés autour de ce film : ne dénature-t-il pas l'œuvre de Balzac, pour lui faire dire ce qu'il n'a pas écrit il y a près de 200 ans ? Ainsi, l'écrivain tourangeau n'était pas féministe, mais il s'est intéressé à la condition féminine. Je trouve que, dans ce domaine, les choix de Dugain sont pertinents, mettant en scène la lente émancipation de l'héroïne. (Dans le roman, elle finit par contracter un mariage blanc.)
Un autre débat porte sur l'aspect esthétique. C'est réalisé de manière austère, certaines scènes semblant éclairées uniquement à la chandelle. Le but est de montrer la frugalité du quotidien de la famille Grandet, alors que le père a secrètement placé des millions, auxquels il ne veut pas toucher (et dont sa famille ignore tout). Incidemment, ces scènes sont d'une grande beauté formelle. J'aime cette austérité au service de l'ambiance.
Je suis plus partagé sur l'aspect romantique de l'histoire. (L'ironie de Balzac a hélas été en partie gommée.) Dans l’œuvre d'origine, Eugénie est une jeune femme naïve, pas très jolie, qui s'entiche d'un cousin falot, totalement superficiel. Dans le film, il est impossible d'être insensible à la beauté simple de Joséphine Japy, le personnage de Charles ayant été modifié pour le rendre plus séduisant, moins superficiel.
En revanche, le portrait du père Grandet (Olivier Gourmet, une fois de plus formidable) a été chargé, lui faisant notamment suggérer la "traite des nègres" comme activité commerciale à son neveu, alors que, pour Balzac, c'est le jeune homme parti en Asie qui a de lui-même choisi ce moyen plus immoral lucratif de gagner sa vie.
J'ajoute que la scène (décisive) se déroulant une nuit, dans la chambre occupée par le cousin, est impensable dans la mentalité de l'époque. Dans le roman, cette nuit particulière est occupée par la rédaction puis la lecture de lettres, qui en apprennent beaucoup à l'héroïne.
Quoi qu'il en soit, les acteurs sont excellents. C'est du beau travail, avec cette fin inédite dont on sent qu'elle a été conçue pour faire écho à notre époque.
P.S.
Je ne résiste pas au plaisir de citer un passage du roman d'Honoré de Balzac, écrivain lucide sur son époque... et sur la nôtre : « Il est dans le caractère français de s'enthousiasmer, de se colérer, de se passionner pour le météore du moment, pour les bâtons flottants de l'actualité. Les êtres collectifs, les peuples, seraient-ils donc sans mémoire ? »
dimanche, 31 octobre 2021
The French Dispatch
Le directeur du supplément hebdomadaire (rédigé en France) d'un quotidien du Kansas décède à la veille de la parution du dernier numéro du magazine, qui va se transformer en hommage. Quatre principaux "papiers" sont mis en exergue. Chacun évoque un pan de la société française de la Ve République, mais aussi les petites et grandes faiblesses de la nature humaine, universelle.
Trois ans après l'excellent L'Île aux chiens, Wes Anderson est de retour, avec une partie de ses acteurs habituels et quelques nouvelles têtes. La richesse de la distribution est impressionnante, en particulier pour les spectateurs français, qui peuvent s'amuser à rechercher, au détour d'une scène, outre les vedettes anglo-saxonnes, quelques visages connus chez nous.
La première histoire nous fait suivre les déambulations citadines d'un drôle de cycliste américain (Owen Wilson). Si certains quartiers de la ville d'Angoulême ont servi de modèle, à la vision de la séquence, il semble évident qu'il s'agit plutôt de Paris, mais un Paris en partie disparu ou fantasmé, un Paris de Province. On est au début de la Ve République, en pleine Guerre d'Algérie, avec des 2 CV dans la rue et des Français qui fument, non pas des Gauloises, mais des... Gaullistes ! C'est réalisé avec brio... et ironie. Une bonne entrée en matière.
La deuxième histoire est pour moi la plus brillante, la plus virtuose au niveau de la mise en scène (toujours aussi géométrique) et la plus emballante au niveau de la caractérisation des personnages. Deux sortent du lot, formant un duo façon "la belle et la bête" : l'assassin-poète (Benicio del Toro, délicieusement animal) et sa muse (Léa Seydoux, vraiment bien... en tout cas meilleure que dans Mourir peut attendre). Comme je n'avais quasiment rien lu ni vu avant de me rendre à la séance, j'ai pu goûter toute la saveur de la première scène avec le peintre et son modèle. Anderson joue avec le regard du spectateur, qui, à partir de la représentation classique d'un peintre bougon et d'une superbe modèle, nous fait imaginer quelque chose qui n'est pas la réalité. Le rapport dominant/dominé est ici assez subtil, surtout quand on découvre quel est le véritable métier de la "muse" ! C'est au détour de cette séquence que l'on croise Adrien Brody, épatant en marchand d'art peu scrupuleux.
La troisième histoire, pour intéressante qu'elle soit, constitue une petite descente en qualité. On nous conte les débuts du mouvement étudiant de Mai 68, sur le mode d'une chronique mêlant réalisme poétique et folie douce à la Anderson. C'est l'occasion de retrouver la fabuleuse Frances McDomand (qu'on a pu apprécier cet été dans Nomadland). Trois éléments font la saveur de cette séquence : la relation inattendue entre la journaliste et le jeune étudiant (Timothée Chalamet, potable), les questionnements de celle-ci concernant sa déontologie et la peinture ironique de la révolte estudiantine.
La quatrième histoire est plus macabre. C'est celle qui compte le plus de morts et elle met en scène des pulsions malsaines, auxquelles s'oppose l'amour de la cuisine bien faite. En théorie, l'article qui sert de support à cette intrigue doit mettre en valeur un chef japonais. Mais c'est l'enlèvement du fils du commissaire (celui-ci incarné par Mathieu Amalric, qu'on a connu plus mauvais) qui sert de fil rouge à l'histoire. Elle nous est racontée par un journaliste noir homosexuel, invité d'un talk-show américain... présenté par l'excellent Liev Schreiber. Ce n'est pas la meilleure histoire du lot, mais elle est assez originale, d'autant qu'elle est en partie réalisée sous forme de film d'animation.
Voilà. Le ton et la mise en scène ont (comme d'habitude) de quoi dérouter les spectateurs. J'ai beaucoup aimé (en version originale sous-titrée)... et j'ai assez envie d'y retourner, pour me (re)plonger dans les détails des plans méticuleusement construits.
11:00 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 29 octobre 2021
Barbaque
Pour bien comprendre sur quel registre s'est placé Fabrice Éboué dans son dernier film, il faut se dire que l'ambiance se situe quelque part entre Delicatessen (de Caro et Jeunet) et Les Tontons flingueurs. Seulement, ici, ce sont les végans que le héros envisage d'éparpiller, « façon puzzle ».
Fabrice Éboué n'a laissé à personne d'autre que lui le soin d'incarner ce boucher artisanal, amoureux de son métier, mais manquant de charisme. Les spectateurs attentifs remarqueront qu'il s'est fait une tête à la Jean-Pierre Darroussin.
Sa compagne (qui tient la caisse de la boucherie) est interprétée par une Marina Foïs vraiment flippante, encore plus que dans Irréprochable. Épouse frustrée, elle s'est découvert une passion pour les tueurs en série, dont elle suit les exploits à la télévision, ne ratant aucun épisode d'une émission présentée par l'inénarrable Christophe Hondelatte.
Le plus drôle (!) est que notre couple de bouchers devient tueur presque par hasard. Mais c'est qu'ils vont y prendre goût... d'autant que la nouvelle viande (succulente) qu'ils se mettent à proposer à leur clientèle (sous l'appellation "porc d'Iran" !) obtient un succès considérable. Voilà qui renfloue les caisses de la boucherie... tout en débarrassant ces nouveaux Bonnie & Clyde de gêneurs horripilants.
Cela nous mène au portrait qui est fait des militants végans. Il est plus nuancé que ce qui pourrait sembler au premier abord. Même le personnage du gendre, véritable tête-à-claques (belle composition de Victor Meutelet), a sa chance. Du côté des bouchers, on oppose le "bon artisan" à l'horrible industriel qui, non seulement s'enrichit en vendant de la merde, mais est en plus un gros con raciste. À ce sujet, Éboué s'autorise quelques saillies au niveau des dialogues, saillies qui seraient sans doute moins bien passées si le réalisateur avait été blanc. De manière générale, j'ai trouvé les dialogues bien écrits. L'humour ne vise pas le plus haut raffinement, mais il est efficace.
Sans surprise, l'étude de caractères la plus poussée est celle des personnages principaux. D'un côté ce sont les héros auxquels (si l'on n'est pas végan) on est tenté de s'identifier. D'un autre côté, cela va tellement loin que l'on est obligé de prendre du recul vis-à-vis d'eux. On comprend que leur fuite en avant est aussi une manière de redonner vie à leur couple.
La violence physique (avec un aspect gore) est présente presque dès le début... mais disparaît assez vite. On nous fait mariner pendant plusieurs quarts d'heure avant de nous gratifier de nouvelles giclées de sang à visée charcutière. (Les amateurs de musique classique apprécieront le contraste entre l'arrière-plan sonore et ce qui est montré à l'écran.) Ce devient même tarantinesque, en particulier dans l'avant-dernière séquence (à la boucherie), qui contient une scène d'anthologie se déroulant dans la chambre froide... à déguster sans modération !
21:09 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
mercredi, 27 octobre 2021
McDonald & Dodds
France 3 continue à nous gâter le dimanche soir. Après nous avoir proposé la quatorzième saison des Enquêtes de Murdoch, la chaîne publique a décidé de nous faire découvrir une nouvelle série britannique.
Deux policiers aux tempéraments très différents sont amenés à travailler ensemble, à Bath, dans le sud-ouest de l'Angleterre.
À gauche ci-dessus se trouve le lieutenant Dodds (Jason Watkins, un visage familier aux téléspectateurs d'outre-Manche). C'est un vétéran de la police locale, placardisé depuis une dizaine d'années. On le méprise parfois, le sous-estime souvent. Il est pourtant méticuleux et compétent.
À droite se trouve la capitaine Lauren McDonald (Tala Gouveia, inconnue au bataillon). D'origine modeste, elle s'est élevée à la force du poignet, se faisant remarquer par ses qualités dans la police de Londres. Son arrivée à Bath n'est au départ qu'une étape (censée être brève), dans une carrière qu'elle espère mener au plus haut niveau.
Entre l'éruptive capitaine et le mollasson lieutenant, l'alchimie met du temps à fonctionner. Dans le premier épisode (diffusé dimanche 24 octobre), on assiste à leur rencontre et aux débuts chaotiques de leur collaboration. Les deux officiers de police finissent par comprendre qu'ils ont intérêt à s'entendre : ce sont deux outsiders (la femme noire qui ne s'en laisse pas compter et le vieil homme blanc intello coincé), animés par une identique volonté de traquer les criminels, même si elle s'exprime de façon différente.
Dans cet épisode fondateur, ils ont fort à faire : l'assassin est particulièrement retors. Ils vont avoir besoin de toute leur ingéniosité et d'un peu de chance pour en venir à bout, un peu à la manière de Colombo (qui semble avoir inspiré le personnage de Dodds).
La musique est légère, les dialogues (à savourer in English, of course) piquants. Je me suis régalé.
19:19 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision
mardi, 26 octobre 2021
Enfer blanc
France 2 a commencé la diffusion de cette mini-série scandinave (comptant huit épisodes au total). Sur le site de France Télévisions, on n'a le plus souvent accès qu'à la version doublée en français. Sur ma Livebox, je peux regarder tous les épisodes en version originale sous-titrée, une version polyglotte puisqu'on y entend parler anglais, danois, suédois, russe et groenlandais.
Le premier épisode plante le décor. On suit une ministre suédoise, qui a rendez-vous au Groenland pour des négociations devant déboucher sur la signature d'un nouveau traité entre les nations arctiques. Sa venue doit débuter par la visite du navire d'une compagnie pétrolière, dont les dirigeants tentent d'influencer la ministre, de sensibilité écologiste. Mais elle décide de "sécher" la rencontre à la dernière minute, y envoyant l'un de ses conseillers (qui est le compagnon d'une policière que connaît la ministre). La visite se déroule malgré tout, interrompue par une attaque armée. Tous les occupants du bateau disparaissent. En Suède, la policière, bien qu'enceinte, décide de se rendre sur place pour retrouver son compagnon. Au Groenland, la police locale semble dépassée. De plus, son chef (un type sérieux, un natif) est en pleine crise de couple. Sa supérieure (danoise), à cheval sur le règlement, vient prendre la direction des opérations.
Le deuxième épisode est plus politique. On nous plonge dans les négociations internationales. Pour conclure un nouveau traité, l'unanimité est requise. Or, il semble que le représentant russe fasse de l'obstruction, plus ou moins ouvertement. Quant à l'équipage du navire pétrolier, il demeure introuvable, le bateau ayant été récupéré vide. La policière suédoise continue à enquêter de son côté, sans s'embarrasser des règles (policières comme diplomatiques). Les enquêteurs finissent par apprendre que l'un des membres de l'équipage a été payé pour laisser sa place. Le chef de la police locale le connaît : c'est un compagnon de beuverie de son épouse.
Le mystère semble s'éclaircir un peu dans le troisième épisode. La clé de l'énigme est un gigantesque gisement d'hydrocarbures, qui aurait été découvert au large des côtes groenlandaises, dans une zone jusqu'à présent inexploitée. Mais qui est au courant et qui a planifié l'enlèvement de l'équipage ? Les spectateurs voient enfin ce qu'est devenu celui-ci. D'autres otages l'ont rejoint. Pour certains personnages, cela devient de plus en plus risqué.
C'est prenant. L'intrigue est en prise avec les questionnements contemporains : le changement climatique, les coups bas diplomatiques, les relations post-coloniales et la place des femmes dans la société. C'est mis en scène avec une certaine subtilité. C'est surtout bien joué et superbement filmé : les plans extérieurs sont à couper le souffle. La musique est entraînante, sans être trop présente.
Je recommande vivement et je suis impatient de voir la suite. (Les épisodes restent en ligne jusqu'en décembre prochain.)
17:42 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision
lundi, 25 octobre 2021
La bite d'Apollon
Il n'est pas facile d'être un vieux pêcheur célibataire dans la bande de Gaza. Il faut jongler entre la dictature du Hamas, le regard inquisiteur des voisins (souvent bigots) et les interdictions israéliennes. Tel est le défi qui se présente à Issa, farouchement attaché à son indépendance, mais qui se verrait bien finir ses jours en compagnie d'une charmante veuve, couturière de son état. Salim Daw et Hiam Abbas incarnent avec un plaisir évident ces deux figures au caractère bien trempé.
La première partie de Gaza mon amour pose ces principes, tout en présentant quelques personnages secondaires : la fille occidentalisée de Siham, des miliciens plus intéressés par les films de guerre que par leur travail et un jeune commerçant (ami d'Issa) qui ne songe qu'à émigrer.
Un soir, le pêcheur remonte une drôle de cargaison dans ses filets : une statue d'un dieu antique, priapique de surcroît. (L'histoire s'inspire de celle dite de l'Apollon de Gaza.) Dans un premier temps, Issa décide de garder la statue pour lui. Peut-être parce qu'elle est belle. Peut-être aussi en songeant à la récompense qu'il pourrait toucher. Mais c'est le début de ses ennuis avec la police gazaouie, qui a des espions partout. La deuxième partie met en scène les relations tumultueuses du héros avec les forces de l'ordre du Hamas, des culs-bénits avides de faire respecter leur version de l'islamiquement correct... mais qui songent eux aussi au profit que pourrait leur rapporter cette statue. Ces événements perturbent les travaux d'approche d'Issa, qui songe à demander la couturière en mariage. Dans le même temps, sa sœur se désespère qu'il ne choisisse pas un meilleur parti. Le vaudeville n'est pas loin.
La troisième partie est celle des dénouements : celui de la tentative d'émigration, celui de l'histoire d'amour et celui du périple de la statue (dont il manque un morceau crucial, détaché dans des circonstances que je m'interdis de révéler ici).
Les réalisateurs, les frères Arab et Tarzan Nasser (auteurs de Dégradé), ont visiblement l'esprit facétieux. Mine de rien, ce petit film est une satire bien troussée du régime dictatorial en place à Gaza, l'obsession phallique des autorités ne se limitant pas à la statue antique : l'admiration éprouvée par les hommes à l'arrivée d'une nouvelle grosse roquette en dit plus qu'une étude psychanalytique...
P.S.
Cette coproduction franco-germano-jordano-qatarie essaie de jouer sur tous les tableaux. D'un côté, c'est d'abord un film de festival, destiné au public international... d'où le fait que le Hamas soit égratigné. De l'autre côté, on y perçoit une dénonciation (surtout symbolique) de l'action de l'armée israélienne. Enfin je note que, d'après les sous-titres, l'étendue de la zone de pêche est beaucoup plus restreinte qu'en réalité. Le film l'estime à une bande située à moins de cinq kilomètres des côtes, alors que le gouvernement israélien l'a portée à 15 milles nautiques (environ 28 kilomètres) quand le Hamas a respecté les trêves conclues. Ces dernières années, cette bande a oscillé entre 9 et 12 milles (17-22 kilomètres), soit bien plus que dans le film.
21:47 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Leur Algérie
Lina Soualem est la fille de Zinedine (familier des seconds rôles sur petit et grand écrans) et d'Hiam Abbas (qui lui avait d'ailleurs confié un rôle dans son film Héritage). Mais elle est surtout la petite-fille d'Aïcha et Mabrouk (les parents de Zinedine), qui ont décidé de se séparer, après plus de soixante ans de vie commune. Nous sommes dans les années 2010, entre Thiers et Paris, dans une famille issue de l'immigration algérienne. En 1h10, ce modeste documentaire ambitionne de raconter tout cela.
Le film retient l'attention en raison de la personnalité des deux grands-parents. Aïcha est volubile, énergique, joyeuse et cache sa gêne sous un rire qui semble inextinguible. Mabrouk est un taiseux, sans doute plus âgé que son ex-épouse et en moins bonne condition physique. Mais il a une "bonne tête" comme on dit et sort parfois des répliques cocasses.
Il ne faut pas se fier aux premières images, anciennes, qui sont de la vidéo bas-de-gamme. La suite du documentaire est proprement réalisée. La petite-fille a suivi chacun des grands-parents seul, puis les a filmés ensemble ou avec leur fils Zinedine (son père à elle).
Plusieurs thématiques sont abordées. Il y a d'abord la condition de la femme. La grand-mère s'est dévouée à son foyer et à ses enfants. Une fois la retraite venue, je pense qu'elle en a eu marre de jouer la bonniche du grand-père, même si elle continue à lui donner un coup de main. De surcroît, elle habite un appartement se trouvant dans l'immeuble situé en face de celui où loge son ex !
Le travail de tout une génération de migrants algériens est ensuite abordé. Mabrouk a eu divers emplois, restant assez longtemps dans la coutellerie, à la grande époque, avant que la mécanisation et la baisse des ventes ne ruinent partiellement le secteur. On notera son recul quant au formidable développement que notre pays a connu depuis les Trente Glorieuses : quand il a immigré, il est arrivé dans un pays qu'il qualifie de "France pauvre". On se dit qu'il serait bon que les générations suivantes, quelle que soit leur origine, aient cela en tête...
Il est aussi question d'identité algérienne/française. Les parents semblent n'avoir que leur nationalité de naissance, continuant à disposer d'une carte de résident. Ils ne sont guère politisés, quoiqu'un peu plus que lorsqu'ils étaient jeunes. On a l'impression de la Guerre d'Algérie leur est passée par-dessus la tête (comme à nombre de Français de métropole d'ailleurs). Dans ce domaine, leur mémoire est un peu factice, reconstruite à partir de ce qu'ils ont vu, lu et entendu après la guerre. On en a un exemple flagrant quand le grand-père, après avoir raconté (en français) s'être rendu en Algérie pour enterrer successivement tous ses oncles, venus comme lui travailler en France, prétend ensuite (dans une conversation en arabe) qu'ils ont tous été tués par l'armée française pendant la guerre. Entre propos de comptoir et perte de facultés mentales liée à l'âge, on est libre de choisir...
Cela n'enlève rien aux qualités du film, vraiment attachant.
dimanche, 24 octobre 2021
First Cow
Il faut attendre très longtemps (pas loin d'une heure) pour que la placide bovidée qui a inspiré le titre de ce film commence à y jouer un rôle. (Sachez que l'animal recruté pour l'incarner se nomme Evie.)
En attendant cette apparition réjouissante, il faut se fader la première heure. Mon Dieu, que c'est long ! On a visiblement voulu nous informer des moindres petits soucis qui émaillaient la vie quotidienne des pionniers de l'Oregon (au nord-ouest des États-Unis) au début du XIXe siècle. C'est surligné au stabilo, pas palpitant pour deux sous et de surcroît pas très bien filmé. On dirait presque une œuvre télévisuelle, les scènes obscures étant mal éclairées. Quelle déception de la part de Kelly Reichardt, dont j'avais apprécié La Dernière Piste !
Le seul éclair de cinéma à retenir dans cette brume vaguement poétique est la rencontre des deux protagonistes de l'histoire, l'Européen Otis Figowitz et le Chinois King-Lu. Entre ces deux-là se noue un compagnonnage qui va nous tenir en haleine pendant le reste de l'intrigue.
J'ai trouvé la seconde partie mieux mise en scène et plus riche au niveau du scénario. La réalisatrice délaisse un peu le style pseudo-contemplatif sous-malickien. Otis le cuistot, surnommé Cookie, va profiter de la présence de la vache pour se lancer dans une lucrative activité commerciale, en compagnie de son acolyte, qui a moins de scrupules (et plus de bagout) que lui. Leur duo pourrait n'être qu'une nouvelle illustration de success story à l'américaine, mais il est plus que cela. L'association des deux personnages fonctionne à merveille. Ils emménagent dans la même cabane (sans qu'apparemment il y ait le moindre sous-entendu sexuel). Une belle amitié se forme, progressivement.
L'exercice de leur activité les met en contact avec différentes figures du monde pionnier, campées par des "gueules" d'acteur. C'est bien rendu, parfois drôle... et appétissant, dans les scènes de cuisine. Je regrette toutefois que la réalisatrice n'ait pas vraiment su comment conclure son histoire. Elle semble s'orienter sur une piste qui s'interrompt, avant son dénouement. Dommage.
20:50 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Storia di vacanze
Dans un quartier pavillonnaire de la banlieue de Rome, des enfants de classe moyenne (plus ou moins aisée) tentent de conjurer leur mal de vivre durant les vacances d'été. Avec ça, on a (presque) tout dit, mais l'on n'a rien dit.
La première partie de l'histoire est ironique. Elle brosse le portrait de familles qui, vues de l'extérieur, semblent chacune avoir acquis leur parcelle de bonheur italien. Il y a ce couple dont les deux enfants brillent à l'école. Il y a ce cadre, fier de sa réussite professionnelle (dans les cosmétiques) et de la beauté de sa fille unique. Il y a aussi cette jeune femme enceinte, encore entretenue par ses parents semble-t-il. Il y a enfin ce drôle de duo, constitué d'un père célibataire macho et de son fils emprunté.
Par moment, j'ai pensé que les réalisateurs (qui ont contribué au scénario de Dogman) tentaient d'adapter Affreux, sales et méchants à la classe moyenne contemporaine. Ainsi, les pères de famille, qui affichent un profil respectable, sont obsédés par les femmes plus jeunes de leur quartier, qu'ils seraient prêts à violer. De son côté, la bimbo enceinte a perdu de sa superbe... mais pas de sa vulgarité, que l'on serait tenté de prendre pour de l'assurance.
Tout ce vernis craque dans la seconde partie. Les adultes se révèlent plutôt lâches et sans envergure. Ils ne constituent pas des modèles auxquels les jeunes pourraient se raccrocher. Les préadolescents vont donc chercher leur propre voie, pour le meilleur et pour le pire.
Je ne m'attendais pas du tout à cela. J'étais allé voir le film sans avoir quasiment rien lu dessus, juste pour le plaisir d'entendre parler italien, dans un métrage qui ne soit pas trop long (une rareté ces temps-ci). J'ai beaucoup aimé la partie sarcastique et j'ai pris une petite claque dans la seconde partie, qui prend parfois la forme d'un puzzle. La toute dernière scène nous invite à repenser à ce qu'il s'est passé auparavant. J'ai aussi été marqué par l'une des séquences précédentes, qui montre le réveil des parents dans une maison étrangement calme.
Même s'il n'est pas parfait, je trouve que c'est un film qui a du style et qui mérite le détour.
18:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Illusions perdues
Salle archicomble pour cette adaptation d'un des romans majeurs d'Honoré de Balzac. Dans les rangées dominaient les tempes argentées, un petit peu plus féminines que masculines. De mon côté, j'ai eu l'impression d'être entouré d'un escadron de profs de Lettres à la retraite.
L'intrigue est découpée en trois parties. La première tourne autour de l'amour (plus ou moins) contrarié de Lucien pour Louise. La deuxième narre l'ascension d'un ambitieux. La troisième met en scène un brutal retour à la réalité.
C'est d'abord la qualité de la distribution qui m'a impressionné. Le film met en valeur deux petits jeunes (Benjamin Voisin et Salomé Dewaels), très bons. Ils sont entourés de comédiens plus confirmés (Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Cécile de France...) tous impeccables. En soutien viennent les "grands anciens" (Jeanne Balibar et Gérard Depardieu), qui ont parfois déçu, mais qui sont remarquables ici. Il faudrait aussi signaler la pléiade de seconds rôles, parmi lesquels je distingue André Macron Marcon, Jean-François Stévenin et Louis-Do de Lencquesaing.
Après un début un peu poussif, je trouve que le film démarre vraiment quand l'apprenti journaliste-poète rencontre l'éditeur Dauriat dans son antre. La réalisation gagne en envergure et les répliques font mouche. (Le talent de Xavier Giannoli semble mieux s'exprimer dans les scènes "confinées".)
Sur le fond, le film touche sa cible quand il dénonce les inégalités sociales et la culture de connivence qui règne dans le monde médiatico-culturel parisien. Je ne connais pas tout le sous-texte, mais je pense qu'à certaines occasions, Giannoli règle quelques comptes personnels. Moins subtiles sont les allusions à la vie politique contemporaine : dès qu'il est question de Rothschild, on met dans la bouche d'un personnage une réplique censée être prophétique...
Le principal défaut du film est de jouer sur le "tous pourris". Au contact du petit monde parisien, même les âmes pures se dégradent. C'est l'amour qui "sauve" (de manière très relative) certains personnages, notamment féminins. On pourra toutefois reprocher au scénario de mettre en avant les individus qui se compromettent et, par exemple, de totalement négliger la presse intègre.
Les 2h30 passent assez bien, en dépit de quelques longueurs. Si l'on a lu le roman et qu'on en a gardé quelques bribes en mémoire, la troisième partie ne surprend pas... mais cela laisse le temps d'apprécier la mise en scène des deux machinations, ainsi que le jeu des acteurs. J'ajoute que les dialogues sont ciselés. J'ai passé un bon moment.
11:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 23 octobre 2021
Venom 2
... le retour, cette fois-ci en version originale sous-titrée (trois personnes dans la salle, moi compris).
Un soir, un peu énervé par le boulot, j'ai eu envie d'une catharsis anthropophage. Va donc donc pour cette suite, qui commence sur le même registre que le précédent opus.
On retrouve Eddie Brock (Tom Hardy) en ménage... avec son "invité" extraterrestre (et pas l'avocate, la vilaine, qui l'a largué pour un type chiant, friqué et fiable). Ce début m'a mis de bonne humeur, avec les chamailleries entre le héros et son double surpuissant, dignes d'une scène de ménage.
En fait, il ne s'agit pas du vrai début, puisque l'histoire a commencé par un retour dans le passé, dans lequel on découvre deux personnages qui vont jouer un rôle clé dans l'intrigue.
La distribution est alléchante. Tom Hardy et Michelle Williams sont accompagnés de Naomie Harris (aussi à l'affiche de Mourir peut attendre) et Woody Harrelson. Ces deux-là sont en pleine forme et semblent avoir kiffé leur rôle. J'ai toutefois été dérangé par l'horrible coupe de cheveux du Kasady/Harrelson sorti de prison. Il n'y a visiblement pas développé un sens aigu de l'esthétique.
Pour relancer l'affaire, les scénaristes se sont creusé les méninges... mais pas trop longtemps. Ils se sont dits que seule une autre entité parasitaire était capable de tenir la dragée haute à Venom. Figurez-vous que celui-ci (dans des circonstances que je me garderai de préciser) va devenir... papa ! De surcroît, le complexe d'Œdipe semble avoir franchi la barrière des espèces, puisque "Carnage" (le doux nom du chérubin) ne pense bientôt plus qu'à dézinguer son "paternel". (Si vous allez voir le film, vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé des guillemets.)
À partir de là, c'est hyper-violent. Très rythmé certes, mais sans l'humour précieux du début. Je reconnais que, techniquement, c'est bien foutu, peut-être même mieux que dans le premier film. Mais mon Dieu que de violence gratuite ! Tout cela pour finalement pas grand chose.
Je suis sorti de là un peu déçu.
P.S.
De manière traditionnelle, le générique de fin a été interrompu, pour céder la place à une scène inédite, assez cocasse, mais qui, surtout, semble indiquer que, du côté de chez Marvel, on songe enfin à faire se rencontrer certains personnages clés.
13:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 21 octobre 2021
La Famille Addams 2
Marqué par le bon souvenir que m'avait laissé le premier volet de l'adaptation animée des aventures de la plus horrifique des familles, je suis passé outre les mauvaises critiques pour tenter la vision de cette suite.
Le personnage de Mercredi (la fille psychopathe) est au centre de l'intrigue. Côté scolaire, elle se fait remarquer par son intelligence précoce, qui attire l'attention d'un scientifique louche. Côté familial, elle se demande si elle est bien à sa place dans la famille Addams, allant jusqu'à douter de sa filiation biologique. S'en suit une multitude de péripéties, menées sur un rythme trépidant... ce qui évite (parfois) au spectateur adulte de s'ennuyer ferme..
Parce que, franchement, il n'y a pas grand chose à retenir de cette nouvelle version, à part les aspects transgressifs de la personnalité de Mercredi, le seul personnage intéressant de ce deuxième long-métrage, en compagnie peut-être de la créature de Frankenstein. La caractérisation des autres personnages est sommaire. Les aspects subversifs de la famille ont été limés, le tout baignant dans de la musique moderne tape-à-l'œil (dance, R'N'B ou rap). J'ai trouvé particulièrement mauvais les personnages du père (Gomez) et de l'oncle Fétide, de surcroît mal doublés en français.
Il y a bien quelques moment d'humour à sauver (les enfants présents dans la salle ont davantage rigolé), mais, pour moi, cela ne vaut pas la peine de payer une place. La série des Hôtel Transylvanie est bien plus réussie.
21:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 16 octobre 2021
Les Mystères de Londres
Cette série policière britannico-canadienne date de 2016 et elle vient d'arriver sur la TNT, plus précisément sur TF1. Son action se déroule au début du XXe siècle et l'ambiance oscille entre celle de Sherlock Holmes et celle des Enquêtes de Murdoch. Elle nous fait suivre les aventures de trois personnages, deux d'entre eux ayant donné leur nom à la série, dans la version originale (Houdini and Doyle).
Voici donc Harry Houdini (Michael Weston), le pétulant illusionniste, au faîte de sa gloire. Quoi qu'habitant encore avec sa mère, il mène une vie de patachon et regarde son époque avec un œil ironique. C'est un fervent rationaliste.
Il doit (amicalement) croiser le fer avec Arthur Conan Doyle (Stephen Mangan), écrivain reconnu qui, au début de la série, vient de "tuer" Sherlock Holmes. Mais ce sont d'autres aspects de sa vie qui passent ici au premier plan : son activité de médecin, ses soucis familiaux... et son penchant pour le paranormal, l'ésotérique.
Navré pour ces deux mâles dominants, mais le véritable personnage principal est Adelaide Stratton, première femme officier de police à Scotland Yard... mais reléguée jusqu'à présent à des tâches subalternes. Elle est incarnée par la délicieuse Rebecca Liddiard, dont j'avais déjà remarqué (entre autres) les jolis sourcils dans Frankie Drake Mysteries.
Le premier épisode, intitulé L'Assassin fantôme, met en scène la formation du trio. Il se réunit au cours d'une enquête sur la mort mystérieuse d'une nonne.
Le deuxième épisode, intitulé Vengeance d'une vie passée, plonge les spectateurs dans l'énigme d'une possible réincarnation, celle d'un homme disparu dans le corps d'un enfant meurtrier. Excellent !
Le dernier épisode diffusé la semaine dernière s'intitule Croire ou ne pas croire. L'intrigue tourne autour d'un étrange guérisseur et de morts inexpliquées. Dans le même temps, la femme de Conan Doyle voit son état de santé changer de manière spectaculaire, tandis qu'Houdini tombe subitement malade.
J'aime beaucoup l'ambiance de la série, très bien servie par les décors, les costumes et l'éclairage. Elle aborde de surcroît des thèmes intéressants, de la religion au féminisme en passant par les croyances populaires.
13:13 Publié dans Cinéma, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, télévision, femmes, filles
vendredi, 15 octobre 2021
Mourir peut attendre
... en version originale sous-titrée, ne serait-ce que pour entendre Daniel Craig s'essayer à un peu de français, avec sa vraie voix. Il est pourtant absent de la première séquence (pré-générique), dont on se demande un petit moment si elle se déroule dans le présent, le passé ou un futur auquel un (très) long retour en arrière est destiné à nous ramener. Cette mise en bouche, conclue sur un lac gelé, est fort bien mise en scène.
Il faut donc attendre pas loin d'un quart d'heure pour retrouver James, qui file le parfait amour avec Madeleine... du moins le croit-il. Les paysages italiens se prêtent merveilleusement à cette romance un brin éculée... d'autant que l'action est bientôt de retour, avec plusieurs scènes de poursuite particulièrement réussies. (Un "Oh !" d'admiration m'a même échappé à l'occasion d'une splendide cascade en moto.)
Le point faible de l'intrigue est incontestablement la relation Bond-Madeleine, d'abord parce que Léa Seydoux n'est pas hyper-convaincante, mais surtout parce que ce choix scénaristique transforme le super-espion en Monsieur-tout-le-monde, instillant une insupportable giclée d'eau-de-rose dans une histoire qui méritait un peu plus de venin.
Fort heureusement, l'ADN bondien a été préservé, à travers les bastons, les poursuites, les gadgets, le glamour et les pincées d'humour. Du côté féminin, c'est la prestation d'Ana de Armas qui est à signaler, la demoiselle démontrant avec brio qu'une robe échancrée à l'extrême ne sert pas qu'à affoler le cœur des mâles hétérosexuels...
On a beaucoup glosé sur l'apparition d'une nouvelle espionne estampillée 007. Sa relation avec le précédent titulaire du titre échappe relativement aux clichés : elle n'est guère agressive avec lui et il évite la condescendance, lui témoignant même du respect. Mais j'avoue que j'ai du mal à croire que Lashana Lynch puisse succéder à Craig dans un rôle à la fois percutant, ironique et séduisant.
Il aurait fallu couper un peu dans les scènes de dialogues, celles entre les tourtereaux et celles avec le méchant de l'histoire, correctement interprété par Rami Malek. Celui-ci ne fera cependant pas oublier ses augustes prédécesseurs. (Avec le recul, je constate que les dialogues constituent souvent le point faible des Bond dernière mouture.)
Au niveau de l'intrigue, on sent venir pas mal de péripéties... y compris la conclusion de l'histoire, trois bons quarts d'heure avant la fin. Je ne vais toutefois pas bouder mon plaisir : on a offert, sur le plan scénaristique comme de la mise en scène, une belle sortie à Daniel Craig.
22:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 02 octobre 2021
Stillwater
C'est le nom d'une petite ville des États-Unis (comptant environ 40 000 habitants), située dans le nord de l'Oklahoma, entre Kansas et Texas.
Bill Baker (Matt Damon, sobre et efficace) y vivote, entre deux emplois manuels. Il est parfois hébergé par sa belle-mère. On finit par apprendre que son épouse est décédée, tandis que leur fille unique Allison est partie poursuivre ses études en France, plus précisément à Aix-Marseille. En réalité, elle y est emprisonnée depuis cinq ans, pour un crime qu'elle jure ne pas avoir commis. (L'histoire est librement inspirée de l'affaire Amanda Knox.)
Poussé (et financé) par la grand-mère, Bill traverse l'Atlantique et débarque dans la cité phocéenne, où il va vivre un sacré choc culturel. La première partie suit l'Américain dans ses démarches quotidiennes, lui qui ne parle pas un mot de français. Armé de sa foi, de sa ténacité et de sa volonté d'être enfin un bon père, il rencontre sa fille, des avocats, des détectives privés... et une Française insouciante de prime abord, mais qui va devenir son principal soutien. Camille Cottin incarne avec talent Virginie, cette intermittente du spectacle parisienne (sans doute végétarienne), venue s'installer à Marseille avec sa fille. Autant elle est vibrionnante, intellectuelle et engagée, autant Bill (gros mangeur de viande) est posé, terre-à-terre, manuel et placide quant au fonctionnement de la société marseillaise. Cette première partie ne nous permet d'ailleurs pas d'en ignorer les aspects peu reluisants : délinquance, incivisme et saleté. Le tout est rythmé, parfois trépidant.
Cette opinion est nuancée par la deuxième partie. Fort heureusement, le scénario ne se limite pas au combat d'un père pour sauver sa fille victime d'une terrible injustice. Cela aurait pourtant suffi à bâtir une intrigue complète. Mais les auteurs se sont mis à quatre (avec Thomas Bidegain pour la partie française) pour écrire une fresque qui s'étend sur des mois. Il est d'ailleurs assez réaliste d'imaginer que les problèmes de la fille ne puissent pas se régler en deux-trois semaines.
Le changement d'ambiance survient lorsqu'Allison obtient le droit d'effectuer une sortie mensuelle, en compagnie d'un chaperon. Le papa désormais très présent va jouer ce rôle. Bill a posé ses valises à Marseille, peut-être définitivement. Il est devenu le colocataire de Virginie, dans un compagnonnage qui, pour l'instant, reste platonique. Il sert aussi de baby-sitter de secours de Maya (Lilou Siauvaud, un nom à suivre), la fille de Virginie, qui est en quête d'un père de substitution... enfin un qui tienne mieux la route que les rencontres occasionnelles de sa mère.
J'ai beaucoup aimé cette partie, filmée avec plus de calme et un souci évident d'esthétique. La famille recomposée fonctionne plutôt bien. Bill, qui a trouvé du travail dans le bâtiment, sait à présent se débrouiller (un peu) en français et Maya acquiert progressivement des bases en anglais. Le redneck américain s'est acclimaté ; il a découvert la beauté des calanques (très bien filmées). Tout bascule un soir de match, au stade Vélodrome (dont l'ambiance m'a semblé bien rendue).
La troisième partie prend le tour d'un thriller, qui nous réserve quelques surprises. Je n'en dirai pas plus, mais je peux quand même ajouter que l'on n'a pas cherché la voie la plus facile dans la conclusion de cette double histoire (la condamnation d'Allison et la relation de Bill avec les Françaises). À la fin, je m'attendais à une scène qui n'est jamais venue.
J'ai adoré ce film, à voir en version originale sous-titrée, pour saisir toutes les difficultés de communication entre l'anglophone strict (du début) et les Français plus ou moins habiles dans la langue de Joe Biden.
P.S.
Je ne peux pas achever cette note sans évoquer une anecdote croustillante. Un jour, Virginie accueille chez elle, outre Bill, sa meilleure amie, experte en informatique. Celle-ci s'inquiète des opinions politiques de celui qui a le profil d'un électeur de Donald Trump. La réponse de Bill, en deux temps, est savoureuse. C'est un peu à l'image du film, construit sur plusieurs couches. On en déguste une avant de découvrir qu'il y a autre chose au-dessous.
14:55 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
mercredi, 29 septembre 2021
Le Sommet des dieux
En matière d'alpinisme, je ne suis ni croyant ni pratiquant. Mais, quand j'ai appris la sortie d'un film d'animation adapté d'un manga de Jiro Tanigushi (lui-même adapté d'un roman japonais), j'ai décidé de tenter l'expérience.
L'intrigue nous fait suivre un photographe japonais amateur d'alpinisme. Un soir, à la sortie d'un bar de Katmandou, il pense être tombé par hasard sur Habu, une des légendes nippones de l'escalade, disparu des radars depuis plusieurs années.
Suivent plusieurs retours en arrière. Pendant que le héros se lance à la recherche de l'alpiniste, on nous fait revivre des épisodes importants de son passé. J'ai trouvé très réussies les scènes d'escalade, à la fois belles et haletantes. (Il serait toutefois intéressant d'avoir l'opinion d'un.e spécialiste.) Certains plans d'altitude sont particulièrement beaux... même si je persiste à penser que des prises de vue réelles auraient été encore plus impressionnantes.
L'intrigue prend aussi la forme d'un polar. En effet, il est possible qu'Habu ait trouvé, au cours d'une de ses expéditions impossibles, l'appareil photographique de feu George Mallory, dont on se demande encore aujourd'hui s'il ne fut pas, presque trente ans avant Edmund Hillary, le premier alpiniste (occidental ?) à avoir gravi l'Everest.
La dernière partie voit le suspens augmenter. On suit la folle tentative de deux hommes, seuls face aux éléments et à leurs faiblesses. C'est bigrement bien foutu.
P.S.
Le réalisateur, Patrick Imbert, est le co-auteur du Grand Méchant Renard.
21:21 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films