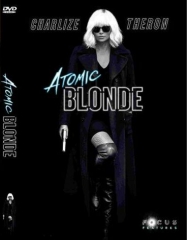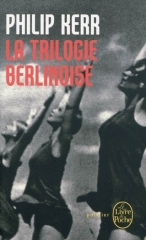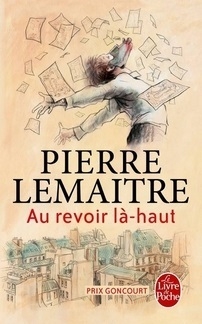mardi, 21 août 2018
The Intruder
Diffusé aussi sous le titre I Hate Your Guts, ce film de Roger Corman, datant de 1962, a été restauré. Il est de nouveau proposé dans certaines salles, alors que The BlacKkKlansman de Spike Lee est sur le point de sortir, ce qui n'est évidemment pas une coïncidence.
Le contexte est celui des débuts de la déségrégation, dans une petite ville du Sud des Etats-Unis, où des adolescents noirs ambitionnent de suivre les cours du lycée des Blancs. Ceux-ci sont majoritairement hostiles au changement mais, par légalisme, semblent vouloir laisser les choses se dérouler dans le calme. Tourné dans le Missouri, le film propose une belle galerie de personnages de l'Amérique profonde, des gens modestes, pas mauvais sur le fond, mais susceptibles de déraper.
La mèche va être allumée par un "intrus", Adam Cramer, qui affirme venir tantôt de Californie, tantôt de Washington. Il se réclame d'une association politique, la Patrick Henry Society, opposée à la fin de la ségrégation. Il a l'allure avenante de William Shatner, qui, à l'époque, n'avait pas encore endossé le costume du capitaine Kirk dans Star Trek.
La première partie de l'histoire nous le présente comme un beau parleur, séduisant, entreprenant avec les femmes. La caractérisation est intéressante, parce qu'un cinéaste du camp opposé pourrait tout à fait créer un personnage miroir, un militant de la déségrégation envoyé par les élites de Washington pour "éclairer" la population locale.
Petit à petit, Cramer dévoile son jeu et enflamme les foules par des discours où percent un anticommunisme sans nuance... ainsi qu'un indéniable antisémitisme. C'est un peu trop théâtral à mon goût, mais assez efficace. Le réalisateur réussit mieux à mettre en scène la montée de tension et les risques de dérapage : la population locale, chauffée à blanc (!) par l'activiste raciste, ne suit pas tout à fait la feuille de route établie par lui. La fin est évidemment morale.
P.S.
L'an dernier, un autre film de la même sensibilité, Du Silence et des ombres (To Kill a Mockingbird dans la version originale), était ressorti sur les écrans français. L'action se déroule dans les années 1930, avec un beau portrait social d'une petite ville du Sud, où un avocat (incarné par Gregory Peck) va tenter de vaincre les préjugés racistes pour faire triompher la justice.
mardi, 07 août 2018
Happiness Road
Ce film d'animation est une oeuvre autobiographique de la Taïwanaise Hsin-Yin Sung, qui s'étend des années 1970 à nos jours. Grosso modo, on suit deux trames chronologiques : celle, actuelle, de la vie d'une expatriée, mariée à un Américain, qui revient (seule) au pays et celle (ancienne) d'une enfant au tempérament affirmé, que l'on voit grandir dans une dictature asiatique occidentalisée.
Le paradoxe de ce film est que, si l'animation semble plutôt destinée à des enfants (cela ressemble un peu aux séries japonaises des années 1980), le fond s'adresse clairement à des adultes. Pour bien saisir toutes les subtilités de l'intrigue, il convient de connaître un peu l'histoire de Taïwan.
L'une des grandes réussites de ce film est la résurrection du monde de l'enfance, avec sa naïveté, ses rêves, ses craintes, ses engouements et ses rivalités. Pour l'héroïne, Tchi, le moment clé est celui de l'entrée à l'école. Ses parents parlent une langue taïwanaise (une sorte de cantonais, je crois), mais c'est en mandarin que les cours sont donnés. Les sous-titres tentent de traduire quelques jeux de mots. Cela se complique un peu quand on apprend que la grand-mère de l'héroïne est une aborigène, une catégorie de population méprisée (à l'époque) sur l'île. Mais elle est dépositaire d'un savoir et de coutumes ancestrales, qui fascinent sa petite-fille... tout autant passionnée par les séries japonaises, tout spécialement Candy !
La narratrice va se faire des amis, en particulier une enfant métis, une blonde dont le père est un soldat américain. Il y a aussi le turbulent maigrichon de la rangée de derrière, qu'elle revoit des années plus tard, juste avant un tremblement de terre. Il y a encore le petit gros, le seul élève de la classe à posséder une montre digitale. C'est le fils du maire... et, lorsque l'héroïne revient au pays pour l'enterrement de sa mémé, elle le croise à son tour en campagne pour être élu.
La vie politique se trouve le plus souvent à l'arrière-plan de l'histoire mais, parfois, elle passe devant. A l'entrée de l'école se trouve une statue de Tchang Kaï-Chek, le fondateur de la République de Chine (autre nom de Taïwan). Au lycée, l'héroïne croise la fille de l'opposant Chen Shui-bian, futur maire de Taipei et président de la République. (L'actuelle présidente, Tsai Ing-wen, est une de ses anciennes ministres.) On a aussi un écho des manifestations pour la démocratisation de l'île, dans les années 1980-1990.
Tchi a pu suivre des études supérieures parce que ses parents se sont saignés aux quatre veines. Dès le primaire et le secondaire, on sent que l'argent joue un rôle important : certains élèves sont favorisés pour la préparation des épreuves. Les parents, des travailleurs modestes, misent beaucoup sur la réussite scolaire de leur fille unique. A un moment, Tchi a voulu rompre avec l'avenir qu'on avait tracé pour elle. De retour au pays, elle comprend mieux ses parents, qui ont l'âge de la retraite, mais continuent à tirer le diable par la queue. Tchi ne sait plus trop où elle en est : taïwanaise/chinoise/américaine, traditionaliste/moderne, célibataire/mariée/divorcée. Tout cela est assez bien vu, et mis en scène avec délicatesse.
P.S.
Cette histoire ressemble beaucoup à celle vécue par une autre Taïwanaise, Li-Chin Lin partie elle vivre en France. Il y a six ans, elle a publié un excellent roman graphique, Formose, qui mériterait d'être adapté au cinéma.
13:44 Publié dans Chine, Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 05 août 2018
Atomic Blonde (DVD)
J'ai raté ce long-métrage, sorti discrètement dans la torpeur estivale de l'an dernier. Je crois même qu'il n'a pas été programmé à Rodez. Et pourtant, ce film d'espionnage, dont l'action se déroule en octobre-novembre 1989, au moment de la chute du Mur de Berlin, ne manque pas de qualités.
C'est d'abord un bien meilleur film de genre que le récent Red Sparrow, même s'il partage avec lui une exploitation racoleuse du corps (splendide) de certaines actrices. (La relation homosexuelle entre l'héroïne, incarnée par Charlize Theron, et l'espionne française, interprétée par Sofia Boutella, a remué les hormones de biens des spectateurs mâles...)
C'est aussi un excellent film d'action, au coeur duquel on trouve un formidable plan-séquence d'une bagarre dans un immeuble de Budapest Berlin. Les bonus du DVD expliquent la conception, la mise en place, l'entraînement (très physique pour C. Theron, qui n'a pas été doublée) et le déroulement de cette séquence rythmée, drôle et sanglante.
Au niveau du scénario, on s'est trituré les méninges. Il s'agit de récupérer une liste d'espions et de démasquer un agent double. Plusieurs pistes nous sont suggérées tout au long du film... jusqu'à la révélation finale, bien amenée. Les acteurs sont bons. Aux côtés des deux femmes, on trouve (entre autres) James McAvoy (toujours irritant mais plus crédible ici qu'en professeur Xavier), Toby Jones et John Goodman.
J'ajoute que la photographie est superbe, chaque type de scène étant associé à des couleurs spécifiques. Enfin, le "vieux" cinéphile que je suis n'a pas détesté la bande-son des années 1980, qui m'a rappelé bien des souvenirs.
Bref, c'est un film à voir !
22:09 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 16 juillet 2018
Histoire du football
Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le football occupe une place importante dans les sociétés contemporaines, en France comme ailleurs. Son histoire est d'ailleurs fort intéressante. J'ai récemment lu deux ouvrages qui en éclairent certains aspects.
A tout seigneur tout honneur. La Coupe du monde 2018 s'étant déroulée en Russie, commençons par le livre de Régis Genté et Nicolas Jallot :
Très bien écrit, l'ouvrage part de l'introduction du football en Russie (par des Anglais) à la gestion poutinienne de ce qui est d'abord perçu comme un outil de propagande. Cela ne date pas du XXIe siècle. Très vite populaire (mais aussi apprécié par des intellectuels comme le compositeur Dmitri Chostakovitch), ce nouveau sport a bénéficié de l'action des frères Starostine, avant la Seconde guerre mondiale. Des supporteurs russes se souviennent encore aujourd'hui de ces précurseurs, dont trois ont été par la suite envoyés au Goulag, sans doute sur ordre de Lavrenti Beria, le chef du NKVD (ancêtre du KGB, dont est issu l'actuel FSB).
Cela-ci a tenté de promouvoir sa "caste" (celle des policiers politiques) à travers des clubs appelés "Dynamo" (ou "Dinamo"). Il y a d'abord eu celui de Tbilissi (Beria étant géorgien), puis ceux de Moscou et de Kiev. Mais à Moscou, le club fondé par les frères Starostine était le Spartak, le grand rival, soutenu successivement par les coopératives agricoles et les Komsomol (l'union des jeunesses communistes). L'histoire des rivalités internes à la Russie épouse en partie celle des rivalités politiques, la fierté locale venant se greffer dessus. D'autres clubs sont apparus à Moscou, le CSKA (l'équipe de l'armée), le Torpedo (l'équipe du secteur automobile) et le Lokomotiv (soutenu, comme son nom l'indique, par les chemins de fer).
Le livre fourmille d'anecdotes, notamment sur la période de la Seconde guerre mondiale. Si certains joueurs vedettes ont été envoyés en front, d'autres ont été préservés pour jouer des matchs de propagande (notamment à Leningrad -aujourd'hui Saint-Pétersbourg, ville qui a subi un siège de 900 jours ainsi qu'une épouvantable famine). Pour l'anecdote, je signale que l'un des sites de la coupe du monde (celui de Saint-Pétersbourg) a été aménagé à l'emplacement du stade utilisé par l'une des équipes de la ville avant-guerre, là précisément où, en 1942, se serait déroulé le match famélique de propagande, retransmis à la radio jusque sur les lignes de combat.
Il est aussi question du "match de la mort", une légende encore vivace aujourd'hui en Russie, sur une rencontre entre des soldats allemands et des joueurs ukrainiens, qui auraient été menacés de mort et, pour certains, fusillés après la rencontre. Les auteurs décryptent parfaitement bien la construction du mythe.
Après la Seconde guerre mondiale, l'URSS rejoint les instances internationales sportives (la FIFA en 1946, le CIO en 1951). On l'a oublié, mais les succès sont arrivés assez vite. La sélection soviétique a remporté l'épreuve aux JO de 1956 (à Melbourne). Elle est devenue championne d'Europe en 1960, lors de la première édition de l'Euro... en France. Quatre ans plus tard, l'équipe est allée jusqu'en finale, battue seulement par l'Espagne, pays organisateur. En Coupe du monde, le bilan est moins flatteur, avec un quart de finale en 1958 et une demi-finale en 1966, en Angleterre (performance que l'actuelle équipe de Russie n'est donc pas parvenue à égaler cette année). Cette édition a été marquée par l'unique victoire des "Trois Lions"... et le rôle de l'arbitre de la finale, qui était soviétique. (C'est très bien expliqué dans le bouquin.)
Cette époque (la fin des années 1950 et les années 1960) est marquée par une figure devenu mythique, le gardien de but Lev Yachine, seul de sa catégorie à avoir décroché le Ballon d'or, en 1963. C'est donc à juste titre que ce joueur a été retenu comme emblème de la toute récente coupe du monde, sur une affiche au style rétro, rappelant immanquablement l'époque soviétique, dont l'actuel président Vladimir Poutine est tant nostalgique :
Au niveau des clubs, c'est dans les années 1970-1980 que les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus. Cela coïncide avec l'arrivée à maturité d'une génération dorée, notamment venue d'Ukraine (du Dynamo de Kiev), où ont été mises en pratiques des méthodes scientifiques d'entraînement. Cela s'est répercuté sur l'équipe soviétique, qu'on a commencé à revoir pointer le bout de son nez en 1982 mais surtout en 1986, au Mexique. Avec le Danemark, c'est l'équipe qui a marqué les esprits dans la première partie de la compétition.
La fin de l'ouvrage est centrée sur la période poutinienne et le rôle des oligarques dans la vie des clubs. Il est question aussi bien du Zénith Saint-Pétersbourg que des clubs du Daghestan et de Tchétchénie. C'est tout aussi passionnant que ce qui précède.
On continue avec un livre aux ambitions plus modestes. Il s'agit de la réédition d'un ouvrage publié en 1954 (sous la plume de Jules Rimet), augmenté de plusieurs textes divers :
Le fondateur du Red Star, qui présida la FIFA de 1921 à 1954, y raconte les premières Coupes du monde, celles auxquelles il a assisté. Cela commence par celle de 1930, en Uruguay. Les dirigeants de la FIFA et les équipes européennes invitées à y participer ont fait le trajet en paquebot. Rimet emporte avec lui le trophée qui ne porte pas encore son nom et qui a été sculpté par un certain Abel Lafleur, né à... Rodez !
Ce n'est pas la seule référence à l'Aveyron que contient ce récit de voyage. Sur le paquebot se trouvent deux chanteurs d'opéra, le Russe Fédor Chaliapine et une certaine Marthe Nespoulous. Les Rouergats qui lisent ce billet auront immédiatement dressé l'oeil l'oreille : c'est un nom assez répandu dans notre département.
Par contre, s'il est assez facile de dénicher, sur la Toile, des enregistrements (audio) de la soprano, les informations biographiques manquent cruellement. En Aveyron, on a plutôt retenu la carrière de son aînée, la cantatrice Emma Calvé, dont une place porte le nom à Rodez.
Mais revenons à nos moutons (en short). Après l'Uruguay, ce fut au tour de l'Italie d'accueillir (et de remporter) la Coupe du monde, en 1934. Avec le recul, Jules Rimet, s'il se félicite de la qualité de l'organisation, semble éprouver quelques regrets, puisqu'il s'est montré accommodant avec le régime fasciste. (Dans un entretien publié en fin d'ouvrage, le petit-fils reconnaît que son grand-père a tendu le bras -comme les autres personnes présentes- lors de la cérémonie d'inauguration.)
Pour populaire qu'il soit, le spectacle des équipes nationales se défiant dans un stade n'est pas forcément rentable, au début. C'est avec réticence que la France accepte d'organiser la Coupe du monde de 1938. A l'époque, l'écho des troubles politiques se fait encore plus grand. Ainsi, l'équipe d'Autriche est contrainte de se retirer de la compétition après l'Anschluss. Fort prudemment, les autorités décident de ne pas prévoir de compétition pour 1942. Pour l'organiser, il était question du Brésil et de l'Allemagne nazie...
En 1950, c'est donc au Brésil que s'est déroulée la quatrième édition. Ce chapitre est écrit de manière à faire comprendre aux lecteurs que les Brésiliens n'envisageaient pas d'autre résultat que la victoire de leur équipe nationale... et que le résultat final fut une tragédie (que l'humiliation en demi-finale face à l'Allemagne, en 2014, est venue raviver).
L'un des textes qui succèdent à ce récit fait le point sur les convictions de Jules Rimet, que l'on a parfois jadis rapproché de Pierre de Coubertin. C'était un contresens. Celui-ci était un aristocrate, qui voyait dans l'amateurisme l'incarnation d'un certain élitisme. Fervent adepte de la professionnalisation du sport en général et du football en particulier, Jules Rimet défendait une vision populaire (et méritocratique) de la pratique du sport. Il n'a cependant pas perçu combien l'introduction massive de l'argent allait le dénaturer.
Mais son livre est bigrement intéressant, de surcroît bien écrit.
P.S.
La fameuse "coupe Jules Rimet" n'existe plus. Donnée au Brésil en 1970, à l'issue de la troisième victoire de ce pays dans la compétition, elle a été volée (et sans doute fondue). Les vainqueurs reçoivent désormais une copie du nouveau trophée (que l'on doit à un Italien).
Cela n'a pas empêché un journaliste du Monde de commettre une boulette, dans l'euphorie de la victoire française hier en finale. Plusieurs photographies ont montré le joueur Kylian Mbappé embrassant le trophée. Dans la version papier du quotidien, il est fait référence à Jules Rimet :
L'erreur a été corrigée dans la version numérique de l'article (qui s'appuie sur une autre photographie) :
samedi, 14 juillet 2018
Una Questione privata
Le dernier film des frères Taviani a pour cadre la fin de la période fasciste, pendant la Seconde guerre mondiale. Il prétend mêler réflexion historique et questionnement amoureux, le principal personnage féminin hésitant entre deux hommes, provoquant chez l'un d'entre eux un cruel dilemme : se réjouir de l'arrestation de son rival ou se porter à son secours.
La facilité aurait consisté à opposer deux prétendants aux orientations politiques opposées : un fasciste et un antifasciste. Tel n'est pas le cas ici, puisque les deux hommes, amis d'enfance, se sont engagés dans les partisans (résistants antifascistes, qui luttent contre la République de Salo, Etat fantoche porté par les nazis, qui ont envahi la péninsule).
Deux périodes se croisent dans le film : l'année 1943, avant la (première) chute de Mussolini, où semble régner l'insouciance, dans un milieu bourgeois ; l'année 1944, celle de la lutte. Et là, les clichés abondent. Les scènes du souvenir, montrant le trio amoureux, sont vues et revues. Mais le pire est atteint dans les scènes d'affrontement de 1944, mal jouées. En fait, les acteurs sont mal dirigés. On le voit aussi quand le héros repasse clandestinement par son village natal et croise ses parents, qui transportent du bois. Cette scène, censée être émouvante, sombre dans le ridicule.
Du coup, on se désintéresse un peu de l'intrigue amoureuse. La jeune femme n'apparaît pas très sympathique. Seul le personnage de Milton (le prétendant intellectuel, évincé par son ami plus sportif) est un peu étoffé. On a su montrer son évolution, mais la prestation de l'acteur ne m'a guère convaincu.
Le film gagne en intensité et en complexité quand le camp fasciste est filmé de l'intérieur. Mais cela fait bien peu pour ce qui reste une ébauche, un brouillon de film qu'il aurait fallu retravailler.
13:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 13 juillet 2018
Hedy Lamarr : from extase to wifi
C'est un documentaire dont j'attendais impatiemment l'arrivée à Rodez. Il est consacré à une actrice hollywoodienne qui fut célèbre en son temps et qui incarna la brune "glamour" voire la tentatrice dans des productions destinées au grand public. Par contre, on ignore en général qu'elle s'intéressait à la technologie et qu'on lui doit sans doute une invention révolutionnaire.
Le documentaire commence par revenir sur la jeunesse de celle qui s'appelait Hedwig Kiesler. Cette Autrichienne est née dans un milieu privilégié (son père était banquier) et, contrairement à la majorité des jeunes femmes de son époque, a bénéficié d'une assez grande liberté. La relation avec le père était forte. Celui-ci était féru d'inventions. il semble avoir communiqué sa passion à sa fille, qui s'amusait à démonter des jouets pour en comprendre le fonctionnement.
A l'écran, on alterne les témoignages de proches, les images d'archives et les documents divers (dont une entrevue oubliée de l'actrice, devenue âgée). C'est l'occasion de (re)découvrir l'Autriche de l'Entre-deux-guerres, avant que les nazis ne mettent la main dessus. Au départ, la jeune femme, issue d'une famille juive convertie au catholicisme, ne voit pas le danger. Elle continue à fréquenter les élites... mais va vite comprendre qu'il vaut mieux prendre le large.
Sa carrière cinématographique commence en Autriche, sous le parfum du scandale. Extase est le titre d'un film où, encore mineure, elle apparaît nue et simule un orgasme. Scandale dans le pays et dans sa famille... et même ailleurs puisque, lorsque la jeune femme faits ses débuts aux Etats-Unis, on lui impose de jouer vêtue...
On comprend assez vite que le joli minois cache un caractère d'acier. (Elle se qualifiait d'enfant terrible, en français dans le texte.) Bien que d'une grande beauté, l'actrice a dû provoquer la chance pour s'imposer... et se faire payer correctement par la production (la MGM, tenue Louis Mayer). La suite nous raconte donc le succès de l'actrice, ainsi que ses déboires sentimentaux.
La Seconde guerre mondiale conduit la vedette autrichienne pas encore naturalisée américaine à soutenir le moral des troupes yankees... et à réfléchir à une technique de guidage des torpilles ! C'est pour moi la principale révélation de ce documentaire. Même si l'actrice s'est appuyée sur le travail d'un musicien ingénieux, il est incontestable qu'elle a eu l'intuition du système de "saut de fréquence", qui, aujourd'hui encore, sert de base aux télécommunications modernes. A l'époque, le projet de l'actrice est traité par le dédain. Elle a pourtant déposé un brevet, qui ne lui a finalement rien rapporté...
La troisième partie est moins gaie. Elle montre le déclin de l'artiste, les difficultés de sa vie personnelle... et les dégâts de la chirurgie esthétique, dont elle fut l'une des premières utilisatrices. Au début, c'était discret, mais, à la fin, c'était horrible. J'ai pensé à Elizabeth Taylor, de la génération suivante, mais qui a connu une évolution assez proche.
Le film est un bel hommage à une femme ravissante et intelligente, qui a voulu vivre libre dans un monde de machos. Ce n'est pas un hasard s'il sort en 2018, produit par l'actrice Susan Sarandon.
lundi, 25 juin 2018
Bienvenue en Sicile !
Une fois n'est pas coutume, je trouve le titre français meilleur que l'original (At War for Love ou In Guerra per amore), que l'on pourrait traduire par "A la guerre par amour". Celui-ci fait allusion à l'histoire d'amour contrariée qui sert de squelette à l'intrigue, alors que le titre français évoque, sur le ton de la comédie, le débarquement des Américains en Sicile, en 1943.
C'est donc d'abord une comédie à l'italienne, avec ses caricatures, son exubérance, sa joie de vivre (et cette langue si musicale). Arturo le charmeur sans le sou rêve d'épouser la belle Flora, que son oncle envisage de marier au fils de l'une de ses relations. On est dans le petit monde des Italo-américains new-yorkais, limite (voire franchement) mafieux. Or, à la même époque, les Alliés préparent l'opération Husky. Du côté américain, on compte s'appuyer sur les liens qui existent entre certains immigrés et le pays d'origine de leurs parents. D'ailleurs, le propre père de Flora vit encore là-bas. Sa bénédiction serait bien utile à Arturo pour empêcher le mariage arrangé par l'oncle. Mais le (possible) futur beau-père de Flora possède lui aussi des relations dans son pays natal. Il va tenter de contrecarrer le projet du rival de son fils.
L'aspect comédie est renforcé par la truculence des villageois qui vont voir débarquer les Yankees. Il y a cet étrange duo, composé d'un aveugle et d'un boiteux, qui seront mêlés à la plupart des péripéties siciliennes. Il y a ce père de famille, dont le fils porte l'uniforme italien (fasciste) et qui garde religieusement une statue du Duce dans un placard. Une intense rivalité l'oppose à sa voisine qui, au moindre bombardement, sort mettre à l'abri une statue de la Vierge. Il est aussi souvent question d'ânes, des vrais, des symboliques... et ceux d'une chanson pour enfant, à laquelle un garçon est particulièrement attaché. C'est l'un des fils rouges de l'intrigue, avec une photographie d'amoureux (maladroitement) prise devant un pont new-yorkais. Cet ancêtre du selfie devient le running gag de l'histoire.
Et puis il y a ces trognes de mafieux. Ah, pour sûr, ils sont gratinés ! Le chef local est une pourriture débonnaire et ventripotente. Ses sbires portent d'horribles moustaches et froncent les sourcils. Vous avez compris que l'on rit souvent à cette comédie... avant que le ton ne change, dans le dernier tiers de l'histoire. Celle-ci s'appuie sur des faits réels. Le gouvernement américain, soucieux de se ménager des soutiens sur place, a conclu un pacte avec le chef mafieux Lucky Luciano. Résultat : le débarquement allié s'est très bien passé (avec peu de pertes). En contrepartie, les conquérants du jour vont confier les clés du pouvoir à des truands, certains se parant des couleurs d'un nouveau parti tout propre, la Démocratie chrétienne.
C'est l'une des forces de ce film (hélas passé quasi inaperçu) que de parvenir à mêler une bluette sentimentale (inspirée de la commedia dell'arte) et une réflexion politique sur un sujet qui a, aujourd'hui encore, un impact sur la société italienne.
00:54 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 19 juin 2018
La Révolution silencieuse
Cette "salle de classe silencieuse" (titre originel, en allemand) est celle de lycéens de RDA (l'Allemagne communiste), sur le point de passer leur Abitur (baccalauréat), en 1956. Un jour, par solidarité avec les Hongrois révoltés contre la domination soviétique, ils décident de se taire pendant deux minutes, en cours d'histoire. Ce battement d'ailes de papillons va déclencher une tempête politique.
Ce n'est pas la première fois que le cinéma allemand se lance dans l'analyse de la période de Guerre froide. Les cinéphiles se souviennent de l'excellent La Vie des autres, en 2007. Plus récemment, on a eu droit à De l'autre côté du mur (dont l'actrice principale est présente ici) et D'une vie à l'autre. L'originalité du film est de se situer avant la construction du Mur de Berlin, quand seuls des contrôles policiers séparaient les deux parties de la ville.
L'univers adolescent est bien restitué, montrant des garçons qui cherchent à voir des femmes nues et des couples qui se forment, avec la maladresse des premières amours et des malentendus. L'habileté du scénario consiste à intégrer l'aspect sentimental à l'intrigue politique. On est visiblement dans un lycée au recrutement populaire (et provincial), avec un public mélangé, puisque les enfants d'un vétérinaire et le fils d'un membre éminent du conseil municipal côtoient des rejetons d'ouvriers. Compte tenu de la relative uniformisation vestimentaire qui régnait à l'époque, il n'est pas facile de les distinguer à leur apparence.
Les auteurs ont aussi voulu éviter le film uniquement à charge. D'un côté, ils montrent quand même que ce pays dirigé par d'anciens opposants au nazisme est devenu une prison pour une grande partie de sa population (la Stasi se comportant quasiment comme la Gestapo). D'un autre côté, les défenseurs du régime communiste (et contempteurs de la démocratie bourgeoise, assimilée au fascisme...) ont voix au chapitre. Concernant l'éducation, le propos n'est pas sans faire écho à notre époque, où se pose la question de la réussite scolaire des enfants des catégories populaires.
Mais il s'agit surtout de l'histoire d'une rébellion pacifique, celle de lycéens en quête d'absolu, mais auxquels on va tenter d'imposer des préoccupations plus terre-à-terre. Le harcèlement moral qu'ils subissent est particulièrement bien mis en scène. (Le réalisateur, Lars Kraume, est aussi l'auteur de Fritz Bauer, un héros allemand, dans lequel joue celui qui incarne le père de l'un des lycéens) Cela fait remonter les vieilles histoires du passé, celui de l'Entre-deux-guerres (avec les allusions au Front Rouge, auquel a appartenu le père de l'un des élèves), celui de la Seconde guerre mondiale... et celui, plus récent, de la révolte ouvrière de Berlin-Est.
C'est dire la richesse des thématiques abordées par ce film qui, de surcroît, s'inspire d'une histoire vraie. (Restez pendant le générique de fin.) Alors, même si c'est parfois un peu mélo, j'ai beaucoup aimé, tant les acteurs sont convaincants et l'arrière-plan historique soigné.
21:16 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films
lundi, 18 juin 2018
La chapelle des brebis
C'est d'un édifice peu connu des Ruthénois qu'il va être question : la chapelle Notre-Dame de Pitié, qui dépendait autrefois de la Chartreuse, dont les bâtiments ont été récupérés par l'Etat lors de la Révolution pour devenir ensuite, sous l'Empire, le siège du haras de Rodez, hélas fermé depuis l'an dernier.
Les touristes ont plus de chance de connaître l'édifice que les Ruthénois, puisqu'il fait partie du circuit patrimonial proposé aux visiteurs du chef-lieu aveyronnais (avec le numéro 29). Pour les locaux, le lieu est ouvert au moins le 13 de chaque mois. Pendant des années, c'est un employé municipal féru d'archéologie, Roger Trémouilles, qui a veillé sur l'édifice.
Ce samedi 16 juin 2018, exceptionnellement, la chapelle a été ouverte au public, dans le cadre d'une manifestation agricole : la (mini-)transhumance des brebis du lycée agricole La Roque, situé sur la commune voisine d'Onet-le-Château.
La première partie du trajet a mené les ovins du gué de Salelles (numéro 1 ci-dessous) à la place du Bourg (numéro 2), en passant par Layoule, le carrefour Saint-Cyrice, la rue Béteille et la place d'Armes.
Le parcours du petit troupeau (une cinquantaine de bêtes) ne fut pas de tout repos. Le long des berges de l'Aveyron, la tendance des brebis à se précipiter brusquement dans une direction inattendue était facilement gérable. C'est devenu un peu plus délicat dans la montée de la rue Béteille, où les passants et les riverains ont eu droit à un étonnant spectacle. (Un des animaux se serait blessé lors d'une bousculade à l'entrée d'une boulangerie-sandwicherie. Un peu de sang a coulé, mais ce serait sans gravité.)
Arrivées place du Bourg, les brebis ont été parquées dans un enclos amovible, où elles ont rapidement été entourées d'une foule considérable... et mitraillées par les téléphones portables. Durant presque deux heures, elles ont pu se reposer et se désaltérer, pendant qu'une animation était proposée à proximité, avec des oies et des chiens de berger.
C'est en fin d'après-midi que les brebis se sont remises en marche, direction l'avenue Victor-Hugo puis le chemin de la Boriette, où les attendaient de vertes prairies, jouxtant la chapelle Notre-Dame de Pitié (numéro 3 ci-dessous).
A l'intérieur de celle-ci, on peut voir un fort joli plafond étoilé (de style marial, je crois) :
Plusieurs statues sont également visibles, certaines plus anciennes que d'autres. Ainsi, l'une d'entre elles représente Jeanne d'Arc. C'est un modèle de série qui doit dater du début des années 1920, peu de temps après la canonisation de la Pucelle (et la création d'une seconde fête nationale, celle du patriotisme).
Une autre sculpture est beaucoup plus ancienne, puisqu'elle date du XVIe siècle. Il s'agit d'une Vierge à l'enfant, classée monument historique. Mais je ne me souviens pas si elle se trouvait dans la chapelle lorsque je l'ai visitée.
17:39 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Jeanne d'Arc | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, médias, presse, journalisme, occitanie, société, culture
dimanche, 17 juin 2018
Le Cercle littéraire de Guernesey
... et de la tarte aux pelures de pommes de terre, puisque tel est le nom complet du club éponyme, composé d'habitants de l'île anglo-normande de Guernesey, qui fut occupée par l'armée allemande durant la Seconde guerre mondiale.
Il y a donc un aspect historique à l'intrigue. Pour les Britanniques, l'Allemand est surtout vu comme l'envahisseur que l'on repousse ou celui que l'on va combattre en France. A Guernesey, la population restée sur place a dû cohabiter, tant bien que mal, avec un occupant qui a pu se révéler odieux... ou sympathique. C'est ce que l'on découvre à la suite d'une série d'allers-retours entre les années 1940-1944 et l'après-guerre.
A Londres, une jeune écrivaine (Lily James, vue récemment dans Baby Driver), qui commence à rencontrer le succès, échange des lettres avec un habitant de l'île. Grâce à lui, elle découvre une partie de l'histoire des habitants, mais elle meurt d'envie d'en savoir plus, pensant de surcroît en faire le sujet d'un article. Dans le même temps, sa vie personnelle est sur le point de basculer, en compagnie du dévoué mais très pressant Mark, un riche et séduisant Américain.
Le séjour de Juliet sur l'île va tout changer. Elle est d'abord surprise de ne pas être aussi bien accueillie que ce qu'elle escomptait. C'est l'occasion pour le réalisateur Mike Newell (auteur jadis de Quatre Mariages et un enterrement) de nous dresser le portrait ironique de la vie provinciale sur cette île reculée, avec un entrelacs de relations humaines complexes, ses petits secrets et ses jalousies rances.
Les personnages sont très bien campés, de la logeuse bigote au postier débonnaire, en passant par la veuve acariâtre, la vieille fille un peu fofolle et Dawsey, le charmant éleveur de cochons, qui ne laisse pas l'héroïne indifférente. Sur le groupe plane l'esprit de la plus rebelle de la bande, Elizabeth, dont l'absence est inexpliquée.
Mêlant comédie romantique et drame historique, le film est subtil, emprunt de douceur. Il est furieusement moderne, parce que son intrigue suit les actions de deux femmes indépendantes, l'écrivaine et la rebelle, la Londonienne et la Guernesiaise, les hommes jouant un rôle plus secondaire. Il est toutefois d'un autre temps par la manière dont les sentiments sont exprimés (à entendre de préférence en version originale sous-titrée). C'est aussi un hommage à la littérature et à la lecture, à travers ces personnages ordinaires, qu'un festin de porc grillé va réunir, mais que la mort pourrait finir par séparer.
C'est l'une des excellentes surprises du moment (avec Trois Visages).
19:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 19 avril 2018
La Mort de Staline
Cette "comédie historique" est l'adaptation d'une bande dessinée (française) à succès, initialement publiée en deux tomes, récemment rééditée en un volume :
Derrière la caméra, on trouve Armando Iannucci, remarqué il y a quelques années pour une autre satire politique, In The Loop. Si la bande dessinée et le film s'appuient (hélas) sur des faits incontestables, il ne s'agit pas d'un documentaire. Dans les détails, la réalité a été parfois un peu "aménagée", pour mieux servir l'intrigue. Mais je trouve que l'ambiance de fin de règne est très bien rendue, au service d'une farce, horrible certes, mais extrêmement drôle.
Au cœur de l'intrigue se débat une bande de mâles dominants, jusqu'à présent soumis au mâle alpha qu'était Staline. La question est de savoir qui dans ce panier de crabes va tirer les marrons du feu. C'est là que le film surpasse la bande dessinée, grâce à l'interprétation magistrale d'une brochette d'acteurs confirmés.
Jeffrey Tambor met tout son talent à incarner Malenkov, le numéro 2 officiel qui, évidemment, n'a pas l'étoffe pour succéder à Staline. Il nous est présenté comme un être veule, lâche... et imbu de sa personne.
Le véritable numéro 2, l'exécuteur des basses œuvres, l'âme damnée de Staline, est Beria, le chef du NKVD (ancêtre du KGB), interprété avec brio par Simon Russell Beale (qui, à mon avis, mérite un Oscar). Parfois, il rend son personnage presque humain, alors que c'était une pourriture de la pire espèce, dont les travers ne sont qu'effleurés aussi bien par la bande dessinée que par le film.
Son principal rival est Khrouchtchev, auquel Steve Buscemi prête ses traits et sa faconde. S'il ne lui ressemble guère physiquement, il réussit à rendre crédible une vision du personnage, qui fut très proche de Staline... et sous-estimé par nombre de ses camarades.
Au sein du Politburo du Comité central (du Parti communiste), ces trois-là sont entourés par d'autres communistes purs et durs, comme Kaganovitch, Mikoyan, Molotov (un peu "chargé" dans le film) et Boulganine, très bien interprété par Paul Chahidi. D'autres hommes jouent un rôle important : Vassili Staline, fils alcoolique et incompétent du dictateur, et surtout le maréchal Joukov, incarné avec une gourmandise évidente par Jason Isaacs :
Et les femmes là-dedans ? Ce sont essentiellement des proies, dont se repaissent les mâles dominants, en particulier Beria, même si ses faveurs allaient plutôt aux jeunes filles, qu'il faisait enlever à la sortie de l'école... Quelques figures émergent toutefois : la fille de Staline, Svetlana (Andrea Riseborough) et surtout la pianiste rebelle, qui a les traits d'Olga Kurylenko, qui apporte un peu de grâce et de lumière dans ce monde abject.
La farandole commence à tourner dès le concert. Cette séquence initiale a pour but de nous faire comprendre la trouille qui régnait à l'époque en URSS. Staline gouvernait par la terreur... et tout le monde se croyait surveillé en (quasi) permanence.
La mort du dictateur donne naissance à des scènes particulièrement jouissives. J'ai apprécié que le réalisateur ridiculise le potentat. Il en profite pour souligner l'arrivisme et la lâcheté de ses sbires, qui se bousculent pour paraître les plus affectés par la mort du Petit Père des peuples.
Leur attitude contraste avec la ferveur, apparemment non feinte, des foules qui convergent vers Moscou pour rendre un dernier hommage au Guide du communisme. Dans le lot, il y en a sans doute qui font le déplacement pour s'assurer que le dictateur est mort, d'autres pour se faire bien voir... et beaucoup par émotion sincère (une sorte de syndrome de Stockholm à très grande échelle).
Très vite, les vieux crabes communistes laissent tomber le masque de l'affliction pour se lancer dans la course à l'échalote. C'est vraiment savoureux, souvent cynique et sardonique. J'ai beaucoup ri à des scènes qui, pourtant, montrent des choses horribles (notamment des exécutions, présentées comme des actes anodins, tant le régime a déjà de sang sur les mains).
Au final, le film ne constitue pas une belle leçon d'histoire, mais plutôt un exposé d'anti-morale politique, servi par un humour féroce. C'est indubitablement la comédie du moment.
P.S.
Le film a été tourné en anglais et, franchement, les acteurs sont tellement bons qu'on se contrefiche qu'ils ne parlent pas russe.
21:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 08 avril 2018
L'Eté de cristal
Il y a environ deux semaines est décédé Philip Kerr, écrivain britannique connu pour ses polars. Il a situé l'intrigue de certains de ses romans dans le monde du football. Mais ce sont les aventures de Bernhard "Bernie" Gunther, détective dans l'Allemagne nazie, qui lui ont valu la reconnaissance internationale. Il y a quelques années, les premiers romans faisant intervenir ce personnage ont été retraduits et publiés en un volume, en collection de poche :
L'Eté de cristal constitue la première partie du volume. L'action démarre peu de temps avant les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936. L'ancien policier, viré parce qu'il n'était pas un nazi militant, est devenu détective privé, mais évite d'enquêter sur les histoires d'adultère, qu'il juge trop dangereuses. Il parvient néanmoins à gagner sa vie avec les affaires de disparition, très nombreuses en Allemagne depuis 1933...
Cette fois-ci, il va être recruté par un riche industriel, dont la fille et le gendre ont été retrouvés morts dans une maison incendiée... avec chacun une balle dans le corps. De surcroît, un collier de diamants et de mystérieux papiers ont disparu.
Voilà Bernie embarqué dans une enquête périlleuse. Il doit veiller à ne pas marcher sur les plates-bandes de la Kripo (police criminelle), tout en se méfiant de la Gestapo : certains de ses membres s'immiscent dans l'affaire, à la demande d'Hermann Goering, qui connaît le riche industriel. S'ajoutent à cela les SS, qui s'inquiètent que l'un des leurs (le gendre) ait pu être assassiné. N'oublions pas non plus les voleurs et les assassins, qui n'ont pas intérêt à être retrouvés.
Il faut donc un peu s'y connaître en histoire allemande (au besoin en révisant ici) pour savourer tout le sel de ce roman. L'auteur s'est visiblement beaucoup documenté et, même s'il prend parfois des libertés avec l'Histoire, le tableau qu'il brosse de la société urbaine allemande sous le IIIe Reich m'a l'air tout à fait fidèle. On y découvre notamment des aspects de la vie quotidienne, parfois méconnus.
J'ajoute que c'est bien écrit (et traduit). L'histoire est racontée du point de vue du détective, un peu cynique, souvent sarcastique. Il n'hésite pas à tourner en ridicule tel personnage important ou tel élément de la propagande. Du point de vue des autorités, même s'il n'est pas nazi, il est relativement fiable car pas suspect de "philocommunisme". Il passe pour un conservateur modéré... mais Bernie finit par reconnaître qu'il lui est arrivé de voter SPD (socialiste) !
Comme l'auteur s'inspire des romanciers américains du milieu du XXe siècle, il fait rencontrer quelques femmes fatales à son héros. Les deux plus marquantes sont l'actrice, seconde épouse du vieil industriel, et la journaliste intrépide, qu'il associe à son enquête, mais dont on finit par perdre la trace...
Pour en savoir plus, il faut lire les aventures suivantes (La Pâle Figure et Un Requiem allemand), qui se déroulent en 1938 et 1947. A l'origine, je pense que le romancier n'avait pas prévu de s'attarder davantage sur son héros. Mais, comme ses livres ont rencontré le succès, il a, par la suite, écrit d'autres romans, dont l'action s'intercale entre ces trois oeuvres, ou les prolonge. En voici la chronologie (incomplète, toute l'oeuvre n'ayant pas encore été publiée en français) :
00:29 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, histoire, livres, roman
jeudi, 05 avril 2018
Le Collier rouge
Le centenaire du premier conflit mondial contribue à la sortie de nombreux films qui ont pour cadre cette guerre. Celui qui nous occupe est adapté du roman de Jean-Christophe Rufin (que je n'ai pas lu). Les spectateurs se retrouvent dans les pas du juge militaire (François Cluzet, correct, sans plus) chargé d'enquêter sur un mystérieux crime ("une connerie", disent certains personnages), celui commis par Morlac, soldat décoré au tempérament révolutionnaire.
Le scénario est suffisamment bien construit pour que l'on suive la majorité du film sans savoir exactement ce que l'on reproche à l'ancien poilu. On se doute que c'est lié à son chien (qui l'a accompagné à la guerre et veille sur lui de l'extérieur de la prison), mais on ignore exactement pourquoi. Dans le rôle du prisonnier, Nicolas Duvauchelle (dont on a déjà pu apprécier le talent dans Je ne suis pas un salaud) est très bon... même s'il n'est pas très crédible en faucheur, dans la scène qui nous le montre aux foins.
Lantier (Cluzet) mène l'enquête. Le profil psychologique de l'accusé l'intrigue. En 1919, les élites françaises se méfient comme de la peste de tout ce qui peut ressembler à un Bolchevique. Mais le gars est aussi un héros de guerre. L'officier va recevoir l'aide d'un gendarme débonnaire (incarné par Patrick Descamps).
Pour résoudre cette énigme, Lantier doit rencontrer Valentine (Sophie Verbeeck), l'ancienne compagne de Morlac (séparée de lui pour on ne sait quelle raison), ainsi qu'une vieille dame aveugle qui prend soin du chien. De son côté, le gendarme va recueillir de précieuses informations auprès du simplet du village, qui a vu des choses mais n'est pas facile à trouver... et à coincer.
A cela s'ajoute le récit de Morlac qui, du fond de sa cellule, va commencer à parler avec Lantier, dont il sent qu'il n'est pas aussi obtus que la majorité des officiers de son rang. Cela nous vaut quelques retours en arrière, dans les tranchées, notamment dans l'est de la France métropolitaine. La meilleure séquence est à mon avis celle qui se déroule dans les Balkans (Morlac ayant été reversé dans l'armée d'Orient). L'histoire de la fraternisation avec les Bulgares, en présence des Russes, est bien mise en scène.
En dépit de toutes ces qualités, je n'ai pas été emballé. Il y a quelques maladresses. Certaines scènes de dialogue auraient dû être retournées. Et puis il y a ce penchant un peu prononcé... C'est une forme de "politiquement correct" de gauche. La guerre, c'est pas bien, les puissants sont des salauds, le patriotisme c'est de la merde... C'est tout de même un peu simpliste. Mais ça se laisse regarder sans déplaisir, d'autant plus que le chien (deux chiens en réalité, des beaucerons) est épatant !
15:01 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 28 février 2018
La Juste Route
Ce film en noir et blanc a pour cadre la Hongrie de l'immédiat après-guerre. En 1945, un bourg est en fête : l'épicier local marie enfin son fils, avec une fille de paysans (auparavant entichée d'un gars parti rejoindre la résistance communiste). Au village, tout le monde (ou presque) s'y prépare. Dans le même temps, à la gare ferroviaire voisine, descendent deux rescapés de la Shoah, qui transportent avec eux deux mystérieuses caisses, qui contiendraient des parfums ou des articles d'hygiène.
Très vite, la nouvelle se répand dans le village. L'intrigue se déploie alors sur deux plans : on suit le parcours des juifs (à pieds) et des deux caisses (sur un chariot), de la gare jusqu'au centre du village. On ne sait pas trop où ils vont exactement ni ce qu'ils viennent faire ici... d'autant que les deux hommes (un âgé, l'autre jeune adulte) sont quasiment mutiques.
Au sein de la population du village, trois familles semblent en savoir plus. La venue de ces juifs ne les arrange pas du tout et réveille des souvenirs que l'on voudrait bien voir rester enfouis. C'est un peu comme si un battement d'ailes de papillon était sur le point de provoquer la naissance d'un cyclone dans ce village.
Le plus gratiné est l'épicier, qui est aussi secrétaire de mairie. Dans l'arrière-boutique, il conserve un étrange album de famille. Quant au coffre de la mairie, il renferme quelques documents compromettants. Plusieurs des adultes du village sont prêts à en découdre avec les arrivants, bien que ceux-ci ne formulent a priori aucune revendication ni menace. D'un autre côté, certains habitants ne supportent plus cette ambiance délétère, ni le poids de la culpabilité.
C'est tout l'intérêt de ce film que de montrer les différentes attitudes des habitants et les conséquences de leur choix sur leur vie de tous les jours. Il convient aussi d'éclaircir le mystère de la présence de ces voyageurs, qui ne sont pas du village, mais sont peut-être apparentés à certains des habitants.
C'est un petit film bien ficelé, bien filmé, qui joue beaucoup sur le non-dit. Dans sa conclusion, il est assez ambigu, mais à nous, Français, dont le pays a aussi connu une période d'occupation allemande (et un gouvernement collaborateur), il évoque bien des choses.
22:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 24 février 2018
Pentagon Papers
Le titre "français" du dernier film de Steven Spielberg est une nouvelle illustration du snobisme de certains distributeurs, qui remplacent le titre d'origine (en anglais), non pas par un équivalent en français, mais par... un autre titre anglais ! (On a récemment vu le même procédé à l'œuvre pour The Passenger et 24H Limit.)
The Post (dans la version originale, dont nous avons d'ailleurs pu bénéficier au CGR de Rodez... un mois après la sortie du film) raconte comment un rapport secret, faisant le bilan de la politique américaine au Vietnam, a fini par être publié, au début des années 1970, d'abord par le The New York Times (pas très content de la manière dont cette histoire est contée par Spielberg), puis par The Washington Post.
Ce film est donc une ode à la liberté de la presse (démocrate), une dénonciation de l'unilatéralisme du pouvoir présidentiel (incarné ici par Richard Nixon, dont les coups de fil du soir sont sans doute une allusion aux tweets nocturnes de son lointain épigone) et l'histoire de l'affirmation professionnelle d'une femme, Katharine Graham (magistralement interprétée par Meryl Streep).
C'est tourné comme un film d'espionnage, avec ses rendez-vous secrets, ses documents ultra-confidentiels, ses coups fourrés et ses (petites et grandes) trahisons. Fidèle à son style, Spielberg a aussi voulu rendre hommage et faire œuvre d'historien. Certaines scènes ont donc un but strictement documentaire, comme celles qui montrent la machinerie d'une entreprise de presse, de la conception à l'impression et la distribution des journaux.
Les comédiens ont dû se fondre dans leur rôle, d'autant plus que nombre d'acteurs de l'époque sont encore vivants, ou du moins très présents dans les mémoires, outre-Atlantique. Voilà donc Meryl Streep et Tom Hanks (excellent en rédac' chef roublard) dotés de coiffures aussi originales que démodées :
Deux personnages se trouvent au centre de l'intrigue. Il y a tout d'abord le (premier) lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, qui va être la source primaire du Times puis du Post. A travers lui, Spielberg veut rendre hommage à ses lointains successeurs, comme Bradley Manning et Edward Snowden (qui, lui, a déjà eu les honneurs d'un documentaire et d'une fiction signée Oliver Stone)... persécutés sous une administration démocrate (celle d'Obama).
Il y a surtout cette "Kay" Graham, l'héritière du Washington Post, qui a dû succéder en catastrophe à son mari infidèle (et suicidaire). C'était il y a plus de quarante ans. A l'époque, la presse était dirigée et rédigée par des hommes, qui ne concevaient pas qu'un esprit en jupon puisse rivaliser avec eux. De surcroît, bien que connaissant parfaitement ce milieu, Kay Graham passait au départ pour une simple rentière. La mise en scène de Spielberg (bien aidée par l'interprétation de M. Streep) se charge de nous faire comprendre quelle était la pression qui pesait sur les épaules de cette femme. Au début, elle tâtonne, intimidée malgré sa connaissance des dossiers. Le film montre sa progressive montée en puissance, jusqu'à cette très belle scène, un soir de réception, dans un salon où, face à une troupe de vieux mecs en costume, Kay va tenir bon. C'est le grand talent de Spielberg que d'avoir réussi à créer quelques-uns de ces moments jubilatoires qui font passionnément aimer le cinéma.
21:46 Publié dans Cinéma, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, histoire
mardi, 13 février 2018
La Douleur
Je me suis décidé à aller voir l'adaptation du livre autobiographique de Marguerite Duras, appelée ici Marguerite Antelme, puisqu'elle est l'épouse du résistant Robert Antelme, que la Gestapo parisienne (française...) vient d'arrêter. Quand j'étais plus jeune, c'est de l'époux dont j'avais entendu parler : son témoignage (L'Espèce humaine) est considéré un peu comme l'équivalent de Si c'était un homme (de Primo Levi), pour les camps de concentration. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il avait été marié à la célèbre (et atypique) écrivaine.
La première partie est très prenante. Elle prend la forme d'un jeu du chat et de la souris entre la frêle et tenace Marguerite (Mélanie Thierry, éblouissante) et l'inquiétant Pierre Rabier (Benoît Magimel, très bon), un gestapiste qui se pique de littérature. (Derrière ce personnage se cache quelqu'un de bien réel, Charles Delval.) Le trouble de l'héroïne est restitué par la mise en scène, qui joue sur la netteté des images et les reflets. Un bon point pour le réalisateur Emmanuel Finkiel (auteur, entre autres, de Voyages et de Je ne suis pas un salaud). A un moment, j'ai même cru reconnaître le visage de Duras âgée dans le reflet d'un reflet de Mélanie Thierry.
Hélas, la seconde partie (qui dure quand même plus d'une heure...) plombe le film. Rabier a disparu, laissant Marguerite face à ses doutes et à son angoisse. Celle-ci prend la forme de pesants monologues, en voix off. Dans ce magma de lourdeur pédante, je distingue toutefois une étincelle (outre la prestation de M. Thierry) : Shulamit Adar, qui incarne Mme Katz, une mère juive persuadée de bientôt retrouver sa fille, qui a été déportée en Europe de l'Est...
Par dessus le marché, c'est le moment où le personnage de Dionys (interprété par Benjamin Biolay, dont le visage semble ne pouvoir prendre qu'une seule expression) devient très présent... trop présent. Du coup, quand on n'a pas succombé à l'envie de piquer un somme, on attend la fin avec impatience.
Dommage.
19:14 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 02 février 2018
L'Echange des princesses
Par un curieux détour du destin, ce film, adapté d'un roman français, coproduit par France 3, réalisé par un Français, dans lequel ont tourné nombre d'acteurs français et où (conformément à la réalité historique) on parle français, même à la cour d'Espagne, est nommé aux César 2018 dans la catégorie... "meilleur film étranger".
Il est réalisé de manière très classique, à tel point qu'on peut dire à son sujet qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de la "qualité française". Certains trouvent cela ennuyeux. Moi, j'ai aimé cette mise en scène académique, parfois quasi picturale, à l'image du plan du début, décalque d'un tableau filmé en zoom arrière.
Je suis aussi "client" des films en costumes, avec ces robes invraisemblables et ces tuniques amidonnées et boutonnées. J'en profite pour rendre hommage au travail des bruiteurs, qui ont parfaitement restitué les frottements des tissus, très agréables aux oreilles.
Mais cette histoire de mariages (arrangés) croisés entre les familles royales de France et d'Espagne vaut surtout pour le jeu des acteurs... et des actrices. On a parlé d'Olivier Gourmet (qui incarne le Régent) et de Lambert Wilson (qui interprète un Philippe V tonitruant). On n'a pas assez souligné la performance d'une brochette de comédiennes épatantes.
A tout seigneur tout honneur. Voici donc Andréa Ferréol, qui incarne la princesse Palatine, la belle-sœur de feu Louis XIV, dont la verve est redoutée à la Cour, mais qui va s'attacher à la toute jeune princesse espagnole que l'on destine à Louis XV encore mineur.
C'est une autre figure tutélaire, de plus modeste extraction, que l'on voit assez souvent dans le film, Mme de Ventadour, gouvernante du futur roi de France puis de sa promise d'outre-Pyrénées. Dans le rôle, Catherine Mouchet (inoubliable jadis dans Thérèse) est impeccable de rigueur et de tendresse contenue.
De son côté, la piquante Ananamaria Vartolomei incarne la fille rebelle du duc d'Orléans, promise au très falot prince des Asturies. Sa beauté a visiblement conquis celui-ci à distance, puisque l'on suggère qu'il a rapidement pris l'habitude de se pogner devant le portrait de Louise Elisabeth...
Mais la véritable révélation de ce film est une adorable poussinette, j'ai nommé Juliane Lepoureau, qui a la lourde tâche de rendre vraisemblable le personnage de la gamine espagnole donnée en pâture au futur roi de France. Elle est vraiment adorable, avec un regard où pétille l'intelligence :
Je me suis laissé prendre à cette étonnante intrigue, portée par la qualité de l'interprétation et la beauté de certains plans. L'information historique est ponctuellement mêlée à la fiction, à travers certains détails de la vie quotidienne ainsi que de petites incrustations évoquant le contexte ou le devenir des principaux personnages.
20:24 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 26 janvier 2018
Les Heures sombres
Décidément, ces dernières années, nos amis anglo-saxons ne cessent de se passionner pour les deux dirigeants britanniques qui ont joué un rôle majeur au début des années 1940, à savoir Winston Churchill et George VI. Celui-ci tint le premier rôle dans Le Discours d'un roi, quand celui-là fut à l'affiche de Churchill. Même si Gary Oldman et Ben Mendelsohn ne font pas oublier ceux qui les ont précédés, ils "assurent" très correctement.
Le premier problème est l'impression de déjà-vu qui se dégage de nombreuses scènes. Que ce soit le Churchill intime, sa relation avec sa secrétaire ou le bégaiement de George VI, à de nombreuses occasions, ce ne sont pas les images de ce film qui s'imposent à l'esprit, mais celles d'autres oeuvres.
Pourtant, je dois reconnaître qu'il y a des efforts de mise en scène. Du (presque) Premier ministre allumant son cigare dans le noir au ballet des doigts de sa secrétaire répondant aux ébauches de discours du même, on est agréablement surpris, et à plusieurs reprises, par certains effets. J'ai aussi en mémoire le moment où la porte de l'une des salles du bunker souterrain se referme sur Churchill, ne laissant voir que son visage dans la petite lucarne, comme s'il était prisonnier.
Ce film a au moins le mérite d'apprendre au public non spécialiste (et de rappeler à ceux qui l'auraient oublié) que le courant pacifiste (celui de l'apaisement) fut très influent au Royaume-Uni et que même Churchill douta parfois de la marche à suivre. Cependant, c'est mis en en scène de manière excessivement mélodramatique : le personnage de Churchill, presque seul contre tous est plongé dans le doute, à un point où il semble prêt de basculer, avant de repartir à la conquête de l'opinion. De la même manière, on ne comprend pas bien comment le roi a changé d'avis, ni comment Churchill a retourné une partie de la Chambre des Communes.
Cela ressemble trop souvent à une enluminure, avec des longueurs et, paradoxalement, des raccourcis historiques malvenus. (La vision des Français est caricaturale et je laisse les spectateurs de Dunkerque juger de l'évocation de l'opération Dynamo...). C'est de surcroît trop complaisant vis-à-vis de l'élite aristocratique britannique. Et que dire de ces acteurs qui prennent la pose ! La caméra s'attarde trop souvent de manière emphatique. Ah, pour sûr, on a remarqué qu'untel a soudainement levé le sourcil ou que tel autre a fermé les yeux quand il a senti venue sa défaite politique. Quant à la séquence dans le métro, si elle commence de manière tonique, elle s'enlise assez vite dans une sorte de politiquement correct meringué.
Bref, en dépit de quelques qualités perceptibles à l'écran, c'est une déception.
21:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 12 janvier 2018
La Promesse de l'aube
C'est l'adaptation de l’œuvre autobiographique de Romain Gary, pseudonyme de Romain Kacew, né dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Vilnius, emmené par sa mère en France dans l'Entre-deux-guerres. Le film balance entre ses deux personnages principaux, la mère occupant le devant de la scène dans la première partie, la seconde étant davantage centrée sur le fils. Mais c'est la relation œdipienne entre les deux qui est au cœur de l'intrigue.
Charlotte Gainsbourg incarne avec talent cette mère juive (qui prie dans une église orthodoxe !), à la fois possessive et ambitieuse pour son fils. L'actrice a acquis une démarche et un accent qui contribuent à renforcer l'authenticité de son personnage, d'autant plus qu'elle s'est révélée crédible lorsqu'elle parle polonais. Aux spectateurs juifs comme aux non-juifs, elle rappellera bien des mamans, parfois excessives dans la manifestation de leur amour.
Le début, en Lituanie polonaise (ou en Pologne lituanienne, c'est selon), est réussi parce qu'il ressuscite une ambiance et une époque aujourd'hui révolues. On perçoit bien les tensions intercommunautaires, tout comme la rage de réussir de Nina (la mère), qui ne recule pas devant l'escroquerie pour s'en sortir. Du côté des enfants, je n'ai pas été très convaincu par celui qui incarne Gary jeune. Par contre, les petits Polonais catholiques sont très bien campés. Du côté des guests, on peut signaler Didier Bourdon (partie 1) et Jean-Pierre Darroussin (partie 2), dans des rôles toutefois un peu stéréotypés.
L'histoire prend de l'ampleur quand le garçon grandit (à Nice, puis à Paris), qu'il commence à s'émanciper (un peu) de sa mère... et à regarder sous les jupes des filles. Son passage par l'armée lui apprend que les préjugés antisémites ne sont pas le privilège des seuls Polonais. La Seconde guerre mondiale constitue évidemment un tournant, le jeune homme devenant enfin un écrivain... mais aussi un héros de l'aviation. Cela nous vaut quelques scènes bien troussées, comme celles qui se déroulent dans le ciel... mais aussi celles qui ont pour cadre l'Afrique.
Même si la mise en scène recourt à quelques facilités c'est un spectacle de qualité, assez prenant.
23:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 26 décembre 2017
Qui était Fernand Forestier ?
Ceux qui l'ignoraient ont pu l'apprendre récemment en lisant la presse aveyronnaise, tout d'abord La Dépêche du Midi, avec un article publié il y a une dizaine de jours, article repris presque mot pour mot avant-hier dans Centre Presse :
Originaire du Bassin (plus précisément d'Auzits, ce qui explique la diligence de La Dépêche), il est devenu gendarme. On remarque qu'il a officié en Tunisie avant d'être nommé dans le Lot, à Figeac. Ce n'est d'ailleurs pas très loin de là qu'il a été fusillé le 8 juin 1944 : à Gramat, selon la fiche (hélas entachée d'une faute) disponible sur le site "mémoire des hommes" :
C'est dans La Dépêche que l'on peut trouver la plus grande précision quant aux auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à Fernand Forestier : ce sont des membres de la tristement célèbre division SS "Das Reich", qui, le lendemain, frappait à Tulle, avant de se déchaîner à Oradour-sur-Glane.
Pour les habitants d'Auzits, ce gendarme résistant n'est pas un inconnu, puisque son nom figure sur le monument aux morts de la commune :
Pour la petite histoire, signalons que ledit monument a été conçu par un architecte qui avait pignon sur rue à l'époque : André Boyer. On lui doit aussi les monuments de Bertholène, Buzeins et Recoules-Prévinquières. A Rodez, il est connu pour avoir donné sa physionomie actuelle au Broussy... et pour avoir projeté de transformer la zone du Foirail, entre la place d'Armes et la gare de Paraire.
18:43 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, actualité, presse, médias, journalisme
samedi, 16 décembre 2017
Les Gardiennes
Xavier Beauvois (Des Hommes et des Dieux) s'est décidé à adapter, à sa manière, le roman éponyme d'Ernest Pérochon (paru en 1924). Il a le mérite de mettre au premier plan ce que, pendant la Première guerre mondiale, on appelait "l'arrière". Cette histoire est donc celle des femmes qui, dans les campagnes, ont fait "tourner la boutique" pendant que les hommes étaient au front, ne pouvant s'appuyer que sur les vieillards, les enfants et les soldats en permission.
Ces femmes de tout âge (de la gamine en chaussettes à la veuve vêtue de noir) sont incarnées par une pléiade d'actrices talentueuses. On a, avec raison, souligné la performance de Nathalie Baye (formidable). On a un peu moins parlé de la révélation de ce film, Iris Bry, totalement inconnue, mais qui irradie aussi bien dans les scènes d'intérieur que dans les prises de vue extérieures. Cette orpheline, placée chez des patrons successifs, va se révéler une excellente fermière... et elle possède un joli filet de voix !
Je suis par contre moins convaincu par Laura Smet, qui n'a vraiment pas la tête d'une paysanne... non pas qu'elle doive être laide ou grossière, mais on sent trop la citadine. Même si je comprends le choix de la distribution (réunir la mère et la fille dans une histoire familiale), je trouve que cela n'apporte rien au film.
Celui-ci revêt souvent un aspect documentaire. On suit les travaux et les jours, dans cette grosse exploitation où les femmes triment du matin au soir. Ainsi, à l'époque, il faut avoir les bras solides pour tenir la charrue tirée par les boeufs. L'essentiel des travaux se fait à la main, y compris la moisson, le seul outil étant à la faucille (et le fléau, pour le battage). L'intrigue s'étendant sur plusieurs années (de 1915 à 1920), on voit débarquer les premières machines : la moissonneuse-lieuse McCormick (tirée par les boeufs) et un tracteur (rudimentaire) Ford (sous la marque Fordson). Heureusement, à cette époque, dans les campagnes, on se serrait un peu les coudes. Mais le film est assez subtil pour nous faire entrevoir les jalousies.
L'amour va se greffer sur cette histoire pleine de deuils. L'un des hommes de la maison est l'objet de convoitises... tout comme, à partir de la fin de 1917, les jeunes et vigoureux soldats américains venus au secours des Français. Cela donne un tour sensuel à certaines scènes.
Le principal défaut du film est son rythme, très lent. A trop vouloir restituer le mode de vie rural, Beauvois peine parfois à se débarrasser de l'accessoire. Il s'attarde aussi un peu trop sur certains plans. Cela n'enlève rien aux qualités mentionnées plus haut, mais cela creuse un fossé entre ce qui reste un bon film et ce qui aurait pu être un chef-d'oeuvre.
21:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 28 novembre 2017
Les Conquérantes
Ce film suisse évoque le combat des femmes pour l'obtention du droit de vote... et de plus de respect au quotidien de la part des hommes. Le début des années 1970 est une époque de remise en cause, chez nos voisins alpins comme ailleurs. Les spectateurs qui ont un peu de kilomètres au compteur retrouveront dans cette Suisse rurale et patriarcale un peu de la France des années 1970-1980, à ceci près que, dans l'Hexagone, c'est depuis 1944 que les femmes peuvent voter.
Cela aurait pu donner un film pesant, militant, poussiéreux. Ce n'est heureusement rien de tout cela. C'est évidemment engagé, mais furieusement drôle, malgré la gravité des situations. Il y a d'abord le contraste entre ces femmes de la campagne, soumises bien qu'enragées de leur condition de bonnes à tout faire, et les jeunes qui ne veulent pas de la même vie de leur mère. Il y a aussi la beaufitude ridicule de certains hommes, vraiment pas subtils. Il y a enfin l'irruption de la révolution sexuelle, dans une scène hilarante au cours de laquelle des femmes revendiquent le mot "clitoris" et découvrent, pour certaines d'entre elles, qu'elles ont un tigre dans le moteur...
On suit plus particulièrement l'évolution de Nora, une timide femme au foyer qui doit se fader un beau-père acariâtre, deux fils égocentriques et un mari gentil mais très sensible au qu'en-dira-t-on. L'une des scènes du début la montre pédalant à vélo, dans l'un des rares moments de totale liberté dont elle jouit. Le déclic est la révolte de sa nièce, dont Nora ne supporte pas la répression. Dans le même temps, elle suit les débats sur le référendum portant sur le droit de vote... et elle se dit qu'elle pourrait reprendre un travail.
Cela fait beaucoup pour son mari Hans, un beau garçon maladroit qui ne l'a jamais fait jouir. Travailleur consciencieux, il est sur le point de bénéficier d'une promotion dans la scierie dirigée par une vieille bique ultraconservatrice. Son départ pour le service militaire va donner des ailes à Nora... et bouleverser le village.
L'héroïne va trouver des alliées : une retraitée à moitié sénile mais audacieuse, une restauratrice d'origine italienne de moeurs très libres et même sa belle-soeur, lassée d'un mari décevant.
Cela donne un ensemble instructif et très plaisant, toujours d'actualité à une époque où l'obscurantisme est loin d'avoir disparu.
vendredi, 10 novembre 2017
Dans un recoin de ce monde
Ce film d'animation japonais est l'oeuvre de Sunao Katabushi, qui a auparavant travaillé pour des studios prestigieux. Ici, il adapte le manga éponyme, créé par une dessinatrice née à Hiroshima, Fumiyo Kono. La particularité de cette histoire est que l'héroïne est une jeune femme d'Hiroshima, douée pour le dessin et dont nous allons suivre la vie dans les années 1930-1940.
Au départ, j'ai trouvé le dessin un peu naïf et pas particulièrement brillant. C'était trompeur. Certaines scènes voient le brio de l'auteur éclater, comme quand il montre l'héroïne en train de dessiner. Sous nos yeux, l'animation prend forme, avec une précision déconcertante. Superbes aussi sont les scènes décrivant la manière dont l'observation de la nature inspire la jeune dessinatrice.
L'intrigue nous conduit à suivre l'histoire japonaise à travers le regard de l'adolescente qui devient femme. Elle est bientôt mariée (sans qu'on lui demande trop son avis) au fils d'une famille de Kure, une grande ville proche d'Hiroshima et qui constitue la principale base navale de la mer Intérieure.
La militarisation du Japon et son entrée en guerre (d'abord contre la Chine, puis contre les Etats-Unis) nous sont montrées par les yeux d'une épouse soumise et travailleuse... qui ne renonce pas toutefois à son passe-temps artistique, d'autant plus que l'époux qu'on lui a choisi se révèle un type attentionné. Délicates sont les scènes qui évoquent l'intimité du couple.
Avec le reste de la belle-famille, les relations ne sont pas toujours faciles, d'autant qu'avec la guerre, la population souffre de pénuries grandissantes. La jeune Suzu va faire son apprentissage de femme au foyer, de belle-fille, de belle-soeur et de voisine. Touchante aussi est sa découverte de la grande ville, au cours d'une sortie qui la voit se perdre dans le quartier des prostituées.
C'est donc moins "engagé" que le Gen d'Hiroshima de Keiji Nakazawa. On n'en perçoit pas moins les échos de la politique japonaise (avec l'intrusion de la redoutable Kempetai) et de la guerre, avec notamment les bombardements de la base navale de Kure, la voisine (et industrielle) Hiroshima semblant curieusement préservée.
Vous vous doutez bien que, petit à petit, le film mène les personnages vers le 6 août 1945. L'explosion est filmée de manière indirecte, mais les conséquences elles sont clairement montrées à l'écran. Cela donne certaines des scènes les plus fortes de ce film, qui n'est pas sans rappeler le récent Lumières d'été.
18:51 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 29 octobre 2017
Au revoir là-haut
Quatre ans après la sortie de 9 mois ferme, j'attendais avec impatience la nouvelle œuvre d'Albert Dupontel. L'an dernier, on l'a vu jouer dans Les Premiers, les Derniers, mais, là, il a adapté l'excellent roman de Pierre Lemaitre (disponible en collection de poche).
Faut-il avoir lu le roman avant d'aller voir le film ? Non, d'autant plus que Dupontel a opéré plusieurs modifications dans l'intrigue et qu'il en a changé la fin. Ne pas avoir lu le roman laisse le plaisir total de la découverte... mais l'avoir lu avant permet d'en savourer mieux l'originalité.
La première est ce grand retour en arrière, sur lequel est bâtie l'histoire. Il n'existe pas dans le roman, dont la trame suit une chronologie classique des événements. L'arrestation d'Albert Dupontel/Maillard est elle aussi une invention scénaristique. L'intrigue (bien que simplifiée par rapport au roman) étant foisonnante, l'ajout du commentaire de l'un des personnages principaux est apparue nécessaire pour faciliter la compréhension des péripéties par le grand public.
Comme l'action débute pendant la Première guerre mondiale, Dupontel se savait attendu au tournant à propos des scènes de tranchées. Il ne déçoit pas, même si cet épisode fondateur est considérablement allégé : le romancier avait beaucoup développé la psychologie des personnages, un aspect que Dupontel n'a conservé que pour celui qu'il incarne !
Ceci dit, les autres personnages principaux sont servis par des interprètes haut de gamme, certains correspondant parfaitement à l'image que je me faisais d'eux en lisant le roman. C'est le cas pour Niels Arestrup (Marcel Péricourt, le père du défiguré), Albert Dupontel, Héloïse Balster (la Gavroche à laquelle l'artiste ancien combattant va s'attacher) et surtout Laurent Lafitte (le rôle du lieutenant -puis capitaine- Pradelle semblant avoir été écrit pour lui). Nahuel Perez Biscayart est une révélation pour moi, dans le rôle de la "gueule cassée". On peut signaler aussi les excellentes compositions de Mélanie Thierry, de Michel Vuillermoz, de Philippe Uchan et d'Emilie Dequenne. Comme les dialogues sont très bien écrits (un peu moins truculents que dans le roman, toutefois), cela nous vaut d'excellents moments de comédie et quelques morceaux de bravoure, en matière de confrontation d'acteurs.
Quand j'y réfléchis, dans presque toutes les scènes majeures intervient Laurent Lafitte. Il y a sa manière de persécuter les poilus, sa rivalité avec Péricourt/Arestrup et sa relation ambiguë avec la fille de celui-ci, qui débouche sur une scène magistrale, dans la chambre à coucher, se concluant par un plan filmé de derrière le lit, la caméra saisissant l'expression de Pradelle à travers les barreaux.
C'est dire si la réalisation est soignée. Dupontel n'abuse pas des effets de caméra, mais c'est souvent brillant, les plans étant visiblement construits avec une extrême minutie, notamment au niveau des déplacements des personnages. Ajoutez à cela une photographie vraiment superbe et vous obtenez une œuvre ambitieuse sur le plan graphique.
Sur le fond, Dupontel reprend la petite musique antimilitariste du roman, ainsi que la dénonciation des puissants. Il y ajoute une dose d'anticléricalisme, particulièrement sensible lors du séjour d'Edouard à l'hôpital militaire. Albert doit se jouer des religieuses pour parvenir à soulager son camarade de combat.
Ensemble, les deux hommes vont monter une arnaque "héneaurme", autour de la fabrication (fictive) de monuments aux morts, pendant que le désormais capitaine Pradelle s'enrichit de son côté grâce à un autre type de fraude, lié à la création des cimetières militaires. (Historiquement, la première est fausse, alors que la seconde s'inspire de faits réels.)
Pour faire tenir son film en deux heures, Dupontel a dû pratiquer quelques coupes (la plupart judicieuses... j'aurais néanmoins aimé qu'il en laisse davantage sur l'affrontement Pradelle-Péricourt). Les changements qu'il a opérés dans la dernière partie de l'histoire sont sans doute liés aux messages qu'il veut faire passer. Dupontel est un moraliste, ce qui permet de comprendre ce qui arrive à l'un des "méchants"... et pourquoi l'arrestation d'Albert prend un tour très inattendu, à la toute fin.
C'est incontestablement l'un des meilleurs films de l'année.
23:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mercredi, 25 octobre 2017
Barry Seal
C'est l'histoire d'un mec, pilote doué, qui s'ennuyait à convoyer des civils dans des avions de ligne, à l'intérieur des Etats-Unis. L'occasion lui est donnée de travailler dans l'intérêt de son pays... et de se faire un max de blé. Le tout n'est pas sans risques, mais, comme le jeune homme est à la recherche de sensations fortes, il ne va pas trop se faire prier.
Tordant quelque peu la réalité des faits, l'intrigue mêle trafic de drogue, lutte anti-communiste et jeux politiques washingtoniens, pour déboucher sur un film d'action drôle et rythmé, presque complètement immoral, mais qui a le mérite de mettre à jour certains aspects de l'interventionnisme états-unien en Amérique latine, au début des années 1980.
Tom Cruise (qui n'en finit plus de rajeunir) incarne avec fougue le jeune pilote qui rêve d'une vie moins conventionnelle. Attention toutefois : s'il va enfreindre quantité de lois, il reste fidèle à son épouse bien aimée (qu'il couvre de cadeaux) et, quand il s'éclate, il boit de l'alcool mais ne consomme pas de cocaïne. C'est qu'il fallait un héros positif à cette histoire remplie de crapules. (Dans la réalité, si Barry Seal était bien un pilote doué -mais pas aussi beau gosse que Cruise, c'était un type foncièrement malhonnête, qui n'a pas eu besoin des agences gouvernementales pour tomber du côté obscur du commerce de marchandises... et sa vie privée fut plus chaotique que ce qui nous est dit.)
Mais, bon, tout cela nous est présenté de manière humoristique, dans un habillage vintage. Ce n'est pas sans rappeler le récent Infiltrator, qui traite d'un sujet très proche. L'un des atouts du film est le choix des retours en arrière, commentés par le "héros". Cela donne davantage de recul à l'histoire.
Celle-ci est drôle parce qu'on y croise une brochette de pieds-nickelés qui vont considérablement s'enrichir en profitant du contexte de Guerre froide. La description de la corruption politique en Amérique centrale vaut aussi son pesant de cacahuètes. Quant aux Contras nicaraguayens, ils sont un peu facilement réduits à une bande de désoeuvrés, surtout attirés par les lunettes de soleil, le whisky et les revues porno que Barry Seal leur apporte pour les amadouer. Ah, le Rêve américain...
Toutes ces facilités passent parce que c'est bien mis en scène. Le réalisateur Doug Liman n'est d'ailleurs pas un inconnu : on lui doit, entre autres, La Mémoire dans la peau et Edge of tomorrow (avec Tom Cruise). Les avions sont très bien filmés... et c'est important, au vu du rôle qu'ils jouent dans l'intrigue. (Dans la réalité comme dans la fiction, ce fut parfois très limite.) J'ai aussi aimé les scènes qui montrent la problématique accumulation de pognon (illégal), qu'on cherche à stocker par tous les moyens possibles (après en avoir déjà beaucoup dépensé). Le réalisateur (tout comme le trafiquant) sait aussi jouer avec les cabines téléphoniques publiques, dont les appels sont à l'époque intraçables. L'un des moments les plus drôles reste celui d'un atterrissage forcé de Barry, qui finit couvert de poudre, dans un quartier défavorisé, s'enfuyant sur un vélo trop petit pour lui !
Voilà. C'est techniquement très bien fait. Mais les aspects négatifs des activités du héros sont atténués voire passés sous silence. On ne nous dit rien des ravages causés par la drogue et on n'a qu'un petit aperçu de la violence dont les trafiquants colombiens étaient capables.
PS
L'histoire se déroule sous les présidences de Jimmy Carter et Ronald Reagan. Mais l'on entend et aperçoit trois autres (futurs) présidents. Ainsi, la procureure de l'Arkansas reçoit un coup de téléphone du gouverneur de l'époque, un certain... Bill Clinton. De son côté, Barry, quand il se retrouve à la Maison Blanche, discute brièvement avec un jeune homme qui lui dit avoir été pilote dans la Garde nationale. Très vite, "Junior" est prié d'entrer dans un bureau, dont on devine qu'il s'agit de celui du vice-président de l'époque, George Bush, son père, accessoirement ancien chef de la CIA et coordonnateur de la lutte anti-drogue...
13:17 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 24 octobre 2017
Les Oubliés
J'avais raté ce film à sa sortie. Il n'était resté qu'une semaine au programme à Rodez, en version française, à des horaires peu compatibles avec mon emploi du temps. Actuellement, il continue à tourner dans quelques cinémas et il est sorti en DVD.
Il raconte l'histoire vraie de soldats allemands (ici des adolescents mobilisés à la fin de la Seconde guerre mondiale), faits prisonniers et envoyés déminer les plages danoises, en 1945. C'est un type de sujet qu'on a évité d'aborder pendant des années : l'armée allemande ayant commis tant de crimes horribles, on n'a pas jugé utile de dénoncer le sort de ces jeunes soldats. Rappelons tout de même que ces mines avaient été posées par l'occupant allemand. Les gamins eux-mêmes avaient subi l'endoctrinement des Jeunesses hitlériennes... et il n'est pas impossible que certains d'entre eux fussent des fils de SS.
Le film pose la question de la responsabilité collective. Alors que les Danois, à l'image de tant de peuples européens, ont souffert à cause des Allemands pendant la guerre, devaient-ils le faire payer aux enfants de ces soldats ?
On leur a confié une tâche délicate et ultra-dangereuse. Ils n'ont reçu qu'une formation express, suffisante toutefois pour effectuer un travail basique, insuffisante quand ils se trouvent face à un dispositif plus élaboré... voire vicieux (une mine en cachant une autre).
Au départ, le sous-officier danois (Roland Møller, vu dans Hijacking, excellent) qui s'occupe d'eux se montre extrêmement dur, déversant sur eux sa haine des Allemands. Mais, petit à petit, il réalise que ce ne sont que des gamins et qu'on fait peser sur leurs épaules une charge qui n'est pas de leur âge. Au fur et à mesure que le temps passe, la petite troupe s'amenuise, amputée de ceux qui périssent dans une explosion. Notons que, si la mise en scène joue avec nos nerfs, elle ne tombe pas dans la facilité. Le réalisateur a voulu éviter que certains événements ne soient trop prévisibles. De la même manière, l'amélioration des relations entre le tuteur danois et la troupe de jeunes démineurs ne suit pas une courbe régulière. Il y a des hauts et des bas.
Je trouve que tous les acteurs sont bons, qu'ils incarnent les Allemands ou les Danois, les civils ou les militaires. Sur un sujet casse-gueule, le réalisateur a construit un film subtil, qui se conclut par un acte d'une grande humanité.
21:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
lundi, 09 octobre 2017
Le Jeune Karl Marx
Méfiez-vous des programmes de présentation : ce film n'est diffusé que dans une seule version, multilingue, puisqu'on y parle (principalement) allemand, (sinon) français et (occasionnellement) anglais. C'est lié à la distribution (internationale) et aux péripéties de la vie du jeune Karl Marx, qui a vadrouillé entre Prusse (rhénane), France, Belgique et Royaume-Uni.
Il est incarné par un très bon acteur allemand, August Diehl, qu'on a récemment pu voir dans En mai, fais ce qu'il te plaît et Diamant noir. Je suis moins convaincu par Stefan Konarske en Friedrich Engels, un rôle certes difficile, puisque c'est un fils à papa qui va se révéler très sensible à la cause ouvrière.
Le film mérite aussi le détour pour les interprètes féminines, en particulier Vicky Krieps (vue dans Colonia) en Jenny Marx et Hannah Steele en Mary Burns, la compagne d'Engels. Subrepticement, le film montre que nos esprits (masculins) rebelles ont encore du chemin à faire, puisque, dans leurs rapports aux femmes, ils se révèlent des mecs comme les autres... et encore, le film n'ose suggérer que Marx a engrossé la bonne de la famille, comme n'importe quel bourgeois phallocrate !
La fin des années 1840, sur laquelle se concentre le film, est celle des révélations pour le duo Marx-Engels, qui va se constituer et, au contact l'un de l'autre, affiner sa pensée. Ils vont notamment se démarquer de Proudhon (Olivier Gourmet, excellent) et de Bakounine, tout en récupérant le mouvement socialiste prophétique anglais. Pour que le tableau soit complet, il nous manque les "socialistes utopiques" (sans doute caricaturés par la catégorie précédente), qui ont hélas été oubliés dans l'histoire de la gauche contestataire, alors que les doctrinaires souvent sectaires tiennent encore aujourd'hui le haut du pavé.
Quant à la classe ouvrière, elle fait l'objet d'assez peu d'attention dans le film. Le début est chargé de nous montrer la difficile condition des employées du textile, mais, à l'image du personnage d'Engels, le réalisateur et le scénariste n'en ont qu'une connaissance externe, limite intellectualisée. Du coup, le film perd beaucoup en force, d'autant plus qu'il manque de rythme. Cela m'a un peu fait l'impression d'une collection de vignettes, plutôt destinée à des intellos. Le capitalisme sans foi ni loi a encore de beaux jours devant lui, vu la maladresse de ceux qui le critiquent...
21:36 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 08 octobre 2017
L'affaire Fualdès, le sang et la rumeur
Jusqu'au 31 décembre 2017, le musée Fenaille de Rodez propose une passionnante exposition consacrée à un fait divers qui a défrayé la chronique il y a 200 ans, en Aveyron bien sûr, mais aussi au plan national et même international.
Dès le vestibule, on est accueilli par la reproduction d'une gravure datant sans doute de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. On y découvre une vue d'un Rodez exigu (peuplé à l'époque de seulement 6 500 habitants), entouré d'espace rural, en particulier sur les pentes aujourd'hui presque intégralement bâties.
De là, on pénètre dans la première salle, consacrée au crime en lui-même. On nous présente Antoine-Bernardin Fualdès, ancien révolutionnaire ardent devenu bonapartiste et procureur impérial au criminel. C'est dire qu'il a dû se faire des ennemis dans le passé, d'autant plus qu'il est franc-maçon (de tendance antimonarchique), une étiquette délicate à porter en 1817, au début de la Restauration, juste après la Terreur blanche.
Le mystère plane toujours sur ce qui s'est passé le soir de ce 19 mars 1817. Vers 20 heures, Fualdès a quitté son domicile ( 1 aujourd'hui situé au début de la rue de Bonald, où l'on peut encore voir la porte d'origine, qui a été légèrement reculée par rapport à la rue, sans doute pour ménager un abri). Il faisait sombre à Rodez, mais le cafetier voisin (2) a reconnu l'ancien procureur parti se promener, une serviette de documents sous le bras, semble-t-il. Au bout de la place de la cité, il a tourné à droite, rue Terral (3). A partir de là, les versions divergent.
L'enquête (bâclée) et la rumeur publique ont très tôt désigné la maison Bancal (4) comme étant le lieu du crime. N'a-t-on pas retrouvé à proximité de celle-ci, rue des Hebdomadiers (aujourd'hui rue Séguy) un mouchoir qui ne peut qu'avoir servi de bâillon ? N'a-t-on pas retrouvé la canne de Fualdès à peine plus loin, rue Terral ? Dans la salle du musée sont proposés plusieurs plans d'époque, ainsi qu'une carte postale du tout début du XXe siècle, permettant de localiser les principaux endroits liés (de manière réelle ou supposée) au crime. Notons que la mairie de Rodez avait fait imprimer l'un de ces plans, dont la vente devait servir à soulager les nécessiteux de la commune.
Le corps de Fualdès ayant été retrouvé en contrebas de la ville, sur les berges de l'Aveyron, à Layoule, aux confins de Rodez et du Monastère, les imaginations se sont déchaînées sur la manière dont le corps y avait été transporté. Contrairement à ce qu'un esprit contemporain pourrait croire, ce n'est pas le chemin le plus court qui a été emprunté. Celui-ci traversait une partie de la cité (la partie Nord), où, le soir, le moindre bruit est susceptible d'éveiller l'attention.
Les assassins (car ils étaient sans doute plusieurs) ont sans doute transporté Fualdès (vivant ou mort) en longeant les remparts de la cité. Ils seraient sortis par la porte Saint-Martial qui, à l'époque, faisait le lien entre l'évêché et la cathédrale. Une fois à l 'extérieur, il y avait peu de chances qu'ils soient dérangés, la zone étant quasi inhabitée... et peu fréquentée le soir.
(gravure présentant une vue de la place d'Armes à la fin du XVIIIe siècle)
La deuxième partie de la première salle propose divers objets en lien avec l'affaire : une reconstitution des vêtements que portait Fualdès ce soir-là, la mise en scène du crime, telle que la version officielle l'a transmise, une vielle comme celle dont devaient jouer les musiciens présents en cette période de foire... et une maquette de la désormais fameuse maison Bancal, réalisée en 1820 par David Niépce. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu : il s'agit du cousin de Nicéphore, l'inventeur de la photographie. Officier des dragons, il s'ennuyait un peu dans le chef-lieu aveyronnais. Et puis cette maison suscitait une telle curiosité... à tel point que les gens y venaient en nombre, prêts à payer pour la visiter. Curiosité supplémentaire : la maquette a été conçue de manière à ce qu'une partie soit amovible, dévoilant l'espace intérieur, minutieusement reconstitué.
L'engouement pour ce fait divers fait l'objet de la deuxième salle, consacrée aux productions de l'époque, particulièrement des années 1817-1818. Aujourd'hui, on dirait que l'affaire "a fait le buzz"... sauf qu'alors n'existent ni internet, ni la télévision, ni la radio, ni le téléphone... C'est donc par les illustrations et les écrits que les informations (les fausses comme les vraies) ont été véhiculées. C'est l'âge d'or de la lithographie, de nombreuses étant exposées dans le musée. Des peintres se sont même déplacés pour faire le portrait des principaux protagonistes, pour la plupart des gens du peuple, dont la renommée va désormais égaler (temporairement) celle des puissants. L'histoire de ce meurtre a donné lieu à des productions théâtrales... et même à la création d'un "cabinet de cire", où a été reconstitué la scène du crime, telle que la rumeur l'a propagée.
Au niveau des écrits,il y a profusion d'édition de feuilles volantes. Pour les plus fortunés, on publie les actes des procès. L'essentiel est publié par la presse, locale comme nationale, puisque des journalistes parisiens ont fait le déplacement. L'un d'entre eux, Hyacinthe Thabaud, a visiblement été traumatisé par Rodez, une ville sombre, peuplée de chauve-souris et de porcs en liberté...
L'une des publications les plus célèbres est les Mémoires de Clarisse Manzon, la fille d'un juge ruthénois, une mythomane qui va précipiter la chute de certains des accusés. Ce livre a été réédité à de nombreuses reprises et même traduit (en anglais, danois...). On a ainsi entendu parler de l'affaire Fualdès dans toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis !
La troisième salle fait le point sur les suites judiciaires, ainsi que sur les zones d'ombre. Plusieurs hypothèses sont évoquées quant aux véritables causes de la mort de Fualdès. Rappelons tout d'abord qu'il y eut trois procès, le premier (celui de Rodez), ayant été cassé pour un vice de forme. Les deux suivants ont eu lieu à Albi, le troisième étant en quelque sorte la queue de comète du deuxième. Voilà pourquoi les trois condamnés à mort ont été exécutés en terre albigeoise, le 3 juin 1818. D'autres accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité, d'autres à des peines plus légères. Quelques-uns ont été acquittés.
Dans cette salle, il est question des mensonges et omissions dans lesquels l'affaire a été engluée. Aucun meurtre n'a été commis dans la maison Bancal, dont les enfants ont pu imaginer un récit fantasmagorique, sans cesse renouvelé, sans susciter le scepticisme des enquêteurs. C'est à l'image de la majorité des témoins (plus de 300 lors des deux premiers procès), comme ce meunier qui, sur son lit de mort, a fini par reconnaître qu'il avait tout inventé pour pouvoir voir du pays ! Le summum est peut-être atteint avec ces lettres anonymes de menace, reçues par Clarisse Manzon... qui se les était envoyées elle-même !
Et encore, l'exposition ne dit pas tout. La lecture de l'excellent catalogue (issu notamment d'un gros travail de fond de Jacques Miquel) nous en apprend d'autres. Je pense à ces témoins à décharge qu'on a tenté de faire revenir sur leurs déclarations, où ceux dont on a totalement négligé les paroles. Parmi eux, il y a ce réfugié espagnol, ancien juge, qui logeait juste au-dessus des Bancal (et donc du lieu présumé du crime)... et qui n'a rien entendu d'inhabituel ce soir-là, tout comme le voisin des Bancal, qui était un ami de Fualdès ! On a aussi "perdu" ces pierres tachées de sang, découvertes à Layoule, ce qui tendait à prouver que c'est là que le meurtre avait été perpétré, et non dans la maison Bancal.
Et puis, il y a ces "liaisons coupables", ces attaches familiales qui unissent les notables royalistes de Rodez et de ses alentours à de prestigieuses familles françaises (comme celle de Decazes). Une hypothèse tient la corde (sans être la seule envisageable), celle d'une vengeance des Chevaliers de la Foi, cette conjuration qui a tenté de remettre Louis XVIII sur le trône, en 1814, et qui a échoué notamment à cause du procureur impérial Fualdès. La bande de royalistes a commis bien des méfaits, qui n'ont jamais été sanctionnés par une condamnation en justice. Quant au procureur et à l'officier de gendarmerie chargés de l'affaire en 1817, il ont été ensuite rapidement décorés de la légion d'honneur... Ils avaient sans doute bien mérité de la Patrie !
PS
Sur le site du musée Fenaille, on peut accéder à un très bon web-documentaire.
PS II
On peut aussi, sur la Toile (ré)écouter des émissions radiophoniques (de RTL et France Inter) qui ont été consacrées à l'affaire.
PS III
Enfin, ne partez pas du musée sans réclamer la reproduction du plan d'époque de la cité de Rodez. (C'est gratuit.) Il est annoté de manière à faciliter la déambulation dans les rues de la ville, tout en suivant l'affaire Fualdès.
17:06 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, société, actualité, culture
mercredi, 04 octobre 2017
Confident Royal
Opération My taylor is rich aujourd'hui, avec le nouveau film de Stephen Frears, en version originale sous-titrée à Rodez ! Ces derniers temps, le cinéma britannique aime à revisiter les moments marquants du passé national (antérieurs à l'adhésion à la CEE...). En juin dernier, on a pu voir un Churchill compatissant au sort des soldats participant au débarquement de Normandie. En juillet, c'est le stoïcisme et le sens du devoir des tommies en 1940 qui fut à l'honneur dans Dunkerque. On a aussi eu droit à l'abnégation du couple Mountbatten dans Le Dernier Vice-Roi des Indes.
Le récent auteur de Florence Foster Jenkins s'est attaqué à un autre monument national, la reine Victoria (vieillissante), remarquablement interprétée par Judi Dench, qui retrouve ainsi le réalisateur de Philomena. Dans le rôle principal, l'actrice assume ses rides et ses dents manquantes, pour composer un formidable portrait de la souveraine, à la fois protégée et corsetée par l'étiquette de la cour. C'est l'occasion de découvrir une brochette de seconds rôles bien campés, entre vieilles badernes et culs pincés, le tout sur fond d'ambitions personnelles.
L'arrivée de serviteurs indiens musulmans va mettre le feu aux poudres. On a un peu rapidement présenté cette histoire comme une totale révélation, issue de la découverte des carnets de l'ancien favori de la reine, en 2010. En réalité, des historiens spécialisés avaient déjà évoqué la chose (certes sans y consacrer un livre entier). En français, une biographie de Victoria datant de l'an 2000 (et signée Roland Marx) consacrait un peu moins d'une demi-page à la petite révolution de cour qui agita le microcosme à l'extrême fin du XIXe siècle.
C'est donc un film orienté (à l'image des récentes productions historiques britanniques), tout à la gloire de la reine, très dur pour "Bertie" (le futur Édouard VII) qui pourtant, une fois devenu roi, engagea le rapprochement avec la France, qui mena à la signature de l'Entente Cordiale. Un autre personnage subit un traitement (à mon avis) injuste : Lady Churchill (la maman de Winston, une Américaine qui a des ancêtres... français), présentée comme une intrigante revêche... sans qu'on ose préciser qu'elle fut (entre autres) l'une des (nombreuses) maîtresses du futur Édouard VII.
Le début est assez drôle, avec la découverte d'une reine gourmande, pas très propre à table et dont le médecin s'enquiert de la qualité des selles... La rencontre avec l'Indien Abdul est aussi assez comique, avec, au centre de l'attention, un de ces horribles desserts à la gelée dans lequel je n'ai pas pu m'empêcher de voir des allusions sexuelles.
La suite est hélas plus plan-plan, manquant de rythme, malgré la qualité de l'interprétation. (Je recommande tout particulièrement la déclaration que Judi/Victoria assène, en gros plan, à un trio d'emmerdeurs masculins dans son bureau.) A voir si l'on se pique d'anglomanie, ou si l'on peut se contenter de suivre les évolutions de Judi Dench à l'écran.
PS
C'est la deuxième fois que Stephen Frears gâche un splendide matériau. Il y a une dizaine d'années, la performance d'Helen Mirren (Elizabeth II dans The Queen) n'avait été que médiocrement servie par un film décevant.
22:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 24 août 2017
Lumières d'été
Jean-Gabriel Périot (auquel on doit le médiocre Une Jeunesse allemande) mêle ici fiction et documentaire pour parler d'Hiroshima et de ses conséquences.
Dans la salle où j'ai vu le film, il était précédé d'un court-métrage du même auteur, 200 000 fantômes, constitué d'un diaporama construit à partir de la superposition de vues du Dôme de Genbaku, le seul bâtiment resté debout au niveau de l'épicentre de l'explosion atomique. En fond sonore, on entend un poème dit en anglais (et non traduit). Le concept de base est intéressant, mais le résultat manque de lisibilité. Les images défilent trop vite et pas dans un ordre strictement chronologique. On comprend quand même que les vues présentent le Dôme avant l'explosion, juste après et dans les phases de reconstruction de la ville.
Le film en lui-même démarre ensuite, par une séquence dont tout le monde a parlé : le témoignage d'une hibakusha, une rescapée de l'explosion atomique. J'ai beau avoir beaucoup lu et vu sur le sujet, j'ai été saisi par les paroles de cette vieille femme digne. J'ai repensé au formidable manga Gen d'Hiroshima, dont l'auteur Keiji Nakazawa était (il est mort en 2012) un autre rescapé du bombardement. Cette séquence est d'autant plus réussie que le témoin est... une actrice.
Le réalisateur du documentaire, un Japonais qui vit à Paris, sort quelque peu bouleversé de cet entretien. Il se trouve dans le parc de la Paix lorsqu'il fait une curieuse rencontre : Michiko, une jeune femme en kimono, délicieusement désuète, qui semble en savoir beaucoup sur la ville d'Hiroshima et les conséquences de l'explosion atomique. Voilà qu'on nous embarque dans une déambulation romantique, à pieds, en train, en ville, au bord de la mer. On assiste à une partie de pêche, un repas entre amis, une cérémonie en l'honneur des ancêtres et un concours de lueurs. Même si on comprend assez vite qui est la jeune femme, c'est assez inattendu, plein de délicatesse et de poésie, culminant dans une scène de chant indescriptible.
Certains critiques ont beau faire la fine bouche, j'ai été très touché par cette histoire, portée par deux actrices formidables : Mamako Yoneyama et Akane Tatsukawa.
23:12 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire