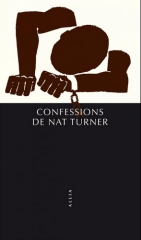mardi, 28 mars 2017
Alibi.com
Philippe Lacheau (auquel on doit notamment Babysitting) revient avec ses acteurs fétiches (lui-même, mais aussi Julien Arruti, Tarek Boudali, Vincent Desagnat, Elodie Fontan), ainsi qu'une brochette d'invités assez savoureux, parmi lesquels je distingue Philippe Duquesne (un habitué), Kad Merad et surtout Chantal Ladesou, dont le numéro de vétérinaire mérite à lui seul le détour.
C'est la même recette que dans les précédents films du réalisateur : marier l'ancien et le moderne, la comédie traditionnelle à la française et l'humour graveleux (pas toujours très fin) venu d'outre-Atlantique. La jeune scène comique française (représentée par Nawell Madani, une ancienne du Jamel Comedy Club) rencontre de vieux routiers comme Didier Bourdon et Nathalie Baye (celle-ci bien meilleure que celui-là).
L'histoire démarre sur les chapeaux de roues avec ces exemples de clients dissimulateurs qui ont recouru aux services de l'agence dirigée par le héros Greg, jeune patron mais vieux célibataire. Bien entendu, il va craquer pour la non moins endurcie (et séduisante) Flo... mais dont le père infidèle est le tout dernier client d'Alibi.com...
Entre mensonges, dissimulation et quiproquos, la suite embraye sur un excellent rythme. On découvre pourquoi le portrait de la mère de Flo est régulièrement trouvé de biais. On apprend comment simuler un selfie avec un faux zèbre... et l'on réalise, si besoin était, à quel point il peut être dangereux de s'en prendre à la communauté des gens du voyage... Mais mon préféré est sans conteste le combat de sabres-lasers tubes de néon (à l'intérieur d'une caravane en mouvement !), auquel répond, un peu plus tard, un son caractéristique émis par un malade sous assistance respiratoire...
La technique de l'imbroglio est éprouvée, mais elle fonctionne. Ici ou là, on peut voir quelques clins d’œil aux "comédies de papa". Ainsi, le périple de Nathalie Baye et Didier Bourdon en voiturette n'est pas sans rappeler de mémorables scènes des Gendarmes (avec De Funès/Cruchot et soeur Clotilde, interprétée par l'inoubliable France Rumilly). Du côté de l'humour djeunse, scabreux, on note le rôle des animaux de compagnie, parfois à leur corps défendant. Toutefois, si le chien passe brutalement du statut de compagnon à celui de ballon de football, le chat fait bien comprendre à deux automobilistes que c'est lui le patron... au besoin en s'en prenant aux parties intimes de leur anatomie...
C'est vrai que, parfois, c'est un peu facile et vulgos, mais j'ai été emporté par le rythme et le culot de cette histoire. On retrouve aussi le soin d'insérer de bonnes scènes d'action (autour des véhicules). Le film s'achève sur une pépite : une parodie de chanson de R'N'B, aux paroles d'une affligeante bêtise.
22:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Grave
C'est l'un des événements cinématographiques de ce trimestre. Il s'agit d'un premier long-métrage de fiction, qui a pour cadre une école vétérinaire et le bizutage d'une promotion au sein de laquelle figure l'héroïne Justine, fille de vétos, dont la soeur aînée est déjà présente dans les locaux.
Je conseille d'être très attentif à la scène du début, qu'on ne comprend pas bien dans l'immédiat, mais qui prend tout son sens par la suite.
De là on passe au bizutage des reçus du dernier concours. Justine est une jeune fille sage, genre première de la classe, végétarienne jusqu'à l'excès... tout comme ses parents (Laurent Lucas, très bien), qui nous sont présentés comme formant un couple de bobos. Certaines des scènes ont de quoi rebuter les âmes sensibles, entre le sang versé sur la tête des bizuts et les choses suspectes qu'on leur fait avaler. S'ajoutent à cela les réveils nocturnes, la mise à sac des chambres et la consommation obligatoire d'alcools forts. Cette partie a l'immense avantage de nous faire percevoir ce que peut être un régime fasciste en formation, le tout avec une autosatisfaction confondante de la part des abrutis anciens.
A ma grande surprise, le coeur de l'intrigue est occupé par la relation trouble entre les deux soeurs. Tour à tour, chacune prend l'avantage sur l'autre... et on ne voit pas tout venir, même si l'on est parfois à deux doigts (un doigt ?) de tout comprendre. Les avanies subies par Justine vont avoir des conséquences insoupçonnées.
Côté macabre, on ne nous épargne pas grand chose, entre le surgissement d'un eczéma très envahissant, le vomi, le sang, les morsures, le sexe "agité"... et la première épilation d'une foufoune. Cela m'a un peu rappelé certaines oeuvres de Peter Greenaway (comme Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant), en moins apprêté. L'ambiance n'est pas sans évoquer aussi le récent White God.
Les actrices principales sont très engagées dans leur rôle. J'attribue une mention spéciale à Garance Marillier, qui réussit à faire croire à toutes les facettes de son personnage, aussi bien la jeune femme coincée que la rebelle perturbée (mais qui prend de l'assurance) ou encore la demi-dingue qui part en vrille.
Notons que la musique n'est pas omniprésente. Elle est assez fascinante et bien dosée. Elle accompagne efficacement une mise en scène qui, pour être discrète, n'en est pas moins extrêmement soignée. Si les soirées murge sont filmées de manière assez classique, les tensions qui rongent l'héroïne sont très bien rendues, tout comme les rapports de force entre les personnages, traduits par l'angle des prises de vue et les mouvements de caméra.
Cela donne un film tendu, brillant, parfois d'une mordante drôlerie, très au-dessus de la moyenne des productions françaises contemporaines. Sa réalisatrice, Julia Ducournau, est à suivre.
P.S.
Une révélation finale vient donner une profondeur supplémentaire à l'histoire, ce qui nous incite à revoir certaines scènes du début sous un autre jour.
00:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 25 mars 2017
Le Concours
La documentariste Claire Simon est revenue se plonger dans la Fémis (dont elle a naguère dirigé le département réalisation), plus précisément au moment du concours de recrutement... des concours devrais-je dire, puisque les candidats postulent à l'un des sept "départements" (réalisation, scénario, production, image, son, montage et décor), lorsqu'ils présentent ce que l'on appelle le "concours général". Vu le profil de certaines personnes filmées, je pense qu'on peut y ajouter le "concours international" (qui ne recrute qu'en réalisation, scénario et montage).
Environ mille personnes ont brigué l'une des quelque 60 places mises au concours. Il n'était évidemment pas question de nous présenter l'intégralité des futurs reçus (à supposer que, candidats, ils aient accepté de se laisser filmer pendant les oraux), encore moins un panorama représentatif de l'ensemble des postulants. Qui plus est, pour "donner sa chance" (à l'écran) à chacun d'entre eux, il fallait monter des séquences assez longues, ce qui a limité le nombre de profils. Ajoutez à cela la volonté de montrer les jurys au travail, face aux candidats et hors de leur présence, et vous aurez une idée de l'ampleur de la tâche que la réalisatrice s'était confiée.
Résultat ? Un film long, très instructif (pas toujours à l'avantage de l'école, d'ailleurs), regorgeant de pépites, mais parfois ennuyeux. On suit le parcours des candidats, des premiers écrits (avec projection d'un extrait de Shokuzai) aux résultats des oraux d'admission. Au niveau des oraux "techniques" (il s'agit d'entretiens portant sur des productions, écrites ou non, des candidats), je pense que la plupart des spectateurs ne peuvent pas saisir toutes les subtilités sans connaître un peu le fond, tel qu'il est décrit dans le rapport 2014.
Sinon, on peut s'intéresser à la personnalité des candidats. Ils sont d'une assez grande diversité (de tempérament), certain-e-s attachant-e-s, d'autres agaçant-e-s... tout comme les membres des jurys. (Amis rouergats : une candidate semble être originaire de l'Aveyron, puisqu'elle appuie sa candidature sur un stage effectué à Millau. Son enthousiasme et sa fraîcheur vont séduire une partie du jury.) Leurs discussions sont animées... et l'on sent poindre, de temps à autre, leurs préjugés. De ce pont de vue, la réalisatrice n'a pas cherché à filmer une enluminure.
Qu'en conclure ? Que de belles personnes présentent ce concours. Que les métiers auxquels forme la Fémis sont plus variés qu'on ne le pense. Que les membres des jurys sont parfois un peu trop représentatifs du petit monde nombriliste du cinéma français. Mon principal regret est que, finalement, il soit assez peu question de cinéma vécu dans ce documentaire.
10:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 23 mars 2017
Kong : Skull Island
Moins de douze ans après la version de Peter Jackson, revoilà le gros gorille sur les écrans, dans une histoire reformatée pour s'insérer dans une trilogie (inaugurée par le dernier Godzilla, dont l'action se déroule pourtant après celle de ce film... ne partez surtout pas avant la fin du générique).
D'un point de vue scénaristique, j'ai apprécié que l'on fasse débuter l'intrigue vers la fin de la Seconde guerre mondiale et qu'on la fasse rebondir pendant le conflit vietnamien. Cela nous vaut une belle séquence introductive, un peu comique, et qui nous donne l'eau à la bouche. (Un peu plus tard, on se rend compte que l'impression transmise par cette séquence est volontairement trompeuse.)
Comme dans beaucoup de films de ce genre, on va suivre une troupe hétéroclite, où se côtoient militaires, scientifiques, aventuriers, des lâches comme des héros, des gens sensés comme de vrais dingues. Petit à petit, leurs défauts vont se révéler... et ils vont faire plein de bêtises.
La première est de se rendre sur cette "île du crâne", dont le sous-sol regorge de surprises. La seconde est d'y balancer des joujoux explosifs qui vont réveiller de dangereuses bébêtes... et mettre le roi des Kongs de mauvaise humeur. (Ce pitoyable calembour m'a été imposé par la Guilde des Blogueurs Amateurs de Jeux de Mots Faciles.)
Bref, si le déroulement des événements suit une trame qu'on qualifiera gentiment de prévisible, les scènes d'action dépotent. De la traversée de la tornade aux affrontements mettant en scène les bébêtes, on en prend plein la vue. Même en 2D, les effets spéciaux sont impressionnants et le gorille est très réussi, à la fois puissant et expressif.
On ne voit quasiment pas passer les deux heures. J'ai très agréablement digéré mon repas... et fait un gros pipi après la séance.
23:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 15 mars 2017
Chez nous
Lucas Belvaux est un réalisateur qui dose son effort : il a livré une quinzaine de films en 25 ans. Il est responsable de certains de mes plus grands émois cinéphiliques, avec sa trilogie Un Couple épatant - Cavale - Après la vie. Plus récemment, on a pu voir de lui 38 témoins.
Ici, il se lance dans le film politique, tout en gardant sa "patte" sociétale. Ce n'est pas tant un brûlot anti-FN qu'un portrait de ceux qui votent pour lui, militent pour lui voire se présentent pour lui. Si Rosetta Emilie Dequenne, mère-courage et infirmière dévouée, attire le regard et la sympathie, c'est incontestablement André Dussolier qui tire la couverture à lui en Philippe Berthier, militant de longue date de l'extrême-droite, patriote sourcilleux, médecin attentif... et manipulateur habile. Par contre, j'ai été moyennement convaincu par la prestation de Catherine Jacob en Agnès Dorgelle (alias Marine Le Pen).
La fachosphère s'est rapidement déchaînée contre un film qu'elle n'avait pas vu (comme il y a deux ans contre Un Français). Elle a eu tort. Le propos est nuancé. Si le portrait de certains militants ou sympathisants est grinçant, on sent l'empathie du réalisateur pour ceux qui sont cassés par la vie, quelles que soient leurs opinions. Derrière la polémique politique, Belvaux place le contexte social : les classes populaires et une partie des classes moyennes blanches se sentent larguées dans notre époque, abandonnées par ceux qui étaient censés les aider.
C'est donc un film à thèse. Concernant le Bloc patriotique (alias le FN), Belvaux veut montrer qu'il n'a pas coupé tous les liens qui le relient aux néo-nazis qui ont nourri ses débuts. L'un des personnages-clés est Stanko (Guillaume Gouix, très bien), ancien petit ami de l'héroïne Pauline, que celle-ci recroise par hasard... et dont elle découvre les nouveaux tatouages, assez explicites sur le plan politique. Pourtant, ce militant "identitaire" va se révéler plus complexe qu'au premier abord. Sa relation avec l'héroïne pourrait le tirer vers le haut. Dans son comportement avec les garçons, il apparaît comme une figure paternelle à la fois autoritaire et bienveillante.
Belvaux n'a cependant pas totalement réussi sa fin. L'intrigue politique se dénoue de manière assez prévisible, mais avec une pirouette (il faut bien regarder les affiches). C'est l'épilogue que je n'ai pas aimé. La réapparition (peu plausible) de certaines images refait basculer la vie intime de Pauline. Cette séquence alourdit inutilement le film, qui aurait dû se conclure sur les conséquences des choix de l'héroïne.
23:17 Publié dans Cinéma, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, cinéma, cinema, film, films
dimanche, 12 mars 2017
La La Land
Je me suis enfin laissé traîner dans une salle obscure pour aller voir ce qui est, selon les Oscar, le meilleur film des douze derniers mois. Au moins, j'ai choisi la version originale sous-titrée. Cela commence plutôt brillamment, avec ce plan-séquence autoroutier, hommage aux comédies musicales d'antan. Il est un peu à l'image du film : techniquement réussi, mais dégageant peu (voire pas...) d'émotion. Damien Chazelle nous prouve encore son habileté un peu plus loin, avec cette scène tournée dans l'appartement occupé par les jeunes femmes.
Soyons honnêtes : c'est bien joué, avec une mention particulière pour les deux interprètes principaux : Ryan Gosling (qui, de La Faille à The Nice Guys, mène intelligemment sa carrière) et Emma Stone (qui, de La Couleur des sentiments à Birdman, possède déjà une belle filmographie). Quand on pense qu'ils n'étaient pas les premiers choix du réalisateur ! Pour le film, Gosling est devenu un pro du piano. Quant à Emma Stone, elle nous montre tout son savoir-faire à l'occasion des scènes de casting. Elle est censée échouer à (presque) toutes... et pourtant, lors de la première tentative, elle est vraiment excellente. (Cela ne suffisait cependant pas, pour moi, pour qu'elle ait l'Oscar, qu'Isabelle Huppert méritait davantage.)
Je mets un bémol aux parties dansées-chantées qui font intervenir les deux personnages principaux. Ce n'est pas mauvais, mais c'est souvent médiocre, comme la première fois où ils se retrouvent seuls sur les hauteurs de Los Angeles, la nuit. Il paraît que c'est voulu... Et puis le contenu des chansons est quand même extrêmement sirupeux. J'ai plus apprécié le fond jazzy, qui se marie bien avec l'ambiance nocturne, mais pas tellement avec la comédie musicale.
Il reste l'intrigue : le désir des héros de réaliser leurs rêves est-il compatible avec leur amour naissant ? La première partie est construite sur le schéma de la montée en intensité du sentiment. Évidemment, les choses vont se gâter par la suite, mettant les héros à l'épreuve au niveau de leur engagement personnel comme au niveau de leur réalisation professionnelle. L'alchimie fonctionne bien entre Stone et Gosling. On est touché par cette histoire, y compris quand on nous propose, pendant quelques instants, la vision de ce qu'aurait pu être leur vie, si les choses s'étaient passées autrement.
C'est donc un bon film, résultat d'un gros travail. Mais quand on apprécie modérément les séquences chantées, il perd une partie de son intérêt.
11:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 11 mars 2017
La Confession
Ce film de Nicolas Boukhrief est une nouvelle adaptation du roman de Béatrix Beck, Léon Morin, prêtre. Pour le réalisateur du Convoyeur, de Cortex et de Made in France, cela représente un défi. Il change de style et s'est lancé dans l'adaptation d'un roman, au lieu de partir d'un scénario original.
L'arrière-plan documentaire (l'occupation allemande) est très soigné. On sent bien que la faim tenaille les habitants de cette petite ville de la moitié nord de la France métropolitaine. On comprend aussi que, face à l'occupant, les habitants ont des comportements... variés. A part à peu près égale, le réalisateur nous présente les accommodements (voire la collaboration) et les actes de résistance. Il a aussi veillé à ce que le portrait des soldats de la Wehrmacht ne soit pas unilatéral. Les personnages secondaires sont d'ailleurs très bien campés, en particulier les collègues de Barny, jouées par Anne Le Ny, Solène Rigot (vue récemment dans Saint Amour), Amandine Dewasmes et Lucie Debay (remarquée dans Un Français).
L'héroïne Barny penche nettement du côté de la Résistance. Employée des PTT, elle détourne une partie des lettres anonymes envoyées à la Kommandantur. Chez elle, elle cache des juifs et elle semble liée à une filière qui passe par une ferme perdue dans les bois. C'est aussi (et surtout) une fervente communiste, athée jusqu'au bout des ongles (qu'elle a un peu trop jolis, petit détail gênant). Dans le rôle, Marine Vacht est sen-sation-nelle ! Comme son personnage connaît une assez forte évolution, on peut la voir jouer sur au moins deux registres très différents. Elle est parfaitement crédible dans les deux (même si je la préfère en matérialiste). Elle est de surcroît très jolie, avec un visage expressif qui prend bien la lumière. On sent que Boukhrief a pris beaucoup de plaisir à filmer cette actrice.
Face à elle se dresse le nouveau curé, un homme beaucoup plus jeune que son prédécesseur, qui vient de décéder. Il semble de surcroît plus moderne que lui, lit beaucoup de livres profanes. A demi-mots (et à l'aide de quelques détails visuels distillés à l'intention des spectateurs), on comprend que, s'il accorde sans remords les derniers sacrements aux miliciens, il est un chaud partisan des Alliés. Il est incarné par Romain Duris.
Autant le dire tout de suite : je suis réservé sur son interprétation. Oh, c'est incontestablement un bon acteur ; là n'est pas la question. Mais il est un peu vieux pour le rôle. De plus, s'il excelle à incarner un prêtre cultivé, habile et séducteur (pour arriver à ses fins prosélytiques), il parvient mal à faire passer le trouble qui finit par gagner le curé, évidemment séduit par cette mère courage rebelle. C'est dommage, parce que le film perd un peu en force. Je suis aussi déçu par la fin, d'où se dégage surtout une grande tristesse.
10:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 10 mars 2017
Logan
Des années après l'époque glorieuse des X-Men, les héros sont bien fatigués. Wolverine/Serval (Hugh Jackman... jackmannissime) n'est plus que l'ombre de lui-même : il boite, tente de se débarrasser d'une mauvaise toux et a du mal à sortir ses griffes (ce que les mauvais esprits interprèteront comme des difficultés d'érection). Au quotidien, il est chauffeur de maître, façon Uber. Mais il a un petit "jardin secret", dans le désert.
C'est la grande originalité de cet épisode des aventures des héros Marvel. Ici, point de costume voyant ni de collant moule-burnes. Les mutants (comme leurs adversaires) sont plongés dans le quotidien déprimant d'un futur proche où il vaut mieux fuir au Canada si l'on veut sauver sa peau, dans cette Amérique post-apocalyptique qui est comme une vision de ce que la présidence Trump pourrait laisser du pays.
On a donc droit à Logan/Wolverine en voiture, Logan en ville, Logan à la campagne, dans le désert, à la montagne, en forêt... Cette collection de vignettes pourrait sembler artificielle. En réalité, elle donne un cadre parfois bucolique à une intrigue d'une folle intensité.
La première trouvaille est celle du refuge de Logan, que je ne vais pas décrire ici, histoire de laisser le plaisir de la découverte. Le héros y retrouve une connaissance et un très vieil ami, incarné par Patrick Stewart (tellement plus convaincant que James McAvoy). Bientôt, on va lui flanquer une gamine entre les pattes. En apparence, c'est une autiste, enfant traumatisée. Mais c'est une bombe atomique en puissance. Dans le rôle, Dafne Keen est une révélation.
Très vite, on nous propose des scènes de baston. Le film contient quatre moments de bravoure : le combat entre Wolverine et les loubards, l'attaque du refuge par les méchants, le premier duel avec le redoutable X-24 et le combat final, qui fait intervenir un nouveau groupe de personnages que Marvel destine sans doute à un brillant avenir...
Au niveau de la mise en scène, c'est emballant. James Mangold, auquel on doit Identity, 3h10 pour Yuma et Wolverine, le combat de l'immortel, sait y faire. Les mouvements des personnages sont quasiment chorégraphiés. Même la jeune Laura (sans doute très bien doublée pour les cascades) virevolte. Du côté des blessures, on est dans l'hyperréalisme. Les habitués ne seront pas (trop) choqués par la cruauté des protagonistes ni l'ampleur des dégâts. C'est quand même diablement sanguinaire... et parfois comique.
Le film est aussi réussi car les scènes de transition ne sont pas que du remplissage entre deux bastons. Il y a tout d'abord les rapports entre Xavier et Logan, de vieux amis qui forment presque un couple, avec ses scènes de ménage. Il y a aussi (et surtout) la relation très chaotique qui s'instaure entre la gamine Laura et le vieux briscard. C'est drôle, remuant... et finalement très touchant.
P.S.
A un moment, les trois personnages en fuite se retrouvent dans une chambre d'hôtel luxueuse. Sur le très grand écran de télévision est diffusé un western, Shane (L'Homme des vallées perdues), dont le parcours du héros entre évidemment en résonance avec celui de Logan.
P.S. II
Dans la même thématique :
12:30 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 08 mars 2017
Miss Sloane
Ce mercredi soir, il y avait mieux à faire que d'assister à la déconfiture d'une équipe de football qatarie. En l'honneur de la journée des droits de la femme, je suis allé voir ce film consacré à une lobbyiste américaine chevronnée, intelligente, machiavélique et déterminée, incarnée à la perfection par Jessica Chastain. Celle-ci, depuis L'affaire Rachel Singer, ne cesse de me surprendre. Quel que soit le rôle qu'elle endosse, elle est marquante, aussi bien dans La Couleurs des sentiments que dans Zero Dark Thirty ou encore Interstellar.
Elle n'est pas toute seule. La distribution compte d'autres "pointures" comme Mark Strong et Sam Waterston (l'ancien substitut du procureur de New York Police Judiciaire, ici dans un rôle à contre-emploi). On remarque aussi la prestation de Gugu Mbatha-Raw, vue récemment dans Free State of Jones.
Au niveau du scénario, c'est du lourd. On nous a bâti un polar alambiqué, qui s'appuie sur la description des mécanismes du pouvoir législatif, intimement lié à la pratique du lobbying (l'action des groupes de pression). A ce sujet, le discours du film est ambigu. D'un côté il dénonce la corruption du système, le pouvoir de l'argent et l'action souvent néfaste de ces brillants entremetteurs que sont les lobbyistes. D'un autre, il montre que le sens de l'intérêt général, couplé à un peu de vice, peut venir à bout de bien des difficultés. En tout cas, on ne nous épargne aucun coup fourré.
C'est aussi l'histoire de la transformation d'une femme (ou plutôt de sa révélation). La froide et impitoyable Elizabeth Sloane va se découvrir plus humaine qu'elle et son entourage ne le pensent, à l'issue d'une série de péripéties qui donnent un côté haletant au récit.
La réalisation se veut très chic, à l'image de son héroïne apprêtée. La musique est très hollywoodienne, soulignant les moments importants. Cela passe. La surprise est que, dans cet univers feutré, Miss Sloane tranche par son absence de scrupule, sa considérable force de travail et sa franchise brutale, jusqu'à la grossièreté.
Ce film n'attire hélas pas les foules. Pourtant, j'ai passé un excellent moment. L'histoire s'achève sur un plan magnifique de Jessica Chastain, sortant d'un lieu que je ne peux pas nommer.
23:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 05 mars 2017
Rock'n Roll
Cette autofiction de Guillaume Canet fonctionne sur les principes de l'inversion et du retournement. On peut parler d'inversion parce que, dans le couple qu'il forme avec Marion Cotillard, c'est la femme qui occupe le premier plan. Dans le film, on va donc voir l'homme se poser les questions que se poserait la jolie épouse d'un comédien célèbre. Suis-je assez bien pour elle ? Qu'est-ce que je vaux professionnellement parlant ? Est-ce que j'ai vieilli ?
C'est d'autant plus intéressant que, jusqu'à il y a dix ans (et la sortie de La Môme), c'était la carrière de Canet qui paraissait la plus prometteuse. En tant qu'acteur, il avait été remarqué dans La Plage, Vidocq, Narco, Jeux d'enfants, Joyeux Noël, La Clé... Mais, surtout, il avait fait de très bons débuts à la réalisation, avec Mon Idole et Ne le dis à personne. Depuis cette époque, la carrière de Guillaume Canet s'est poursuivie (récemment avec La prochaine fois, je viserai le coeur et Le Secret des banquises), mais celle de Marion Cotillard a connu un essor formidable.
C'est avec beaucoup d'autodérision que le réalisateur nous présente la relation de couple et les efforts de celui qu'on appelle parfois "Monsieur Cotillard" pour exister, professionnellement parlant. Deux types de scènes se répondent : celles de tournage d'un film "art et essai" (où Canet, à son grand désespoir, incarne le père d'une adolescente) et celles de la famille Fenouillard Cotillard, avec Guillaume en papa poule, tout mignon, tout gentil, aimé par sa compagne oscarisée, qui se lance dans l'apprentissage du joual pour tourner avec Xavier Dolan ! C'est souvent hilarant. Ceux qui n'en auraient pas encore conscience découvriront l'excellente actrice qu'est Marion Cotillard, dans un registre comique où hélas on ne la voit guère.
Le premier retournement survient quand Canet décide de se la jouer rock'n roll. Il est bien sûr pathétique, ce qui nous vaut plusieurs moments savoureux, des fantasmes du quadra qui se rêve rebelle à la soirée alcoolisée qui se termine en vidéo trash sur les réseaux sociaux. Je recommande aussi tout particulièrement la séquence chez le couple Hallyday, Johnny se prêtant de bonne grâce au jeu !
Cependant, au bout d'une heure et quart, l'ambiance change. On ne s'en rend pas compte tout de suite, parce qu'on reste sur la même thématique. Mais le ton se fait plus grave. Le personnage incarné par Canet va prendre des décisions "drastiques", qui vont le transformer. D'un côté, j'ai trouvé gonflé qu'on ne se limite pas à la comédie people (vouée au succès) et qu'on parte vers quelque chose de plus philosophique. D'un autre côté, je trouve que Canet n'a aucun recul vis-à-vis de ce que devient son personnage. On nous pousse presque à adhérer à sa démarche puisque, par un nouvel effet de retournement, c'est la Marion Cotillard de fiction qui se trouve fragilisée. Et, même si la séquence finale, en partie parodique, remet l'humour au premier plan, le coup de la chanson de Demis Roussos devant la caravane est ri-di-cu-le.
C'est dommage, parce que c'était au départ une comédie très enlevée, qui se termine en eau de boudin.
11:42 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 02 mars 2017
Lumière ! L'aventure commence
Le sortie de ce documentaire-hommage, signé Thierry Frémaux (délégué général du Festival de Cannes... et directeur de l'Institut Lumière), est un petit événement, puisqu'il propose, en version restaurée, un échantillon de l’œuvre des frères Lumière, les courts films de cinquante secondes étant classés par thème.
Il y a bien entendu les incontournables, comme La Sortie des usines Lumière, dont on découvre qu'en réalité, il existe non pas une, non pas deux, mais trois versions différentes ! Ici, Thierry Frémaux se fait historien, l’œil acéré, habile à débusquer le "détail qui tue" dans une scène en apparence anodine, un peu à l'image de ce que l'on peut voir à l’œuvre dans la série Mystères d'archives (pour ceux qui connaissent).
Parmi les autres "classiques", il y a bien sûr L'Arroseur arrosé ou encore L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Si le premier nous paraît aujourd'hui surjoué, le second n'a rien perdu de sa force. C'est l'occasion, pour Frémaux, de souligner la qualité du cadrage et de la mise en scène. On sent qu'il n'est pas loin d'affirmer que les Lyonnais d'adoption ont tout inventé dans le septième art.
L'un des thèmes évoque les œuvres faisant intervenir des enfants. Il y a bien sûr ceux des couples Lumière, mais aussi des gamins des rues, comme ces joueurs de billes guère effrayés par la caméra. Pour moi, le plus beau film reste celui confrontant la gamine sur une chaise à un superbe chat, habile... et très gourmand :
Paraissant d'abord étrangement obéissant, le matou va rapidement se révéler incontrôlable... et entreprenant :
Outre des aspects de la vie quotidienne de la bourgeoisie, le documentaire ressuscite le travail des ouvriers et des manœuvres, filmés avec beaucoup de respect et une incontestable inventivité : à l'écran, l'action se déroule sur deux voire trois plans. Pour nous midi-pyrénéens, l'intérêt s'éveille lorsqu'apparaît à l'écran une scène tournée aux mines de Carmaux.
Saisissantes aussi sont les vues du Paris de l'extrême fin du XIXe siècle, ou ces scènes de bord de mer. Les cinéastes étaient visiblement très éclectiques. L'ensemble constitue un foisonnant catalogue, véritable couche géologique d'une France qui a disparu. C'est de surcroît l'un des plus beaux films sortis en salle ces derniers mois, bercé par la musique limpide de Camille Saint-Saëns.
23:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 26 février 2017
Lion
Ce film fait partie des multinominés aux prochains Oscar. Il s'inspire d'une histoire vraie assez extraordinaire. La première partie se déroule en Inde, dans un village perdu au cœur du pays, puis à Calcutta. Les scènes alternent moments de joie et de tristesse. On nous fait découvrir l'Inde ultra-pauvre d'il y a une trentaine d'années, d'abord rurale puis urbaine. C'est globalement assez dur (quand on nous montre tous les dangers qui guettent les enfants esseulés), même si des moments de bonheur émergent.
C'est prenant parce que les interprètes sont assez bons. Les enfants ont fait l'objet d'une sélection sévère, si bien que les deux gamins qu'on voit le plus à l'écran sont très convaincants. Toutefois, je trouve que c'est celui qui incarne l'aîné (Guddu) qui s'en sort le mieux, le plus jeune (qui joue le héros Saroo) me semblant plus limité.
C'est de plus très bien filmé. Au début et, par la suite, à plusieurs reprises, on tente visiblement de nous en mettre plein la vue avec des plans aériens. Mais ce sont les scènes urbaines, à Calcutta, qui sont les plus réussies, avec une superbe photographie.
La deuxième partie se déroule en Australie. On retrouve le héros devenu adulte, un jeune homme bien dans sa peau, à qui la vie tend les bras. Sauf que... le passé va refaire surface. Dans le rôle de l'ancien enfant adopté rongé par le doute et la culpabilité, Dev Patel (celui de Slumdog millionaire) est très bon. Il est épaulé par une brochette d'acteurs confirmés. Du côté australien, on a Rooney Mara, Nicole Kidman (malgré la chirurgie esthétique...) et David Wenham. Du côté indien, outre ceux déjà mentionnés, on peut signaler l'apparition de Nawazuddin Siddiqui (remarqué dans The Lunchbox) et surtout de Tannishtha Chatterjee, qu'on a pu voir récemment dans La Saison des femmes et Déesses indiennes en colère.
La troisième partie voit le héros partir en quête. Je me garderai bien de raconter ce qu'il va trouver. Je peux quand même dire que, vers la fin, j'ai eu les yeux qui piquent... Satanées poussières !
11:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 18 février 2017
L'Empereur
Douze ans après La Marche de l'empereur, Luc Jacquet (auquel on doit aussi La Glace et le ciel et Il était une forêt) nous revient avec un documentaire consacré aux manchots de l'Antarctique. Le scénario est familial : on suit les efforts des parents pour faire survivre leur progéniture, avant de découvrir les premiers pas de celle-ci, jusqu'à l'acquisition de l'autonomie.
Le déroulé n'est toutefois pas strictement linéaire : on nous propose des retours en arrière, et même quelques images du premier film. On a visiblement voulu éviter le côté parfois pesant des documentaires. Quant au commentaire lu par Lambert Wilson, il évite les deux principaux écueils : il n'est ni abscons ni nunuche. La musique n'est pas trop présente, juste ce qu'il faut.
Mais le plus intéressant est ce que l'on voit à l'écran. Les images sont superbes, que ce soient celles de la banquise, celles de l'océan ou bien celles des manchots. Ceux-ci sont parfois filmés en super gros plan : on a l'impression de pouvoir les toucher ! Et qu'est-ce qu'ils sont beaux, à la fois gracieux et dignes.
Je pense que l'une des raisons du succès qu'ils rencontrent est l'anthropomorphisme dont nous faisons preuve. Voir ces marcheurs empruntés trébucher (voire tomber) sur la glace les rend proches de nous, tout comme les couples qu'ils forment, avec ce souci de préserver leur progéniture unique. Encore aujourd'hui, je suis étonné de la relative facilité avec laquelle les adultes arrivent à se reconnaître et à repérer leur petit, qu'ils n'ont parfois pas vu depuis des mois. Il semblerait qu'ils se guident essentiellement à l'oreille.
A propos des couples, les spectateurs avisés remarqueront l'équitable répartition des tâches entre le mâle et la femelle, les deux couvant alternativement le petit, pendant que l'autre part chercher de la nourriture. C'est même la mère qui abandonne la cellule familiale la première, quand elle juge que le petit peut se débrouiller seul.
Celui-ci n'est pourtant pas bien grand, n'ayant en général pas achevé sa mue. Ces peluches vivantes et maladroites sont vraiment attendrissantes ! Très jolies aussi sont les scènes de séduction entre les adultes. Et l'on retrouve ces étranges processions, que les animaux forment quasi instinctivement. C'est vraiment un chouette film !
02:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 15 février 2017
Silence
Le nouveau film de Martin Scorsese (nettement moins tape-à-l'oeil que Le Loup de Wall Street) est l'adaptation d'un roman japonais, mais son intrigue a un arrière-plan historique : les tentatives de christianisation du Japon, notamment par les Jésuites, ordre auquel appartiennent les héros.
Le film (dans sa version originale) est polyglotte : on y entend parler anglais, latin, japonais et même chinois. Scorsese semble suivre la même démarche que Clint Eastwood dans Lettres d'Iwo Jima : son oeuvre ne sera pas une vision occidentalo-centrée. Toutefois, il n'a pas poussé le réalisme jusqu'à faire s'exprimer les personnages principaux européens en portugais. Déjà qu'il a eu du mal à financer le film...
D'un point de vue visuel, c'est superbe. Scorsese n'a pas perdu la main. Epaulé par un très bon directeur de la photographie, il réalise de superbes plans des zones côtières comme des intérieurs. Les scènes de nuit sont les plus belles, avec une incontestable maîtrise des éclairages. Je note cependant un certain penchant à montrer la saleté à l'écran... penchant qui concorde avec le propos du film.
Scorsese a visiblement pris du plaisir à mettre en scène une lente défaite, celle des Européens sûrs d'eux face à la civilisation (et à la force) japonaise. Pour les spectateurs occidentaux, c'est original, mais, à l'écran, c'est long à venir. On doit subir des tunnels de dialogues pas franchement palpitants. De surcroît, je ne suis pas convaincu par le choix d'Andrew Garfield pour le rôle principal. Il était meilleur dans Tu ne tueras point, mais il interprétait un personnage plus monolithique. Il est visiblement moins à l'aise dans le rôle d'un homme de plus en plus tourmenté, dont les convictions vont vaciller. A ses côtés, Adam Driver (que l'on voit beaucoup moins) est plus marquant. Surtout, quand Garfield se retrouve face à Liam Neeson, on sent clairement qu'il y a une classe d'écart.
Beaucoup de choses sont assez prévisibles dans cette histoire. Du coup, comme l'action n'est guère trépidante, je me suis un peu ennuyé. J'ai eu le temps de goûter la beauté de certains plans mais, franchement, pendant 2h40, ça fait long. Il convient néanmoins de rester attentif jusqu'au bout. En chrétien convaincu, Scorsese a voulu montrer que la véritable victoire est intérieure, en tout cas beaucoup plus discrète que ne le furent les tentatives d'évangélisation...
14:35 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 11 février 2017
Tempête de sable
Ce film israélien a pour héros des Bédouins du Néguev, des Arabes du désert, en partie sédentarisés. On suit plus particulièrement une famille, l'aînée des enfants, la charmante et impétueuse Layla, étant l'héroïne de l'histoire. C'est elle qui va lever un vent de tempête qui menace de tout emporter sur son passage.
On s'attend essentiellement à ce qu'il soit question de mariage forcé, mais, habilement, le film démarre sur une scène qui illustre le fort attachement qui existe entre le père et sa fille aînée. Cependant, on va très vite comprendre que ce père n'est pas prêt à aller à l'encontre des traditions. L'intrigue nous fait donc découvrir, globalement, la situation des femmes dans une société patriarcale contemporaine.
La première partie est bien centrée sur un mariage, mais ce sont des adultes qui sont directement concernés. Ici, il est question de polygamie... et peut-être aussi de transmission masculine : l'homme qui accueille sa deuxième épouse a quatre enfants... uniquement des filles. Le regard se concentre sur la première épouse, qui ne manque pas de caractère, mais qui n'a guère de marge de manoeuvre. Dans le rôle, Rubal Abal (vue auparavant dans Héritage) est excellente.
On sent même qu'au sein du groupe familial, la fille aînée n'est pas loin de prendre le dessus sur sa mère... tant qu'elle bénéficie du soutien de son père. Celui-ci lui apprend à conduire et, fait extraordinaire, l'encourage à poursuivre ses études. On sent même qu'il regrette que ses résultats ne soient pas plus brillants.
Cela s'explique parce que Layla a un peu la tête ailleurs. Certes, ses études lui ont laissé entrevoir une autre vie, dans laquelle elle ne serait pas destinée à élever les enfants qu'elle aurait d'un mari imposé. Mais, surtout, elle est tombée amoureuse, d'un gars d'une autre tribu. Va-t-il plaire à son père ? La famille de son chéri (dont on comprend qu'elle a eu à souffrir des autorités israéliennes) est-elle assez honorable ? Cette amourette cadre-t-elle avec les plans qu'a concoctés le père pour sa fille ?
Le coeur de l'intrigue est constitué par cette opposition père-fille. Mais cela a aussi des conséquences sur les jeunes soeurs de l'héroïne... et surtout sur sa mère. On sent la jeune femme prête à tout. Elle va devoir prendre une décision lourde de conséquence, quelle qu'elle soit.
C'est pour moi un très bon film. Sur un canevas connu (les amours contrariées), la réalisatrice (qui est aussi scénariste) a greffé le contexte israélien et la question de la place des femmes dans la société.
P.S.
Pour en savoir plus sur le sujet, on peut lire une étude universitaire d'Ivan Sand (très critique vis-à-vis de la politique menée par les gouvernements israéliens). Un intéressant (et très ponctuel) contrepoint est proposé par... le site de Tsahal (l'armée israélienne), qui évoque le rôle (méconnu) des Bédouins dans la défense du pays. (Les lecteurs avisés remarqueront l'emploi de l'expression "Judée-Samarie" à la place de Cisjordanie...)
15:41 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 09 février 2017
Lego Batman, le film
C'est la sortie événement de cette semaine, loin devant les attrape-nigaude matraqués par la publicité. Ceux qui ont savouré La Grande Aventure Lego ne seront pas dépaysés. Le style graphique est le même, le ton parodique omniprésent... et c'est d'ailleurs davantage destiné aux grands qu'aux petits, au-dessus de la tête desquels risquent de passer pas mal d'allusions !
Dès le début, j'ai aimé le commentaire parodique du générique, qui se moque gentiment de certains tics hollywoodiens. Notre guide est Batman-le-héros-viril-qui-n-a-besoin-de-personne. Le film a évidemment pour objectif de démontrer le contraire.
En attendant que Batman ne rejoigne le commun des mortels, on le montre mettre sa race à une brochette de vilains, dans une séquence cocasse et survitaminée. Mais l'image scintillante du justicier solitaire cache la vie recluse d'un homme triste, sans famille, dont les habitudes vont être (en partie) dérangées par l'arrivée d'un orphelin très dégourdi.
Les sources de gag sont donc nombreuses. Outre les invraisemblables combats, on a l'égocentrisme de Batman, les maladresses de ses amis... et le comportement puéril des méchants. A certains moments, cela va même trop vite, tellement c'est riche... encore un coup pour nous faire acheter le DVD !
Au niveau du sous-texte, tous les publics sont servis : Batman tombe raide dingue amoureux de la nouvelle commissaire... tout en entretenant une relation amour/haine très ambiguë avec le Joker. N'oublions pas que la plupart de ces messieurs portent des collants...
Bref, malgré la bande-son très rap, j'ai passé un excellent moment, en compagnie d'une troupe de crétins parfois futés.
P.S.
Ceux qui apprécient ce genre d'humour peuvent se ruer en toute confiance sur d'autres animations Lego, pour la télévision. Ainsi, plusieurs séries estampillées "Lego Star Wars" ont été produites. Les Contes des Droïdes (diffusés avant que ne sorte en salles Le Réveil de la Force) racontent toute la saga... du point de vue de R2-D2 et de C-3PO. C'est hi-la-rant !
Auparavant avaient été produites Les Chroniques de Yoda, dont la première saison s'intercale sans doute entre L'Attaque des clones et La Revanche des Siths, et la seconde entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Le petit bonhomme vert aux pouvoirs extraordinaires y joue un rôle essentiel, avec ce sens de la dérision qui évite toute grandiloquence.
Plus récemment, j'ai découvert Les Aventures des Freemakers, dont l'action se déroule elle aussi entre les épisodes V et VI. Cette série met en scène des sortes de garagistes-brocanteurs de l'espace, un trio composé de deux frères et d'une sœur. Ces autoentrepreneurs pleins d'allant sont toutefois assez gaffeurs... mais le plus jeune sent la Force en lui. C'est moins désopilant que les deux autres séries, mais cela se regarde sans déplaisir.
23:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 08 février 2017
Neruda
Ce portrait romancé de l'écrivain chilien Pablo Neruda est signé par un autre Pablo, Larrain, dont le médiocre Jackie est actuellement en salles. J'apporte cette précision pour deux raisons. La première est qu'il est rare de voir deux films récents d'un même réalisateur occuper les écrans. La seconde est qu'il est difficile de croire que le même homme ait pu, à quelques mois de distance, réaliser deux œuvres aussi dissemblables.
Autant Jackie est pesant, engoncé, prévisible, autant Neruda est vivant, virevoltant... voire facétieux. Le principal artifice de mise en scène consiste dans le montage alterné de plusieurs versions de certaines scènes de dialogue, tournées sous des angles voire dans des lieux différents. Cela donne une impression d'étrangeté ou de cocasserie... et nous incite à nous méfier de ce qui nous est montré : l'histoire qui nous est contée est en cours de construction... bref, c'est de la "réalité améliorée" ou une fiction réaliste. Neruda ayant été lui-même un peu affabulateur, quel plus bel hommage pouvait-on lui rendre que de romancer cet aspect de sa vie !
Il convient aussi d'être observateur : certains plans réservent quelques surprises. A plusieurs occasions, Neruda tente de se dissimuler (avec succès). Il reste aux spectateurs (et aux policiers qui le poursuivent vainement) à deviner où il se cache, par exemple dans le bordel ou encore dans la librairie.
Au-delà de son aspect comique, le film n'en assène pas moins quelques vérités. J'ai apprécié qu'on déboulonne (un peu) la statue du grrrand écrivain. Neruda était un bourgeois dilettante, communiste en partie par provocation. S'il était sans doute sincèrement choqué par le sort des prolétaires chiliens, il pensait surtout à s'envoyer en l'air... et tenait absolument à bénéficier des services de domestiques, même en cavale.
C'est toute l'histoire de ce film, qui voit l'écrivain poursuivi par un policier zélé... et un peu admirateur de ses œuvres. Dans le rôle d'Oscar Peluchonneau, Gael Garcia Bernal (que Larrain avait déjà dirigé dans No) est excellent, au point de parfois voler la vedette à l'écrivain... ce à quoi s'évertue son personnage, d'ailleurs ! (Signalons qu'il a existé un Oscar Peluchonneau Bastamante directeur général de la police chilienne... en 1952, soit quelques années après l'époque à laquelle se déroule l'intrigue. Ici encore, réalité et fiction s'entrecroisent.)
Au passage, le Chilien Larrain, qui avait situé l'action de Santiago 73 à l'époque du coup d’État de Pinochet, nous fait croiser le futur dictateur, alors jeune officier, dirigeant un camp de détention de communistes du côté d'Iquique, dans le nord du pays, où s'étend le désert d'Atacama. Ce nom a éveillé ma curiosité. Où l'avais-je déjà entendu ? Dans le documentaire Chomsky et compagnie, qui évoque le massacre de mineurs commis par l'armée chilienne en 1907.
Neruda est donc un film très riche, qui nous instruit et nous divertit sans se prendre au sérieux. J'ai toutefois été un peu déçu par le dernier quart d'heure, le réalisateur ayant visiblement eu du mal à conclure son histoire.
P.S.
Le massacre de 1907 a inspiré l'écrivain Hernan Rivera Letelier, dont le roman Les Fleurs noires de Santa Anna a pour cadre les jours qui ont précédé la tuerie. On y suit des personnages hauts en couleur, pauvres et, en général, dignes. Ils vont se révolter contre leurs conditions de travail (et de vie) et déclencher un formidable mouvement populaire, qui va affoler les possédants.
23:31 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films
mardi, 07 février 2017
La Grande Muraille
Cette coproduction américano-chinoise vise le plus large public possible... avec, en priorité, les nombreux spectateurs des Etats-Unis et de Chine. Le cadre principal de l'action est l'un des monuments emblématiques de la Chine (et du patrimoine mondial). Par contre, l'intrigue, loin de s'inspirer d'événements historiques, s'appuie sur une légende. C'est une sorte de mélange de film en costumes chinois et de Seigneur des anneaux, avec une pincée de Kingdom of Heaven.
Le propos est éminemment politique. Il montre que, face à une gigantesque menace (les animaux incarnant la barbarie, qui pourrait être celle du djihadisme), Occidentaux et Orientaux doivent unir leurs forces pour triompher. Accessoirement, au-delà de leurs différences, les braves de chaque camp ont plus de points communs qu'ils ne le croient.
Du côté des Orientaux, on identifie bien les Chinois (les peuplades mongoles étant présentées comme sous-développées). C'est l'époque de la dynastie Song, qui a vu l'invention de la poudre à canon et du principe de la boussole, entre autres. (Accessoirement, le public non cultivé apprendra qu'au Moyen Age, c'était la civilisation chinoise qui était la plus avancée.) Du côté des Occidentaux, c'est plus ambigu : Matt Damon incarne un chevalier anglais (qui s'est battu pour l'un des rois nommés Harold, qui vécurent tous deux au XIe siècle)... mais c'est incontestablement un Américain. Au niveau du scénario, on a joué sur cette double identité. Au plan symbolique, le film met en scène une hypothétique alliance sino-américaine, mais il pourrait aussi se comprendre comme la dénonciation de la perte de certaines valeurs par les Européens (risque qui menace aussi les Chinois).
Mais on peut très bien s'émanciper de ce sous-texte et se contenter de profiter du spectacle. La photographie est superbe, très colorée, et les effets spéciaux au poil. Signalons que Lucasfilm (à travers notamment sa filiale Skywalker Sound) y a apporté sa touche... en compagnie d'une brochette de contributeurs, tchèques, indiens et même français.
Les acteurs sont bons, ne surjouent guère. Le public a aussi l'occasion de découvrir une ravissante actrice chinoise, Jing Tian, à laquelle l'armure bleue sied à merveille... et que sa coiffure extravagante ne gêne nullement au combat !
Ce film est donc à classer dans la catégorie "divertissement grand public". C'est joli à regarder, romanesque à souhaits, sans prise de tête. Cela ne va pas changer l'histoire du cinéma, mais on passe un bon moment.
22:15 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, filmd
lundi, 06 février 2017
Jackie
Ce faux biopic est centré sur les moments et les jours qui ont suivi l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, vus par sa veuve. Cette trame est encadrée par des retours en arrière (des extraits d'un programme télévisé auquel la First Lady avait participé) et l'entretien accordé par l'héroïne à un journaliste (une fois le tumulte passé). Il s'agit donc d'un film à entrées multiples, sur le pouvoir, sa représentation, le poids des médias, la vie d'une femme mal considérée (avant d'être adulée) et sur le(s) deuil(s).
Natalie Portman a pris le phrasé et la démarche de Jackie Kennedy. Par son jeu, elle nous montre aussi l'évolution du personnage : à la nunuche de 1961 a succédé, en 1963, une femme certes tenaillée par la souffrance, mais plus sûre d'elle et capable d'utiliser les rouages du système.
Le reste de la distribution est de bon niveau. On ne voit pas trop les autres acteurs, dont le jeu est réduit à la portion congrue. On remarque néanmoins la bonne prestation de Peter Sarsgaard (en Robert Kennedy). Je note aussi qu'on a trouvé un acteur qui a une certaine ressemblance avec le défunt président.
Le problème vient, en partie, de la réalisation. Oh, c'est du travail propret, avec un petit côté vintage dans la recréation du grain de l'image télévisuelle (pour les scènes anciennes). Mais c'est trop sage, trop millimétré. On finit par s'ennuyer terriblement, d'autant qu'on a veillé à ne pas égratigner la légende Kennedy.
A mon avis, il aurait été plus pertinent d'élargir l'ampleur chronologique du sujet, pour évoquer les études suivies par Jacqueline Bouvier (qui n'était pas une idiote) et, après la période Maison Blanche, sa tentative de refaire sa vie avec le milliardaire Onassis.
P.S.
Quitte à aller voir un film qui rende hommage à une femme célèbre (incarnée par une actrice très talentueuse), autant choisir Dalida.
23:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films
dimanche, 05 février 2017
La Vallée des loups
Cette vallée alpine (de cheval) nous demeure secrète, le réalisateur Jean-Michel Bertrand voulant la préserver de l'intervention humaine. Je pense malgré tout qu'une personne connaissant la région peut, en s'appuyant sur les images et sur les remerciements qui figurent dans le générique de fin, arriver à retrouver les lieux de tournage.
Commençons donc par ces images superbes de paysages de montagne, d'un lever de soleil brumeux ou de surfaces enneigées. C'est évidemment une ode à la nature, à travers le minéral, le végétal... et l'animal. Bien avant de voir les loups, on entre en contact avec les chouettes (succès garanti auprès du public, à condition qu'il n'attrape pas de torticolis), les blaireaux (il n'y en avait pas dans la salle, apparemment), les cerfs, les biches, les chamois, les lièvres, les corbeaux, les fourmis, les renards... C'est beau à voir, parce que les animaux sont filmés dans leur milieu naturel et parce que la photographie n'est pas dégueu.
C'est aussi souvent drôle, parce que le comportement des bestioles prête parfois à sourire et parce que J-M Bertrand se met en scène, avec une bonne dose d'autodérision. Précisons qu'il n'est pas tout seul à tenir la caméra. Les prises de vue ont été réalisées par deux personnes, Marie Amiguet épaulant le réalisateur. C'est particulièrement visible sur certaines scènes, où les prises de vue ne peuvent pas avoir été réalisées par une caméra fixe disposée par l'unique personne présente sur les lieux.
Cela me conduit à une petite critique. Ce qui nous est présenté comme le fruit de l'immersion aventureuse d'un baroudeur passionné est aussi le résultat d'une mise en scène. Certains moments, présentés comme fortuits, ne le sont pas tout à fait.
L'un des exemples les plus flagrants est la première vision d'un loup. Elle semble survenir alors que le réalisateur nous est montré en train d'uriner. Il se retourne et -contrechamp- on voir un loup, au loin, qui semble l'observer. C'est évidemment le résultat au mieux d'une reconstitution (seules les images du loup sont une capture sur le vif, les autres ayant été rejouées pour les besoins du film), au pire d'une invention (le réalisateur a bien filmé par hasard ce loup, de jour, et a décidé ensuite d'ajouter une scène le montrant en train d'uriner à ce moment-là pour "pimenter" son histoire).
Un autre exemple est cette scène qui voit le réalisateur marcher devant un arbre dans lequel se cache une chouette, dans une niche située en hauteur. La caméra, posée latéralement au chemin, semble capter une rencontre fortuite. En réalité, il y a fort à parier que la chouette a été repérée auparavant et qu'il a été décidé de mettre en scène le passage de J-M Bertrand devant cet arbre-là.
On va me dire : ce ne sont là que de menus détails, mais ce procédé de fausse rencontre, tout comme le tournage a posteriori de plans contrechamp nuit à la rigueur du propos (qui est militant).
On n'en est pas moins passionné par le périple du réalisateur. D'abord attiré par les rapaces, il décide de se concentrer sur les loups, dans ce parc naturel où l'activité humaine ne vient pas déranger la vie des animaux sauvages. La vision, assez précoce, du premier loup, l'incite à croire qu'il va rapidement arriver à ses fins... Que nenni ! La première année d'observation s'achève sans nouvelle rencontre. Il doit se résoudre à installer des caméras à déclenchement automatique (si elles repèrent du mouvement dans leur champ de vision). Cela nous vaut d'étranges images nocturnes (pour la plupart) de la faune sauvage, vraiment captivantes.
J'ai particulièrement aimé la séquence qui montre la compétition qui existe, à distance, entre les loups et le renard pour l'occupation d'un territoire. Le chef de la meute commence par marquer le terrain à l'aide d'excréments. Plus tard, le renard vient uriner dessus. De retour, les loups grattent le sol à proximité... là où, plus tard, le renard va à son tour faire ses besoins. Je vous laisse découvrir à quelles extrémités se laisse porter le canidé à la queue touffue !
Le résultat est un passionnant documentaire, très engagé en faveur du loup... et c'est à mon avis sa principale limite. Si l'on ne nous cache pas le mode alimentaire de canis lupus, jamais on ne le voit réellement chasser ni tuer ou dépecer une proie. Par contre, on a tenu à nous montrer des images de louveteaux jouant comme des chiots. Dans un parc national, la présence des loups se justifie pleinement : ils contribuent à l'équilibre de la chaîne alimentaire. Par contre, dans un parc naturel régional (dont la vocation est de concilier protection de la nature et activités humaines), la présence du loup est une menace pour l'élevage extensif, qui a besoin de grandes pâtures sans danger pour les animaux domestiqués.
23:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 04 février 2017
Sahara
Ce film d'animation franco-canadien est porté par une pléiade de voix connues du grand public : Omar Sy, Louane, Vincent Lacoste (très bon en en serpent djeunse), Ramzy, Jean Dujardin, Grand Corps Malade, Sabrina Ouazani, Jonathan Lambert ou encore Clovis Cornillac (que j'ai adoré en ver luisant).
Pourtant, la première partie ne m'a pas du tout emballé. Non que ce soit mauvais, mais je me suis senti comme exclu de l'histoire, visiblement destinée au (très) jeune public. A un moment, j'ai même piqué du nez !
Fort heureusement, cela change vers le milieu du film, avec deux séquences capitales : la rencontre des vers luisants dans la grotte et l'introduction du personnage du charmeur de serpents. La première est à la fois drôle et superbe sur le plan visuel. On s'attend bien sûr à de jolis effets d'éclairage, mais on est aussi ravi quand cela prend un tour psychédélique. Quant à l'arrivée du charmeur de serpents, elle débouche sur une scène de danse très réussie.
La suite maintient l'intérêt : les héros vont faire la rencontre de touristes du désert... humour garanti ! On rit aussi beaucoup lors de la rencontre du poisson des sables (Michaël Youn, étonnamment bon). La virtuosité est plus flagrante lors de la séquence de battle dance, qui va opposer deux femelles. Les animateurs ont réussi à faire se mouvoir les serpents de telle manière qu'à l'écran, on a quasiment l'impression de voir des jeunes femmes.
La dernière partie de l'intrigue est la plus trépidante. Cela devient un film d'action très prenant... et visible par tous.
Voilà. Si l'on supporte la première partie, cela constitue un bon divertissement.
17:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 02 février 2017
L'Histoire officielle
C'est le titre d'un film argentin (oscarisé), sorti en 1985 et tourné en secret dès la chute de la dictature militaire, en 1983. Il ressort aujourd'hui dans une version restaurée. C'est une œuvre majeure, d'abord par la qualité de l'interprétation, mais aussi par la force du sujet qu'elle aborde (les disparus de la dictature), ultra-brûlant à l'époque.
Le titre est à double-sens, puisqu'il fait allusion à la censure qui sévit en 1982-1983 sur les crimes de la dictature... et au métier de l'héroïne Alicia, qui enseigne l'histoire dans un lycée de garçons. Cultivée et autoritaire, elle impose une certaine vision du passé, qui va être contestée par certains élèves.
La remise en question va aussi toucher son histoire personnelle. On apprend vite qu'elle est stérile et que sa fille Gaby a été adoptée il y a environ 5 ans... en réalité, elle a été apportée au domicile conjugal par l'époux de l'héroïne, un homme d'affaires très en cour auprès des officiers qui dirigent le pays depuis 1976.
Mais l'on sent que l'ambiance est à la fin de règne. Plusieurs scènes sont chargées de nous montrer que l'on parle beaucoup par sous-entendu, y compris au sein de l'élite privilégiée. La glace va craquer une première fois lors d'une soirée "entre filles" : l'héroïne revoit sa meilleure amie, de retour au pays après une absence de six ans. La scène s'engage sur un ton très futile, limite agaçant. Et, soudain, elle bascule dans le drame, notamment grâce au talent de l'actrice qui incarne Ana.
La grande bourgeoise sent ses certitudes vaciller et décide de mener sa propre enquête sur l'origine de sa fille. Cela va la conduire à rencontrer une de ces grands-mères de la place de Mai, dans une scène de café absolument étourdissante, qui voit une femme changer petit à petit d'attitude en écoutant la seconde, qui se livre et se décompose.
C'est donc un film de femmes, très fort bien qu'un peu daté. Soulignons aussi la très bonne composition d'Hector Alterio, qui interprète le mari d'Alicia.
Je pense que ce film a inspiré d'autres réalisateurs sud-américains, comme Adrian Caetano (auteur de Buenos Aires 1977), Lucia Cedron (Agnus Dei) ou encore les Chiliens Patricio Guzman (Nostalgie de la lumière et le génial Bouton de nacre) et Pablo Larrain (Santiago 73 et No).
23:11 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 29 janvier 2017
Dalida
Presque cinq après Cloclo, le cinéma français replonge dans le biopic d'une vedette populaire morte prématurément. Coïncidence ou pas, les deux chanteurs ont passé leur enfance en Égypte, dans la communauté européenne. Ils ont aussi l'Italie en commun, plus précisément la Calabre, dont est originaire la famille de Iolanda Gigliotti, tout comme celle de la mère de Claude François. On note que les deux enfances ont été bercées par la musique, notamment celle jouée au violon.
Là s'arrêtent les ressemblances. La vie de Dalida est un écheveau de moments d'intense bonheur et de drames, qui l'ont conduite à deux tentatives de suicide, la seconde réussie. Autre différence : la chanteuse n'a pas eu d'enfant, elle qui aurait tant voulu être mère, quitte à laisser un peu tomber sa carrière.
Contrairement à Cloclo, Dalida nous fait découvrir le passé par touches, à l'aide de retours en arrière. Cela donne au film un côté puzzle qui n'est pas déplaisant, ni déstabilisant : on sait toujours où et quand l'action se déroule. De plus, à l'écran, les tons varient en fonction du lieu et de l'époque. C'est le moment de signaler la grande qualité de la photographie et les efforts pour mettre en scène de manière un peu originale le parcours d'une personne qui a tant occupé les écrans.
J'ai en tête deux moments particulièrement bien filmés : la demande en mariage de Lucien Morisse, acceptée mais qui vient trop tard (ce qui nous est montré à l'aide de la dissociation des glaces du miroir de la loge) et l'entrée puis la sortie de la scène du palais des sports de Paris. La réalisatrice Lisa Azuelos a su porter à l'écran le monde des paillettes et sa face cachée.
Pour cela, elle a pu aussi s'appuyer sur la distribution. Tout le monde le dit mais je vais le répéter quand même : dans le rôle-titre, Sveva Alviti est une révélation. Certes, à la base, il y a bien une ressemblance physique entre l'actrice et la chanteuse qu'elle est chargée d'incarner. Mais elle a su acquérir les attitudes et une partie du phrasé de la vedette. Signalons que le film est polyglotte, principalement tourné en français et en italien, avec des touches d'anglais et d'arabe. Quel plaisir que d'entendre la langue de nos amis transalpins !
Sveva Alviti est épaulée par une batterie d'acteurs chevronnés, de Jean-Paul Rouve à Riccardo Scamarcio (excellent en Orlando), en passant par Patrick Timsit et Nicolas Duvauchelle. J'ai cité des comédiens de sexe masculin, parce que la vie de Dalida a été marquée par ses rencontres, aussi bien artistiques que sentimentales, les deux s'entremêlant souvent. Ce biopic est donc aussi le portrait d'une femme (qui tente d'être) libre, qui a aimé l'amour et la chanson d'amour, avant de découvrir, sur le tard, qu'elle pouvait aussi interpréter des titres plus "exigeants".
Du coup, même si on n'est pas un inconditionnel de la chanteuse (dont les titres illustrent les principaux moments de l'histoire), on peut s'attacher à ce portrait de femme, très bien interprété.
16:19 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, musique
mardi, 24 janvier 2017
Un Sac de billes
C'est Christian Duguay (auteur récemment de l'inégal Belle et Sébastien : l'aventure continue) qui s'est chargé de cette deuxième adaptation du récit autobiographique de Joseph Joffo. Il s'est appuyé sur une distribution de luxe, les parents du gamin étant interprétés par Patrick Bruel et Elsa Zylberstein (tous deux très bien). De plus, au détour d'une scène, on croise Christian Clavier (en médecin patelin) et surtout Bernard Campan, excellent en libraire pétainiste.
Mais la meilleure surprise fut pour moi la prestation de Kev Adams, surprenant en résistant juif. Le concernant, on sera attentif au dialogue qu'il entretient avec un officier SS, auquel il finit par lâcher : "Je suis juif... et je t'emmerde !" Je pense que, dans ce cas comme à quelques autres occasions dans le film, les situations ou les dialogues, qui s'écartent parfois un peu de l'oeuvre d'origine, répondent à des problématiques contemporaines.
La première partie de l'histoire est assez emballante. Le film reprend la fameuse scène des clients allemands du coiffeur parisien, l'image lui donnant une tension supplémentaire par rapport au papier. Mais le plus marquant des moments est sans conteste cette soirée au cours de laquelle le père, naguère très fier de sa judéité, donne à ses fils une leçon qu'ils ne sont pas prêts d'oublier...
Peut-être est-ce dû à mon grand âge, mais j'ai davantage apprécié les scènes faisant intervenir les adultes... peut-être tout simplement parce qu'ils jouent mieux que les enfants... surtout mieux que celui qui incarne le héros, à qui j'ai eu plus d'une fois envie de coller des gifles. Il n'y a pas que son jeu qui m'a agacé. Son personnage n'évolue quasiment pas. Il est trop souvent dans la chialerie, alors que le livre de Joffo montre bien qu'il s'est petit à petit endurci, qu'il a beaucoup mûri et, surtout, qu'il est devenu très débrouillard (tout comme son aîné d'ailleurs). Autant de choses qui sont mal rendues dans le film.
Il reste plusieurs très jolis moments à savourer, comme ce morceau de violon en pleine cavale, ou les éructations du libraire antisémite devant son jeune protégé, qu'il prend soin d'emmener à l'église... Je suis donc sorti de là partagé. Le film est tout à fait visible et contient de très bonnes scènes, mais il est gâté par certains défauts. On pourrait aussi regretter que, par rapport au livre, il ait passé sous silence trop d'épisodes marquants (je pense notamment aux rencontres de paysans).
P.S.
La déportation des juifs de Nice fut l'oeuvre notamment d'Aloïs Brunner, une des pires crapules auxquelles le IIIe Reich ait offert une carrière inespérée. On a récemment entendu à nouveau parler de lui. Une enquête publiée dans le magazine XXI affirme qu'il serait mort en 2001, dans les geôles syriennes, après avoir beaucoup servi le père de Bachar el-Assad.
21:13 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films
samedi, 21 janvier 2017
Julieta
Séance de rattrapage cette semaine, grâce au Festival Télérama, qui permet de (re)voir certains des films art et essai qui ont marqué l'année dernière. Dans la liste, je me permets de recommander Elle (ne serait-ce que pour Isabelle Huppert), Café Society (un bon Woody Allen), Frantz (malgré Pierre Minet), Midnight Special (inclassable), Ma Vie de courgette (une animation audacieuse sur le fond). Pour la beauté des images (et pour 3,5 euros), on peut aussi éventuellement tenter La Tortue rouge.
L'auteur de ces lignes fut un fan de Pedro Almodovar, jusqu'au milieu des années 1990. J'aimais son côté déjanté, un peu obsédé sexuel, hein, et je trouvais qu'il savait choisir ses actrices. Ce dernier point n'a pas changé, mais, depuis vingt ans, le cinéaste a pris du bide et semble bander mou. Voilà pourquoi je n'étais pas allé voir Julieta à sa sortie. Concernant Almodovar, je m'étais arrêté définitivement à Volver.
Nous voilà en présence d'un mélo, dont les personnages principaux sont des femmes, en particulier l'une d'entre elles, dont le prénom a donné son titre au film. Elle est incarnée par deux actrices, à deux époques différentes. Celle qui nous guide dans l'histoire a plus de quarante ans. A l'aise financièrement, elle s'apprête à quitter l'Espagne pour partir vivre au Portugal avec son nouveau compagnon, qu'elle a rencontré dans sa "deuxième vie". Mais, soudain, la première va ressurgir.
On la découvre par l'entremise du journal intime que l'héroïne se décide à écrire, en forme de lettre à sa fille qu'elle a tant aimée et qu'elle n'a pas revue depuis plus de dix ans. Les retours en arrière nous font découvrir les débuts de vie d'adulte, avec la séquence marquante du train, puis le séjour en bord de mer. C'est là que tout s'est joué. Les actrices sont épatantes. On retrouve même avec plaisir Rossy de Palma, dans un second rôle piquant voire inquiétant...
Le problème est que c'est cousu de fil blanc. N'importe quel spectateur doté de quelques neurones comprend la véritable raison de la séparation de la fille et de la mère. Les rares péripéties de l'intrigue sont quand même téléphonées (du compagnon pécheur qui prend la mer en pleine tempête à la gamine qui s'éloigne soi-disant pour vivre une retraite spirituelle). Il reste heureusement le savoir-faire d'Almodovar, qui joue avec nous dès la première image, intrigante. Cela donne un film plaisant, sentimental dans le bon sens du terme, mais loin des chefs-d’œuvre qu'il a réalisés auparavant.
20:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 19 janvier 2017
The Birth of a Nation
Ce biopic rend hommage, d'une certaine manière, à Nat Turner, un esclave noir américain qui s'est révolté en 1831, dans l'Etat de Virginie. Derrière et devant la caméra, l'acteur-réalisateur Nate Parker a tenté de concilier film militant et production hollywoodienne.
Pour cela, il a réuni une brochette de comédiens très convaincants, les méchants comme les gentils. Au niveau de la mise en scène, on remarque la volonté d'appuyer là où ça fait mal, sur les nombreuses (et diverses) violences dont les esclaves ont été victimes. Impressionnante est la scène au cours de laquelle un red neck esclavagiste casse les dents de l'une des ses "propriétés", calmement, à coups de marteau. Le metteur en scène n'a toutefois pas osé aller "trop" loin : les viols ne sont que suggérés. On en perçoit toutefois parfaitement les conséquences, grâce au talent des actrices.
La réalisation est assez scolaire et, à ce que j'ai pu en juger, s'inspire de prestigieux précédents. Ainsi, l'inévitable scène du fouet n'est pas sans rappeler ce que l'on voit dans 12 Years a Slave... mais en moins bien. Vers la fin, la bagarre de rue qui oppose esclaves révoltés et milice esclavagiste est un évident décalque du magnifique début de Gangs of New York... sans le talent de Scorsese. Enfin, l'esprit de révolte est bien mieux mis en scène dans l'excellent Django unchained du non moins excellent Quentin Tarantino.
A part cela, c'est du cinéma très correct, mais qui souffre de la comparaison avec d'autres productions, assez récentes et bien meilleures. De surcroît, je soupçonne les scénaristes d'avoir un peu (beaucoup) "tordu" la réalité historique pour servir leur propos (fort louable), à savoir la dénonciation de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est l'impression que j'ai eue après avoir lu Confessions de Nat Turner, un excellent petit livre, publié aux éditions Allia (qui ont eu l'intelligence d'en mettre un extrait en ligne).
Encadré par une présentation et une mise en perspective, on trouve le récit du rebelle, mis par écrit par son avocat juste avant son exécution. On en regrette davantage le film auquel cela aurait pu donner naissance.
19:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, histoire, film, films
samedi, 14 janvier 2017
La Mécanique de l'ombre
Ce polar hexagonal a puisé sa matière dans l'histoire politique récente de la France, en mêlant plusieurs époques, à ce qu'il m'a semblé. Ainsi, en toile de fond, on reconnaîtra des aspects aussi bien de la campagne présidentielle de 1988 (avec la libération des otages du Liban en jeu) que de la rivalité Chirac-Balladur de 1995 ou encore de l'ascension politique de Nicolas Sarkozy (puisqu'il est question d'argent libyen).
Au coeur de l'intrigue se trouvent des écoutes téléphoniques, sans doute illégales. Mais le véritable mystère porte sur le(s) commanditaire(s), que l'on va mettre du temps à découvrir. Nous voilà donc embarqués aux côtés d'un homme ordinaire, cadre moyen qui se retrouve au chômage, en dépit de réelles qualités professionnelles. Cet homme bienveillant, méthodique, qui tente de surmonter sa dépendance à l'alcool et une séparation douloureuse est incarné avec beaucoup de retenue par l'excellent François Cluzet (déjà très bon dans le récent Médecin de campagne).
Mais le film ne serait pas aussi prenant s'il n'était pas épaulé par une formidable batterie de seconds rôles. Parmi eux, qui distinguer ? Evidemment Denis Podalydès, froid et mystérieux. Mais aussi Simon Abkarian, étonnant en agent de terrain fougueux voire incontrôlable. Je n'oublie pas non plus Sami Bouajila, Philippe Resimont (un visage connu des amateurs de séries télévisées) et Alba Rohrwacher (que l'on a pu voir récemment dans L'Ami, François d'Assise et ses frères).
L'autre bonne surprise de ce film est la qualité de la mise en scène. Thomas Kruithof est pour moi un illustre inconnu, mais il fait preuve d'un incontestable savoir-faire. Son principal talent est de savoir susciter le malaise et l'étrangeté autour de l'ambiance de barbouzes. On perçoit très bien la paranoïa qui gagne progressivement le personnage principal, qui va d'ailleurs beaucoup évoluer dans l'histoire. Notons que les scènes d'action comme les moments intimistes sont réussis.
Le scénario est habilement construit. Il associe la vie quotidienne d'un homme qui tente de ne pas perdre pied à la mise en place d'un complot à visée politique. Assez austère sur la forme, le film n'en constitue pas moins une excellente surprise.
12:26 Publié dans Cinéma, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 13 janvier 2017
Passengers
Ces "passagers" sont les 5 000 personnes en hibernation sur un vaisseau spatial en route pour une lointaine colonie. Mais l'on va s'attacher au sort de deux d'entre eux (dans un premier temps), un électro-mécanicien (Chris Pratt, très musclé et très débrouillard) et une journaliste (Jennifer Lawrence, dont le corps -magnifique- a visiblement tapé dans l'oeil du metteur en scène...).
Autant le dire tout de suite : j'ai été passionné par ce film, alors que les deux acteurs principaux font partie des vedettes que j'estime "surcotées". Oh, ils ne jouent pas mal (heureusement !), mais leurs performances n'ont rien d'exceptionnel. (Pour moi, c'est Michael Sheen qui est le plus convaincant, dans le rôle d'un barman-androïde !)
Par contre, derrière la caméra, il y a un type (Morten Tyldum, auquel on doit notamment Imitation Game) qui connaît son affaire. Ce que l'on voit à l'écran est un habile assemblage de décors futuristes très variés et de paysages numériques d'une beauté somptueuse. Dès le début, j'ai été cueilli par cette vision du vaisseau dans l'espace. Et que dire des deux "promenades en terrasse", au cours desquelles les héros profitent de la vue, en scaphandre ! On pourrait aussi parler des plans du réacteur, très réussis.
Mais la scène la plus emballante est celle qui se déroule à l'occasion d'une des pertes de gravité. L'héroïne est alors en train de nager dans la piscine-hublot (une excellente trouvaille, soit dit en passant). La voilà piégée dans une gigantesque bulle d'eau, alors que tous les objets flottent dans la pièce ! Quand on n'a pas l'oeil rivé sur le maillot de bain (exquis) que porte J. Lawrence, on peut pleinement profiter du spectacle.
Ceci dit, le scénario n'est pas d'une grande originalité. Si plusieurs mystères planent sur le vaisseau et son fonctionnement, l'intrigue suit un chemin assez linéaire. La première partie est assez surréaliste : on suit un homme (presque) seul dans une immensité technologique. Les plafonds ont beau être très hauts, c'est parfois étouffant. Puis commence une histoire d'amour un peu particulière, qui va connaître ses hauts et ses bas. Là-dessus se greffe un joli suspense. A un moment, j'ai pensé que l'on se rapprochait un peu trop de Mission to Mars.
On nous ménage suffisamment de rebondissements pour que l'intérêt soit maintenu jusqu'à la fin, que j'ai toutefois trouvée décevante. Mais cela reste un très bon divertissement grand public (moins prise de tête que Premier Contact), à voir absolument sur (très) grand écran.
23:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 10 janvier 2017
Your Name
Au Japon, Makoto Shinkai est un auteur reconnu, dont les précédents longs-métrages ne sont pas sortis en salles en France. C'est donc avec cette œuvre ambitieuse que le grand public va le découvrir. Le scénario mêle la tradition japonaise (les relations entre adolescents), le fantastique et un romantisme échevelé, surtout vers la fin.
Cependant, dès le début, on est frappé par la qualité des images. Sur un grand écran, c'est un réel plaisir des yeux. S'y ajoute une incontestable virtuosité technique, visible par exemple quand une femme fume une cigarette ou quand des personnages se retrouvent dans une voiture : ils sont "filmés" de l'extérieur, à travers le pare-brise et les multiples reflets.
La première partie de l'histoire est assez cocasse : une lycéenne qui s'ennuie dans son village montagnard va vivre temporairement dans la peau d'un garçon de Tokyo qui, à cette occasion, se réveille avec une jolie paire de nichons : le voilà dans le corps de la lycéenne. Cela donne naissance à de bons moments de comédie, un peu appuyés parfois.
Les ados qui ne se connaissent pas vont apprendre à communiquer (leur interversion n'est qu'intermittente). Chacun va essayer d'améliorer la vie de l'autre. Ainsi, le garçon un peu bourru se découvre une part de féminité, ce qui ne laisse pas indifférent une partie de son entourage. Quant à la jeune fille, elle devient tout à coup plus audacieuse et même caractérielle.
Les deux histoires vont évidemment finir par se rencontrer, une fois qu'un mystère aura été résolu. Je ne peux pas en révéler la teneur, mais l'intrigue est marquée par un coup de théâtre qui donne une autre ampleur au film. Il prend alors le chemin d'une mission impossible, à laquelle on a envie de croire... jusqu'à la toute fin, qui n'est pas sans rappeler (partiellement) celle de L'Effet papillon.
En attendant, on aura découvert un peu le "Japon de l'envers", montagnard, rural, où subsistent certaines traditions... et des pouvoirs magiques.
21:58 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 08 janvier 2017
Faut pas lui dire
A première vue, on serait tenté de classer cette production franco-belge dans la catégorie des chick flicks, une expression anglo-saxonne parfois abruptement traduite en "films de gonzesses". Comme les héroïnes sont issues de la classe moyenne, on pense à Sex and the city.
La principale qualité est le rythme. Le tempo est rapide, sur une musique entraînante... et ça ne dure qu'1h30. Les actrices (qu'on a voulues assez différentes les unes des autres) ont la pêche. Toutes les quatre sont belles, amoureuses... et trompées, d'une manière ou d'une autre.
Au coeur de l'histoire se trouve la préparation du mariage de Yaël (Stéphanie Crayencour, qui a des airs d'Alexandra Lamy), un peu la nunuche du groupe. Ses cousines apprennent que le futur, Maxime (Arié Elmaleh, à qui l'on a envie de filer des claques), n'est pas irréprochable. Son infidélité est même un peu plus "corsée" que ce qui est dévoilé dans la bande-annonce. Pour compliquer le tout, l'ancien grand amour de Yaël (caricature d'ex-djeunse qui a gardé sa barbe de trois jours... comme la plupart des personnages masculins, d'ailleurs) est de retour.
Mais la véritable héroïne est la femme de tête du quatuor, Laura l'avocate, dont le personnage s'inspire sans doute du vécu de la réalisatrice, Solange Cicurel, à laquelle ressemble physiquement Jenifer Bartoli, qui interprète le personnage. Elle s'en sort d'ailleurs plutôt bien. Elle aussi se retrouve coincée entre deux mecs, son futur ex-mari (qui semble penser avec sa bite) et un nouveau client, charmeur mais un peu dépassé par les événements.
Ma préférée, la plus drôle de la bande, est Anouch, l'Arménienne folle de son papa (qu'aucun homme ne peut égaler). Du coup, elle batifole, évite de s'attacher... et traite les mecs assez durement. Tania Garbarski donne toute sa fougue à ce personnage moins lisse que les autres.
On termine avec Eve, celle qui semble la plus heureuse, au début. Elle s'agace que tout le monde lui répète sans cesse à quel point elle a de la chance d'avoir un mari séduisant, attentionné et fidèle. Le problème est que cela dure depuis vingt ans et qu'elle s'emmerde un peu ! Comme ses cousines, elle va se retrouver coincée entre deux mecs... et avec une rivale. Dans le rôle, Camille Chamoux est vraiment très bien :
Par contre, si les personnages féminins sont globalement sympathiques, leurs homologues masculins sont plutôt à pleurer. Grosso modo, ce sont des mous et/ou des lâches et leurs interprètes ne contribuent pas à leur donner du relief... sauf Laurent Capelluto (qu'on a vu incarner Imad Lahoud dans L'Enquête). Cela se vérifie au niveau des scènes : celles qui ne font intervenir que les femmes sont très bonnes. Par contre, quand un couple est seul à l'écran, c'est plus inégal.
Heureusement, les dialogues sont assez bons, avec beaucoup de réparties (certaines graveleuses) qui font mouche. Alors, on se laisse volontiers entraîner dans les aventures du sympathique quatuor, en sachant que la conclusion de l'histoire risque d'être prévisible, voire politiquement correcte.
16:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films