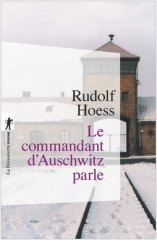jeudi, 22 février 2024
Le Royaume des abysses
Cette animation chinoise (que j'ai pu voir, au cinéma de Rodez, en mandarin sous-titré... trop la classe !) puise à de multiples inspirations : chinoises bien sûr, mais aussi japonaises et françaises (les œuvres de Jules Verne).
Dès l'introduction, on sent la volonté de se calquer sur le modèle japonais qui a réussi : le studio Ghibli. En effet, sur l'un des cartons qui précède le début de l'histoire, on peut voir dessiné un rongeur, emblème de la maison de production chinoise. La conception de l'image rappelle le logo du studio japonais, qui introduit les films d'Hayao Miyazaki.
On est rapidement saisi par la qualité de l'animation, la profusion de couleurs, la fluidité des mouvements. Clairement, ce film marque l'arrivée des studios chinois dans la cour des grands. Ils ont désormais les moyens techniques de rivaliser avec Disney-Pixar, DreamsWorks et leurs concurrents japonais (entre autres). Toutefois, à la longue, cette richesse visuelle devient fatigante. Elle n'est pas toujours utilisée à bon escient, selon moi. Ceci dit, sur un très grand écran, c'est très plaisant à voir.
L'intrigue joue sur un double niveau de lecture. On commence par suivre une famille de classe moyenne, avec deux enfants. On comprend assez vite qu'après départ de sa première épouse, le père de l'héroïne s'est remarié... et vient d'avoir un garçon avec sa nouvelle compagne. Le gamin devient le "petit empereur" de la famille recomposée. La fille aînée, Shenxiu, se sent délaissée, d'autant que sa mère biologique semble avoir coupé les ponts avec sa vie d'avant. La pré-ado est en pleine dépression, ce que presque personne dans son entourage ne remarque. Elle voudrait retrouver sa vie d'avant, surtout la relation forte qu'elle entretenait avec sa mère (qu'elle appelle "Mama" dans la version originale). Une sorte de berceuse sert de leitmotiv à cette relation. C'est je crois une composition d'origine occidentale (au violoncelle), peut-être du Beethoven (ou du Schumann). Au cours d'une croisière, elle se retrouve perdue dans l'océan, où elle pense retrouver sa mère, par l'intermédiaire de créatures fabuleuses. Et c'est parti pour de trépidantes aventures.
C'est agité, avec de l'humour et un fond de cafard. Shenxiu rencontre un chef restaurateur, capitaine d'un bateau-restaurant amphibie, où le personnel comme les clients sont des animaux aux comportements humains. C'est l'occasion pour le cinéaste de se moquer quelque peu de l'attitude des riches Chinois en vacances (réputés pour leur sang-gêne... un peu comme les Français d'ailleurs). Ils sont représentés comme arrogants, obèses, grossiers... Le chef, quant à lui, utilise ses talents culinaires pour s'enrichir, quitte à profiter indûment des créatures de la mer.
Deux d'entre elles attirent l'attention : une sorte de poulpe protéiforme, qui se prend d'amitié pour l'héroïne, et le fantôme rouge qui, quand il surgit, se révèle particulièrement menaçant.
Au bout d'1h30, je commençais à me lasser de la débauche d'effets et d'une petite tendance larmoyante quand s'est produit un coup de théâtre, un twist qui a redonné à tout ce qui précède une saveur supplémentaire. Certes, la fin est un peu trop explicative, jusqu'au générique qui contient des scènes ultérieures, sans doute pour rassurer le public auquel cette histoire un peu sombre aurait fichu le bourdon. (Allez, je vous le dis : ça se termine bien.)
Je pense malgré tout que ce Tang Xiaopeng est un réalisateur à suivre.
00:14 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 19 février 2024
Tout sauf toi
Je n'avais pas entendu parler de la sortie de cette romcom (comédie romantique) mais, ce week-end, en quête de divertissement léger, je me suis laissé tenter par ce film, réalisé par Will Gluck (auquel on doit les deux Pierre Lapin) et dans lequel figure Sydney Sweeney, qui m'avait impressionné l'an dernier dans Reality.
En rentrant (tardivement) dans la salle, j'ai eu un petit choc : il n'y avait quasiment que des femmes dans le public, adolescentes ou jeunes adultes. Complétaient la séance deux mâles grisonnants plutôt bien conservés et quelques femmes entre deux âges. A priori, pas de retraité... ni d'adolescent de sexe masculin (j'ai bien regardé : aucun), ce qui a eu un gros avantage : cela sentait bon, sans odeurs de transpiration, de musc, de pet ou de pieds.
Le scénario est sans surprise : deux très jolies personnes vont se rencontrer, s'attirer, se détester, s'éloigner, se rapprocher, se repousser et, finalement, s'aimer. Je pense ne rien dévoiler d'essentiel. Tout l'intérêt du film réside dans les épreuves que le (futur) couple va devoir surmonter.
La première consiste en l'utilisation d'un cabinet de toilettes, le jour de leur rencontre, dans un café pour bobos. La ravissante demoiselle, Bea (Sweeney, dont la costumière ne nous permet pas d'ignorer qu'elle a un corps de déesse) se retrouve en fâcheuse posture, ce qui lui arrivera de nouveau au cours d'un vol de nuit à destination de l'Australie (Sydney se rendant donc à... Sydney !).
C'est la marque de fabrique de cette romance, qui veut éviter de sombrer dans la guimauve. Certaines scènes sont donc quelque peu "épicées", tout en restant grand public. Le vrai-faux prétendant de Bea, l'irritant et charmant Ben (Glen Powell, qui a dû arrêter de compter les heures passées sur le banc de muscu), va lui aussi connaître les affres de situations embarrassantes. Soyez attentifs aux scènes aquatiques et aériennes... et à ce qui se passe dans les caleçons ! Pauvre garçon...
Durant la première partie (celle de la rencontre, de la rupture puis des retrouvailles, j'ai bien ri. J'ai aussi apprécié la période de chamailleries des deux tourtereaux, invités au mariage de la sœur de Bea, en compagnie des meilleurs amis de Ben, de son ex (venue avec un surfeur doté de deux neurones), des parents de Bea... et du précédent fiancé de celle-ci.
Quand l'ambiance romantique prend le dessus (autrement dit : quand le scénariste décide que les chamailleries doivent céder la place au rapprochement sentimental), je trouve que le niveau baisse et que la dynamique est moins forte. On essaie bien de réintroduire un énorme pénis de l'enjeu en mettant en danger l'union de Claudia et Halle (un mariage gay transethnique, c'est dire si l'on frôle le "politiquement correct" à la sauce démocrate), mais cela fonctionne moyen, même quand on y ajoute la possible séparation définitive des héros.
Tout ce petit monde est interprété par des comédiens dont le recrutement a dû fortement s'appuyer sur des critères physiques. Les dames en particulier sont toutes très minces, avec un joli minois.
J'ajoute que les paysages sont superbes, à tel point que je me suis demandé si ce n'était pas l'office de tourisme de la Nouvelle-Galles-du-Sud qui avait tourné les images. En tout cas, ça donne envie d'y aller.
L'histoire s'achève sur un générique chanté collectivement et composé d'un montage d'images extraites de presque toutes les scènes du film. (En clair : lors du tournage de chaque scène, un moment a été consacré à la future chanson du générique, à charge ensuite pour les monteurs de mixer le tout.)
C'est une sorte d' « objet gentil », comme dirait Luc B.
20:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 18 février 2024
Cocorico
Le scénario de cette comédie sociétale mêle deux arguments narratifs : l'annonce d'un mariage transclasse (entre l'héritière d'un important domaine viticole et le fils d'un ex-garagiste) et la découverte de leurs origines par les quatre parents, par l'entremise de tests ADN lancés en secret par les futurs (?) mariés.
Ces deux-là ont beau jouer un rôle déterminant dans l'intrigue, ils sont moins présents à l'écran que les quatre cadors qui incarnent leurs parents. Je signale quand même la bonne prestation de Chloé Coulloud, très convaincante en jeune femme moderne.
Du côté des géniteurs, on a droit à deux beaux couples caricaturaux. A ma gauche (en haut), se trouvent les Martin, avec Gérard le garagiste devenu concessionnaire Peugeot, fier de sa francitude, marié à Nicole, épouse effacée qui ignore la composition d'une branche de son arbre généalogique. Didier Bourdon et Sylvie Testud nous livrent de fort belles compositions. Je trouve le premier mieux utilisé que dans les films de Philippe Lachaud (et on lui a réservé quelques répliques saillantes). La seconde est épatante, notamment à partir du moment où elle découvre l'origine d'une partie de sa famille. Testud incarne très bien ce personnage qui, d'une certaine manière, part en vrille.
A ma droite (en bas sur la photographie) se trouvent les Bouvier-Sauvage, une famille "vieille France", pétée de thunes, de bonne conscience et de préjugés. Le rôle de Frédéric va comme un gant à Christian Clavier, qui certes en fait des caisses... mais des caisses de Bordeaux grand cru ! A ses côtés, Marianne Denicourt est Catherine, une grande bourgeoise faussement effacée, qui va s'affirmer dans l'adversité.
La première partie nous présente les deux familles et leur rencontre, pleine de sous-entendus. C'est délicieux, caricatural, méchant. Dans la salle, ça ricanait sec.
Tout le monde attend avec impatience de découvrir ce que contient chaque enveloppe. Dans l'ordre, Gérard, Catherine, Nicole et Frédéric vont apprendre à quelle(s) population(s) leurs ADN se raccrochent... et c'est à chaque fois savoureux. Le talent du scénariste-dialoguiste-réalisateur (Julien Hervé, qui parvient presque à faire oublier qu'il a contribué à l'aventure des Tuche...) est de faire rebondir l'intrigue à chaque révélation.
La troisième partie montre les deux couples tentant de gérer les informations concernant leur passé familial. C'est inégal, parfois drôle, parfois totalement anodin. On s'achemine sans surprise vers une fin convenue, qui réconcilie tout le monde, chacun assumant sans excès son arbre généalogique...
... mais ce n'est pas tout à fait fini. Au vu de la manière dont se déroulait l'histoire, je m'attendais à un nouveau coup de théâtre, qui survient tardivement et de manière partielle... sans doute pour ménager la possibilité d'une suite.
Voilà. J'ai ri. Souvent. Peut-être pour de mauvaises raisons. Mais j'ai passé un bon moment.
P.S.
C'est clairement une comédie qui ne vise pas très haut. (Pour une fois, je suis -presque- d'accord avec ce qu'en disent les critiques du Masque & la Plume.) L'auteur s'est montré très sage dans l'exploitation de la face cachée des arbres généalogiques. De ce point de vue, un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? était plus transgressif... et Didier Bourdon qui, jadis, a joué avec Les Inconnus un sketch se moquant du théâtre de boulevard, est devenu un peu l'incarnation de ce qu'il caricaturait autrefois.
22:49 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
Léo
Sous-titré "la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci", ce film d'animation anglo-saxon (intitulé The Inventor dans sa version d'origine) ne traite que d'une petite partie de la vie de Léonard de Vinci, ses dernières années (1516-1519), qu'il a vécues sous l'autorité du pape Léon X (à Rome) puis du roi François Ier (à Amboise).
Il est composé de trois types d'images : celles mettant en scène de petites poupées filmées en stop-motion, celles, plus classiques, dessinées (évoquant des moments d'imagination) et celles qui reproduisent des croquis du "génie florentin" (les plus belles, de très loin). Je suis moyennement convaincu par l'utilisation des poupées et des maquettes. J'ai déjà vu ce procédé à l’œuvre, ailleurs... mieux fait.
Sur le fond, c'est intéressant. On nous montre un créateur protéiforme, obsédé par la recherche de la Vérité (anatomique, spirituelle...), tentant d'échapper aux foudres de l’Église catholique, mais devant se plier aux exigences de son nouveau mécène, le roi de France, hélas présenté comme un adolescent immature (tout comme les souverains d'Angleterre et d'Espagne). Les personnages féminins sont plus captivants, à commencer par celui de la reine mère, Louise de Savoie (doublée par Marion Cotillard), une femme de caractère (à laquelle, hélas, on fait manier l'épée, une totale invraisemblance). Plus cocasses sont les interventions de Marguerite d'Angoulême, la sœur aînée de François Ier (doublée par Juliette Armanet)... et la grand-mère du futur Henri IV. On fait de ce personnage le plus grand défenseur de la modernité (avec Léonard) : femme indépendante, cultivée, entreprenante (déjouant les instructions du roi). On va même jusqu'à présenter le duo Marguerite-Léonard comme précurseur du développement durable...
Le film a toutefois le mérite d'évoquer le projet (réel) de cité idéale, conçu par Léonard et devant être aménagé à Romorantin. Du coup, hélas, tout le reste de son œuvre passe au second plan : la Joconde fait tapisserie et les petites créations mécaniques de l'Italien ne sont introduites qu'en guise d'amusement. En revanche, il est un aspect de la vie de Vinci que le film se garde d'évoquer : son homosexualité. (Je parlerai bientôt d'un autre film, dans lequel, au contraire, le réalisateur fantasme plutôt l'homosexualité de son personnage principal.) Dans son périple français, il est pourtant accompagné de Francesco Melzi, présenté comme son assistant, mais qui était aussi son amant (auquel il a légué ses études et croquis).
Ceci dit, le film en dit déjà beaucoup... et même trop, pour nos têtes blondes (brunes, rousses, chauves...). Les gamins retiendront peut-être que Léonard était gaucher et capable d'écrire à l'envers mais, dans la salle où je me trouvais, les plus jeunes ont rapidement décroché. Pour ceux qui ne connaissaient rien de l'artiste-inventeur, la somme d'informations à gérer est trop importante... et je doute qu'ils aient compris quoi que ce soit quand il est question d'âme.
Du coup, je suis sorti de là mitigé.
09:54 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 16 février 2024
Madame Web
Sony-Columbia suit les traces de Disney, promouvant une nouvelle vague de super-héros, en féminisant et diversifiant (sur le plan ethnique) la distribution. On ne peut pas ne pas voir de similitude avec The Marvels, sorti il y a quelques mois.
Ici, l'intrigue se situe dans l'univers étendu de Spider-Man et s'inspire d'épisodes de comics que je ne connais pas (j'avais déjà arrêté d'en lire à l'époque de leur publication). J'ai donc éprouvé le plaisir de la découverte d'une ambiance à la fois familière et renouvelée, très féminisée.
L'héroïne reçoit très tôt dans la vie des pouvoirs spéciaux (prévoir l'avenir), grâce à une morsure d'araignée... mais je ne révèlerai pas dans quel contexte. Dakota Johnson prête sa plastique avantageuse à cette Cassandra Web, destinée plutôt à jouer le rôle de grande sœur dans ces aventures....
... eh, oui, la pauvre. Non seulement elle risque sa vie pour sauver celle de trois adolescentes qui mériteraient quelques gifles, mais, en plus, elle doit jouer le rôle de mère de substitution, un aspect intéressant du scénario : il met en avant une forme de "sororité" (une fois que les pisseuses ont pris un peu de plomb dans la tête) et critique indirectement la famille américaine de classe moyenne, dont sont issues les ados.
Celles-ci sont une illustration des quotas désormais à l’œuvre dans toute grosse production qui se respecte outre-Atlantique : le trio est composé d'une WASP, d'une Afro-américaine et d'une Latino. (Un partout, la balle au centre.) Notons que, si le film promeut l'égalité et l'inclusivité, c'est toujours par l'intermédiaire de petites bombasses hétéros, en mini-jupe ou crop top. (De ce point de vue, The Marvels était un poil plus audacieux, avec deux des héroïnes "bien en chair" et un soupçon d'homosexualité chez au moins une des trois.)
Ces (provisoirement) fragiles jeunes femmes se retrouvent confrontées à un mâle alpha, une sorte de self-made man doté de super-pouvoirs, incarné par... Tahar Rahim, ma fois très convaincant. Le plus intéressant dans l'histoire est que, pour le vaincre, les jeunes femmes vont devoir s'entraider et surtout... utiliser leur cerveau. Rien que pour cela, je trouve que ce film mérite le détour. Les effets spéciaux sont de qualité et, si le scénario souffre parfois d'approximations et d'un peu trop de "juste à temps", on passe un bon moment.
P.S.
Le public habituel des adaptations de comics, plutôt masculin et adepte d'une vision traditionnelle des rôles (le mec baraqué en sauveur, la jolie demoiselle impressionnée par la grosse bosse dans son costume hyper-moulant son altruisme et ses super-pouvoirs) semble ne pas avoir apprécié cette nouvelle recette : le film se fait méchamment (et - à mon avis - injustement) descendre sur Allociné dans l'évaluation des spectateurs.
22:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 14 février 2024
Chien & chat
Cette comédie romantique joue sur les relations entre les membres d'un double duo, celui formé par une chatte instagrameuse et un chiot abandonné d'un côté, une influenceuse et un cambrioleur de l'autre. Les premiers sont doublés (avec talent) par Inès Reg et Artus. Les second sont incarnés par Reem Kherici (la réalisatrice) et Franck Dubosc.
Ces associations jouent sur les contrastes : un chien et une chatte (numériques) d'un côté, une tonitruante influenceuse et un cambrioleur discrétissime de l'autre. Sans surprise, ceux qui, au départ, ont du mal à se supporter, vont finir par s'entraider et s'apprécier.
Si la fin est des plus convenues, le chemin pour y parvenir l'est moins. On nous propose une série de péripéties assez rocambolesques, avec cascades et situations cocasses à la clé. C'est bien filmé, de manière efficace, et monté au cordeau. Une présence apporte un peu de sel à cette histoire, celle d'un étrange policier, à la fois redoutable adversaire et personnage destiné à s'en prendre plein la figure, que ce soit à cause des animaux ou des humains. Dans le rôle, Philippe Lacheau (venu prêter main-forte à son ex) excelle.
Derrière la caméra, Reem Kherici se débrouille plutôt bien. Sans atteindre le niveau des films tournés par Lacheau, le résultat est meilleur (et moins vulgos) que le récent 3 jours max (de Tarek Boudali). Dans la salle, on a ri, de sept à soixante-dix-sept ans.
23:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Vivre avec les loups
Jean-Michel Bertrand est de retour, avec son sujet de prédilection... et une cadreuse/directrice de la photographie de talent : Marie Amiguet, dont on a pu déjà apprécier le travail sur La Panthère des neiges.
Bertrand est un amoureux de la nature, de la montagne, un mec sincère, selon moi. On l'accuse parfois d'être le loup écologiste qui s'avance revêtu d'une peau de brebis. Je trouve qu'ici le propos est moins manichéen que dans ses précédents films, notamment La Vallée des loups.
La moitié du temps, on le suit à l'affût, dans sa cabane au Canada alpine ou à proximité. C'est toujours aussi passionnant à suivre, que les images soient de beaux plans chiadés ou des extraits des caméras à déclenchement automatique. (Même les scènes montrant la vie quotidienne -rustique- de Bertrand sont intéressantes.) On retrouve une grande partie de la faune sauvage aperçue auparavant. Le cinéaste se concentre sur les loups, notamment un couple qu'il avait repéré. La femelle était sur le point de mettre bas... mais il n'a jamais vu les petits. Les parents eux-mêmes ont disparu... et une (autre) petite meute est apparue, à la limite de leur territoire.
C'est l'un des grands mérites de ce film (notamment par rapport aux précédents) : ne pas hésiter à montrer à l'écran les effets de la violence de ce prédateur, sur la faune sauvage, mais surtout sur la faune domestique.
L'autre moitié du film (par morceaux) narre les voyages de Bertrand, dans différentes régions où la présence du loup est avérée. On va de l'Italie du Nord à la Normandie, en passant par la Bretagne, le Massif Central et la Suisse. A chaque fois, le cinéaste rencontre des éleveurs et des bergers, qu'il a sans doute choisis parmi les moins hostiles au loup. (Les autres l'ont peut-être menacé, comme le suggère une courte scène du début.) J'ai bien aimé voir ces jeunes, plutôt citadins d'origine, exposer leur ressenti, leurs doutes quant à leur "mission" : contribuer à faire exister un élevage résilient, qui s'habituerait à la présence du loup (grâce à la pose de clôtures et à la présence de chiens, notamment patous).
Le film est suffisamment bien fait pour que partisans et adversaires du loup s'y retrouvent (au moins en partie). Je remarque que, parmi les jeunes bergers qui continuent à croire en la coexistence possible, c'est plutôt le fatalisme qui domine : les éleveurs devraient se résigner à un "pourcentage de pertes"... On est libre d'adhérer ou pas à ce propos.
Il me reste à aborder le principal point faible de ce documentaire : la contextualisation. Un parc naturel national (comme celui des Écrins) n'a pas les mêmes fonctions qu'un parc naturel régional (comme celui de l'Aubrac ou des Grands Causses en Aveyron). L'objectif principal d'un PN est la conservation du milieu naturel. L'activité humaine est même proscrite en zone cœur. Là est possible la réintroduction d'un prédateur tel que le loup. En revanche les PNR, conçus par les acteurs locaux, sont d'abord des outils de développement rural. On tente d'y concilier activités humaines et protection de l'environnement. La réintroduction du loup dans ces espaces menace le concept même de parc régional ainsi que le maintien de certaines appellations agricoles (AOP, IGP), qui induisent un élevage extensif, le seul menacé par le retour des grands prédateurs.
P.S.
Avec ce film, Jean-Michel Bertrand ne livre pas un simple nouveau documentaire. Il semble faire une sorte de bilan. Il m'a un peu rappelé le Luc Jacquet de Voyage au pôle Sud.
15:27 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
La Zone d'intérêt
Grand Prix au dernier festival de Cannes (certains affirmant que c'est la vraie Palme d'or), cette fiction à caractère documentaire de Jonathan Glaser a été tournée en allemand (pour plus de réalisme, je présume). Les dialogues n'y occupent toutefois guère de place, l'essentiel du signifiant étant porté par ce que l'on voit à l'écran... et ce que l'on n'y voit pas, mais dont on devine la présence.
C'est toute la question qui se pose, quand on traite du fonctionnement du camp d'Auschwitz (qui, rappelons-le, fut un camp triple : d'abord de concentration, auquel se sont ajoutées deux annexes, une usine chimique et un centre d'extermination, Birkenau).
C'est dans ce sens je pense qu'il faut comprendre l'écran noir du début. Certaines choses sont immontrables, mais on peut quand même les évoquer avec force, grâce à la mise en scène.
Il convient donc d'être attentif aux détails, à ce qui entre au domicile de la famille de Rudolf Hœss, à ce dont on discute le plus souvent à demi-mots, à ce qu'on peut voir quand on est à la porte d'entrée ou dans le jardin.
Le reste du temps, on nous présente la vie ordinaire d'une famille traditionnelle de cadre supérieur, l'épouse s'occupant du foyer, l'époux partant au travail le matin, revenant le soir. L'épouse (tout aussi nazie que le mari) dispose de domestiques, soit des Polonaises (catholiques) du coin, soit des détenues allemandes (non juives). Toutes sont consciences de la précarité de leur situation et des petits avantages qu'il y a à travailler sous la houlette d'une maîtresse de maison, même acariâtre.
Cella-ci, interprétée par Sandra Hüller, vole presque la vedette à Christian Friedel (qui incarne Hœss). Le directeur du camp (de 1940 à 1943) gardera une partie de son mystère, tandis que le caractère de son épouse se dévoile au fur et à mesure que le film avance... et ce n'est pas à l'avantage du personnage.
Martyriser des déportés et exterminer des juifs et des Tsiganes est donc un travail comme les autres pour les cadres nazis. Ils prennent soin de célébrer l'anniversaire du patron, à l'entrée de sa maison, de l'autre côté de la rue où commence le camp. Dans son salon, Hœss reçoit des gradés et les représentants d'entreprises qui tentent d'obtenir un marché crucial : celui de la construction de nouveaux crématoires et de nouvelles chambres à gaz. On est en pleine horreur humaine, mais filmée de manière glacée, frontale, sans explication. J'ai trouvé cela brillant, mais pas facile à supporter sur le plan émotionnel.
Une séquence particulièrement signifiante est celle de la venue de la belle-mère de Hœss. Ancienne femme de ménage, elle vit comme une ascension sociale le mariage de sa fille avec un dignitaire nazi. Elle est ravie de découvrir la maison de maître (même si elle n'est pas aussi grande qu'elle se l'imaginait), la présence de domestiques (aucune n'étant juive, prend-on la peine de lui préciser)... et les petits à-côtés. Elle a appris qu'une de ses anciennes patronnes juives a été déportée au camp, sans que cela l'afflige... mais elle ne sait pas tout. Durant son bref séjour, elle va dormir dans l'une des chambres des enfants du couple Hœss. (Ils ont cinq gosses !) L'une des fenêtres donne sur le camp. De temps en temps, de la fumée sort de cheminées, au loin. Elle entend ce qui ressemble à l'arrivée de trains, des cris étouffés... La belle-mère finit par comprendre ce qu'il se passe "de l'autre côté". Je laisse à chacun(e) le plaisir de découvrir sa réaction.
Tout le film est comme cela, par petites touches glaçantes, la caméra et le hors-champ suggérant beaucoup, pour qui prend la peine d'écouter, de regarder et de réfléchir.
Certes, compte tenu de son sujet, c'est un film assez pénible (sur le fond), mais, sur la forme, c'est magistral.
P.S.
Pour mieux comprendre la psychologie de Rudolf Hœss, on peut lire son autobiographie (rééditée en collection de poche), rédigée quand il était emprisonné en Pologne, attendant d'être jugé, après guerre. En dépit des tentatives d'autojustification (énoncées sans doute pour échapper à la peine de mort), son témoignage est fort instructif, à la fois sur l'auteur et sur le milieu dans lequel il a évolué, de sa jeunesse au commandement du camp.
14:04 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
lundi, 12 février 2024
Pauvres Créatures
J'ai enfin pu voir (en version originale sous-titrée) ce film de Yorgos Lanthimos, une sorte d'anti-conte de fées féministe. Cela démarre dans une ambiance victorienne, chez un médecin au visage rafistolé qui fait immanquablement penser à la créature du docteur Frankenstein... sauf que ce Godwin Baxter est médecin, du genre inventif. Dans le rôle, Willem Dafoe est (une fois de plus) épatant. La caméra, par le choix des focales et des prises de vue, contribue à un sentiment d'étrangeté. La musique est à l'unisson.
On découvre très vite l'étrange fille de "God", Bella, au comportement erratique, fantasque. Elle est cruelle et sans filtre, à l'image d'une grande enfant à laquelle on n'aurait pas enseigné les limites. Le film est l'histoire de son auto-éducation, de sa libération et de son asservissement. Emma Stone prête corps et esprit à ce personnage hors du commun. Elle irradie durant tout le film.
Un déclic se produit quand la jeune femme goûte au "fruit défendu", d'abord toute seule, puis en compagnie d'un bellâtre narcissique, incarné par un Mark Ruffalo surprenant. Leur idylle prend chair dans un Lisbonne uchronique, mis en scène avec un incontestable brio. Petit à petit, le rapport de force s'inverse entre le vieux beau et sa jeune apprentie, qui prend de l'assurance.
Un autre tournant survient durant une croisière de luxe. C'est l'occasion pour l'héroïne d'acquérir d'autres "compétences" que sexuelles. Une dame âgée lui fait découvrir la littérature. Le temps de la maturation intellectuelle commence, ce qui conduit la jeune femme à porter un autre regard sur les adultes qui l'entourent. Toujours aussi bien mise en scène (et interprétée), cette partie m'a enchanté.
Je n'en dirais pas autant de l'épisode parisien. Visuellement, il rappelle la période lisboète. C'est donc joli à regarder, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (avec toujours une bonne utilisation des espaces). Mais, sur le fond, je n'ai guère goûté cette quasi-apologie de la prostitution volontaire, appuyée de surcroît par une mise en scène limite putassière. On sent que le réalisateur a aimé filmer les corps nus, dans des positions peu valorisantes. J'y ai vu comme une mise en abyme, la comédienne se prostituant volontairement à la caméra.
L'intrigue rebondit dans les deux dernières parties, que je ne raconterai pas. L'intérêt pour le film grandit à nouveau, jusqu'à une conclusion assez piquante.
Voilà. J'ai été emballé. C'est brillant sur le plan visuel, les plans étant nourris de détails parfois croquignolesques, comme ces animaux chimères dans le jardin du médecin. Sur le fond, c'est signifiant, même si je ne suis pas toujours d'accord avec le propos. Après La Favorite et The Lobster, Lanthimos confirme qu'il est l'un des réalisateurs les plus talentueux de notre époque.
10:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 11 février 2024
Le Royaume de Kensuke
C'est à un duo britannique que l'on doit cette animation (adaptée d'un roman), destinée a priori à tous les publics. L'intrigue doit se dérouler dans les années 1990, même si aucun contexte précis n'est donné. On sait juste que le vieil homme qui habite l'île perdue est un ancien soldat japonais, sans doute âgé de 70-80 ans. On pense évidemment à Onoda, même si son histoire est quelque peu différente.
Avant d'en arriver à cette rencontre, on découvre une famille (britannique) en vacances, sur un voilier. La père et la mère sont accompagnés de leurs deux enfants, l'aînée plus mature que le cadet, un garçon assez capricieux... dont on finit par comprendre qu'il est parvenu à introduire un passager clandestin... plutôt une passagère... très poilue (Stella).
Ce début m'a un peu agacé. J'y ai retrouvé, concernant les enfants et adolescents, des clichés trop souvent répandus dans le cinéma de fiction. Soit c'est un lieu commun pour les auteurs du Septième art, soit c'est une méthode peu subtile pour faire avancer le scénario dans la direction voulue (les gamins/ados faisant immanquablement de grosses bêtises), soit nos amis les artistes vivent dans des familles peuplées de gosses mal élevés. J'en côtoie (pré-adolescents comme adolescents) assez régulièrement et je trouve que l'écrasante majorité d'entre eux est bien plus fréquentable que les personnages censés les représenter sur grand écran.
De ce début je sauverais juste l'apparition de la passagère clandestine poilue, incontestablement la plus sympathique des protagonistes... de surcroît très bien dessinée et animée. Il ne lui manque que la parole !
Pour moi, le film décolle vraiment à partir du moment où l'action se déroule sur l'île. La qualité du dessin est particulièrement visible au niveau des animaux : orangs-outans, oiseaux, insectes... La forêt équatoriale (tropicale ?) réserve bien des surprises, une fois que ce petit con de Michael commence à l'explorer. Il y entre en contact avec le Kensuke du titre, le seul autre occupant humain... qui ne parle pas la même langue que lui.
Un des enjeux de l'histoire est la naissance de cette improbable relation amicale, entre un gamin qui va rapidement beaucoup apprendre de la vie et un vieillard qui au départ ne goûte que la compagnie des forces de la nature. L'insertion progressive du gamin dans la vie quotidienne de Kensuke est touchante (bien que, là encore, agaçante au départ).
D'autres humains vont débarquer sur l'île. Ils représentent clairement une menace : ils sont armés et se déplacent dans un bateau d'où s'échappe une vilaine fumée noire. On n'en saura guère plus sur eux. Ils sont juste là pour servir de repoussoir... tout comme l'armée américaine, présente dans les souvenirs de Kensuke.
Celui-ci, comme Michael, a "perdu" sa famille et a trouvé du réconfort dans la compagnie des animaux. Les deux humains vont tisser des liens, entre eux et avec les animaux, dans un contexte de quasi-paradis tropical, tellement bien aménagé par le vieil homme qu'on se croirait parfois dans un village-vacances écolo-responsable.
C'est, pour moi, là où le bât blesse. Au-delà des belles images et du propos tout à fait louable en faveur du respect de la nature, on nage en plein politiquement correct, avec de gros sabots. Pour des adultes, cela manque singulièrement de subtilité. Pour des enfants, cela peut passer.
Un film à recommander aux (grands)parents de gauche qui voudraient formater l'esprit de leurs (petits)enfants.
23:23 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
A Man
C'est un peu par hasard que je suis allé voir ce film japonais, d'un réalisateur inconnu (Kei Ishikawa). J'ai été attiré par l'histoire de l'épouse qui découvre, à la mort de son mari, qu'il n'était pas celui qu'il prétendait.
Mais avant d'en arriver là, le cinéaste prend son temps. Il nous conte la naissance d'un amour, en province. Lui est un jeune homme emprunté, dessinateur compulsif, nouveau venu dans la petite ville. Elle est la fille de commerçants du coin. Elle a vécu à Yokohama (dans le Grand Tokyo), s'y est mariée, a eu deux enfants, puis a divorcé. Elle est revenue épauler ses parents dans la boutique de papeterie, juste avant la mort de son père. Ce contexte familial n'est pas ce qu'il y a de mieux mis en scène. En revanche, la naissance de l'histoire d'amour est belle, tout comme la description d'une nouvelle vie de famille... jusqu'à l'accident. (Notons que les scènes de sylviculture sont plutôt bien conçues et font respirer l'intrigue.)
A partir de là, le polar prend le dessus. La jeune veuve engage son ancien avocat (qui l'a aidée pour son divorce). Celui-ci va donc enquêter sur le mari... mais aussi sur une personne qui porte le même nom. Dans le même temps, on découvre la vie privée du juriste, un beau gosse assez brillant, qui a la particularité d'être d'origine coréenne, ce que son beau-père (extrême-)droitier n'oublie pas de rappeler à l'occasion d'un repas de famille. J'ai aussi bien aimé les scènes de travail, au cabinet juridique, qui font intervenir l'avocat et son associé.
En fait, l'enquête est un prétexte pour aborder des thèmes sociaux : l'usurpation d'identité, la disparition volontaire, la peine de mort, le racisme (principalement anti-coréen)... ainsi que l'univers de la boxe ! La deuxième partie du film est vraiment passionnante, tout en étant marquée par une grande délicatesse dans la peinture des relations humaines.
Le personnage du fils aîné de l'héroïne prend un peu d'ampleur. Il se pose des questions sur son identité. Tout jeune, il a porté le nom de famille de son géniteur (qu'il a peu connu), avant de prendre celui de sa mère, après le divorce. Le remariage de celle-ci l'a conduit à adopter le nom -officiel- du bûcheron dessinateur, dont il apprend qu'il est usurpé. L'incertitude quant à l'identité réelle du second mari a des répercussions inattendues, au niveau des rites funéraires mais aussi de la transmission du produit d'une assurance-vie.
Le séduisant avocat fait preuve d'une singulière opiniâtreté dans la résolution de cette affaire. Elle semble prendre un tour de plus en plus personnel. Cette dernière partie est un peu plus languissante, peut-être un poil moins réussie que les précédentes. Le réalisateur finit par boucler ses trois arcs narratifs... et nous réserve un petit coup de théâtre final, que chacun interprètera à sa guise.
La sortie de ce film fut discrète, mais je conseille de ne pas le rater s'il passe près de chez vous.
P.S.
Certains des acteurs paraîtront familiers aux amateurs de productions japonaises. Ainsi, l'avocat est incarné par Satoshi Tsumabuki, vu l'an dernier dans La Famille Asada, tandis que Sakura Andô (la veuve) figure dans la distribution du récent Godzilla Minus One. Quant à Akira Emoto (qui interprète un criminel emprisonné), c'est un vétéran du septième art nippon, qu'on a pu voir dans L'Anguille, Zaitochi ou encore John Rabe.
10:21 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 09 février 2024
Chasse gardée
Au mois de janvier, ce film a été l'un des plus gros succès (en terme d'entrées) au cinéma de Rodez, avec... Les SEGPA au ski... ce qui a fait dire à l'une de mes connaissances que la succession de la vieille génération de beaufs était déjà assurée.
Faisant fi de ces préjugés, je me suis glissé dans une salle obscure, histoire de vérifier si cette comédie de prime abord franchouillarde ne valait pas mieux que cela.
Le début est sans surprise, chaque groupe socio-professionnel étant dans son bain, une sorte de nouvelle version des rats des villes et des rats des champs. (Cette amorce ne donne pas du tout envie de vivre à Paris.)
On attend avec impatience que débute la confrontation. Le réalisateur Frédéric Forestier (auquel on doit aussi bien Le Boulet et Stars 80 que Les Bodin's en Thaïlande...) fait durer le plaisir : les ruraux accueillent plutôt bien les Parisiens, qui font des efforts pour s'intégrer à la vie du village picard.
La première partie de chasse est assez spectaculaire. C'est l'occasion de découvrir un sanglier dont on n'a pas fini d'entendre parler dans la suite de l'histoire. L'intrigue commence à se corser quand débarque peut-être la meilleure séquence, celle qui fait intervenir Thierry Lhermitte (le papa de la Parisienne, accessoirement redoutable avocat). Le repas de chasse vaut son pesant de terrine... et il est une nouvelle preuve qu'en France, la bouffe et le pinard contribuent au "vivre ensemble".
La suite vire à la quasi-guerre civile. C'est plaisant parce que, des deux côtés, les comédiens ne se prennent pas au sérieux... tout en incarnant leur personnage avec conviction.
Le scénario ménage plusieurs rebondissements. Tout le monde en prend pour son grade et, au final, chacun fait des concessions. L'histoire se conclut de manière consensuelle (anciens et néo-ruraux se coalisant contre une nouvelle menace), sur une chanson de Bourvil.
Ce n'est pas la comédie du siècle, mais elle détend... et, comme dasola, je trouve qu'elle vaut mieux que ce qui transparaît dans la bande-annonce.
P.S. I
Le titre fait référence à une réplique, dans la bouche d'un personnage féminin... non chasseur.
P.S. II
Didier Bourdon figurant en tête de distribution, les spectateurs de ma génération attendent avec impatience le moment où il sera fait allusion au célèbre sketch des Inconnus... Il faut patienter longtemps, jusqu'à une partie de chasse qui vire au complot.
21:44 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
mercredi, 07 février 2024
Daaaaaali !
Anaïs Demoustier
Edouard Baer
Jonathan Cohen
Pio Marmaï
Didier Flamand
Jean-Marie Winling
Romain Duris
Gilles Lellouche
Boris Gillot
... nous ravissent dans le dernier film de Quentin Dupieux. Outre la performance des acteurs (au premier rang desquels je place Jonathan Cohen et Edouard Baer), il faut signaler l'inventivité de la mise en scène et l'habileté du scénario, mieux ficelé que d'habitude. On a ainsi droit à des récits emboîtés, des scènes tournées à l'envers, de la mise en abyme, du non-sens, de l'incongruité... et pas mal d'humour.
Outre celui de Salvador Dali, l'esprit de Luis Buñuel souffle sur ce film enlevé, qui se moque de tout sauf de son public et égratigne au passage aussi bien le marché de l'art que le vedettariat.
Voilà l’œuvre qui aurait dû représenter la France aux Oscar !
20:44 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, art, culture, peinture
La Tresse
J'ai fini par me laisser traîner dans une salle obscure pour voir l'adaptation du roman à succès de Laetitia Colombani (par elle-même). Dans la salle, j'ai ressenti la curieuse impression qu'une brochette de mâles étaient dans la même situation que moi.
Hélas, seules des séances en version doublée sont disponibles dans mon cinéma local. Pour la partie canadienne, ce n'est pas gênant. Les voix semblent correspondre aux personnages. Cela devient limite pour la partie italienne, durant laquelle j'aurais tellement aimé entendre parler la langue de Giorgia Meloni Dante. De surcroît, dans cette partie, il est question d'un migrant indien (sikh) qui tente de s'améliorer dans la compréhension et la pratique de l'italien. (A ce sujet, on remarque qu'il progresse très rapidement dans la compréhension de l'Italienne...) Le pire est atteint dans la partie indienne. Elle est très correctement filmée mais, la plupart du temps, les voix ne correspondent pas aux personnages. Cela m'a gêné.
J'ai tout de même apprécié ces portraits de femmes lumineuses, de la mère de famille intouchable qui veut un autre destin pour sa fille unique à la brillante avocate divorcée, en passant par la jeune fille de patron de PME, assez anticonformiste. Chez ce personnage, j'ai particulièrement aimé qu'on montre une protagoniste adepte de la lecture, une activité hélas souvent complètement absente des films de fiction.
Je ne suis toutefois pas emballé par le cœur de l'intrigue. Le scénario place progressivement les trois héroïnes au fond du trou, de manière très appuyée. C'est assez attendu concernant l'Intouchable, dont j'aime toutefois qu'elle conserve sa combativité. (Par contre, sa gamine...) J'ai trouvé très datée (ie patriarcale) l'ambiance familiale italienne. Sérieusement, au XXIe siècle, en Italie ? J'ai été presque énervé par la partie canadienne, avec une héroïne agaçante à force de vouloir tout contrôler : avocate géniale, super-maman et guerrière implacable contre le cancer. Le principe de réalité finit par s'imposer à elle, mais il n'était pas nécessaire d'être aussi manichéen.
Bref, ce n'est pas inintéressant (surtout dans la V.O. à mon avis), mais c'est trop surligné pour moi.
13:32 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
dimanche, 04 février 2024
Le Dernier des Juifs
... de sa cité. Tel est le sort qui pend au nez de Bellisha, une sorte de Tanguy juif, qui ne parvient pas à quitter l'appartement familial, qu'il partage avec sa mère, gravement malade. L'immeuble comme le quartier, jadis marqués par la présence juive (notamment originaire d'Afrique du Nord) est aujourd'hui majoritairement peuplé de (descendants de) migrants musulmans, certains hostiles aux "sionistes de merde" comme ils sont parfois appelés.
Noé Debré réussit le tour de force de traiter avec malice (et subtilité) de sujets sérieux : la montée d'un virulent antisémitisme paré de la défense des Palestiniens, la nostalgie d'un monde qui n'est plus et les soubresauts d'une relation mère-fils.
Le film doit beaucoup à la qualité de ses deux interprètes principaux : Agnès Jaoui en mère juive lucide (qui fait semblant de croire aux mensonges de son fils) et Michael Zindel, tout en finesse, dans le rôle d'un jeune rêveur qui ne veut pas se laisser enfermer dans les préjugés et les catégories édictés par les adultes. (Il entretient une relation secrète avec une jeune métis... mariée !) On pourrait croire son personnage destiné à être broyé par la méchanceté humaine, mais en fait il est à la fois habile et désarmant, tout comme le scénario.
Celui-ci joue sur les clichés et les préjugés qui entourent nos concitoyens juifs. Ainsi, dès qu'un drame survient au Proche-Orient, certains abrutis en tiennent pour responsables les juifs du monde entier, y compris ceux de Seine-Saint-Denis. Pas de bol pour eux : ils se trompent d'appartement, l'inscription antisémite "décorant" la porte d'entrée des voisins... chinois. Plus tard, le domicile de Giselle et Bellisha finit par être cambriolé... mais les voyous n'y trouvent rien d'intéressant, alors qu'ils croyaient les "feujs" pétés de thunes...
Le second degré est aussi présent dans la manière dont les deux "assiégés" évoquent leur situation. Ainsi, lorsque la mère parle de la nécessité de quitter le quartier, plusieurs solutions sont envisagées, en France... et à l'étranger. Mais, lorsque son fils (pourtant partisan de rester) évoque la possibilité d'émigrer en Israël, c'est la mère qui refuse, jugeant que là-bas, c'est plein de juifs et que, du coup, ils risquent fort de se faire escroquer !
Le même procédé est à l’œuvre quand Bellisha héberge un jeune délinquant de la cité d'origine subsaharienne. Celui-ci lui avoue ne pas aimer les juifs... mais que, lui ça va, il l'apprécie. Quand Bellisha, interloqué, lui demande s'ils connaît d'autres juifs (ce qui pourrait expliquer la mauvaise opinion qu'il a d'eux), le délinquant lui répond que non, avant de se souvenir d'un mec qui a joué dans le même club de foot que lui... avec qui il s'entendait bien.
D'autres moments sont tout aussi réjouissants et signifiants, comme le passage avec les élus municipaux (d'ardents défenseurs de la "cause" palestinienne... qui ne veulent surtout pas être soupçonnés d'antisémitisme) ou celui du cours de krav-maga, durant lequel le frêle Bellisha montre qu'il possède des ressources inattendues. J'ai aussi adoré l'une des séquences du début, qui voit le jeune homme tenter de faire signer un contrat d'installation de pompe à chaleur à un vieil homme alcoolique.
Le dernier tiers du film est plus dans l'émotion, avec la relation mère-fils qui prend un tour moins joyeux. J'ai été touché, par cette partie comme par le reste de l'histoire, qui baigne dans les chansons d'Enrico Macias, sur fond de quartier HLM.
Compte tenu du contexte à la fois français et international, le film a hélas peu de succès. Je conseille de se précipiter pour le voir tant qu'il est à l'affiche.
22:37 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 03 février 2024
Argylle
Le nouveau long-métrage de l'un des enfants terribles d'Hollywood, Matthew Vaughn, oscille en l'hommage et la parodie de classiques du film d'espionnage ou d'action. On est immédiatement mis en condition avec une séquence brillante qui entremêle les clins d’œil au dernier James Bond et à Mission impossible. On sent aussi que, derrière la caméra, Vaughn veut montrer qu'il n'a rien à envier à certains petits maîtres contemporains. Il le confirme avec l'éblouissante séquence du train, à la fois ultraviolente et cocasse, décalque évident de Bullet Train. Dans le rôle de l'agent aussi redoutable que décontracté, Sam Rockwell est chargé de faire (un peu) oublier Brad Pitt. Je trouve qu'il y arrive. Globalement, il réalise une excellente performance dans ce film.
La séquence du train (pour moi la meilleure du film) n'est pas un simple décalque de son modèle. Elle met en œuvre certains des principes appliqués par Vaughn tout au long de l'histoire, avec un montage haché, limite virtuose, qui entretient la confusion entre la fiction et la réalité. Le cinéaste nous embarque dans un périple violent et halluciné, gagné par la surenchère.
Ce sont souvent les acteurs que l'on voit dans au moins deux versions d'une histoire qui s'en sortent le mieux. Ils nous montrent plusieurs facettes de leur talent. Cela nous amène à Bryce Dallas Howard, dont le personnage d'Elly est le plus protéiforme de l'intrigue. La comédienne rend crédible presque toutes ses incarnations... mais, au bout d'un moment, cela finit par ne plus être vraisemblable du tout (en gros : dès qu'elle porte la robe jaune, vraiment moche... Il paraît que c'est du Versace...).
Visiblement, la production a laissé les mains libres à Vaughn. Résultat : 200 millions de dollars pas toujours bien utilisés. Je pense notamment à l'une des séquences de baston, évidemment parodique, évidemment référencée : celle qui se déroule dans le mystérieux QG de la Division. C'est une relecture rose-bonbon d'un des Kingsman que j'ai trouvée proche du ridicule, quand bien même la mise en scène serait chiadée. (Et donc oui : Vaughn s'autoparodie...)
Pendant environ 1h30, c'est drôle, surprenant, enlevé. On accepte les "juste à temps", quelques grosses ficelles et des acteurs qui en font des caisses... même le chat cabotine ! (Mais, celui-là, je l'adore !) Les trente dernières minutes tombent dans l'action-guimauve, avec un manque de vraisemblance devenu excessif. Dommage, parce deux gros tiers du film sont bien.
20:37 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 02 février 2024
La Ferme des Bertrand
Ce documentaire agricole retrace les grandes évolutions d'une exploitation familiale (bovine), en Haute-Savoie (commune de Mieussy), de 1972 à 2022. Les images ont été tournées en 1972 (en noir et blanc), en 1997 (en couleurs, "granuleuses", de format carré) et en 2022 (de très bonne qualité). L'auteur est un documentariste connu, Gilles Perret, engagé à gauche. On lui doit notamment Les Jours heureux et La Sociale. Ici (peut-être parce qu'il est originaire du coin), le propos militant a tendance à s'effacer derrière la volonté de rendre hommage à une lignée de travailleurs.
Les images datant de 1972 sont les moins nombreuses. On y voit un trio de frères, jeunes, vigoureux, qui ont repris l'exploitation familiale après des trajectoires diverses, l'un des trois étant, dans un premier temps, parti chercher son bonheur à la ville. Deux d'entre eux ont effectué leur service militaire en Algérie. Au début des années 1970, l'exploitation n'est quasiment pas mécanisée.
Vingt-cinq ans plus tard, en 1997, les trois frères sont toujours à l’œuvre... et toujours célibataires. Du coup, c'est l'un de leurs neveux, Patrick, qui les a rejoints. (Il est sans doute le fils de l'une de leurs sœurs.) Lui est marié (à Hélène, co-exploitante) et a trois enfants, deux filles et un garçon, que l'on fait témoigner. Les tracteurs et autres machines agricoles sont devenus très présents. Le travail semble moins pénible qu'autrefois.
En 2022, deux des trois oncles sont décédés... tout comme Patrick (à 50 ans). Sa veuve est sur le point de prendre sa retraite, laissant son fils Marc et l'un de ses gendres mener leur barque. L'exploitation va se doter d'une salle de traite automatique. La nouvelle génération est encore plus branchée machines que la précédente (au point de limiter le plus possible le travail strictement manuel)... et elle est plus présente auprès des membres de sa famille.
J'ai trouvé cela passionnant et beau. Cela dure 1h25 et l'on est pris par la diversité des thèmes abordés et l'habileté du montage, qui alterne les séquences issues de périodes différentes, plutôt que de proposer un suivi strictement chronologique.
Je recommande vivement.
18:49 Publié dans Cinéma, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société, histoire, agriculture, france
mercredi, 31 janvier 2024
Un Coup de dés
Ce coup de dés est un tournant de la vie, qui fait que celle-ci bascule d'un côté ou de l'autre. L'intrigue de ce film d'Yvan Attal en met en scène plusieurs, de l'agression au domicile d'une famille au départ retardé d'un avion, en passant par une discussion dans une voiture, l'oubli d'un téléphone portable sur un bateau et une dispute dans un appartement.
Alain Resnais en aurait sans doute fait une brillante comédie, à l'image du diptyque Smoking / No Smoking. Attal a choisi le drame bourgeois, voix off à la clé. Le côté polar de l'intrigue m'a plu, d'autant que l'interprétation est de qualité, avec notamment Marie-Josée Croze, Maïwenn et Guillaume Canet (Attal me paraissant un poil moins convaincant).
En revanche, le coup de la voix off m'a déplu, d'autant qu'elle est soulignée par une musique un peu pompeuse, qui finit par agacer. Ceci dit, il convient d'un peu se méfier de ce qu'on nous montre au début, le principe des retours en arrière étant un petit peu trompeur. En dépit d'une gestion du suspens parfois maladroite, je trouve que certains effets sont réussis et que, surtout, Attal parvient à maintenir une forte tension presque tout au long du film.
Au centre de l'histoire se trouve le duo d'amis Mathieu-Vincent (Attal-Canet). Autant le premier est terne, modeste, introverti, respectueux des règles, autant le second est brillant, flambeur, aventurier et truqueur. Dans la vie, c'est le second qui occupe le devant de la scène. Mais il ne serait rien sans le premier. Que peut-il se passer le jour où l'homme de l'ombre, affable et soumis, décide de faire passer ses désirs avant ceux des autres ? L'intrigue tente de répondre à cette question.
Ce n'est certes pas le film de l'année, mais j'ai trouvé la presse bien sévère pour ce qui constitue un agréable divertissement, pas dépourvu de sens.
11:26 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 27 janvier 2024
Les Colons
Le titre de ce film à prétention historique est ambigu. Le terme "colons" semble désigner les étrangers (européens ou nord-américains) venus tenter leur chance au Chili à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. Ce sont plutôt des migrants, dont certains se sont mis au service des dominants, les criollos (ou créoles), descendants eux des colons installés dans les premiers temps de la conquête européenne. Cette alliance se fait au détriment des Indiens, dépossédés de leurs terres, pourchassés, voire violé(e)s, tué(e)s.
Cet aspect-là, pour démonstratif qu'il soit, constitue la part intéressante du film, en particulier lorsqu'est mis en scène le fossé qui sépare les pauvres (qu'ils soient amérindiens ou pas) de l'élite dirigeante (fortunée), qu'elle soit conservatrice (comme le grand propriétaire Menéndez) ou progressiste (comme l'envoyé gouvernemental).
La première partie prend la forme d'un western crépusculaire, puisqu'il s'accompagne d'exécutions et de viols. Les paysages sont jolis, mais mon Dieu que c'est poussif ! J'ai plus d'une fois piqué du nez. Je trouve aussi que le jeu de certains acteurs est maladroit. C'est dommage, parce que la cause est belle.
Une séquence m'a particulièrement posé problème : celle qui fait intervenir des militaires en rupture de ban. Ils sont britanniques (notamment gallois). L'apparence de respect des règles va assez rapidement laisser la place à des pulsions moins civilisées. Dans cette séquence, j'ai ressenti de la part du réalisateur la double volonté de dépeindre ces Occidentaux de la manière la plus péjorative qui soit et de les humilier. Devant cette caméra, tous les vices sont européens (ou nord-américains). On tombe dans une forme de manichéisme.
La seconde partie nous projette quelques années plus tard. Sur le fond, elle donne une autre saveur à l'histoire. Sur la forme, elle est moins intéressante.
Le sujet était porteur, mais le résultat n'est pas particulièrement emballant.
12:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Si seulement je pouvais hiberner
C'est à peu près ce que déclare l'un des personnages de l'histoire (un des frères du héros), quand tous se retrouvent frigorifiés dans leur yourte sédentarisée, en banlieue d'Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie.
Les hivers y sont beaux mais rudes. Les superbes paysages d'Asie centrale sont parfois masqués par les fumées issues des systèmes de chauffage à l'ancienne, de vieilles chaudières à charbon, au rendement aléatoire... et encore, quand on a du charbon.
Se procurer cette source d'énergie fossile est l'un des objectifs prioritaires de la famille du héros, composée d'une mère et de ses quatre enfants : une fille et trois garçons. Le père est mort et la mère n'est pas bien vaillante. On comprend à demi-mots qu'elle peine à surmonter sa dépendance à l'alcool... et son peu d'appétence pour le travail.
Du coup, c'est le fils aîné Ulzii qui prend de plus en plus en charge le ravitaillement de la famille. Pour cela, il doit jongler avec ses études. Le lycéen est doué en sciences. Il pourrait prétendre à beaucoup mieux que ses camarades de classe... à condition de réussir ce fameux concours de recrutement national, auquel son prof de physique est prêt à le préparer bénévolement. Mais, entre les tentations d'un ado et les soucis familiaux, la vie quotidienne place Ulzii devant des choix cornéliens, d'autant qu'une fierté excessive l'empêche de demander de l'aide, ne serait-ce qu'à un couple de vieux voisins compatissants.
Dit comme ça, cela pourrait sembler misérabiliste. Pas du tout en fait. La description du quotidien de cette famille pauvre prend un tour documentaire. (Les enfants sont bien dirigés.) On découvre aussi les inégalités croissantes qui traversent la capitale, entre quartiers modernes, récemment aménagés, disposant de tout le confort, et quartiers plus traditionnels, pas dénués de charme, mais terriblement précaires.
C'est de surcroît bien filmé, avec de beaux plans d'ensemble de la ville ou de ses abords et des scènes bien troussées en intérieur, les yourtes se révélant propices à une mise en scène plus intimiste.
09:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 24 janvier 2024
Godzilla Minus One
Curieusement, ce film japonais a "bénéficié" de deux sorties sur grand écran, en France. La première, dans une combinaison très limitée de salles, est survenue en décembre dernier. Sans doute en raison de l'engouement suscité par le film, il a été décidé de le reproposer, à un plus large public... et c'est tant mieux.
L'intrigue n'a pas été chamboulée par rapport aux classiques de la franchise (qui compte plus de trente films mettant en scène la grosse bébête radioactive). Du côté d'Hollywood, en 1998, Roland Emmerich attribuait aux essais nucléaires français du Pacifique la naissance du monstre. Plus récemment, en 2014, Gareth Edwards remontait aux origines (l'après Seconde Guerre mondiale), en convaincant à moitié. Sans trop en dire, je peux quand même affirmer qu'ici, on sous-entend que la (re)naissance de Godzilla est un poil plus ancienne...
Cela nous amène à l'un des grands intérêts de l'histoire : la peinture du Japon de 1945-1946, entre destructions, famine et familles déconstruites. On suit notamment un ancien kamikaze (qui n'a pas pu aller jusqu'au bout) et une mère célibataire qui sort de l'ordinaire. Après une introduction en fanfare (avec la grosse bête), l'intrigue prend des chemins à la fois sociologiques et psychologiques. On est loin des gros sabots états-uniens.
Je rassure les fans de film à grand spectacle : on en a pour son argent, avec de bons effets spéciaux... ce qui confirme qu'il n'est pas nécessaire de mettre "un pognon de dingue" dans les technologies numériques pour créer une œuvre à la fois spectaculaire et vraisemblable.
Godzilla joue un double rôle. D'un côté, il est le destructeur, à la fois créature de la démesure humaine et son prédateur ultime. D'une autre côté, il est le déclencheur, celui dont la présence oblige les humains à faire des choix, à mûrir, s'engager... C'est l'occasion pour nous de voir évoluer une famille recomposée, vaille que vaille. C'est assez touchant sans être hyper souligné.
En revanche (le film étant plutôt destiné au public est-asiatique), je n'ai guère apprécié certains scènes surexpressives, dans l'autoflagellation ou le larmoiement.
Cela reste néanmoins un film hautement recommandable.
17:09 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 21 janvier 2024
Stella, une vie allemande
Une jeune femme répète un spectacle musical (jazzy) avec son groupe d'amis musiciens. Ils sont jeunes, bien de leur personne, assez doués, avec une forte envie de croquer la vie à pleines dents. Certains (dont l'héroïne éponyme) espèrent signer un contrat avec un producteur de Broadway... mais, voilà : nous sommes en 1940, en Allemagne (nazie)... et ces musiciens (tout comme la chanteuse) sont juifs.
L'intrigue (inspirée d'une histoire vraie, celle de Stella Goldschlag, que je conseille de ne pas lire avant d'avoir vu le film) est découpée en deux parties. La première est, à mon avis, la moins intéressante. C'est celle qui contient les scènes les plus traditionnelles, voire convenues, auxquelles le réalisateur tente d'apporter un peu d'originalité caméra à l'épaule. Le résultat n'est guère convaincant. Ainsi, on perçoit trop bien que les musiciens ne jouent pas vraiment pendant les scènes de répétition. Seule la chanteuse sonne juste. Il faut dire que Paula Beer irradie dans ce long-métrage, où elle est filmée sous toutes les coutures, dans tous les états. Elle confirme tout le bien que je pense d'elle depuis Frantz.
Mais on a déjà vu (en mieux) les scènes de débrouille, celles de vagues d'arrestation ou de dissimulation. C'est peut-être utile pour les jeunes générations, mais les vieux cinéphiles (et lecteurs) n'auront pas le plaisir de la découverte. Certaines scènes m'ont même paru grotesques, comme la fiesta dans un riche appartement berlinois, en plein bombardement, ou le rapport sexuel à moitié consenti, dans la ferveur de l'instant.
Le film bascule lors de l'arrestation par la Gestapo, qui enclenche une série de tortures que la caméra aborde frontalement. C'est à la limite du soutenable... et beaucoup plus réaliste que bien des œuvres antérieures consacrées au sujet, dans lesquelles souvent on élude ou on ne montre que les conséquences des mauvais traitements.
Cette violence explicite est toutefois nécessaire pour faire comprendre le basculement de l'héroïne. Au départ, elle n'est qu'une jeune femme un peu frivole, prête à bien des concessions pour continuer à profiter de la vie, en dépit des circonstances. Elle passe d'un homme à l'autre, chaparde, truande... mais, dans cette seconde partie, son comportement devient extrêmement discutable.
Le réalisateur ne juge pas... du moins, pas immédiatement. (On sent quand même son point de vue au moment du deuxième procès, après guerre.) Il laisse sa chance à son personnage, très bien incarné par Paula Beer. C'est un peu longuet, mais l'histoire est bigrement forte. Je ne la connaissais pas. Elle m'a vraiment retourné et je trouve que, d'un point de vue général, elle pose de bonnes questions, entre autres : qu'est-on prêt à faire pour survivre ?
14:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 20 janvier 2024
Krisha et le Maître de la forêt
Ce conte sibérien est une animation sud-coréenne réalisée en stop-motion : les personnages sont des poupées, qui ont été animées image par image. Cela a donc demandé un travail fou, une méticulosité de dingue. Le résultat est visuellement assez impressionnant.
Deux trames narratives se croisent : la vie des nomades Nénètses, en particulier celle d'une famille, dont la mère tombe malade, et l'expédition d'un duo de chasseurs, menée par un officier soviétique sans scrupule (qui déplore le peu de motivation des nomades à rejoindre les kolkhozes).
De la part du réalisateur, on sent la volonté de montrer que la nature est belle... et cruelle. Le froid extrême qui règne dans ce grand Nord sibérien peut se révéler mortel, sans compter la présence des loups, les plus dangereux prédateurs... avec les humains.
C'est visible par les petits et les grands, mais ce n'est pas "nunuche". On voit les nomades consommer de la viande et du sang de renne, ainsi que l'affection qui les lie aux bêtes de leur troupeau. Il y a donc du sang à l'image, y compris quand les chasseurs s'en prennent à un ours mythique, ce "Maître de la forêt" dont les adultes attentifs identifieront l'équivalent humain, en tendant l'oreille.
C'est donc à la fois fantastique et réaliste, à l'image des anciens contes (notamment européens). Les deux enfants vont devoir surmonter des difficultés pour tenter de sauver leur mère (peut-être victime de l'anthrax). Le garçon agaçant du début (du genre capricieux) se met à penser un peu aux autres et Krisha apprend à surmonter ses pulsions (agressives ou pleurnichardes) pour parvenir à ses fins.
Cela dure 1h10 et c'est vraiment chouette.
P.S.
Les Nénètses (ou Nenets) ont fait l'objet d'un semi-documentaire, il y a une douzaine d'années : Neko, dernière de la lignée.
17:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 13 janvier 2024
Dream Scenario
Il y a deux ans, à Cannes, Kristoffer Borgli s'était fait remarquer avec Sick of myself, un petit bijou d'ironie mordante. Dans son nouveau film, il traite encore de la célébrité, mais sous un autre angle : ici elle survient par accident.
C'est l'histoire de Paul Matthews, un prof de biologie évolutive dans une fac modeste. D'un côté, on peut dire qu'il a réussi. C'est un intellectuel installé à un poste d'autorité, son épouse (incarnée par une vieille connaissance : Julianne Nicholson, vue jadis dans New York, section criminelle) est belle et intelligente et il vit dans une superbe maison. Mais il n'a pas obtenu la reconnaissance académique qu'il estime mériter et ses cours en amphi ne suscitent pas l'enthousiasme des quelques étudiants qui les suivent.
Lorsque Paul commence à apparaître dans les rêves des personnes qu'il connaît... puis dans ceux de celles qu'il ne connaît pas, il devient un phénomène de société. C'est savoureux (d'autant qu'au départ Paul semble ne jouer aucun rôle particulier dans les rêves), très bien joué par Nicolas Cage, convaincant en quinqua un peu empâté, un peu chauve, pas vraiment sexy.
Cela dérape quand le Paul Matthews des rêves se met à agir dans ceux-ci, soit de manière positive (il provoque de profonds émois chez certaines dames), soit de manière négative (il est violent, voire il tue).
La scène de bascule est celle qui se déroule chez la ravissante employée d'un groupe de communication, avec lequel l'enseignant est entré en contact pour promouvoir le livre qu'il ne parvient pas à écrire. Borgli a conçu une scène "déconstructive". En effet, elle semble prendre le chemin de ce qu'on a déjà beaucoup vu dans d'autres films ou séries : une belle jeune femme, fascinée par le héros (pourtant pas bien excitant), s'apprête à se donner à lui... sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que le déboutonnage de pantalon a provoqué une double salve d'éclats de rires dans la salle.
A partir de là, le ton change. La vie du prof devient un enfer. C'est beaucoup moins drôle que dans la première partie, mais cela en dit autant voire plus. Le réalisateur décoche ses flèches contre une forme de politiquement correct, notamment la volonté du doyen de la fac de ne pas faire de vague. Le superficiel bruit médiatique du début tourne quasiment au harcèlement d'un homme qui n'a rien fait pour mériter cela... tout comme il n'avait rien fait pour mériter la célébrité. Mais les conséquences ne sont pas de même nature, ni de même intensité.
L'histoire se conclut de manière ironique, en France. C'est sympa, mais l'intensité a baissé, je trouve.
09:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 11 janvier 2024
Moi capitaine
Environ cinq ans après Dogman, Matteo Garrone revient avec un autre film sociétal coup-de-poing, consacré cette fois aux migrants africains, ici principalement sénégalais.
La première partie se passe autour de Dakar. On y découvre les héros de l'histoire, dont, durant tout le film, on aura du mal à dire s'ils sont frères ou bien cousins, les sous-titres naviguant entre ces deux possibilités. Ce début ne m'a pas enchanté. J'ai eu du mal à entrer dans l'histoire et à suivre cette intrigue en wolof (sous-titré), mâtiné de termes français. De plus, certains acteurs (visiblement non professionnels) ne sont pas convaincants.
Pour moi, le film décolle vraiment quand les garçons arrivent aux franges du Sahara, au début d'un périple qui se révèlera plus dangereux et compliqué que ce qu'ils avaient imaginé au départ. Garrone fait montre de son savoir-faire, filmant le désert à la fois comme un piège sournois et un espace empreint de beauté.
La meilleure partie est sans conteste le séjour en Libye, qui commence par un "détroussage" nocturne en plein désert, suivi d'une période de semi-esclavage. Le début nous montre des passeurs et une mafia cruels au possible, avant qu'un peu de nuance ne soit introduite. Tous les Libyens ne sont pas des salauds et un peu d'humanité émerge, notamment aussi parce que certains des migrants ébauchent une forme de solidarité. Une belle relation naît entre un maçon (guinéen je crois) et le plus jeune des Sénégalais, Seydou.
Concernant ce personnage (et celui de son cousin, Moussa), un basculement se produit. Au départ, l'aîné est le plus entreprenant et semble en position de force. Au fur et à mesure du périple, le cadet mûrit, prend de l'assurance... et des décisions parfois draconiennes, alors que l'aîné se retrouve en position de faiblesse.
On attend avec impatience la dernière partie, censée montrer la traversée de la Méditerranée, direction l'Italie. Elle est clairement moins réussie, le discours militant prenant (pour moi) nettement le dessus sur le projet cinématographique. L'ensemble n'en constitue pas moins une œuvre forte, clairement engagée, perfectible, mais qui pose de bonnes questions.
P.S.
Sur le même thème, je recommande La Pirogue (à mon avis plus réussi).
21:15 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
samedi, 06 janvier 2024
Mon Ami Robot
Cet étonnant film d'animation espagnol (par le réalisateur de Torremolinos 73) a pour cadre officiel le New York des années 1970-1980, ses quartiers populaires, un peu crasseux (marqués par la délinquance) et ses lieux récréatifs (peut-être Coney Island). Mais c'est aussi une histoire futuriste, dans laquelle les habitants peuvent s'acheter un robot de compagnie à monter soi-même. C'est enfin une animation recourant au classique effet de substitution, les animaux (dont le héros, Dog) remplaçant les humains, chaque espèce représentant un type de population différent.
Le scénario est plus élaboré que ce à quoi je m'attendais. Après la description d'une solitude urbaine, le film passe au compte de fées de l'amitié, jusqu'au drame. Arrivé à ce point, je me demandais comment les scénaristes allaient pouvoir tenir leur histoire pendant encore plus d'une heure... eh bien ils ont réussi leur pari. Le héros comme son robot de compagnie, séparés, vont faire des rencontres, chacun de son côté. Ces rencontres sont plus ou moins enthousiasmantes... d'autant qu'il faut parfois se méfier de ce que l'on nous montre à l'écran. Est-ce la réalité des personnages, ou bien autre chose ?... La dernière partie nous réserve de nouvelles péripéties.
L'animation m'a aussi agréablement surpris. C'est moins simpliste que cela en a l'air, de prime abord. Il faut s'intéresser aux décors (notamment urbains), vraiment chiadés. Il y a aussi quelques effets remarquables, comme ce dessin à la buée, sur la vitre d'un bus, qui se révèle différent de ce que l'on croit, une fois achevé et complètement révélé. Je pense aussi à la "séquence des marguerites", virtuose.
C'est drôle dans la première partie, puis émouvant, à plusieurs titres. C'est compréhensible par les petits et les grands. (Dans la salle où j'ai vu le film, cela allait de 7 à 77 ans.) Pour moi, c'est une réelle bonne surprise, parce que j'avais peur que les critiques aient quelque peu survendu le film.
23:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Une Affaire d'honneur
Après avoir tant joué dans des œuvres dites "de cape et d'épée", Vincent Perez a décidé d'en réaliser une. Son intrigue ne se déroule pas sous la monarchie, mais au début de la IIIe République. Les années 1880 sont celles de la consolidation républicaine, mais avec une profusion de duels, l'exercice étant désormais fort prisé de la bourgeoisie dominante... masculine.
Trois histoires vont se croiser. il y a tout d'abord celle du maître d'armes (fictif) Clément Lacaze, ancien militaire, vétéran de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. C'est l'une des plus fines lames de France et c'est son orgueil. Son neveu se retrouve embarqué dans une histoire sordide : pensez donc, il s'est épris de la jeune épouse d'une gloire militaire nationale. S'ajoutent à cela les actes d'une militante féministe (qui elle a bien existé) : Marie-Rose Astié de Valsayre. En plus de revendiquer le droit de vote des femmes, elle milite pour l'abolition du décret napoléonien qui interdit le port du pantalon aux dames (à Paris)... et elle se pique de manier l'épée, comme les messieurs.
J'ai été pris par cette triple intrigue parce que les acteurs sont très bons, en particulier Roschdy Zem, impérial en figure hiératique de l'escrime. Doria Tillier (un peu maigrichonne pour être totalement crédible en bretteuse) convainc en féministe libertaire. Vincent Perez fait un très bon antagoniste, tout comme Damien Bonnard, qui semble avoir pris plaisir à incarner un gros blaireau. A l'arrière-plan, on remarque notamment Guillaume Gallienne. Tout cela sent la "qualité française"... et ce n'est pas ennuyeux.
La mise en scène s'est évertuée à reconstituer les rituels de duel (à l'épée, au pistolet, au sabre), tout en ménageant le suspens (jusqu'à la fin), même si l'on sent un peu trop venir le drame du début. Les quatre séquences de combat sont fort bien conçues.
Si je devais mettre un bémol, ce serait à cause de l'ébauche de romance entre Lacaze et Astié que Perez et sa scénariste ont voulu insérer. Bof, bof...
Si on laisse de côté cet aspect secondaire de l'intrigue, on passe un très bon moment.
18:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mercredi, 03 janvier 2024
Kina & Yuk, renards de la banquise
Les latitudes extrêmes sont au programme des salles obscures, ces temps derniers... mais c'est plutôt l'hémisphère austral qui a été à l'honneur jusqu'à présent, que ce soit dans le documentaire (Voyage au Pôle Sud), la fiction intimiste (Soudain seuls) ou le film à grand spectacle (Aquaman 2).
Ici, direction le Grand Nord canadien, plus précisément le Yukon, où évoluent des renards de la banquise, de photogéniques petites boules de fourrure, à la fois prédateurs et gibiers pour de plus gros mammifères.
Kina la blanche est la femelle, gravide. Sur le point de mettre bas, elle a besoin de plus de nourriture que d'habitude... et d'une tanière sûre, à l'abri des intempéries comme des prédateurs. Le mâle Yuk (au pelage brun) est à la fois son compagnon de jeux et son protecteur.
Le début nous montre le couple en pleine idylle, gambadant dans les folles prairies de l'insouciance plaines enneigées du monde arctique. Très vite, les amoureux vont être séparés, à cause de l'imprudence de Yuk (et du vilain réchauffement climatique).
A partir de ce moment-là, la caméra suit séparément les deux renards... et l'on s'aperçoit vite que le réalisateur s'est surtout attaché à la renarde. Kina doit d'abord échapper au renard roux, un congénère certes, mais d'une race différente... et qui ne dédaigne pas becqueter de la viande goupilesque.
Encore plus dangereux sont les loups, qui errent aux alentours de Jack City, où la renarde trouve refuge. Elle veille aussi à se tenir à l'écart des étranges bipèdes et des monstres sur roues qui peuplent cette ville.
Fort heureusement pour elle, elle va se faire une copine, nommée Rita.
Je n'en dévoilerai pas plus. Les péripéties sont assez nombreuses. Elles retiennent l'attention des petits, sans surprendre les grands. Les images sont superbes, les animaux quasi magnifiés... avec réalisme toutefois. Les loups sont montrés tels qu'ils sont : de redoutables prédateurs, qui ne craignent que les ours (qui les dédaignent) et les êtres humains (qui délèguent leur défense à des chiens qui sont rarement de taille). Le réalisateur s'est cependant gardé de montrer des images choquantes, en particulier celles de la manière dont les carnassiers sauvages se nourrissent.
C'est hyper-balisé sur le fond et de grande qualité sur la forme, comme le précédent film de Guillaume Maidatchevsky, Aïlo, une odyssée en Laponie.
17:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 31 décembre 2023
Les "Riton" 2023
L'année sur le point de se terminer fut riche en plaisirs cinématographiques. Une cinquantaine de films m'ont particulièrement "emporté" (comme l'an dernier). Sur cette cinquantaine, une vingtaine furent (pour moi) particulièrement marquants. Il m'est impossible d'en extraire un podium, tant la qualité fut présente dans les salles obscures, dans des genres différents... et encore, je ne parle que des films que j'ai pu voir. J'ai en raté quelques-uns, pas toujours mauvais...
Sans surprise, la catégorie des "films d'animation" est très fournie. Ce genre est devenu pour moi l'une raisons qui me poussent à me rendre dans les salles obscures.
- Riton du retour du Grand Maître : Le Garçon et le héron (un de mes films de l'année)
- Riton de l'animation mythologique : Pattie et la colère de Poséidon
- Riton de la mise en images de légendes populaires : La Maison des égarées
- Riton de l'adaptation d'un comic book : Spider-Man across the spider-verse
- Riton de l'animation picturale : Hokusai
- Riton de l'animation d'inspiration japonaise : Mars Express
- Riton de l'animation extra-terrestre : Mad God
- Riton de l'animation au ras des pâquerettes : Marcel le coquillage (un de mes films de l'année)
- Riton de l'animation qui met le nez des Français sur une partie de leur passé : Interdit aux chiens et aux Italiens
- Riton de l'animation qui élève : Elémentaire
- Riton de l'animation qui fait voyager : Inspecteur Sun et la malédiction de la veuve noire
- Riton de l'animation qui fait bouger : Détective Conan : le sous-marin noir
Voilà qui nous conduit aux films réalisés par de bons cuisiniers, qui ont compris que le public ne venait pas au cinéma pour se faire chier.
- Riton du film à la sauce tomate : John Wick IV
- Riton du film à la sauce napolitaine : Equalizer 3
- Riton du film à la sauce barbecue : Mayday
- Riton du film à la sauce harissa : Babylon (un de mes films de l'année)
- Riton du film à la sauce piquante : Les Gardiens de la galaxie 3
- Riton du film à la sauce moule-burnes : The Flash
- Riton du film qui "fait revenir" ses personnages : Indiana Jones 5
- Riton du film cuisiné à l'ancienne : Mission : impossible - Dead Reckoning I (un de mes films de l'année)
- Riton du film qui embroche : Les Trois Mousquetaires (D'Artagnan comme Milady, tous deux faisant partie de mes films de l'année)
C'est souvent grâce à des films d'action ou de super-héros que j'ai ri. La comédie est un genre sinistré au cinéma. Elle rapporte de l'argent (parce qu'elle ne coûte pas très cher à produire)... mais elle m'emballe rarement. Dans ce naufrage (qui n'est pas que français), je distingue les œuvres suivantes.
- Riton du film de jeune con : Alibi.com 2
- Riton du film de vieux con : Testament (un de mes films de l'année)
- Riton de la comédie sociétale qui a fait grincer quelques dents : Une Année difficile
Cela m'amène aux "films de genre" (plutôt polars ou thrillers), un type d’œuvre qui a lui aussi tendance à m'attirer dans les salles obscures.
- Riton du film sardonique : Sick of myself
- Riton du film dentaire : Earwig
- Riton du film mordant : Les Meutes
- Riton du film angoissant : Missing : disparition inquiétante
- Riton du film d'enquête : Marlowe
- Riton du film à choix multiples : Le Tourbillon de la vie
- Riton du film à choix unique : Soudain seuls (un de mes films de l'année)
- Riton du film à choix cornéliens : Les Ombres persanes (un de mes films de l'année)
La fiction nous ramène souvent à la réalité. Celle-ci nous a été habilement présentée par plusieurs œuvres à caractère documentaire.
- Riton moyen-oriental révoltant : 7 hivers à Téhéran (un de mes films de l'année)
- Riton ukrainien accablant : Pierre Feuille Pistolet
- Riton américain intrigant : Reality (un de mes films de l'année)
- Riton écologiste à moitié rassurant : Les Gardiennes de la planète
- Riton germanique apaisant : Anselm : le bruit du temps
- Riton japonais réjouissant : La Famille Asada (un de mes films de l'année)
- Riton polonais émouvant : Promenade à Cracovie
Les films historiques sont un prolongement naturel des documentaires. Ils ont été particulièrement variés cette année.
- Riton du film qui nous en apprend encore sur la Seconde Guerre mondiale : Natural Light (un de mes films de l'année)
- Riton du film qui nous rappelle ce que fut la terreur stalinienne : Le Capitaine Volkonogov s'est échappé (un de mes films de l'année)
- Riton du film qui évoque de manière originale une dictature disparue : Chili 1976
- Riton du film qui montre un aspect inquiétant des démocraties libérales : La Syndicaliste
- Riton du biopic : L'Abbé Pierre
- Riton du film victimaire : Emmett Till
- Riton du film qui transcende une tragédie : Killers of the Flower Moon (un de mes films de l'année)
Pour terminer ce palmarès, je vais distinguer des longs-métrages que je qualifierais de "délicats". Tous sont marqués par une certaine subtilité, toutefois pas mise en scène de la même manière.
- Riton du film terrestre : L'Improbable Voyage d'Harold Fry
- Riton du film aérien : The Lost King (un de mes films de l'année)
- Riton du film climatique : En plein feu (un de mes films de l'année)
- Riton du film de destinée : La Voie royale
- Riton du chant du cygne : Vivre (un de mes films de l'année)
- Riton du film de résurrection : Sur les chemins noirs (un de mes films de l'année)
- Riton du film sur les beautés simples de la vie : Perfect Days (un de mes films de l'année)
Je n'ai pas placé par hasard deux œuvres "japonaises" en début et fin de palmarès. Ce sont deux des plus beaux films que j'ai vus ces dernières années. Ils ne seraient sans doute pas loin du podium, si je parvenais à en établir un.
20:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 30 décembre 2023
Les Trois Mousquetaires : Milady
Sortie quelques mois après le premier volet, cette seconde partie de l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas (père) met en avant le personnage de l'espionne de Richelieu, l'envoûtante, la machiavélique, la rebelle Milady de Winter, incarnée avec toujours autant de talent par Eva Green. (Allez, un César !)
Paradoxalement, ce personnage n'est pas si présent que cela. Cela confirme que les deux films n'en font qu'un, l'insistance mise sur tel ou tel protagoniste étant plutôt de pure forme : D'Artagnan occupe une aussi grande place dans le second volet que dans le premier.
Toutefois, chaque apparition de Milady est déterminante. Dans le premier tiers de l'histoire, la séquence qui lui fait retrouver le cadet de Gascogne recèle son lot de surprises. Elle est surtout virevoltante. Plus tard arrive la scène que les connaisseurs de l'histoire attendent : le face à face avec Athos (différent du roman, la scène se concluant d'une manière qui ménage l'avenir). Un moment de grâce est atteint en Angleterre, où l'on découvre Milady sous un autre visage (pour la seconde fois, victime, pas uniquement bourreau), avec aussi une incroyable scène dans la grange.
Les autres comédiens sont convaincants. François Civil m'a semblé plus à l'aise que dans le précédent opus, mais toujours moins marquant que Romain Duris, Pio Marmaï et Vincent Cassel, qui constituent un formidable trio. J'y ajouterais Marc Barbé et surtout Eric Ruf, impeccable en cardinal de Richelieu.
C'est toujours aussi feuilletonnesque. Le film regorge de péripéties, de cascades, de trahisons. Les dialogues sont bien écrits, souvent "piquants". Sur le fond, c'est moins joyeux, plus noir que le premier volet, ce qui me convient. Sur le plan visuel, c'est peut-être encore meilleur. J'ai passé un excellent moment... et j'aimerais bien qu'il y ait une suite (vingt ans après ?), comme la fin semble le suggérer.
18:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films