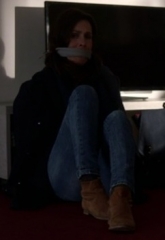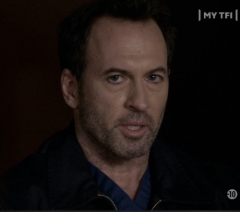lundi, 27 juillet 2020
Ipman 4
Il était une fois, dans un grand pays oriental, un maître du kung-fu, à la fois puissant et sage. Dans sa jeunesse, il avait vaillamment combattu l'invasion du méchant voisin japonais. En Occident, on le connaît pour avoir formé une vedette du cinéma et des arts martiaux : Bruce Lee.
En 1964, se sachant atteint d'une maladie incurable et se faisant beaucoup de souci à propos de son unique et turbulent rejeton, le maître consentit à se rendre en Californie, croyant que dans le pays de la liberté, où tant de ses compatriotes avaient émigré, un avenir radieux s'offrait à lui et à son fils.
Hélas ! Hélas ! Trois fois hélas ! Dans le pays des hommes au long nez qui mâchent de la gomme sucrée et boivent de l'eau colorée qui fait roter, le maître ne rencontre que racisme et incompréhension. Nombre de ses compatriotes (ou de leurs descendants, tous considérés comme d'authentiques Chinois...) courbent l'échine face au Blanc dominateur... et n'acceptent pas la Voie de la modernité proposée par l'élève Bruce. Dans le même temps, la gentille fille de l'un des maîtres des arts martiaux locaux est persécutée par une petite peste blanche de son lycée, soutenue par de grands crétins joueurs de hockey. On est content quand maître Yip Man vient corriger cette bande d'impudents.
De son côté, l'élève Bruce met tranquillement sa race à un grand baraqué en pyjama bleu... sans même enlever sa jolie veste en cuir.
Mais le mal rôde sans cesse autour des gentils Chinois. Il a le visage de l'entraîneur de karaté des Marines (plus baraqué et plus vilain que le type en pyjama bleu) et de son chef, un sergent encore plus baraqué et encore plus méchant que le plus baraqué d'avant. Tous ces Blancs arrogants vont se prendre une branlée faire sévèrement rappeler à l'ordre par maître Yip Man, facilement au début, un peu moins facilement à la fin.
Moralité : la Chine est belle et grande, tolérante, respectueuse et pleine de sagesse, tandis que les Zaméricains, c'est rien que des grosses brutes racistes avec un sourire de dentifrice.
23:15 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, film, films
Mon Ninja et moi
Ce film d'animation danois n'est pas tout public. Comme il évoque le travail forcé des enfants et le harcèlement scolaire (entre autres), il est déconseillé aux très jeunes enfants, qu'il risque d'effrayer. Par contre, dans la salle où je me trouvais, les bambins âgés d'une dizaine d'années ont été captivés.
Cela commence fort, avec une séquence se déroulant en Thaïlande, dans une usine fabriquant des jouets (des poupées). Les "ouvriers" sont des enfants, maltraités par le contremaître local, lui-même soumis au donneur d'ordres occidental. Le drame qui se déroule le jour de sa visite conditionne la suite de l'histoire.
Nous voilà transportés au Danemark, dans une petite ville. On suit plus particulièrement la vie d'une famille recomposée, dont fait partie le jeune héros. A la maison, cela ne se passe pas très bien : il doit subir au quotidien le fils du nouveau compagnon de sa mère, un glouton narcissique que son père démissionnaire a très mal élevé. La maman elle est une bobo-écolo dont les talents culinaires sont... particuliers. Ils y a donc (heureusement) un peu d'humour dans ce portrait familial. Le film se veut aussi éducatif : on montre aux enfants les bases de l'hygiène (se laver les dents, les mains, manger sainement, à heures fixes...).
Pour Alex, la principale source de problèmes est le collège. Y sévit une bande de petits cons harceleurs, auxquels personne n'ose s'opposer. J'ai été un peu surpris du tableau : la cantine de cet établissement danois est sale et les gamins n'ont pas droit à un véritable repas ; cela ressemble à ce que j'ai vu de cantines américaines...
La manière dont le collège et ses "occupants" sont représentés n'évite pas les clichés. Les personnages d'adultes comme de jeunes sont assez caricaturaux. Cela nous vaut quelques instants d'humour, mais cela manque un peu de subtilité.
C'est le moment de parler de l'élément qui dynamite l'histoire : la poupée-ninja. Celle-ci est le résultat d'un spectaculaire accident. Elle est dotée de pouvoirs surnaturels... et elle parle (y compris en imitant des voix). Dès que ce personnage est en action, cela devient plus vivant, plus drôle. Cette poupée est animée par un esprit vengeur, qui va aider Alex à régler ses problèmes... ou lui en créer d'autres. Tout cela est bien vu, surtout que même le personnage du ninja évolue.
Résultat : on passe un bon moment et les jeunes reçoivent une petite leçon de morale.
14:38 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
vendredi, 24 juillet 2020
Madre
C'est le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, auquel on doit El Reino et Que Dios nos perdone. Il est centré sur le personnage d'une mère (divorcée), d'abord à trente ans, puis à quarante. La trame de l'histoire se découpe en quatre parties.
La première se déroule dans le passé, dans l'appartement d'Elena (Marta Nieto, for-mi-da-ble). C'est un triple tour de force : il s'agit d'abord, sauf erreur de ma part, d'un seul plan-séquence virtuose. De plus, la tension est créée par une simple conversation téléphonique et le talent d'une comédienne (dont le débit est proche de celui d'une mitraillette), qui incarne à la perfection une mère que la disparition de son fils (que l'on suit en temps réel, par téléphone interposé) va bouleverser.
On retrouve l'héroïne dix ans plus tard, sans doute dans les Pyrénées-Atlantiques. L'Espagnole a tout plaqué pour refaire sa vie côté français. Elle gère un bar-restaurant proche d'une plage, celle qu'elle pense être le lieu de la disparition de son fils, qui n'a jamais été résolue. D'un côté elle semble avoir trouvé un équilibre dans sa seconde vie (ainsi qu'un nouveau compagnon, très compréhensif), de l'autre on la sent encore secrètement traumatisée. Elle est d'une maigreur effrayante et mange si peu...
Tout bascule quand elle croise un groupe d'apprentis-surfeurs, parmi lesquels se trouve un adolescent de seize ans qui lui rappelle son fils. Est-elle en train de devenir dingue ? Est-ce le supposé instinct maternel qui parle (et ne trompe pas) ? Cette deuxième partie est d'autant plus passionnante que le personnage de l'adolescent est fouillé. C'est un jeune homme intelligent et sensible, que celle qu'on surnomme parfois "la folle de la plage" intrigue.
Hélas, cela se gâte par la suite. La troisième partie subit un sacré coup de mou. Le pire est atteint dans la séquence de la soirée en boîte, particulièrement malsaine (et pas du tout raccord au niveau du comportement de l'héroïne).
La dernière partie fait remonter l'intérêt. L'action prend presque la forme d'un thriller. Même si je n'ai pas aimé la fin, je trouve que cette histoire, telle qu'elle nous est contée, mérite le détour.
23:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 23 juillet 2020
Lands of Murders
L'été est devenu une terre de cinéphilie : on profite de la "basse saison" pour sortir de petits thrillers du style Exit, ou des polars étrangers comme Rojo (en 2018), Le Caire confidentiel et Que dios nos perdone (en 2017) ou encore La Isla minima (en 2015).
C'est l'intrigue de ce dernier film qui a inspiré Lands of Murders. Le contexte a été modifié : l'Espagne post-franquiste a été remplacée par l'Allemagne d'après la chute du Mur, au tout début des années 1990. Les méandres de la rivière Neisse succèdent aux marécages du Guadalquivir.
Deux adolescentes d'origine ouvrière ont disparu. Deux enquêteurs sont envoyés du Nord, un de Hambourg, l'autre de Rostock. Le premier (Patrick) est plus jeune, plus svelte, plus respectueux des règles et plus cérébral. Le second (Markus) est visiblement un ancien de la Stasi, qui connaît bien le terrain et travaille "à l'ancienne" (avec alcool et bourre-pif). C'est un type massif, dont l'apparente rugosité masque une certaine subtilité. C'est en outre un remarquable dessinateur. Dans le rôle, Felix Kramer est une révélation. Il apporte un plus par rapport à la version espagnole, où les acteurs n'étaient pourtant pas manchots.
L'autre intérêt de la transposition est le contexte est-allemand, celui de la transition entre une société corsetée par l'Etat-parti (unique) et une société libérale, avec ses inégalités. Entre la misère sociale, la drogue et la prostitution, le tableau ne manque pas de noirceur. Vient s'ajouter la présence d'un tueur en série. Clairement, c'est poisseux... mais bigrement bien fait.
Au talent des acteurs s'ajoute la mise en scène, qui plombe l'ambiance... avec style. Je n'ai pas revu La Isla minima depuis sa sortie en salles, mais je suis persuadé que certains plans (notamment aériens, ou de poursuite en voiture) sont décalqués du film d'origine.
Cela n'enlève rien aux qualités de la version allemande, d'une beauté dégueulasse...
20:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 22 juillet 2020
Abou Leila
C'est le nom, ou plutôt le pseudonyme de la personne que recherchent les deux héros du film. Autant l'un paraît solide, baraqué et calme, autant l'autre semble fragile, malade, imprévisible. On nous incite à penser que l'un des deux est policier.
Mais avant de les rencontrer, on assiste à une scène d'exécution, mystérieuse... et à la limite de l'amateurisme. On est en pleine guerre civile algérienne (dans les années 1990). On présume que l'agresseur, barbu, est islamiste, l'agressé, d'apparence occidentale, incarnant le camp d'en face. Dès cette introduction, on sent qu'un regard aigu guide la mise en scène.
La suite est un road-movie saharien, un peu comme si deux enquêteurs de Sydney se rendaient dans l'outback australien. Y a pas à dire, les paysages sont d'une minéralité captivante. Ils écrasent les personnages. Le désert est en lui-même une menace, mais, en plus, il sert de refuge à de dangereuses créatures.
A partir de ce moment-là, le réalisme alterne avec l'onirisme. Il convient d'être attentif aux vêtements que portent les personnages principaux : ils indiquent dans quel type de séquence on se trouve. L'un des deux héros commence à perdre pied, ce qui donne lieu à trois séquences aussi violentes que déroutantes : celle de la portière, celle de l'hôtel-foyer et celle des montagnes. Cette dernière nous ramène paradoxalement dans la réalité, puisqu'elle conduit l'un des hommes à son passé, grâce à un bel artifice de mise en scène. A cette occasion, on revoit la scène du début, sous un autre angle.
Dans ces moments de délire, la frontière entre l'humain et l'animal s'évanouit. Les uns deviennent les substituts des autres, et réciproquement. Je pense qu'à travers ce procédé, le réalisateur veut montrer la bestialité de cette guerre civile, la régression qu'elle a représenté.
Si l'on accepte d'être dérouté, si l'on supporte les longs plans ouvragés, ce polar atypique peut faire passer un très bon moment.
22:06 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 21 juillet 2020
L'Etat sauvage
Ce western français, féministe et (légèrement) interracial, a été tourné au Canada, en français et en anglais... et pour cause : il raconte le périple d'une famille de riches émigrés hexagonaux aux États-Unis, durant la Guerre de Sécession.
On sent que le réalisateur David Perrault a vu la version longue d'Apocalypse now, contenant la séquence se déroulant dans la plantation tenue par des Français, en pleine Guerre du Vietnam. On sent aussi qu'il a vu La Dernière Piste, dont l'intrigue n'est pas sans ressembler à celle de son film. On comprend enfin qu'il connaît Les Proies, tant on se demande parfois qui, entre les cow-boys et les demoiselles qu'ils accompagnent, est l'objet du désir de l'autre... On pourrait continuer longtemps ce petit jeu des références, vu qu'il est évident que le metteur en scène a ingurgité du néo-western par hectolitres.
En tout cas, dès le début, il fait montre de son savoir-faire. La scène nocturne se déroulant dans ce qui doit être une chapelle en ruines est superbe sur le plan visuel et parfaitement maîtrisée en terme de dramaturgie. A plusieurs reprises, on reverra ce talent à l'oeuvre, par exemple dans la séquence du bal (perturbé par des soldats nordistes) ou lors de la scène du repas, dans une maison abandonnée. J'ajoute que les plans extérieurs ont été tournés dans des décors naturels... et, dans une grande salle, c'est d'une beauté à couper le souffle.
En dépit de toutes ces qualités (auxquelles il faut ajouter un bon jeu des acteurs), je suis sorti de là mitigé, en raison de plusieurs énormités. La grosse faute scénaristique est la séquence du chariot coincé sur une corniche. Alors que le bon sens dictait de faire passer les jeunes femmes entre la falaise et le véhicule, ou au-dessus (voire au-dessous), voilà-t-y pas que l'on décide de les faire marcher au bord du précipice, le dos collé au chariot !...
Une autre invraisemblance est la scène de forêt, censée se dérouler à moins d'une journée de marche du village où la famille s'est réfugiée. Alors que le village croule sous la neige et le brouillard, pas le moindre flocon n'est visible à 20-30 kilomètres de là...
Le sommet du ridicule est atteint dans une scène nocturne, lorsque la vilaine Bettie (une sorte de sous-Calamity Jane) se met à danser autour du feu, en compagnie des cinq lascars masqués de sa bande. C'est d'autant plus regrettable que, jusque-là, ce personnage avait été plutôt bien campé par Kate Moran. (Ensuite, ça part en sucette.)
Voilà. C'est un film plein de qualités (notamment visuelles), mais plombé par quelques séquences mal conçues.
22:09 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 20 juillet 2020
Divorce Club
Par temps quasi caniculaire, fréquenter les salles (obscures) climatisées est plus qu'une question de cinéphilie... d'autant qu'il n'y a pas foule. Et puis, qui n'a pas connu une fin de mariage / concubinage / PACS / relation longue (rayer les mentions inutiles) traumatisante ? Si, en plus, l'action se déroule souvent la nuit, dans une propriété de rêve, avec parc arboré et piscine, pourquoi ne pas se laisser tenter ?
A cette liste de faux prétextes pour aller voir une comédie lourdingue, qu'on espère riche en situations graveleuses, il faudrait ajouter la présence au générique d'une pelletée de comédiens de talent : François-Xavier Demaison, Grégoire Bonnet (qui porte très bien le slip) et Benjamin Biolay (qui serait "monté comme un poney") chez les messieurs, Caroline Anglade (actuellement aussi à l'affiche de Tout Simplement Noir), Audrey Fleurot, Frédérique Bel (bien barrée) et Charlotte Gabris (déjà remarquée dans Demi-soeurs) chez les dames. Je suis moins convaincu par les prestations d'Arnaud Ducret et Michaël Youn.
Cela commence de manière très appuyée, avec la vision sirupeuse d'un couple magnifique qui va se fracasser sur l'infidélité publique de la mariée. On rigole quand même, mais on attend mieux. La première véritable bonne séquence se déroule dans un sex-shop en vente. Elle marque la rencontre entre le héros Ben (époux outragé, brisé, martyrisé... mais bientôt libéré !) et Marion, elle déjà divorcée et en passe d'ouvrir un club de combat féminin. La situation est pleine de sous-entendus, tout comme les dialogues. Les interprètes s'y prêtent bien.
Après, il y a quelques coups de mou, jusqu'à la fameuse soirée, celle durant laquelle le héros va devoir fêter dignement ses 41 ans dans la somptueuse maison de son meilleur ami (devenue une garçonnière), tout en se rendant à un important dîner amoureux avec Marion. La nécessité pour le héros de se trouver à deux endroits en même temps donne naissance à des moments assez cocasses, même s'il y a quelques facilités.
L'une des meilleures séquences est incontestablement l'avant-dernière. Elle intervient après une ellipse d'un mois (pour une raison que je me garderai de révéler), à l'occasion de l'inauguration du fameux club... et ça va saigner !
Voilà. Cela ne restera pas dans les annales, mais ça fait passer un agréable moment.
22:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 19 juillet 2020
Nuestras Madres
Ces mères sont des femmes guatémaltèques, âgées de 50 à 70 ans environ, et qui ont subi les violences des dictatures militaires qui ont jadis ensanglanté ce pays d'Amérique centrale coincé au sud du Mexique :
Le héros est Ernesto, un anthropologue judiciaire d'une trentaine d'années. Avec ses collègues, il travaille à l'exhumation et l'authentification des corps des victimes, suivies (quand c'est possible) par leur restitution à la famille survivante. Dès le premier plan, c'est la dignité qui s'impose : on nous propose une vue du dessus d'une table, sur laquelle sont petit à petit disposés des ossements récemment découverts. Aucun dialogue n'est nécessaire pour comprendre la minutie du travail exécuté... pas plus que la cause du décès.
Pour Ernesto, ce travail va prendre un tour personnel le jour où une vieille paysanne indienne vient le voir. Elle et les autres femmes de son village voudraient donner une véritable sépulture à leurs compagnons assassinés (et ainsi "pouvoir converser avec eux"). Son témoignage est bouleversant. Pour appuyer sa démarche, elle apporte une photographie de groupe, sur laquelle Ernesto croit reconnaître son père disparu, un guérillero surnommé "le Chef".
Nous voilà embarqués au fin fond de la campagne guatémaltèque, dans des montagnes où seule une partie de la population parle espagnol. (Les habitants sont sans doute des descendants des Mayas.) Là, le citadin moderne plein de bonnes intentions va se heurter aux réalités locales. Le film prend quasiment un tour ethnographique.
La deuxième partie de l'histoire nous ramène à Guatemala City, où réside Ernesto, en compagnie de sa mère, médecin. Celle-ci ne tient pas trop à remuer le passé... et l'on finira par comprendre pourquoi. En attendant, on assiste à une fête d'anniversaire "militante", au cours de laquelle on entonne un célèbre chant révolutionnaire. (N'oubliez pas que la mère a prénommé son fils Ernesto !)
Je ne dévoilerai pas la conclusion de l'histoire, à l'image du film, très forte et très digne. C'est une oeuvre à la fois belle (sur le plan visuel) et riche sur le fond. Et tout cela, en à peine 1h20 !
11:23 Publié dans Cinéma, Histoire, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 16 juillet 2020
Chained
Il y a dix ans, Yaron Shani se faisait remarquer par son film Ajami, un polar inextricablement lié au conflit israélo-arabe.
Chained est une oeuvre davantage centrée sur l'intime. C'est aussi le premier volet d'un diptyque, celui qui met en avant la vision de l'époux. Beloved (que je n'ai pas encore vu) raconte la même histoire, mais du point de vue de l'épouse Avigail.
L'époux est Rashi, un policier chevronné, calme et autoritaire, qui ne passe rien aux délinquants. Il est quand même parfois un peu "limite". A la maison, il domine clairement son épouse (qu'il aime profondément) et la fille de celle-ci, une ado qui sent la révolte gronder en elle. (Encore une ! MAIS ARRÊTEZ ! C'EST INSUPPORTABLE !)
La mise en scène est habile : que ce soit en plan large ou en plan serré (voire en gros plan), on sent peser l'autorité naturelle du principal personnage masculin. C'est de surcroît bien interprété, en partie par des acteurs non professionnels. Les dialogues sont ciselés. (Voilà un film que tous les réalisateurs français narcissiques devraient voir et revoir, pour comprendre comment on met en scène une crise de couple.)
Le petit monde de Rashi va progressivement s'écrouler. C'est d'abord au boulot que surgissent les problèmes, puis dans la cellule familiale, avec l'ado bien sûr, puis avec l'épouse, dont on ne nous montre pas le point de vue. Et puis celle-ci disparaît de l'écran, occupé désormais quasi exclusivement par Rashi (avec ses collègues, ses parents...). Quand Avigail réapparaît, on comprend immédiatement que les choses ne seront plus comme avant.
Du coup, on a furieusement envie de voir Beloved, qui va sans doute nous en apprendre de belles sur l'épouse, sa mère et ses nouvelles amies. Un mystère plane aussi sur certains actes de Rashi.
Vite, la suite !
22:01 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 15 juillet 2020
Exit
Depuis une dizaine d'années, l'été cinématographique n'est plus uniquement la saison privilégiée des comédies de fond de tiroir et des blockbusters pour ados. C'est aussi l'époque où certains distributeurs tentent la sortie d'un polar exotique ou d'un thriller malin à petit budget.
Cette année, la filière danoise se confirme. Après Hijacking (en 2013), après The Guilty (en 2018), voici Exit, sorte de huis-clos en plein chantier de percement d'une ligne de métro souterrain.
Une journaliste (Rie) est autorisée à suivre les ouvriers du chantier, à les interroger et à les photographier où elle veut. Son reportage a pour but de montrer (et de valoriser) l'internationalisation du travail, puisque c'est une entreprise italienne qui intervient au Danemark, avec des employés danois, italiens, mais aussi croates et africains (érythréens notamment).
La première partie du film dresse un portrait peu flatteur de la jeune femme. Elle est pleine d'enthousiasme et de bonne volonté, mais elle n'y connaît pas grand chose. Elle imagine que les ouvriers qui acceptent de travailler dans des conditions très difficiles sont là par amour du boulot ou pour la camaraderie, alors qu'ils sont surtout intéressés par la paye. Elle ne se rend pas compte que la personne qu'elle interroge en anglais lui répond "yes, yes" pour lui faire plaisir... et elle sous-estime le danger.
La suite de l'histoire va la faire évoluer. Mais je trouve que le personnage ne gagne pas vraiment en sympathie. A la suite de l'accident (que je me garderai de raconter), elle se retrouve confinée à des dizaines de mètres sous terre avec deux ouvriers étrangers. Au début du reportage, tout le monde se trouvait mutuellement sympathique. Lorsque des vies sont en jeu, les véritables personnalités ressortent. Dans un premier temps, Rie frise la crise de nerfs, avant de se comporter de manière très égoïste, puis altruiste. Elle finit même par faire preuve d'un incontestable courage, alors qu'un des personnages masculins connaît une évolution inverse : l'ouvrier calme et réfléchi du début va petit à petit laisser place à un homme très intransigeant, voire dangereux.
L'observation des changements de caractère ne manque pas d'intérêt, d'autant que le scénario ménage quelques rebondissements. C'est notamment l'occasion d'apprendre (pour celles et ceux qui l'ignoreraient) ce qu'est un tympan percé. Ici, la caméra et le son se font subjectifs, tout comme plus tard dans le petit tunnel. Du point de vue de la mise en scène, c'est assez ingénieux.
Sur le fond, alors que le propos du film semble orienter les spectateurs vers une morale "bien-pensante" (c'est la collaboration entre des individus de culture différente qui va leur permettre de s'en sortir), les deux dernières séquences renversent la table pour introduire le malaise... et c'est bigrement bien vu.
Au final, même si j'ai parfois été un peu irrité par ce que je voyais, je trouve que ce petit film mérite le détour, ne serait-ce que par l'originalité du contexte.
22:18 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
mardi, 14 juillet 2020
L'Aventure des Marguerite
C'est l'histoire de deux adolescentes prénommées Marguerite (même si l'une des deux insiste pour qu'on l'appelle Margot), chacune privée de son père, l'une en 2019 (à cause de la séparation de ses parents), l'autre en... 1942 (à cause des Allemands). Une malle magique va changer leur vie : chacune va se retrouver à l'époque de l'autre.
Il faut immédiatement signaler que c'est la même jeune actrice qui incarne les deux personnages. Retenez bien son nom : Lila Gueneau fera parler d'elle, j'en suis persuadé. Elle rend crédibles les deux personnages, celui de la fille sage (mais avec du caractère) de 1942 et celui de l'ado perturbée (et casse-couilles) de 2019. (Au passage, j'en profite pour dire aux scénaristes, producteurs et cinéastes français que ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à éduquer correctement leurs ados qu'il faut en dégoûter les autres !)
Le choc des cultures, dans les deux cas, fonctionne pleinement. La Marguerite de 1942 est sidérée par la France hyperconnectée, pleine de bruits et d'objets électriques. La Margot de 2019 est révulsée par la lenteur et le conformisme de 1942... et en plus, ça capte pas !
Le ressort comique s'appuie aussi sur des personnages secondaires. En 2019, il s'agit de deux hommes... euh, en fait, un adulescent et un ado. Le premier est incarné par Clovis Cornillac (qu'on retrouve sous les traits d'un autre personnage, en 1942). C'est un graphiste free-lance et, surtout, c'est le nouveau compagnon de la mère de Margot. Il va s'en prendre plein la gueule pendant 1h30 ! Le second mec est Nathan, le meilleur ami de Margot, un garçon très décalé (il a les cheveux longs, un horrible appareil dentaire et un style vaguement "gothique"), qui va être très utile aux deux jeunes filles.
En 1942, Margot va être aidée par Alice, la tante de Marguerite, incarnée avec pétulance par Alice Pol. Je la trouve excellente, un peu dans la veine de Josiane Balasko et Valérie Lemercier. Notons que ce personnage est aussi présent en 2019, à la toute fin de l'histoire... mais je n'en dis pas plus. Sachez juste qu'il y a un lien entre la famille de 1942 et celle de 2019. Chaque Marguerite a une mission à accomplir.
C'est vraiment un chouette film, qui dit des choses sur les relations familiales... et fait parfois furieusement rire.
P.S.
Pour bien comprendre une partie du contexte, il faut savoir ce qu'était la zone interdite en 1942. Depuis juin 1940 et jusqu'à la fin de 1942, la France métropolitaine est principalement divisée en deux : la zone occupée et la zone non-occupée. En réalité, le découpage était plus complexe :
L'Alsace et la Moselle avaient été réannexées par l'Allemagne, tandis que le Nord-Pas-de-Calais était dans une situation intermédiaire, sans doute préparatoire à une absorption par un Etat flamand pronazi. S'ajoutait à cela la fameuse zone interdite, où le retour des réfugiés de 1940 était interdit et où était prévu un repeuplement allemand. Comme, dans le film, on voit des voitures immatriculées 90 (correspondant au Territoire-de-Belfort, inclus dans la Z.I. en 1942), je pense que l'action se déroule à l'intérieur de l'ellipse rouge. Mais, bon, à la limite, peu importe : ce n'est pas un film historique.
22:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Papi-Sitter
J'ai longtemps hésité avant d'aller voir cette comédie "à la française" (sous-entendu : franchouillarde). Il faut dire que le réalisateur, Philippe Guillard, est l'un des scénaristes attitrés de Fabien Onteniente, réalisateur d’œuvres inoubliables comme Camping ou Disco...
J'ai finalement cédé à la tentation, en raison de la présence au générique d'un duo de grandes gueules du cinéma français : Olivier Marchal et Gérard Lanvin. Ils incarnent les deux grands-pères (le premier du côté maternel, le second du côté paternel) chargés de s'occuper de la petite-fille, scolarisée en Terminale, pendant que les parents de celle-ci tentent de se relancer dans la vie active.
Autant le premier, enfant de la balle, est noceur, bordélique et bruyant, autant le second (capitaine de gendarmerie à la retraite) est travailleur, méthodique et policé. C'est évidemment caricatural, mais les deux comédiens se sont glissés avec un plaisir évident dans ces costumes taillés sur mesure. De la part d'Olivier Marchal, ce n'est pas surprenant, mais je dois dire que la composition de Gérard Lanvin en veuf qui voit très peu son fils et sa petite-fille est convaincante, au point de rendre son personnage touchant. (Il va d'ailleurs se décoincer un peu dans la suite de l'histoire.)
En attendant ces moments d'émotion, qui vont donner de l'épaisseur aux principaux personnages masculins, c'est leur antagonisme qui est mis en scène, de manière efficace. On sourit aux premières escarmouches, mais l'on espère bien sûr que cela va dégénérer... pour notre plus grand plaisir. La petite-fille n'est pas la dernière à mettre de l'huile sur le feu.
Elle est incarnée par Camille Aguilar. Celle-ci campe une énième adolescente en crise, rivée à son téléphone portable, à qui on a parfois envie de filer une paire de gifles. Les scénaristes ont toutefois évité d'en faire une horrible pétasse. C'est une jeune qui se cherche... et qui met tout en œuvre pour ne pas bosser au lycée. (Les adultes âgés constateront que les ados actuels n'ont pas inventé grand chose en matière de filouterie, puisqu'il est toujours question d'imiter la signature des parents et de prétexter une soirée de travail chez une copine pour faire l'école buissonnière.)
L'une des meilleures séquences du film est celle qui voit les deux papys se rendre dans l'établissement où est scolarisée Camille. Ils vont tomber de haut (en découvrant le comportement réel de leur petite-fille) et tomber bien bas, en se donnant en spectacle aux lycéens. La scène durant laquelle les deux vieux garnements se font rabrouer par la directrice vaut son pesant d'heures de colle !
J'ajoute que les acteurs principaux sont épaulés par de bons seconds rôles, notamment Anne Girouard, Philippine Leroy-Beaulieu et Laurent Olmedo.
Tout le monde aura compris que c'est une comédie facile, mais efficace. Dans la salle, jeunes comme moins jeunes ont ri.
13:28 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 13 juillet 2020
The Mallorca Files
Ce soir, France 2 diffuse les deux derniers épisodes de la première saison de cette série britannique, produite par la BBC, à qui l'on doit aussi Meurtres au paradis, qui a visiblement inspiré cette nouvelle comédie policière.
Comme la tradition le veut désormais depuis une vingtaine d'années, les héros forment un duo paritaire d'enquêteurs, l'une étant plutôt rigide (au départ), l'autre plus fantasque. Bien entendu, leur relation professionnelle débute sur un mode tendu, avant qu'un rapprochement ne s'esquisse au fil des épisodes. Bien des lecteurs de ce billet auront reconnu la trame de séries comme Castle, Mentalist ou encore Magnum (nouvelle mouture, dont le seul intérêt est la prestation de Perdita Weeks en Higgins au féminin).
Ici, le charme des îles Baléares (en particulier de Majorque) remplace le paradis guadeloupéen. L'équivalent du très strict Richard Poole est Miranda Blake, lieutenante britannique obsédée par son travail et maniaque du contrôle. Je dois dire que l'actrice Elen Rhys porte très bien la chemise boutonnée jusqu'au col, les souliers et le pantacourt (qui laisse entrevoir ses ravissantes chevilles). Bien entendu, au fur et à mesure que le temps passe, elle va un peu se "décoincer" au contact de son collègue volubile.
Celui-ci (à gauche sur l'image du dessus) est un Allemand, Max Winter (incarné par Julian Looman, un peu agaçant). Il s'est très bien acclimaté à l'archipel espagnol. Ce grand costaud aime les plaisirs de la vie : la bonne chère, la bière et sa compagne espagnole. (Dans quel ordre ? Mystère.) Il a tendance à mener ses enquêtes "à la coule", même si, au fond, il est presque aussi obstiné que sa nouvelle collègue par la recherche de la vérité.
Les intrigues n'ont rien de décoiffant, mais le contexte insulaire nous offre parfois de superbes plans méditerranéens. La musique d'accompagnement est aussi très agréable. Mais, je ne cache pas que, pour moi, le principal attrait de cette série est le personnage de Miranda (et la manière dont elle est campée par Elen Rhys). Non seulement elle a un charme fou, mais, en plus, par les expressions de son visage, la comédienne fait passer pas mal de choses :
J'ajoute qu'il vaut mieux écouter les épisodes en version originale sous-titrée, la VF n'étant pas de très bonne qualité. Il serait vraiment dommage de se priver du délicieux accent anglais d'Elen Rhys !
Sur le site de France Télévisions, quatre épisodes sont encore visibles : les deux de la semaine dernière et les deux de ce soir.
L'intrigue de "Le roi de la petite reine" (épisode 7) se déroule dans le milieu du cyclisme, avec le dopage en question. On appréciera aussi les chamailleries entre les deux enquêteurs, dont la conclusion survient au cours d'une improbable course de vélos.
"Du sang dans l'arène" (épisode 8) nous plonge dans le monde de la corrida... et chez les machos de l'île. L'intrigue est assez bien ficelée, avec, de surcroît, plusieurs moments cocasses (notamment avec un taureau). C'est aussi l'épisode durant lequel un début de rapprochement survient entre les deux héros.
"L'homme le plus recherché de Majorque" (épisode 9) tourne autour d'un meurtre que l'on croyait élucidé. Le fond de l'affaire se révèle plus compliqué et plus sombre.
La saison 1 se termine par l'un des meilleurs épisodes (le dixième), intitulé "Télé contre réalité". Au centre de l'attention se trouve une émission du genre Star Academy. C'est souvent drôle et même un poil sarcastique sur les travers du monde contemporain. Durant cet épisode, la grande question est de savoir si Miranda, dont le purgatoire aux Baléares est sur le point de s'achever, va quitter l'archipel pour retrouver sa patrie londonienne... à moins que les charmes insulaires ne la fassent changer d'avis. Suspens...
C'est joliment fait, cela ne prend pas la tête et se déguste comme un bon verre de blanc (frais), à l'ombre, sur une chaise longue.
15:30 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, cinema, cinéma, film, films
vendredi, 10 juillet 2020
Tout Simplement Noir
Dans les cinémas CGR, ce film a bénéficié d'une campagne de promotion très agressive. La bande-annonce a été complétée par des saynètes tournées à l'intérieur des salles, le personnage principal (JP) y jouant son propre rôle, celui d'un beauf loufoque et engagé.
Je nourrissais donc quelques appréhensions avant d'aller voir ce film, même si la bande-annonce est assez alléchante, avec quelques exemples de "clash" bien choisis.
Jean-Pascal Zadi (inconnu au bataillon, pour moi) incarne donc JP, un intermittent du spectacle qui n'arrive pas à percer. La situation des (hommes) Noirs en France le révolte. Du coup, il se lance dans l'organisation d'une marche revendicative. Suivi par une petite équipe de tournage, il va rencontrer diverses personnalités de la "communauté", pour le meilleur et pour pour le rire...
Les influences sont diverses, à l'image de l'entourage de JP. Il y a du Spike Lee, du Michael Moore, du François Ruffin et peut-être du Pierre Carles. Je me dis qu'il a dû aussi voir C'est arrivé près de chez vous.
Le résultat est une suite de sketchs presque tous réussis. Ils ont été écrits et tournés sur la base de l'autodérision. Le personnage principal se pose en rebelle, mais, au moins autant que son engagement, ce sont ses défauts qui vont ressortir au fur et à mesure de ses rencontres. Il n'est pas aussi "conscientisé" que les militants de la Ligue de défense des Noirs, pas aussi bon rappeur que Soprano, pas aussi bon acteur qu'Omar Sy... Mais tous ces "notables" ont accepté de figurer dans son film, d'y jouer leur propre rôle et de s'y faire égratigner. En échange, le héros JP leur sert soit de faire-valoir, soit de punching-ball... C'est bien foutu et je pourrais voir et revoir les séquences avec Claudia Tagbo, Soprano, Lucien Jean-Baptiste et Eric Judor (ces deux derniers nous livrant une formidable prestation).
Les auteurs en profitent pour critiquer celles et ceux qui se cantonnent à du divertissement commercial, pas vraiment haut-de-gamme, mais qui leur permet de bien gagner leur vie. Notons que "JP" ne se place pas sur un piédestal : il se fait filmer dans une scène (avec son compère Fary) où on le voit accepter de renier ses principes en échange d'une somme à six chiffres...
C'est l'une des grandes qualités de film : la finesse d'écriture, qui culmine dans trois scènes. Celle du dialogue avec les "soeurs" voit le petit macho noir se faire rappeler à l'ordre, avant qu'il ne berne son auditoire avec une référence à Nelson et Winnie Mandela dont personne ne semble percevoir l'ironie. Le coup de grâce vient lorsqu'après la rencontre, on voit l'une des intervenantes en pleine contradiction avec les propos qu'elle a tenus auparavant. Mais, si c'est au nom du métissage...
La deuxième scène marquante est la réunion qui se tient chez Ramzy. Alors que le sujet de la discussion est l'union des minorités, très vite le communautarisme et les préjugés réciproques surgissent. Là, JP devient observateur et donne une petite leçon de républicanisme.
La dernière scène finement écrite est la rencontre entre le héros et Omar Sy, qui finit par se produire. Quel contraste entre l'acteur populaire, richissime, bien dans ses chaussures de luxe baskets et l'artiste revendicatif qui, à part son couple, n'a rien réussi dans sa vie. J'ai trouvé particulièrement bien venu le retournement de situation qui s'opère : durant tout le film, il est régulièrement question d'Omar Sy, pas en bien (il est un peu le repoussoir du héros), mais ici, la vedette la joue modeste et renverse sans le vouloir toute la rhétorique de JP. Là encore, c'est très bien fichu.
La seule limite que je poserais est la systématique représentation négative des forces de police. C'est je crois le seul sujet abordé dans ce film sans la moindre nuance. C'est dommage, mais l'ensemble n'en reste pas moins une intelligente et savoureuse comédie.
P.S.
Ne partez pas trop vite à la fin : vous risqueriez de manquer quelques "incrustes" de Jean-Pascal Zadi !
P.S. II
Comme pour La Marche, il y a sept ans, on assiste, sur le site allocine.fr, à un matraquage anti-Zadi. Dès avant la sortie du film, une volée de critiques aussi brèves qu'extrêmement négatives a été publiée, le plus souvent par des auteurs venant de créer leur compte... Les racistes de base restent mobilisés.
jeudi, 09 juillet 2020
Lucky Strike
Le titre de ce film noir sud-coréen fait bien entendu référence à une marque de cigarettes (que l'un des personnages considère comme son porte-bonheur). C'est aussi une allusion aux "coups du sort" qui surviennent à plusieurs reprises, bouleversant l'intrigue.
A première vue, rien ne semble relier l'employé du sauna, la prostituée, le fonctionnaire des douanes, le prêteur sur gages crapuleux et la femme de ménage de l'aéroport. En fait, si : un sac de pognon, qui doit contenir l'équivalent de 500 000 dollars. De quoi refaire sa vie... à condition d'être prêt à tuer ?
A partir de là, le puzzle se met en place. Dans un premier temps, on ne comprend pas tout. Il faut un peu se triturer les méninges, tout en profitant des scènes, qui ont souvent un arrière-plan comique. On est dans la caricature, façon Pulp Fiction. Un spectateur français y percevra aussi des références aux vieux polars de l'après-guerre, style Les Tontons flingueurs et Touchez pas au grisbi.
A qui appartient réellement ce sac de voyage griffé ? Quel est le corps découvert en morceaux ? Qui est l'homme écrasé par un bus ? Et cet autre, renversé par une voiture ?
Aux personnages du début vont s'ajouter une gérante de bordel, un flic très intrusif, le cousin du fonctionnaire, un tueur au couteau (anthropophage), une petite frappe chinoise et le patron du sauna. Tout ce joli monde joue sa partition, dans une ambiance souvent nocturne, propice à tous les crimes et toutes les trahisons.
Notons que quand ils ne sont pas horriblement cruels, les personnages masculins sont principalement lâches. Les personnages féminins sont (pour moi) plus intenses, en particulier celui de la gérante du bordel, qui se révèle très tenace et pleine de surprises.
Cela ne va pas révolutionner le cinéma, mais j'ai passé un très bon moment.
12:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 07 juillet 2020
Irresistible
Cette comédie satirique est concentrée sur le rôle des spin doctors, ces conseillers en communication qui, outre-Atlantique (et ailleurs), ont contribué à faire de la vie politique un spectacle permanent de superficialité et de faux-semblants. On va en suivre deux, un démocrate (qui vient d'échouer à faire élire Hillary Clinton), l'autre républicaine, qui a plutôt le vent en poupe.
Attention, le trait est appuyé, parfois gras... mais j'ai apprécié, notamment la scène de réveil avec les assistants vocaux. J'ai aussi goûté la caricature du bobo de la côte Est (qui correspond au Parisien, chez nous les Frenchies), qui cherche à ne pas être trop voyant quand il se rend en province chez les ploucs du Wisconsin (un Etat rural du nord des Etats-Unis). Dans le rôle du conseiller démocrate en quête de rebond, Steve Carell est excellent.
Non moins excellents sont Chris Cooper (le vétéran populaire, aux valeurs compatibles avec les grands bourgeois des mégapoles), Rose Byrne (la salope républicaine prête à tout), Mackenzie Davis (la fille modèle, qui va se révéler particulièrement roublarde) et la brochette de seconds rôles plus vrais que nature en rednecks aux moeurs simples et rugueuses.
Nous voilà embarqués dans une improbable campagne municipale, dans une ville de 5 000 habitants qui a perdu les deux tiers de sa population depuis la fermeture de la base militaire, où la majorité des commerces ont fermé, en attendant le tour du lycée.
Dans cette campagne, tous les coups sont permis et, comme chacun des deux grands partis considère cette élection locale comme un test d'envergure nationale, ce sont des dizaines de millions de dollars qui vont être investis. (Il vaut mieux d'ailleurs connaître un peu le système politique états-unien pour savourer tous les détails de l'intrigue.)
Et puis vient le coup de théâtre, totalement inattendu, même si, après réflexion, quelques signes avant-coureurs avaient été distillés. Le réalisateur a même le culot de nous proposer trois fins alternatives.
J'ai adoré.
23:03 Publié dans Cinéma, Politique étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 06 juillet 2020
Mosquito
Ce moustique est Zacarias, 17 ans, portugais, engagé volontaire (en 1917) dans l'armée de son pays qui a rejoint l'Entente, contre les empires centraux, en particulier l'Allemagne. Le jeune homme a saisi l'occasion de fuir la vie morne et sans espoir que lui offre sa province. Il veut défendre sa patrie et les valeurs démocratiques. On comprend aussi qu'il espère être envoyé en France... et il se retrouve en partance pour l'Afrique, où se concentre ce qui reste de l'empire colonial portugais. L'une de ses possessions, le Mozambique, est d'ailleurs voisine du Tanganyika allemand :
Sur la carte des empires coloniaux ci-dessus, je n'ai fait figurer que les possessions allemandes (en rouge) et portugaises (en vert).
On découvre d'abord la troupe de bras cassés que le gouvernement portugais envoie outremer. Ils sont sous les ordres d'un vieux de la vieille, un sergent qui a fait les campagnes coloniales, du genre paternaliste et truculent (en plus d'être alcoolique et bedonnant). Celui-ci se désole de n'avoir pour renfort que des "joueurs de fado". Il tient en plus haute estime ses supplétifs africains, ses "nègres" comme il dit.
Ce film est donc une plongée dans l'univers colonial du début du XXe siècle. On est immédiatement saisi par la scène du débarquement des troupes, les soldats étant portés par des serviteurs noirs. En plus d'être signifiant, c'est superbement filmé, le réalisateur João Nuno Pinto affectionnant les plans nocturnes ou crépusculaires, en lumière naturelle. C'est souvent d'une beauté à couper le souffle.
Le plus intéressant survient quand le héros (incarné par João Nunes Monteiro, qui a beaucoup payé de sa personne) plonge au coeur du Mozambique, d'abord avec deux serviteurs africains, puis un, puis tout seul. A partir de ce moment-là, les temporalités s'entrecroisent... ainsi que les réalités alternatives. A plusieurs reprises (parce qu'il est malade ou parce qu'il a consommé des substances psychotropes), le héros a des hallucinations. Comme le réalisateur nous place dans la tête du soldat, c'est à nous de déterminer si ce que l'on voit à l'écran est la réalité ou bien la déformation de celle-ci... voire un délire complet.
Zacarias finit par atterrir dans un village gouverné par les femmes, où il va faire office d'esclave, avant d'être intégré à la communauté. Le retournement de situation est piquant, bien mis en scène, d'autant plus que seuls les dialogues en portugais sont sous-titrés. Lorsque les Africains parlent en makonde ou makua, c'est par leur gestuelle qu'on peut arriver à les comprendre. Là, le film se fait quasiment ethnographique.
Notre petit soldat va finir par rencontrer un Allemand. Les pérégrinations de ces deux Robinson de l'Afrique ne manquent pas de saveur, avant que le drame contemporain ne les rattrape. En quelques mois, Zacarias aura mûri de dix ans. Notons que le réalisateur a voulu une fin morale à son histoire. Je n'en dirai pas plus, mais sachez qu'il est question d'un lion.
Pour qui s'intéresse à la représentation de la colonisation, cette oeuvre de plasticien ne manque pas d'envergure.
22:41 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 05 juillet 2020
Be natural
C'est ce que lançait Alice Guy-Blaché à ses acteurs, il y a plus de cent ans de cela... et c'est le titre du documentaire consacré à la première femme cinéaste, injustement oubliée. L'an dernier, j'avais consacré un billet à cette réalisatrice dont j'ignorais jusqu'alors l'existence.
Alors que cette pionnière est française, il a fallu attendre qu'une Américaine s'intéresse à son cas pour que ce film soit tourné. L'histoire d'Alice Guy se mêle aux débuts du cinéma. A l'origine, c'est une simple secrétaire de Léon Gaumont. Mais elle est curieuse de tout et plutôt entreprenante. Comme le cinématographe naissant n'est pas perçu comme un genre majeur, en France, on pouvait laisser une femme s'y adonner... à condition que son travail de secrétaire n'en pâtisse pas !
Ce film est aussi l'occasion de voir et d'entendre la pionnière. La réalisatrice Pamela Green a beaucoup utilisé un entretien télévisuel datant de 1957, un autre du début des années 1960, ainsi qu'une émission radiophonique de la même époque. (On peut entendre un extrait ici.)
Le documentaire est aussi intéressant pour ce qu'il dit de l'occultation des femmes de l'histoire du cinéma. Du côté français comme du côté états-unien, les anthologistes semblent avoir été longtemps saisis de la même fièvre sélective... misogyne. Alice Guy a même été doublement victime, puisque non seulement on a attribué nombre de ses oeuvres à des hommes, mais qu'en plus on lui a dénié la place de première femme réalisatrice, la remplaçant souvent par une comédienne qu'elle avait lancée.
C'est toutefois aux Etats-Unis qu'Alice Guy-Blaché a connu la prospérité. Avec son mari, elle a monté un studio de production (Solax) qui rencontra le succès. On nous en décrit le fonctionnement en détail. Cette partie américaine fera découvrir à certains spectateurs qu'avant Hollywood, il y eut le New Jersey. Le film raconte dans quelles circonstances les producteurs et les cinéastes ont fini par partir s'installer en Californie.
Le documentaire est aussi une enquête généalogique. Alice Guy-Blaché a une descendance aux Etats-Unis. Grâce à des animations (notamment cartographiques), on suit le film en construction, à travers les déplacements et les échanges téléphoniques de Pamela Green. Elle nous fait partager son enthousiasme pour ses découvertes. Elle finit par mettre la main sur quantité de documents, se trouvant aux Etats-Unis mais aussi dans le reste du monde (jusqu'en Australie !). Il existait donc bien de nombreuses sources sur la vie et le travail d'Alice Guy. La longue occultation de son oeuvre n'en est que plus scandaleuse.
C'est d'ailleurs une limite de ce film : la profusion de documents mis à l'écran, parfois pendant à peine une ou deux secondes. On sent que la réalisatrice a voulu éviter que ses spectateurs ne s'ennuient. C'est réussi, mais au prix d'un défilement parfois trop rapide. J'aurais aimé pouvoir m'attarder sur certaines photographies ou certains extraits de films.
Ce documentaire n'en reste pas moins passionnant et nécessaire.
P.S.
Dans la salle où je l'ai vu (dans un cinéma lotois reconstruit), j'étais seul !
samedi, 04 juillet 2020
Jumbo
Le titre de cette inclassable coproduction franco-belgo-luxembourgeoise reprend le surnom d'un des personnages, qui s'appelle en réalité... "Move it". C'est un... manège, dont l'héroïne Jeanne (Noémie Merlant, très bien) tombe amoureuse.
Cette jeune femme vit avec sa mère, si différente d'elle. Autant l'une est réservée, pudique, peu soucieuse de son apparence, autant l'autre (incarnée par une Emmanuelle Bercot en pleine forme) est rock'n'roll, avec maquillage, décolletés pigeonnants et verbe haut en couleur.
Jeanne est "technicienne de surface" dans un parc d'attractions. Elle travaille le soir, après la fermeture, quand il n'y a plus personne... et ça lui plaît. Au boulot, elle écoute la musique qu'elle veut et, surtout, elle a le parc pour elle seule.
Sa vie connaît un tournant quand est installé un nouveau manège. Doté de grands pistons et de grosses boules, il est impressionnant... et il commence à interagir avec Jeanne. Cela nous vaut une scène qui n'est pas sans rappeler Rencontres du troisième type.
A partir de là, soit on adhère, soit on rejette l'argument du film. J'ai adhéré. Je trouve que la mise en scène parvient à faire "vivre" le manège, avec lequel Jeanne communique grâce à un code de couleurs. Une improbable relation amoureuse naît entre la femme de ménage et cette machine qu'elle frotte, qu'elle caresse, qu'elle bichonne... et qui expulse des jets d'huile ! Dit ainsi, cela pourrait sembler graveleux, mais c'est mis en scène de manière poétique... et avec un incontestable savoir-faire. (Soyez attentifs aux reflets qui apparaissent au détour de certaines scènes.)
On s'y attendait : l'héroïne suscite l'incompréhension de son entourage, en particulier de sa mère. Ce film est aussi une histoire de tolérance (le manège se substituant à un amoureux que la famille -ou le voisinage- juge inconvenant). Noémie Merlant fait pleinement croire à son personnage, une jeune femme qui préfère passer ses journées à bricoler des attractions miniatures dans sa chambre plutôt que d'étaler sa vacuité sur les réseaux sociaux.
Une difficulté majeure était de conclure cette histoire. La réalisatrice le fait avec poésie et loufoquerie.
Un peu comme Le Secret des banquises il y a quatre ans, ce petit film francophone est un ovni cinématographique auquel il faut donner sa chance.
23:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 02 juillet 2020
Nous, les chiens
Cette animation sud-coréenne place les canidés au centre de l'intrigue. Ils aboient, bien sûr, mais ils parlent aussi, une licence poétique qui facilite l'identification. Car, si les auteurs ont pris soin de faire adopter aux héros des comportements authentiquement "animaux", il est non moins vrai que les caractères des personnages principaux sont inspirés de ceux des humains. Cela donne un mélange étrange, parfois naïf, mais d'une incontestable force.
Deux groupes vont entrer en contact : les "chiens des villes" et les "chiens des champs". Les premiers ont été récemment abandonnés par leur maître, mais sont restés au contact des humains, dont ils tentent de tirer leur pitance. Les seconds sont carrément retournés à l'état sauvage... et méprisent les premiers.
Voici le héros, Moong-chi (on a laissé aux personnages canins leur nom coréen), bel animal docile, dont on suit l'abandon et la progressive découverte de l'égoïsme de certains humains. Cette histoire est aussi celle de l'acquisition de l'autonomie et de la maturité, un peu à l'image d'un enfant qui grandit.
Sa rencontre avec les autres chiens abandonnés des villes est souvent émaillée d'humour. La troupe est dirigée par un petit vieux grincheux, entouré d'un grand costaud pas super-intelligent, de deux miniatures assez agitées et d'un terrier très indépendant.
Dans les rôle des méchants, on a les molosses dressés par un horrible personnage, à la fois éleveur de chiens et gérant d'une fourrière. C'est clairement une brute, capable de tout.
C'est le moment de dire que le fond de l'histoire est parfois dur (la mort et la violence sont présentes), mais qu'à l'écran, on a évité de représenter les scènes les plus choquantes. On en voit plutôt les conséquences. Les auteurs ont su pratiquer les ellipses nécessaires sans affadir leur propos.
La rencontre puis la collaboration avec les chiens de la forêt redonne du tonus à l'intrigue... et introduit un biais sentimental. Il va être davantage question d'amours canines dans la seconde partie, qui voit la petite troupe rencontrer de gentils humains.
La quête de la Terre promise, ce paradis réputé à l'abri des violences humaines ménage quelques surprises. Mais, à qui connaît un peu l'histoire coréenne, la localisation de cet endroit sauvage semblera logique. Les adultes trouveront sans doute la fin un peu trop mélodramatique, avec plus d'invraisemblances que dans le reste du film, mais l'ensemble n'en constitue pas moins un divertissement agréable... et civique.
P.S.
En voyant ce film, les cinéphiles purs et durs penseront peut-être à une autre animation, The Plague Dogs, qui date des années 1980 mais était ressortie sur nos écrans il y a quelques années de cela.
18:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 30 juin 2020
L'Ombre de Staline
Cette ombre s'étend sur l'Europe de l'Est et au-delà, puisque, à cette époque (le début des années 1930), le régime soviétique suscite l'admiration de milliers d'idiots utiles occidentaux, en particulier du correspondant du New York Times (très bien interprété par Peter Sarsgaard). C'est pour éclaircir le mystère des étourdissants succès économiques de l'URSS (alors que l'Occident s'enfonce dans la crise des années 1930) que le journaliste britannique Gareth Jones part pour Moscou, espérant au passage réussir la "passe de deux", à savoir obtenir une entrevue avec Staline, après celle décrochée avec Hitler.
Le jeune homme est incarné par James Norton, que les téléspectateurs connaissent pour ses rôles (très différents) dans les séries Happy Valley et Grantchester. Au cinéma, on l'a aperçu dans Mr Turner et Les Filles du docteur March. Dans la version originale, on entend le personnage principal s'exprimer en gallois, anglais et russe : c'est une coproduction britannico-polono-ukrainienne, très soucieuse de reconstituer le contexte de l'époque. (En tendant un peu l'oreille, au cours d'une séquence de partouze à Moscou, on entendra même un peu parler français, par une "participante" peu farouche...)
Au niveau de la distribution, je signale aussi la présence de Vanessa Kirby (vue récemment dans Fast & Furious : Hobbes & Shaw et Mission impossible - Fallout), dans un rôle marquant.
Ce film vaut le détour en raison de la peinture de l'aveuglement des Occidentaux (vis-à-vis de Staline comme d'Hitler, dont le pouvoir de nuisance est terriblement sous-estimé) et de la reconstitution d'un régime totalitaire encore un peu "artisanal".
Le plat de résistance est bien entendu le séjour que le héros effectue clandestinement en Ukraine (alors intégrée à l'URSS). Par étapes, il y découvre les conséquences d'une des plus terribles famines que le monde ait connue, une famine que les historiens accusent le régime stalinien d'avoir volontairement accentuée, voire créée (notamment pour briser le peuple ukrainien, rebelle à l'autorité russe). Pour moi, la séquence la plus poignante est sans conteste celle des enfants abandonnés, qui parviennent à survivre dans des conditions que je ne révèlerai pas.
Le paradoxe est que ces horreurs côtoient de la beauté, celle de la campagne ukrainienne enneigée et celle des chants tragiques des enfants, dont le héros va finir par comprendre le sens.
J'ai entendu des commentaires désobligeants de certains critiques à propos de la mise en scène d'Agneszka Holland (connue pour avoir réalisé des épisodes des séries Cold Case et House of Cards, ainsi que le long-métrage Europa Europa). Je ne partage pas ces points de vue négatifs. Les épisodes caméra à l'épaule ont leur sens : ils transmettent la vision d'un drogué, la peur d'un homme traqué ou le désarroi du héros tenaillé par la faim. Le reste du temps, c'est classique et plutôt bien fichu.
A une époque où le pouvoir poutinien remet Staline à l'honneur et où, en Allemagne, une poignée d'inconscients en appelle à Lénine, la sortie de ce film est un acte d'éducation civique.
14:56 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 27 juin 2020
La Communion
Je viens de découvrir ce film polonais, sorti avant le confinement et, fort heureusement, de retour dans les salles obscures. Le héros se prénomme Daniel. Ce n'est pas un enfant de choeur... même s'il sert la messe aux côtés du prêtre du centre éducatif fermé, où il purge une peine pour meurtre. Il y côtoie d'autres petites racailles jeunes en recherche qui ont suivi le mauvais chemin. Dans le rôle, Bartosz Bielenia est une révélation.
Grâce à son zèle, il réussit à sortir précocement du centre, avec une promesse d'embauche dans une scierie, dans un coin paumé de la Pologne. Mais il a d'autres projets. Cependant, rien ne va se passer comme prévu.
Je ne vais pas raconter ici l'enchaînement des circonstances qui conduisent le héros à se faire passer pour un prêtre. Le délinquant, amateur d'alcool, de cigarettes en tout genre et de musique techno, se révèle assez habile dans la gestion d'une communauté paroissiale, peut-être parce qu'il a pleinement conscience de ce qu'est le péché. La fonction fait l'homme, qui, au contact de personnes souffrantes, s'humanise.
De surcroît, il arrive dans le village alors qu'un drame empoisonne l'atmosphère. Il va aussi découvrir qu'un secret est lié à ce drame. Le condamné pour meurtre se découvre une âme de justicier. Dit comme cela, cela a l'air d'un simplisme outrancier, mais c'est mis en scène avec grâce. Jan Komasa construit des plans qui peuvent être d'une stupéfiante beauté (une danse en boîte de nuit, l'incendie nocturne d'un atelier, une descente de bus en pleine campagne...) ou d'une limpidité glaçante, comme ceux confrontant certains des protagonistes, au centre fermé comme dans le village.
J'ajoute que les seconds rôles sont eux aussi excellents, les acteurs donnant de l'épaisseur à des personnages construits de manière assez subtile. Parmi eux, les spectateurs des Innocentes reconnaîtront Eliza Rycembel.
Le scénario est suffisamment bien ficelé pour ménager le suspens jusqu'à la fin. C'est incontestablement l'un des films à voir en ce moment.
21:29 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 26 juin 2020
Woman
J'ai enfin pu voir ce documentaire, réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Il compile plusieurs dizaines d'entretiens, parmi les deux mille réalisés dans une cinquantaine de pays (identifiables sur une carte interactive disponible sur le site dédié au film).
En guise d'introduction, on nous propose des déclarations de fierté (d'être une femme), auxquelles succèdent quelques exemples de ce qu'elles ont à subir : harcèlement, inceste, excision (une séquence très pénible).
La thématique suivante est le sexe, dont les femmes parlent soit avec des mots choisis (de manière plutôt allusive), soit de manière très crue. La majorité des témoignages sont hétérosexuels, mais il est aussi question d'homosexualité, voire de bisexualité. Notons que les propos sont diffusés en langue originale et sous-titrés en français.
Vient ensuite la séquence "maternité", désirée, imposée... ou (rarement) refusée. On parle aussi de mariage, dans ce qu'il peut avoir de beau ou d'abominable. (Certaines des intervenantes ont été défigurées, dans des circonstances que je vous laisse découvrir.)
Le documentaire n'élude pas la question de l'apparence physique. Les témoins sont d'âge et de condition physique différents. On parle donc de vieillissement, de maladie, mais aussi de chirurgie esthétique.
Curieusement, alors que le film est assez long (1h40), il est assez peu question de l'emploi des femmes. On nous parle bien de la surcharge de travail qui pèse sur celles qui vivent dans les pays les plus ruraux. Du côté des pays développés, c'est le Canada qui est pris pour exemple, avec une cadre supérieure qui est parvenue à briser le "plafond de verre".
L'avant-dernière séquence est l'une des plus dures. Il y est question de viols de guerre, d'esclavage. Certains des témoins sont des Yézidies, l'une d'entre elles livrant une histoire particulièrement atroce (sur une gamine de neuf ans).
Pour éviter que cela ne se termine sur une note sombre, une séquence plus optimiste a été ajoutée en guise de conclusion.
J'ajoute qu'entre deux séquences, on nous propose un interlude. Parfois, c'est une création artistique, un peu snob à mon goût. Sinon, on nous offre quelques vues de villages et de femmes qu'on n'entendra pas dans le film.
L'ensemble est très fort (bien qu'un peu long). Je trouve que c'est un film qu'on pourrait passer dans les collèges et les lycées, tant il embrasse de thèmes "civiques".
jeudi, 25 juin 2020
The Hunt
Ce petit thriller met en scène une chasse à l'homme joyeusement gore. Cela commence par un dérapage dans un avion, où, apparemment, tout n'est que luxe, calme et volupté... C'est fou ce qu'on peut faire avec un talon-aiguille !
Après une ellipse, on se retrouve en pleine forêt, loin de tout, avec un groupe de personnes bâillonnées. Il ne faut pas se relâcher, parce que les éclaboussures sont vite de retour... et à haute dose. Deux jeunes femmes (une blonde puis une brune... un partout, la balle au centre) subissent un sort horrible, mis en scène avec une dérision morbide.
L'une des meilleures séquences voit un duo de survivants débarquer dans une station-service typiquement américaine. Je ne peux évidemment pas raconter ce qu'il s'y passe, mais sachez que, pour les spectateurs, c'est l'occasion de faire la rencontre d'une jeune femme au physique très avantageux... et surtout experte en maniement des armes :
Elle est incarnée par Betty Gilpin, une comédienne que les fans de la série Elementary connaissent : dans la saison 4, elle a interprété la nouvelle petite amie de Sherlock, aussi sexy que décalée sur le plan intellectuel... et amatrice de chats.
Mais revenons à nos moutons... et au petit cochon, nommé Orwell. Le gibier rescapé va se muer en traqueur, pour notre plus grand plaisir. Même s'il manque de réalisme, le petit massacre mis en scène dans la tanière des chasseurs est du plus bel effet.
C'est le moment choisi par le réalisateur pour opérer un retour en arrière. On y découvre les motifs de l'organisation de cette chasse et les raisons qui ont poussé au choix des proies. Sans rien révéler d'essentiel, je peux quand même dire qu'il est question d'une vengeance. L'action culmine lors d'un face-à-face entre une belle blonde et une belle brune, qui s'envoient de gros pruneaux dans la tronche. Là encore, cela manque de réalisme, mais, quand on est pris dans le rythme, c'est assez jouissif.
ATTENTION : LA SUITE RÉVÈLE DES ÉLÉMENTS CLÉS, QU'IL VAUT MIEUX NE PAS CONNAÎTRE AVANT D'AVOIR VU LE FILM !
C'est une oeuvre politique, trumpiste même. Bigre !
On s'en rend compte en découvrant qui sont les proies et les chasseurs. Ceux-ci sont désignés comme des "progressistes mondialistes" (en clair, pour un public américain : des démocrates), adeptes du politiquement correct. Ils sont tournés en dérision à l'occasion des scènes de dialogues. Ainsi, lorsque l'un d'entre eux s'adresse au groupe (composé d'une femme et d'une demi-douzaine d'hommes) en disant "les mecs" (guys dans la V.O.), il se fait vertement reprendre... et finit par s'excuser ("Désolé, j'ai genré."), comme s'il venait de péter ! Peu après, c'est un autre membre de l'équipe (blanc) qui est accusé "d'appropriation culturelle"... parce qu'il porte un kimono. Le trait est encore plus gras quand, au moment du choix des victimes, un grand débat oppose les futurs chasseurs lorsqu'il est question d'inclure une proie "africaine-américaine".
Du côté du gibier, on n'a que des Blancs, supposés républicains, électeurs de Donald Trump. Certains sont racistes, homophobes, d'autres simplement fana-mili ou conspirationnistes façon "vérité alternative". Dans un premier temps, ils sont tous présentés de manière sympathique. Un peu plus tard, à l'occasion du retour en arrière, on découvre que la plupart sont des gros cons. Le film nuance donc un petit peu son propos, surtout quand on apprend les circonstances réelles de la création de cette chasse à l'homme.
23:31 Publié dans Cinéma, Politique étrangère, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
mercredi, 24 juin 2020
En avant
Je n'avais pas vu le dernier Disney-Pixar à sa sortie, en mars dernier. La réouverture des cinémas m'a permis de de combler cette lacune.
La scénario est assez original : il place des personnages légendaires (elfes, licornes, cyclopes, lutins, gnomes...) dans un contexte "banlieusard", au sens états-unien du terme. Après une belle introduction humoristique, on les retrouve donc comme substituts d'Américains moyens, habitant un quartier résidentiel. Le contraste est assez réjouissant, avec quelques belles trouvailles : le chien domestique qui est une dragonne (nommée Fournaise !) facétieuse et gourmande, le policier-centaure moustachu et bedonnant...
Le premier tournant de l'histoire est la résurrection partielle du père disparu. Cette "moitié de père" va suivre le duo de héros dans leurs aventures. Ce sont deux frères très dissemblables. L'aîné est un gros balourd fan de fantasy, le cadet est introverti, mais plus futé. Il finit par comprendre qu'il a un don.
Les voilà partis à la recherche d'une pierre magique, susceptible de ressusciter complètement le père décédé. Sur leur chemin, ils vont croiser la célèbre Manticore (qui, dans la VF, a la voix de Maïk Darah, qui double -entre autres- Whoopi Goldberg) et un improbable gang de hells angels. Cette quête n'est pas sans rappeler celle du Seigneur des anneaux, auquel il est (me semble-t-il) plusieurs fois fait référence (sur le plan visuel). On note aussi un clin d'oeil à Toy Story.
Au cours de ces aventures, les deux adolescents mûrissent. Le cadet prend confiance en lui. L'aîné prend conscience du regard que les autres portent sur lui. Il doit sortir de sa "zone de confort" pour jouer son rôle de grand frère. Même la mère est de la partie. Pour protéger ses enfants, cette "maman grizzli" n'hésite pas à s'attaquer à un dragon ! Cela se conclut dans l'émotion, les garçons apprenant à faire leur deuil du père.
Franchement, c'est beau, sur la forme comme sur le fond.
16:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 22 juin 2020
Trois étés
Voilà un film qui n'était pas encore arrivé à Rodez au moment du confinement. Je n'en connaissais pas la réalisatrice, mais l'actrice principale, Regina Casé, remarquée il y a quelques années dans Une Seconde Mère.
L'intrigue se déroule toujours en décembre-janvier (période d'été dans l'hémisphère Sud), au moment des fêtes, sur trois années : 2015, 2016 et 2017. Le théâtre principal de l'action est une splendide villa, à proximité de l'océan Atlantique.
La première année voit la fête de Noël coïncider avec les 25 ans de mariage du couple de grands bourgeois. L'argent coule à flots pour ces privilégiés qui, s'ils traitent avec bienveillance le petit personnel, veillent à le remettre à sa place quand il se permet quelques libertés. Cette première demi-heure met en scène avec brio le gigantesque écart social séparant des individus qui pourtant se côtoient. L'héroïne est Mada, la majordome, la seule qui s'autorise quelques privautés avec les puissants, mais qui se dévoue corps et âme pour eux.
Incidemment, on remarque que, dans tous les groupes de "dominants" (les propriétaires de la villa, leurs amis, l'équipe de télévision, les riches touristes), les personnes à la peau claire sont les plus nombreuses, tandis que chez les employés de maison (les habituels comme les occasionnels), on est beaucoup plus "basané".
Un an plus tard, la situation a changé. La villa ne va pas recevoir la famille des propriétaires pour Noël. Dans un premier temps, on ne sait pas où ils sont. Ils semblent avoir coupé les ponts... et n'alimentent même plus leurs comptes sur les réseaux sociaux où, d'habitude, ils dégueulent leur joie de vivre dans un luxe effréné. Ce sont donc les employés qui vont faire la fête dans la villa !... Mais, attention, la police est sur le point de débarquer.
La dernière demi-heure montre l'équipe restreinte des employés un an plus tard, toujours dans la villa désertée par ses propriétaires (on sait désormais pourquoi). Seul le grand-père gâteux, ancien prof intègre, reste sur place. Une nouvelle famille s'est formée, autour de la débrouille (les salaires ne sont plus versés). Mada découvre les joies de "Harry bnb" et propose aux touristes des visites nautiques de la côte friquée, avec quelques commentaires bien sentis sur les propriétaires des villas plus ou moins occupées.
Mais c'est l'arrivée d'une équipe de télévision qui redonne du tonus à l'intrigue (qui avait un peu molli dans la deuxième partie). Cela nous vaut un véritable morceau de bravoure, avec Mada en vedette. On comprend pourquoi cette femme plus toute jeune ne semble pas avoir de vie de famille. C'est poignant.
Cerise sur le gâteau : la conclusion est belle.
19:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 21 juin 2020
La réouverture des salles de cinéma
A Rodez, c'est dès lundi que le public va enfin pouvoir retrouver les salles obscures. Au programme figurent des longs-métrages déjà à l'affiche en mars dernier (avant le début du confinement), ainsi que quelques nouveautés.
Parmi les ressorties françaises à l'affiche du CGR de Rodez, il n'y a (pour moi) rien d'exceptionnel, mais quelques productions honnêtes. Les amateurs d'histoire se tourneront vers De Gaulle, de facture très classique. Plus piquant est La Bonne Epouse (dont l'action se déroule juste avant Mai 68), qui fut pour moi une agréable surprise. Celles et ceux que l'humour facile ne rebutent pas se risqueront à 10 jours sans maman, une comédie basique, moins calamiteuse que ce que je redoutais. Enfin, les amateurs d'univers poétique goûteront Une Sirène à Paris, une réussite surtout sur le plan visuel.
A ce florilège j'aurais pu ajouter Radioactive, le biopic de Marie Curie réalisé par Marjane Satrapi... en anglais, le film étant l'adaptation d'un roman graphique britannique. Il a été boudé par les critiques français... mais il vaut bien mieux que ce qu'ils en ont dit.
C'est sans surprise du côté anglo-saxon qu'il faut chercher les meilleures ressorties. Dark Waters est un excellent film militant, fouillé, très bien interprété. A l'opposé du spectre politique, Le Cas Richard Jewell est un très bon film "de droite". J'ai gardé pour la fin une petite perle, The Gentlemen, que j'ai bien envie d'aller revoir en version originale sous-titrée.
Cela nous mène tout naturellement aux oeuvres de pur divertissement. C'est aussi à cela que sert le cinéma : oublier ses soucis, se vider la tête et plonger pendant 1h30 à 2h dans un univers totalement étranger. Le Voyage du Dr Dolittle est à classer dans la catégorie "tout public", avec de superbes trucages numériques. L'Appel de la forêt joue sur le même registre, avec Harrison Ford à la place de Robert Downey Jr, les chiens et les loups remplaçant la ménagerie fantastique de Dolittle.
Aux amateurs de sensations fortes, je recommande plutôt Invisible Man, avec Elisabeth Moss. C'est aussi en raison de la présence d'une actrice au générique que je suis allé voir Birds of Prey. Margot Robbie s'est éclatée dans le rôle d'Harley Quinn, une vilaine exubérante que je me contenterai de qualifier de "chipie"...
Je ne voudrais pas terminer ce billet sans conseiller un "film de mecs" : Bad Boys for life. C'est pas subtil, bruyant, clinquant, mais assez bien foutu. Pour digérer, en attendant mieux.
15:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
mardi, 16 juin 2020
Tandem (à moitié) fictif
C'est ce soir que France 3 achève la rediffusion de la saison 3 de la série Tandem (dont la quatrième saison nous a été proposée en avril-mai derniers). Pour moi, c'est une découverte, puisque je n'ai commencé à regarder cette série que cette année.
Le premier des quatre épisodes (le neuvième de la saison) s'intitule "Port d'attache". Il constitue un moment charnière dans l'évolution de la série, puisqu'il voit le départ de la (charmante) lieutenante Camille Barbier (incarnée par Nelly Lawson, dont on a pu aussi, à l'occasion, apprécier le timbre de la voix). Son cadeau de départ est quelque peu surprenant :
Elle est remplacée par la pétulante Inès Zaïdi (Baya Rehaz), dont le personnage a pris de la consistance dans la saison 4 :
L'intrigue, pas inintéressante, entremêle de vieilles histoires de famille et la photographie.
L'épisode 10 ("Diamants noirs") marque une montée de tension dans la brigade, puisque la menace que représente le colonel semble se préciser. Pour la déjouer, le capitaine Marchal va mettre au point un astucieux stratagème (fondé sur sa connaissance des principes qui régissent la fonction publique... je n'en dis pas plus). Dans le même temps, l'équipe enquête sur une mort qui paraît (presque) en tout point accidentelle. On est dans le milieu de la truffe et, là encore, les histoires de famille jouent un rôle important.
Pour moi l'épisode suivant "Le chemin des templiers" est le meilleur de la soirée, mais aussi le meilleur de la saison... et sans doute l'un des meilleurs de l'ensemble de la série. D'une part, j'ai beaucoup aimé le fond de l'intrigue, qui baigne dans les légendes qui touchent aux chevaliers templiers... et la cité d'Aigues Mortes constitue un superbe écrin pour les plans tournés en ville. D'autre part, la mise en place du stratagème imaginé par Marchal pour éviter la mutation de son ex-compagne donne lieu à des scènes particulièrement cocasses :
La saison se conclut par "La peur au ventre", un épisode inhabituellement sombre, au cœur duquel se trouve la violence faite aux femmes. Le commandant Soler se retrouve en première ligne, contestée par son colonel et, malgré cela, prête à enfreindre les ordres pour secourir des femmes battues :
C'est riche en émotions. Les deux acteurs principaux (Astrid Veillon et Stéphane Blancafort) sont toujours aussi formidables. Leur complicité fait plaisir à voir.
P.S.
D'après les programmes télévisuels, il semble qu'à partir de la semaine prochaine France 3 ait décidé de diffuser une autre série. Je n'aurai donc pas l'occasion de voir les épisodes de la saison 1. Dommage.
P.S. II
J'ai oublié de signaler un autre atout de la série : sa musique d'accompagnement, signée Arno Alyvan. Il a notamment particulièrement réussi l'habillage audio des scènes comiques.
21:10 Publié dans Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, médias, cinéma, cinema, film, films
lundi, 15 juin 2020
The Event
J'ai récemment découvert cette série (qui a pourtant presque dix ans), dont l'intégralité des épisodes est disponible (gratuitement), en version originale comme en VF, sur MyTF1.
Au départ, on croit se trouver devant une resucée, un mélange de Lost (sans les spéculations religieuses) et de 24 heures chrono (sans le décompte du temps). Un attentat est organisé contre le tout nouveau président des Etats-Unis, qui vient de découvrir l'existence d'une base secrète en Alaska, où sont emprisonnés depuis plus de soixante ans des extraterrestres qui ont échoué sur notre planète. L'intrigue politique se mâtine donc de science-fiction, de romantisme et de valeurs familiales. Il faut subir les premiers épisodes, nourris de nombreux retours en arrière (envoyés dans le désordre), pour prendre conscience de la richesse de cette histoire originale, qui tourne autour d'une douzaine de personnages-clés.
On commence par le couple de héros, Leila et Sean, deux tourtereaux à la limite du supportable. Elle est une blondasse naïve (et un tantinet chialeuse), tandis que lui est le beau gosse serviable, presque trop propre sur lui. Dans la VF, il a la même voix plaintive que le Spencer Reid d'Esprits criminels. C'est agaçant... et sans doute un peu volontaire de la part des producteurs, qui dévalorisent légèrement leurs héros en début de saga, avant de les montrer de plus en plus responsables, voire héroïques. Et voilà comment se mettre le jeune public dans la poche !
Chez les puissants, c'est un trio qui mène la danse, avec le président Martinez (un démocrate idéaliste), son épouse Christina (une femme engagée qui a quelques secrets) et le vice-président (républicain) Jarvis, à la fois ambitieux, orgueilleux et patriote. Ce ticket n'est pas sans rappeler celui formé par Barack Obama et Joe Biden, mais aussi celui, plus ancien, constitué de John Kennedy et Lyndon Johnson. Au fur et à mesure des épisodes, on comprend à certaines allusions que les scénaristes ont voulu lancer quelques piques à Obama (l'idéaliste devenu le champion des exécutions extrajudiciaires), en l'associant à une figure qui évoque plutôt une image caricaturale de Johnson.
L'intrigue est donc nourrie de références à l'histoire des Etats-Unis, les extraterrestres détenus se substituant aux prisonniers de Guantanamo et le Washington Monument au World Trade Center.
L'action des puissants s'appuie sur des collaborateurs dévoués, bien que non exempts d'arrières-pensées :
Blake Sterling (à gauche) est un directeur de la Sécurité nationale vétilleux, un tantinet dissimulateur, mais grand commis de l'Etat. Son personnage s'étoffe de manière assez surprenante au cours de l'histoire. Celui de Simon Lee (à droite) réserve aussi quelques surprises : le policier dévoué et efficace cache lui aussi quelques secrets. Mais son profil psychologique demeure assez stable tout au long de la série. On notera que ces deux personnages importants sont incarnés par des habitués des seconds rôles sur le petit écran.
Du côté des extraterrestres, les figures dominantes sont Sophia et Thomas. Elle est prisonnière depuis des décennies, alors que lui est un infiltré (il n'a pas été repéré par les Terriens). Je vous laisse découvrir quel lien secret les unit.
Pour compléter le tableau, il faut signaler deux autres protagonistes. Commençons par Michael, pilote de ligne, père attentif de Leila et qui, lui aussi, cache de lourds secrets :
Je termine par celle qui est presque ma préférée : Vicky, une "méchante" très badass à propos de laquelle on va découvrir que, sous sa carapace de sarcasme et de cuir, elle cache un coeur qui bat :
En dépit de quelques grosses ficelles scénaristiques et du recours au "juste à temps", j'ai été pris par cette série d'anticipation, à la distribution soignée (avec de nombreux seconds rôles intéressants) et aux effets spéciaux plutôt réussis.
P.S.
L'unique saison comprend 20 épisodes, complétés par deux supplémentaires, pour boucler l'intrigue... mais le coup de théâtre final laisse la porte ouverte à une reprise ultérieure.
22:42 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : médias, télévision, cinema, cinéma, film, films
mardi, 19 mai 2020
Tandem de ruptures
La comédie policière diffusée par France 3 se révèle être la série la plus rafraîchissante du moment. Ce mardi soir sont diffusés deux nouveaux épisodes inédits.
Le premier, "Le jeune homme et la mer" (le neuvième de la saison 4), a pour arrière-plan le milieu du kitesurf. L'intrigue policière est correctement conçue mais, là encore, ce sont les péripéties de la vie privée des personnages principaux qui donnent toute sa saveur à l'épisode. Les parents de la commandante Léa Soler sont séparés. Son père (le colonel de la brigade) squatte chez Paul, son ex-gendre, avec lequel il s'entend bien. Il décide même de retourner sur le terrain, ce qui crée quelques situations cocasses. Toutefois, les meilleurs moments restent ceux qui confrontent les deux héros, l'une des scènes se concluant de manière particulièrement drôle :
Le second épisode inédit s'intitule "Or blanc". Il a pour cadre le monde viticole... et celui du jeu. C'est toujours globalement bien construit, avec en bonus de savoureuses pointes d'humour. C'est au tour de Léa d'accueillir chez elle l'un de ses parents séparés... sa mère, avec laquelle elle était un peu fâchée. Dans le même temps, elle doit gérer les débuts agités de son fils Thomas chez les pompiers... et les fantaisies vestimentaires du lieutenant Erwan Lebellec, qui lui aussi héberge sa mère, un personnage fantasque que l'on a découvert la semaine dernière.
On attend avec impatience les derniers épisodes de la saison, qui seront diffusés la semaine prochaine.
15:37 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, cinéma, cinema, film, films, médias, actu, axtualite, actualites, actualité, actualités