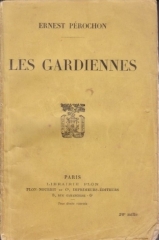vendredi, 02 février 2018
L'Echange des princesses
Par un curieux détour du destin, ce film, adapté d'un roman français, coproduit par France 3, réalisé par un Français, dans lequel ont tourné nombre d'acteurs français et où (conformément à la réalité historique) on parle français, même à la cour d'Espagne, est nommé aux César 2018 dans la catégorie... "meilleur film étranger".
Il est réalisé de manière très classique, à tel point qu'on peut dire à son sujet qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de la "qualité française". Certains trouvent cela ennuyeux. Moi, j'ai aimé cette mise en scène académique, parfois quasi picturale, à l'image du plan du début, décalque d'un tableau filmé en zoom arrière.
Je suis aussi "client" des films en costumes, avec ces robes invraisemblables et ces tuniques amidonnées et boutonnées. J'en profite pour rendre hommage au travail des bruiteurs, qui ont parfaitement restitué les frottements des tissus, très agréables aux oreilles.
Mais cette histoire de mariages (arrangés) croisés entre les familles royales de France et d'Espagne vaut surtout pour le jeu des acteurs... et des actrices. On a parlé d'Olivier Gourmet (qui incarne le Régent) et de Lambert Wilson (qui interprète un Philippe V tonitruant). On n'a pas assez souligné la performance d'une brochette de comédiennes épatantes.
A tout seigneur tout honneur. Voici donc Andréa Ferréol, qui incarne la princesse Palatine, la belle-sœur de feu Louis XIV, dont la verve est redoutée à la Cour, mais qui va s'attacher à la toute jeune princesse espagnole que l'on destine à Louis XV encore mineur.
C'est une autre figure tutélaire, de plus modeste extraction, que l'on voit assez souvent dans le film, Mme de Ventadour, gouvernante du futur roi de France puis de sa promise d'outre-Pyrénées. Dans le rôle, Catherine Mouchet (inoubliable jadis dans Thérèse) est impeccable de rigueur et de tendresse contenue.
De son côté, la piquante Ananamaria Vartolomei incarne la fille rebelle du duc d'Orléans, promise au très falot prince des Asturies. Sa beauté a visiblement conquis celui-ci à distance, puisque l'on suggère qu'il a rapidement pris l'habitude de se pogner devant le portrait de Louise Elisabeth...
Mais la véritable révélation de ce film est une adorable poussinette, j'ai nommé Juliane Lepoureau, qui a la lourde tâche de rendre vraisemblable le personnage de la gamine espagnole donnée en pâture au futur roi de France. Elle est vraiment adorable, avec un regard où pétille l'intelligence :
Je me suis laissé prendre à cette étonnante intrigue, portée par la qualité de l'interprétation et la beauté de certains plans. L'information historique est ponctuellement mêlée à la fiction, à travers certains détails de la vie quotidienne ainsi que de petites incrustations évoquant le contexte ou le devenir des principaux personnages.
20:24 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mercredi, 31 janvier 2018
Les nominations pour les César 2018
Ça y est ! L'Académie des arts et techniques du cinéma (français) a rendu publique la liste des nommés. Je dois dire que, cette année, je suis plutôt satisfait des choix qui ont été faits par les votants... mais je redoute le palmarès final, qui risque d'être très éloigné du mien.
Dans un monde idéal, voici celles et ceux que j'aimerais voir récompensés.
César de la meilleure actrice : Emmanuelle Devos, dans Numéro Une (à défaut, Charlotte Gainsbourg, excellente dans La Promesse de l'Aube).
César du meilleur acteur : Reda Kateb, dont la performance dans Django a été quelque peu sous-estimée en raison du semi-échec rencontré par le film.
César du meilleur acteur dans un second rôle : Niels Arestrup ou Laurent Lafitte, dans Au revoir, là-haut.
César du meilleur espoir féminin : sans aucune contestation possible Iris Bry, dans Les Gardiennes.
César du meilleur scénario original : Julia Ducournau, pour Grave (juste devant Claude Le Pape et Hubert Charuel, pour Petit Paysan)
César de la meilleure adaptation : évidemment Albert Dupontel et Pierre Lemaitre pour Au revoir là-haut.
César de la meilleure musique originale : Christophe Julien, pour Au revoir là-haut (devant Jim Williams, pour Grave).
César du meilleur son : Jean Minondo, Gurwal Coïc-Gallas, Cyril Holtz et Damien Lazzerini pour Au revoir là-haut.
César de la meilleure photo : Vincent Mathias, pour Au revoir là-haut (ou Caroline Champetier, pour Les Gardiennes).
César du meilleur montage : Christophe Pinel, pour Au revoir là-haut (ou Julie Léna, Lilian Corbeille et Grégoire Pontecaille pour Petit Paysan).
César des meilleurs costumes : sans hésiter Mimi Lempicka, pour Au revoir là-haut.
César des meilleurs décors : Pierre Quefféléan, pour Au revoir là-haut.
César de la meilleure réalisation : sans conteste Albert Dupontel, pour Au revoir là-haut.
César du meilleur long-métrage d'animation : Zombillénium (une excellente surprise).
César du meilleur premier film : mon coeur balance entre Grave et Petit Paysan. (Le contexte socio-économique me pousserait à choisir le second, mais je pense que le premier est encore plus abouti sur le plan cinématographique.)
César du meilleur film étranger : The Square, mais je ne serai pas scandalisé si Dunkerque ou Le Caire confidentiel décroche la statuette.
César du meilleur film : évidemment, assurément, indubitablement, inévitablement, irrésistiblement Au revoir là-haut, d'Albert Dupontel.
vendredi, 26 janvier 2018
Les Heures sombres
Décidément, ces dernières années, nos amis anglo-saxons ne cessent de se passionner pour les deux dirigeants britanniques qui ont joué un rôle majeur au début des années 1940, à savoir Winston Churchill et George VI. Celui-ci tint le premier rôle dans Le Discours d'un roi, quand celui-là fut à l'affiche de Churchill. Même si Gary Oldman et Ben Mendelsohn ne font pas oublier ceux qui les ont précédés, ils "assurent" très correctement.
Le premier problème est l'impression de déjà-vu qui se dégage de nombreuses scènes. Que ce soit le Churchill intime, sa relation avec sa secrétaire ou le bégaiement de George VI, à de nombreuses occasions, ce ne sont pas les images de ce film qui s'imposent à l'esprit, mais celles d'autres oeuvres.
Pourtant, je dois reconnaître qu'il y a des efforts de mise en scène. Du (presque) Premier ministre allumant son cigare dans le noir au ballet des doigts de sa secrétaire répondant aux ébauches de discours du même, on est agréablement surpris, et à plusieurs reprises, par certains effets. J'ai aussi en mémoire le moment où la porte de l'une des salles du bunker souterrain se referme sur Churchill, ne laissant voir que son visage dans la petite lucarne, comme s'il était prisonnier.
Ce film a au moins le mérite d'apprendre au public non spécialiste (et de rappeler à ceux qui l'auraient oublié) que le courant pacifiste (celui de l'apaisement) fut très influent au Royaume-Uni et que même Churchill douta parfois de la marche à suivre. Cependant, c'est mis en en scène de manière excessivement mélodramatique : le personnage de Churchill, presque seul contre tous est plongé dans le doute, à un point où il semble prêt de basculer, avant de repartir à la conquête de l'opinion. De la même manière, on ne comprend pas bien comment le roi a changé d'avis, ni comment Churchill a retourné une partie de la Chambre des Communes.
Cela ressemble trop souvent à une enluminure, avec des longueurs et, paradoxalement, des raccourcis historiques malvenus. (La vision des Français est caricaturale et je laisse les spectateurs de Dunkerque juger de l'évocation de l'opération Dynamo...). C'est de surcroît trop complaisant vis-à-vis de l'élite aristocratique britannique. Et que dire de ces acteurs qui prennent la pose ! La caméra s'attarde trop souvent de manière emphatique. Ah, pour sûr, on a remarqué qu'untel a soudainement levé le sourcil ou que tel autre a fermé les yeux quand il a senti venue sa défaite politique. Quant à la séquence dans le métro, si elle commence de manière tonique, elle s'enlise assez vite dans une sorte de politiquement correct meringué.
Bref, en dépit de quelques qualités perceptibles à l'écran, c'est une déception.
21:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
Les Gardiennes (le roman)
Ayant apprécié le film réalisé par Xavier Beauvois, j'ai voulu en savoir plus sur le roman qui l'avait inspiré, d'autant plus qu'il y aurait de notables différences entre l'oeuvre d'Ernest Pérochon et le long-métrage.
Je me suis procuré un exemplaire d'époque, publié en 1924. (C'est mon côté snob.) Je l'ai trouvé d'une lecture agréable, plutôt facile. Ce sont les descriptions "à la Zola" qui m'ont le moins enchanté, Pérochon n'ayant pas le talent du pape du naturalisme.
Par contre, l'écrivain sait camper une situation et dramatiser une scène. L'intrigue est plus noire que dans le film et un peu plus fouillée. Elle compte plus de personnages, y compris dans la famille qui est au coeur de l'histoire. Hortense (incarnée par Nathalie Baye au cinéma) a eu quatre et non pas trois enfants. Il manque Norbert, le fils aîné (lui aussi parti au front), dont l'épouse peine à gérer seule la petite exploitation du ménage, à proximité de celle de ses beaux-parents. Hortense a encore son mari, qu'elle mène à la baguette.
Les caractères sont les mêmes que dans le film. Celui d'Hortense est encore plus intense : elle peut se montrer plus dure, mais on la sent aussi davantage souffrir. Beauvois a donc un peu limé les angles, tout comme il a rendu sa fille Solange plus sympathique. Dans le roman, c'est vraiment une grosse feignasse... et elle trompe réellement son époux Clovis.
Au niveau des autres fils, il n'y pas grand chose à dire. Ils correspondent à ce que l'on peut voir dans le film, à ceci près que Constant n'est pas instituteur dans le roman. Quant à l'interprétation de Francine par Iris Bry, elle est en totale conformité avec ce que j'ai pu lire, même si l'actrice rousse interprète une jeune femme brune.
Les personnages secondaires pimentent un peu plus l'intrigue dans le roman. Il y a les deux valets (renvoyés quand débute le film) et, surtout, il y a Maxime, le fils de Norbert et Léa (et donc le petit-fils d'Hortense), un chenapan qui va se prendre d'affection pour Francine. Grâce à lui et à Georges, la jeune femme découvre les marais de la région, avec leurs chenaux à la limite du praticable, un aspect de l'histoire totalement évacué du film, qui n'évoque que la plaine céréalière.
Je termine par l'un des personnages-clés, Marguerite, secrètement amoureuse de Georges. Dans le film, elle est la fille que Clovis a eue d'un premier mariage (la mère étant morte en couches), alors que, dans le roman, elle est une cousine, qu'Hortense verrait bien épouser son dernier fils. Le roman la montre avec son frère tenter de garder à flot la boulangerie, alors que le père est sous les drapeaux. La rivalité amoureuse n'est pas aussi tendue que dans le film.
Quant à la conclusion, elle diffère un peu. Dans le roman, Francine finit par recroiser Hortense et a une explication avec elle. Elle s'éloigne alors qu'elle n'a pas encore accouché, mais elle est devenue une femme indépendante.
Même si le style et certaines considérations sociétales sont un peu datés, cette lecture fut une agréable surprise.
15:29 Publié dans Cinéma, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, littérature, livres, écriture
mercredi, 24 janvier 2018
The Passenger
Voici donc Le Passager, titre qu'aurait dû porter le film si le distributeur n'avait pas joué les grosses feignasses. (Le plus cocasse est que le titre d'origine est The Commuter, que l'on pourrait traduire par "Le Banlieusard" ou "Le Pendulaire".) Liam Neeson retrouve Jaume Collet-Serra, qui l'a déjà dirigé dans Sans Indentité, Non-Stop (pas le meilleur) et, il y a trois ans, Night Run (potable). Ici, même si le héros est un peu fatigué (à soixante ans, il espère prendre sa retraite d'ici cinq ans), on est plutôt dans le haut du panier, question "film d'action pour amateurs du genre".
Le début est habilement construit. La superposition de plusieurs scènes tournées à des moments différents, mais dans exactement les mêmes contextes, nous fait bien comprendre ce qu'est la vie quotidienne (en semaine) d'un col blanc banlieusard new-yorkais.
Mais la petite vie (censée être) idéale du héros va rapidement prendre un tour plus sombre : il apprend une terrible nouvelle et, dans la foulée, se retrouve pris dans une machination qui le dépasse. Coup de bol pour ce courtier en assurances : c'est un ancien flic. Son expérience (ainsi que quelques vieux réflexes) va lui être très utile pour (tenter de) se sortir de ce mauvais pas.
Au niveau du scénario, c'est bien construit. Dans un premier temps, le héros doit identifier une personne dans le train, sur la base d'indices ténus. Le problème est que de nombreux passagers correspondent au début de profil qu'il s'est construit. L'intrigue prend un tour Cluedo, d'autant plus qu'un meurtre est rapidement commis.
L'action n'est pas en reste, avec quelques scènes de baston bien filmées (Collet-Serra sait faire) et un réel sens de l'utilisation des espaces clos, du sas intermédiaire entre deux rames à la trappe d'un wagon, en passant par les rangées plus ou moins encombrées. L'ancien flic d'origine irlandaise fait merveille avec ses grosses paluches et son sens de l'observation. Il s'avère quasi-insubmersible, malgré les gnons, malgré le couteau, malgré les flingues, malgré les trahisons.
La tension monte par saccades, en particulier quand l'un des trains de banlieue s'emballe. A l'écran, cela donne une séquence particulièrement spectaculaire.
C'est donc un bon divertissement, pour peu qu'on accepte qu'un jeune sexagénaire puisse corriger successivement plusieurs gredins dans la force de l'âge. A l'arrière-plan, on notera quelques considérations sur l'endettement des ménages états-uniens, le coût des études (de la maternelle à la fac) et l'indécence des hommes d'argent. Ce n'est déjà pas si mal, pour une œuvre grand public.
21:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 18 janvier 2018
In The Fade
Au CGR de Rodez, nous avons eu ce film en sortie nationale... et en version originale sous titrée ! Alléluia ! (Il est aussi possible de le voir en version doublée.) C'est quand même l'occasion d'entendre parler la langue d'Angela Merkel, ce qui n'est pas si fréquent dans la province reculée du Rouergue... où le premier employeur privé est la filiale d'une entreprise allemande, Bosch...
Le début est déroutant. Un homme se trouve en prison, mais il est habillé comme un maquereau futur marié. C'est filmé par un dessous-de-bras. On comprend plus tard pourquoi. Suit la séquence du bonheur. On découvre l'héroïne Katja (Diane Kruger, formidable), une épouse et mère comblée, ancienne étudiante rockeuse tatouée (beurk !). Les dialogues sont souvent cocasses... voire assez crus.
Evidemment, on attend la rupture de ton. (L'intrigue s'inspire d'une histoire vraie.) Même si c'est un brin mélodramatique, on compatit à la douleur de Katja. Diane Kruger (ai-je dit qu'elle est formidable ?) ne triche pas. Une scène magnifique montre le progressif affaiblissement de tous les sons, face à la douleur muette de la veuve.
Vient ensuite l'enquête puis le procès. L'enquête est déroutante, parce que les victimes sont, dans un premier temps, presque considérées comme des suspects. Fatih Akin (le réal) nous fait toucher du doigt les différences de point de vue : l'époux étant un ancien délinquant, kurde de Turquie, les policiers soupçonnent un tas de trucs louches. Et comme Katja n'est elle-même pas une sainte, la situation devient étouffante.
Le procès finit par arriver. C'est mis en scène de manière à montrer la rigueur de l'organisation judiciaire... et la dureté d'une mécanique censée préserver la démocratie, mais qui a tendance à broyer aussi les parties civiles. C'est l'occasion de découvrir deux très bons acteurs : Ulrich Tukur (vu dans Amen, Le Couperet, La Vie des autres, John Rabe) et surtout Johannes Krisch (vu notamment dans Le Labyrinthe du silence), qui incarne l'un des avocats de la défense, un type incontestablement très habile, mais dont on comprend assez vite qu'il ne défend pas les néo-nazis que pour l'argent...
Une nouvelle rupture de ton intervient dans la dernière partie. Katja (avant que j'oublie : il faut que je vous dise à quel point Diane Kruger est formidable) prend des décisions radicales. On se demande jusqu'où cela va la mener. Cela donne des scènes d'une tension extrême, le film ménageant le suspens jusqu'au bout.
On prend une sacrée claque... et quelle actrice !
PS
Bon, allez, je le reconnais : même pas maquillée, même en larmes, même droguée, même mal fringuée, même pas lavée, même tatouée, Diane Kruger reste canon. C'est une énorme injustice de la vie... mais c'est au service d'une excellente histoire.
18:57 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 16 janvier 2018
Made In France
J'ai enfin eu l'occasion de voir ce film (en DVD), dont la sortie en salles, initialement prévue en novembre 2015, a été annulée pour les raisons que l'on sait.
Par bien des aspects, il rappelle l'œuvre fulgurante et elle aussi prémonitoire de Philippe Faucon, La Désintégration, sorti en février 2012, juste avant les massacres commis par Mohamed Merah. Le film de Nicolas Boukhrief (dont on a pu voir l'an dernier La Confession) me semble avoir un peu plus d'ampleur.
On y suit un groupe de jeunes hommes, radicalisés dans une mosquée clandestine, tenue par un prêcheur assez charismatique :
Une petite cellule va se former autour d'un converti, de retour du Pakistan et de l'Afghanistan. Il est (formidablement) interprété par Dimitri Storoge, un habitué des seconds rôles vu notamment dans Belle et Sébastien et L'Odeur de la mandarine. L'originalité du scénario est de nous faire toucher du doigt son intimité avec une femme tout aussi intégriste que lui, mais tenue à l'écart de son projet terroriste.
Le héros de l'histoire est Sam, un journaliste indépendant, d'origine franco-algérienne, qui s'est immiscé dans le groupe, sans imaginer jusqu'où cela allait le mener. Il est incarné par Malik Zidi, un autre visage familier souvent visible au second plan.
A leurs côtés, on trouve François Civil (à l'affiche de Ce qui nous lie, l'an dernier) en fils de bourges converti, caricature de djeunse écervelé avide de sensations, en quête de transgression. Et puis il y a Driss, l'ancien délinquant, une boule de violence (plus ou moins) contenue, auquel Nassim Si Ahmed prête ses traits.
Le premier dérapage survient quand la bande cherche à se procurer des armes. Une étape supplémentaire est franchie au moment du vol de l'engrais. La découverte de leur "mission" va susciter des réactions contrastées chez les jeunes hommes. Dans le même temps, Sam est de plus de plus sur la corde raide, puisqu'il se trouve dans le collimateur de la DGSI.
C'est donc aussi un bon thriller, qui nous réserve plusieurs coups de théâtre. Il est d'autant plus regrettable qu'il n'ait pas eu sa chance en salles.
PS
Le DVD contient trois scènes coupées et un entretien avec Nicolas Boukhrief.
22:01 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
lundi, 15 janvier 2018
The Wedding Plan
La réalisatrice Rama Burshtein signe une sorte de comédie romantique hassidique... un genre qu'elle vient sans doute d'inventer. C'est dire le caractère improbable de ce film, qui repose essentiellement sur les épaules de l'actrice principale, Noa Koler, une révélation.
Elle incarne Michal, une célibataire trentenaire très pieuse, qui désespérait de trouver le prince charmant. On apprend par la suite qu'elle a cru trouver son bonheur après avoir rencontré... 123 mecs, au cours de 490 heures de rendez-vous ! (Elle a compté, oui...) Le 123e semblait être le bon... mais rien ne va finalement se dérouler comme prévu, l'héroïne développant une étrange aptitude à saboter son bonheur.
C'est que la dame est exigeante. Non pas qu'elle attende de l'élu qu'il soit particulièrement beau ou riche. On la voit d'ailleurs très soupçonneuse quand une vedette de la pop (qu'elle adule au point d'avoir fait de l'un de ses "tubes" sa sonnerie de portable...) manifeste de l'intérêt pour elle. Elle veut aimer et être sincèrement aimée pour ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. Autant dire que la quête du graal de l'amour ne s'annonce pas de tout repos.
C'est d'autant plus urgent que, bien que ses fiançailles aient été rompues, Michal a maintenu la date du mariage... sans savoir qui occupera la place du marié ! Elle suscite l'incompréhension de sa mère, l'étonnement de sa soeur (elle-même engagée dans un mariage chaotique) et l'attendrissement de sa meilleure amie, avec qui elle partage sa mini-fourgonnette, dans laquelle elle transporte des animaux "exotiques", qu'elle exhibe contre espèces sonnantes et trébuchantes. Comme on peut le voir, dans cette histoire, rien n'est conventionnel.
Voilà notre héroïne lancée à la recherche du mari parfait... en 22 jours. Elle va faire de drôles de rencontres... les juifs hassidiques de sexe masculin se révélant parfois très très étranges. Les spectateurs pas trop mous du bulbe devineront comment l'intrigue risque de se conclure. La réalisatrice maintient néanmoins un joli suspense, nous conduisant à nous demander si, à un moment donné, Michal n'a pas des hallucinations.
Ce n'est pas une comédie sardonique, ni trépidante (elle manque même parfois de rythme), mais c'est un film bigrement original.
22:58 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 14 janvier 2018
Le Portrait interdit
Cette coproduction franco-chinoise s'inspire d'une histoire vraie, celle du portrait d'Ulanara, concubine puis épouse officielle de l'empereur Qianlong, qui a régné pendant la majeure partie du XVIIIe siècle. (Sur bien des aspects, on pourrait le comparer à notre Louis XIV.) Notons que cette oeuvre se trouve aujourd'hui en France, au musée de Dole :
C'est dans cette ville du Jura qu'est né Jean-Denis Attiret, le jésuite peintre envoyé à la cour de Chine pour y exercer ses talents... et répandre la religion catholique. Dans le rôle, Melvil Poupaud ne s'en sort pas trop mal. Les autres acteurs, français comme chinois, m'ont paru plus convaincants. J'inclus dans la liste Fan Bingbing, dont les cinéphiles ont pu apprécier le talent dans I am not Madame Bovary, sorti en 2017.
L'intrigue repose sur la curiosité et la fascination qu'exercent mutuellement l'un sur l'autre l'Orient et l'Occident, la concubine et le jésuite. Beaucoup de choses se passent dans les regards, la gestuelle. Le non-dit a une importance capitale et il est suffisamment bien mis en scène pour que l'on comprenne tout. La concubine est attirée par le peintre, qui tombe sous le charme de son modèle, ce dont l'empereur et son conseiller finissent par s'apercevoir. Deux des plus belles scènes sont placées aux extrémités du film. Je recommande la première séance de pose de la concubine, à la fois drôle et scintillante. Et puis il y a la présentation du portrait à l'empereur, qui réalise à ce moment précis que sa compagne a peut-être un peu trop ouvert la porte au jésuite... et que celui-ci a réalisé son oeuvre avec les couleurs de l'amour.
J'ai aussi apprécié les scènes de jardin, pleines de poésie et des sons de la nature. C'est un havre de paix pour Ulanara, qui échappe temporairement à l'étiquette rigide de la cour... et qui en profite pour discuter avec une sorte de double ectoplasmique.
Cependant, la qualité esthétique et la réussite de certaines scènes ne parviennent pas à faire oublier le manque global de rythme. Cela dure 1h40, mais, en sortant, on a l'impression d'avoir passé plus de deux heures dans la salle. Quelque part entre le superbe Epouses et concubines (de Zhang Yimou) et le médiocre Silence (de Martin Scorsese), Charles de Meaux a un peu raté sa cible.
15:10 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 13 janvier 2018
Le Crime de l'Orient-Express
Cette nouvelle adaptation du roman d'Agatha Christie n'est arrivée que cette semaine au CGR de Rodez. Elle bénéficie d'une distribution haut-de-gamme, Kenneth Branagh étant entouré de Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench, Daisy Ridley (bonne performance de l'héroïne de la nouvelle trilogie Star Wars) et Willem Dafoe (dont la présence et le contexte balkanique m'ont d'un coup replongé dans The Grand Budapest Hotel).
Commençons par ce qui est réussi : l'habillage visuel. Les décors sont soignés, la lumière très travaillée, les paysages parfois magnifiques. C'est du travail de pro, servi par des acteurs chevronnés, sur un scénario malin (quoi que connu des adeptes de la romancière et d'une bonne partie des cinéphiles).
Et pourtant, je n'ai pas été emballé. Ce n'est pas lié au manque de suspens : j'ai eu beau connaître la plupart des détails de l'intrigue, je me suis volontiers prêté au jeu des devinettes, ce film-là présentant quelques différences avec les précédentes adaptations. Le principal problème est la version doublée en français. Je ne sais pas si le rendu est le même en anglais, mais une partie des dialogues sonnent faux... sans compter que, dans la version originale, le personnage principal (Hercule Poirot) est censé parler anglais avec un fort accent belge !
Cela m'amène au cas de Kenneth Branagh. Le réalisateur s'est confié le rôle du détective... et, à mon avis, il n'aurait pas dû. Oh, ça, il a de belles moustaches, il est très fort en déduction, mais il ne suscite aucune sympathie. Surtout, l'acteur britannique n'est pas parvenu à faire correctement ressortir la part de ridicule de Poirot, un exercice dans lequel David Suchet s'est montré plus brillant :
De surcroît, dans la plupart des épisodes de la série télévisée diffusés en France, Suchet est doublé par l'excellent Roger Carel. Pour incarner Poirot, il aurait à mon avis fallu un autre acteur... ou bien qu'il soit doublé par une autre voix. Cela m'a presque constamment gêné dans le film.
Les spectateurs attentifs auront remarqué, qu'à la fin de l'histoire, Poirot est approché par une personne qui lui suggère de se rendre dans la vallée du Nil. Eh oui : on nous prépare une suite...
12:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 12 janvier 2018
La Promesse de l'aube
C'est l'adaptation de l’œuvre autobiographique de Romain Gary, pseudonyme de Romain Kacew, né dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Vilnius, emmené par sa mère en France dans l'Entre-deux-guerres. Le film balance entre ses deux personnages principaux, la mère occupant le devant de la scène dans la première partie, la seconde étant davantage centrée sur le fils. Mais c'est la relation œdipienne entre les deux qui est au cœur de l'intrigue.
Charlotte Gainsbourg incarne avec talent cette mère juive (qui prie dans une église orthodoxe !), à la fois possessive et ambitieuse pour son fils. L'actrice a acquis une démarche et un accent qui contribuent à renforcer l'authenticité de son personnage, d'autant plus qu'elle s'est révélée crédible lorsqu'elle parle polonais. Aux spectateurs juifs comme aux non-juifs, elle rappellera bien des mamans, parfois excessives dans la manifestation de leur amour.
Le début, en Lituanie polonaise (ou en Pologne lituanienne, c'est selon), est réussi parce qu'il ressuscite une ambiance et une époque aujourd'hui révolues. On perçoit bien les tensions intercommunautaires, tout comme la rage de réussir de Nina (la mère), qui ne recule pas devant l'escroquerie pour s'en sortir. Du côté des enfants, je n'ai pas été très convaincu par celui qui incarne Gary jeune. Par contre, les petits Polonais catholiques sont très bien campés. Du côté des guests, on peut signaler Didier Bourdon (partie 1) et Jean-Pierre Darroussin (partie 2), dans des rôles toutefois un peu stéréotypés.
L'histoire prend de l'ampleur quand le garçon grandit (à Nice, puis à Paris), qu'il commence à s'émanciper (un peu) de sa mère... et à regarder sous les jupes des filles. Son passage par l'armée lui apprend que les préjugés antisémites ne sont pas le privilège des seuls Polonais. La Seconde guerre mondiale constitue évidemment un tournant, le jeune homme devenant enfin un écrivain... mais aussi un héros de l'aviation. Cela nous vaut quelques scènes bien troussées, comme celles qui se déroulent dans le ciel... mais aussi celles qui ont pour cadre l'Afrique.
Même si la mise en scène recourt à quelques facilités c'est un spectacle de qualité, assez prenant.
23:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 11 janvier 2018
Un Homme intègre
Cet homme à l'honnêteté chevillée au corps est Reza, un modeste pisciculteur, installé avec sa ravissante épouse (directrice d'école) et son fils dans le nord de l'Iran. On apprend un peu plus tard que les deux parents ont été étudiants à Téhéran, où vivent encore certains de leurs amis.
Par petites touches, on découvre le quotidien de cette classe moyenne modeste, plutôt moderniste : même si la directrice d'école porte le voile, elle en fait le moins possible, tandis que son mari (pas plus qu'elle d'ailleurs) ne fait montre du moindre zèle religieux. Pis encore, Reza fabrique en douce de l'alcool de pastèque (scènes magnifiques à la clé), qu'il consomme dans le plus grand secret, dans un lieu connu de lui seul, où il échappe aux pesanteurs villageoises... et à la surveillance des nervis de la mosquée.
Ceux-ci sont liés à un entrepreneur local, une fripouille (faussement dévot) avec lequel le héros va avoir maille à partir. Le placide Reza, qui ne veut pas transiger sur ses principes, commet néanmoins une erreur, dès le début : il utilise la violence face à l'injustice et refuse de faire la moindre concession.
Le grand talent du réalisateur Mohammad Rasoulof est de mettre en place la mécanique de l'engrenage, à l'aide de scènes du quotidien. Petit à petit, on perçoit l'écheveau de compromissions qui lie certains des notables locaux (qui voient le couple comme des intrus, voire des empêcheurs de tourner en rond). Une simple altercation entre deux personnages peut déboucher sur une cascade de conséquences, l'argent étant évidemment le nerf de la guerre.
Au-delà de la chronique tendue d'un coin de province, c'est donc d'abord un film politique et social, qui trace un portrait au vitriol de certaines élites iraniennes. L'intrigue balance entre deux tendances : d'un côté, on nous suggère à intervalle régulier qu'il ne faudrait pas grand chose pour que tout s'arrange, d'un autre, on sent comme le poids du fatum qui nous précipiterait vers une fin tragique.
Le réalisateur (bien aidé par des acteurs inconnus mais épatants) parvient à suggérer beaucoup de choses avec peu d'effets... et il va nous surprendre jusqu'à la fin, au moment où l'on comprend que tout ce que nous avons vu jusqu'alors n'était peut-être que le produit d'une manipulation.
C'est vraiment un excellent film, à voir absolument.
21:53 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 04 janvier 2018
Le Musée des merveilles
Ce n'est que récemment que j'ai pu voir cette nouvelle adaptation d'une oeuvre de Brian Selznick (six ans après la sortie de Hugo Cabret, de Scorsese), en version originale sous-titrée. L'originalité de l'histoire vient de la superposition de deux intrigues se déroulant à cinquante ans d'écart, autour de New York, autour du thème de la surdité (qui frappe les deux personnages principaux). Bien évidemment, les deux intrigues sont liées. Des indices sont laissés ici ou là pour permettre aux spectateurs de faire le lien. Soyez attentifs aux personnages féminins qui écrivent...
D'un point de vue formel, c'est incontestablement la partie se déroulant en 1927 qui est la plus belle. C'est un superbe noir et blanc, tourné du point de vue de Rose, l'enfant sourde séparée de sa mère et de son frère aîné. Elle se réfugie dans l'imaginaire, la construction de maquettes et le cinéma muet. A l'image de ce qui se passe dans ce dernier, la musique remplace les sons. On n'entend aucun dialogue... et cela passe sans problème.
Dans le rôle de Rose, la jeune Millicent Simmonds est mimi tout plein, épatante de fraîcheur... d'autant plus que, comme je l'ai appris après avoir vu le film, elle est elle-même sourde (depuis l'âge d'un an) :
Les deux garçons sont les héros de la partie se déroulant en 1977. A droite se trouve Ben, orphelin recueilli par son oncle et sa tante. Il souffre beaucoup du récent décès de sa mère (incarnée par Michelle Williams)... mais il ignore tout de son père. La réponse se trouve peut-être dans les étranges cauchemars qu'il fait.
A gauche se trouve Jaimie, une rencontre fortuite que fait Ben à New York, et qui va devenir son ami. Jaden Michael est d'un naturel confondant, preuve que le réalisateur Todd Haynes (auquel on doit, entre autres, Loin du paradis et I'm not there) a su diriger avec beaucoup de doigté son équipe juvénile. L'un des nombreux attraits de ce film est d'ailleurs la naissance de cette amitié, très bien mise en scène.
Dans cette partie ("normalement" sonorisée, pour une raison que je laisse à chacun le soin de découvrir), les spectateurs plus âgés retrouveront peut-être avec nostalgie l'ambiance des années 1970, plus particulièrement de l'été caniculaire de 1977, qui est aussi la période d'activité d'un célèbre tueur en série (objet du film Summer of Sam). Cela pourrait expliquer que Jamie, dont les parents sont divorcés, réside à cette époque davantage chez son père, dans le centre de New York, plutôt que chez sa mère, dans le Bronx.
De mon côté, je ne risque pas de regretter les horribles coupes de cheveux de l'époque, pas plus que les baskets moches, les pantalons à pattes d'éléphant et, l'hiver, les insupportables sous-pulls. Sur le personnage du jeune Ben, on peut voir quelques traces du mauvais goût en vigueur ces années-là.
Les deux intrigues vont finir par se rejoindre, grâce notamment à un livre consacré aux "cabinets des merveilles", qui traverse les époques. La conclusion, émouvante, intervient dans un musée, où a été construite une hallucinante maquette de la ville de New York.
Poétique et mystérieux, ce conte transgénérationnel n'a hélas pas trouvé son public en France. N'hésitez pas à tenter votre chance, s'il est diffusé près de chez vous.
22:36 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Prendre le large
Ce long-métrage a fini par arriver à Rodez, presque deux mois après sa sortie en salles. J'en reparlerai sans doute dans un autre billet, mais les cinéphiles ruthénois nourrissent quelques inquiétudes depuis le rachat de Cap Cinéma par CGR.
En attendant, revenons au film. Sandrine Bonnaire (quasiment pas maquillée) incarne une ouvrière textile sur le point d'être licenciée. Elle n'est pas particulièrement belle ou intelligente et s'habille de manière conventionnelle pour pas cher. On est donc loin ici d'un personnage d'héroïne flamboyante. Il s'agit plutôt d'une antihéroïne, travailleuse honnête, pas militante syndicale pour deux sous... et surtout une femme qui se sent seule : elle est veuve et son fils unique a quitté la région lyonnaise pour Paris, où il mène sa vie à l'écart de sa mère. Celle-ci a de surcroît noué peu de liens d'amitié dans son univers professionnel. Il lui reste sa maison, sa voiture... et son travail.
Plutôt que de perdre celui-ci (avec le risque de ne plus jamais en retrouver de semblable), Edith préfère accepter un reclassement au Maroc, suscitant l'incompréhension autour d'elle. (C'est un aspect de l'intrigue qui n'est pas sans rappeler le récent Crash Test Aglaé.) Vu son ancienneté dans la boîte (25-30 ans apparemment), elle pouvait compter toucher une indemnité de licenciement représentant deux ans et demi à trois ans de salaire. C'est là qu'intervient le premier trait de caractère de l'héroïne : elle croit à la valeur travail et préfère tenter une nouvelle vie de l'autre côté de la Méditerranée plutôt que de se morfondre seule dans la campagne rhodanienne. Dans cette première partie de l'histoire, la mise en scène suit le mode documentaire, qu'elle retrouvera par la suite.
La deuxième partie montre l'installation et les premiers pas de la Française à Tanger. Le réalisateur réussit à creuser un fossé entre Edith, qui voit presque tout sous un jour favorable, et les spectateurs, qui ressentent un malaise face à ce qu'ils perçoivent comme une dégradation de ses conditions de vie. Plusieurs scènes ont pour fonction d'enfoncer le clou.
Et puis, petit à petit, de petits bonheurs se font jour. C'est un après-midi de congé ensoleillé, c'est un peu de réconfort et d'amitié de la part d'une collègue, de l'hôtelière ou de son fils. C'est un peu de liberté retrouvée grâce à une mobylette d'occasion.
Mais, comme ce n'est pas un conte de fées, la cruelle réalité va reprendre le dessus. Gaël Morel en profite pour nous faire découvrir différentes catégories de travailleurs pauvres (des femmes notamment) et nous faire toucher du doigt les aspirations d'une jeunesse qui étouffe dans un Etat patriarcal. On a toutefois évité de trop politiser le propos.
C'est vraiment un beau film, à la fois cruel et empreint d'humanité.
00:03 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 01 janvier 2018
Tout l'argent du monde
Voici donc le premier film tourné avec Kevin Spacey, sans que celui-ci apparaisse à l'écran (sauf dans la bande-annonce d'origine, toujours accessible sur la Toile). Il faut reconnaître que, quelle que soit la performance de l'acteur de Swimming with sharks, Seven, Usual Suspects, American Beauty et (plus récemment) Baby Driver, le vétéran Plummer le remplace avantageusement.
Dans le film, s'il est un Plummer qui ne joue pas très bien, c'est le jeune Charlie, qui interprète le petit-fils de l'homme le plus riche du monde, celui qui se fait enlever. C'est peut-être le seul point faible d'une distribution très professionnelle, où l'on retrouve, entre autres, Mark Wahlberg, Romain Duris... et surtout Michelle Williams, presque méconnaissable et qui livre une excellente composition dans le rôle de la belle-fille du milliardaire.
Le film vaut d'abord pour le portrait d'un homme d'affaires misanthrope, égoïste, radin... et amateur d'art. Christopher Plummer est vraiment très bon dans ce registre, servi par un scénario aux petits oignons. Je recommande tout particulièrement l'histoire de la statue prétendûment achetée sur un marché d'Héraklion et le coup de la cabine téléphonique payante... dans un hall de la maison du château de campagne de Getty senior.
La tension vient davantage des scènes italiennes, se déroulant à Rome et en Calabre (la pointe de la botte), celles-ci tournées (au moins en partie)... en Jordanie (la défiscalisation italienne n'ayant sans doute pas été jugée assez alléchante par la production yankee).
C'est un bon suspens, qui s'accompagne de scènes quasi documentaires sur le fonctionnement traditionnel de la 'Ndrangheta. Il y a bien quelques facilités çà et là mais, comme c'est bien joué (et qu'on a gardé les dialogues en italien dans la version française), on ne voit guère le temps passer.
23:18 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 31 décembre 2017
Les "Riton" 2017
Voici venu le temps... des palmarès cinématographiques. Je suis toujours aussi dubitatif vis-à-vis des cinéphiles qui réussissent à distinguer un ou trois films marquants sur une année complète. Même une liste limitée à dix "pépites" me paraît difficile à établir. Voici donc mes coups de cœur de 2017.
Dans la catégorie "les femmes ont (parfois) une vie de merde et tentent de la changer"
- Riton du film d'emmerdeuse extrême-orientale : I am not Madame Bovary
- Riton du film d'emmerdeuses afro-américaines : Les Figures de l'ombre
- Riton du film d'emmerdeuses européennes : Les Conquérantes
- Riton du film d'emmerdeuse proche-orientale : Tempête de sable
- Riton du film de victimes moyen-orientales : Des Rêves sans étoiles
Dans la catégorie "films à valeur documentaire"
- Riton du film bourré de puces : Kedi - Des chats et des hommes
- Riton du film garanti sans puce : L'Empereur
- Riton du film bourré de paysages exotiques : Nés en Chine
- Riton du film bourré de graisses : Le Fondateur
- Riton du film bourré de testostérone : Borg/McEnroe
- Riton du film bourré de talents vocaux : L'Opéra
- Riton du film bourré de talent pictural : La Passion Van Gogh (un des films de l'année)
- Riton du film bourré de pellicules : Lumière ! L'aventure commence (un des films de l'année)
Dans la catégorie "les guerres inspirent de très belles oeuvres"
- Riton du film de famille : Cessez-le-feu
- Riton du film d'ambiance de guerre : Dunkerque
- Riton du film d'après-guerre : Au revoir là-haut (un des films de l'année)
- Riton du film d'après-guerre lointaine : Lumières d'été (un des films de l'année)
- Riton du film d'avant-guerre : Dans un recoin de ce monde
Dans la catégorie "les œuvres d'animation sont souvent bien mieux conçues que le tout-venant des fictions"
- Riton du manga qui porte le genre à un niveau rarement atteint : Your Name (un des films de l'année)
- Riton du manga qui traite de sujets délicats : Hirune Hime
- Riton de l'animation qui ne prend pas les enfants pour des imbéciles : La Bataille géante de boules de neige
- Riton de l'adaptation d'une bande dessinée : Zombillénium
- Riton de la meilleure continuation d'une série : Moi, moche et méchant 3
- Riton du plus gros délire animé : Lego Batman, le film
Dans la catégorie "les comédies ont du mal à nous surprendre, mais certaines y parviennent, parfois"
- Riton de la satire provinciale : Citoyen d'honneur
- Riton de la fantaisie mondialisée : Crash Test Aglaé (un des films de l'année)
Dans la catégorie "certaines œuvres grand public m'ont particulièrement touché"
- Riton du biopic musical : Dalida
- Riton du biopic tiers-mondiste : Lion
- Riton du film de science-fiction plus ambitieux sur la forme que sur le fond : Passengers
- Riton du film de super-héros : Logan (un des films de l'année)
Dans la catégorie "les films de genre réservent encore de bonnes surprises"
- Riton du Frenchie qui se débrouille bien : La Mécanique de l'ombre
- Riton de l'Espagnol qui n'est pas maladroit non plus : L'Homme aux mille visages
- Riton de l'Espagnol qui se débrouille encore mieux : Que Dios nos perdone
- Riton de l'Egyptien qui déchire sa race : Le Caire confidentiel (un des films de l'année)
On termine avec la catégorie des "films coup-de-poing"
- Riton du meilleur film avec une fin ratée : The Square (un des films de l'année)
- Riton du meilleur film rural : Petit Paysan (un des films de l'année)
- Riton du meilleur film urbain : A Beautiful Day
- Riton du meilleur film "ethnique" : Get out
- Riton du meilleur film étouffant : Detroit
- Riton du meilleur film de scénariste-monteur : K.O. (un des films de l'année)
- Riton du meilleur film en costumes : The Young Lady (un des films de l'année)
- Riton du meilleur film de gonzesses : Grave (un des films de l'année)
Archives :
- les Riton 2016 ... ben y en a pas eu
- les Riton 2015
- les Riton 2014
- les Riton 2013
- les Riton 2012
- les Riton 2011
- les Riton 2010
- les Riton 2009
- les Riton 2008
- les Riton 2007
- les Riton 2006 (ce qui ne nous rajeunit pas)
15:41 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 30 décembre 2017
Kedi - Des chats et des hommes
Le titre est un mot turc désignant les chats, les matous... plutôt des mâles donc (castrés ou pas). Que l'on se rassure : dans ce bref documentaire (1h20), il est aussi amplement question des femelles, parfois très caractérielles !
Nous voici plongés dans certains quartiers d'Istanbul (à proximité d'une zone portuaire dédiée à la pêche et le long de rues commerçantes traditionnelles), où des chats errants ont élu domicile, nourris, câlinés voire logés par les résidents ou les clients de passage. Ce sont très majoritairement des chats de gouttière, des bâtards, même si l'on voit quelques bêtes racées (dont une abandonnée).
Les caméras (l'une d'entre elle montée sur une petite voiture télécommandée !) suivent plus particulièrement une dizaine de bêtes à poils. Même si elles ne sont pas toutes belles, la réalisation leur rend hommage, grâce notamment à de superbes (très) gros plans. On a aussi l'occasion d'admirer la souplesse de plusieurs animaux. Mais l'objectif principal du film est de nous faire découvrir leur caractère.
Il y a la "patronne" du magasin de vêtements, qui sait pouvoir y faire la sieste... et qui n'hésite pas à apostropher les passants pour obtenir de la nourriture, dont elle réserve une partie à sa progéniture.
Il y a les quatre chatons orphelins, dont s'occupe un père de famille modeste. Il va pouvoir compter sur l'appui d'un matou de passage, un mâle sans attaches qui décide de devenir le papa et la maman de la progéniture !
Il y a encore ce couple asymétrique, avec la minette en dominante, qui se nourrit en premier et veille à ce que monsieur ne soit pas tenté de culbuter la première chatte de passage ! Elle se laisse toutefois approcher par un artisan, qui apprécie son indépendance.
On s'attache aussi au "protecteur des terrasses", un matou vigilant qui traque les souris. Il semble plus efficace que la mort-aux-rats et a obtenu le droit de déambuler à sa guise entre les chaises.
D'autres bêtes ont pris pour cible un appartement situé au premier étage, qui abrite un chat d'intérieur tout timidou, que sa maîtresse fait, de temps en temps, cohabiter avec certaines "racailles" de la rue. C'est entre ces "invités" qu'un conflit va éclater...
L'exception à la règle est le chat distingué, qui a sa place réservée sur une chaise, à l'entrée d'un restaurant où il veille à ne pas pénétrer pendant le service. Très digne, il toise la clientèle sans émotion apparente... sauf quand, à travers la fenêtre, il voit le cuistot s'approcher des aliments dont il raffole. A ce moment-là, il sait parfaitement se faire comprendre !
Le film s'attarde aussi sur ceux qui caressent ou qui nourrissent les animaux (souvent des personnes âgées). Cela donne de très belles scènes, pleines de poésie. Cela contrebalance la précarité de la vie des félins urbains. Beaucoup meurent écrasés par une voiture ou... de cancer. Il faut dire qu'ils ont le nez au niveau des pots d'échappement... Leur espace de vie est aussi menacé par la rénovation urbaine, qui supprime nombre d'espaces verts (en particulier les jardins) et remplace les immeubles traditionnels (pleins de recoins) par de gros machins modernes sans âme.
C'est très correctement filmé, sur une musique bien choisie. Sur grand écran, les chattes et les chats sont vraiment attendrissants.
22:39 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 25 décembre 2017
Ferdinand
Par un étrange détour du destin, ce film d'animation sort en France juste après l'annonce du rachat de la Twentieth Century Fox par Disney. Or, il est produit par Blue Sky, la filiale animation de la Fox... et, dans l'adaptation du conte pour enfant, il succède à Disney, qui, en 1938, avait livré un court-métrage sur le même sujet.
Aux manettes, on a Carlos Saldanha, qui a co-réalisé les trois premiers Age de glace. Il est aussi l'auteur de Robots, de Rio et de sa suite Rio 2. Son savoir-faire est visible assez tôt, au cours de la séquence de la Fête des fleurs, à la fois brillante et drôle.
Petits et grands peuvent prendre plaisir à cette histoire, qui évoque l'amitié, la virilité et les différences. Tout le monde ne rit pas forcément en même temps : les petits adorent la chèvre et les hérissons débrouillards ; les adultes goûtent davantage les scènes faisant intervenir les trois canassons maniérés à l'agzent chermanique. J'ai quand même un faible pour le taureau génétiquement modifié, présenté au départ comme une véritable machine à tuer, et qui va considérablement évoluer...
Au chapitre des séquences emballantes, il faut ajouter celle de l'abattoir, une improbable opération de secours qui va se transformer en délirant ballet taurin !
Tout cela nous conduit à la dernière partie du film, la plus risquée selon moi, puisqu'elle tourne autour d'une corrida. Au départ, je me disais que les auteurs allaient se contenter de ménager la chèvre et le chou, pour ne déplaire à personne. Dans un premier temps, le torero est présenté comme antipathique, arrogant. Petit à petit sont instillés des éléments de l'univers tauromachique, qui tendent à le montrer sous un jour plus favorable. Mais (heureusement), au cours du combat dans l'arène, se produit un retournement totalement inattendu (et fort bien mis en scène).
Du coup, j'ai trouvé ce film assez habile et, par moments, très drôle. C'est une bonne détente, pas idiote sur le fond.
18:52 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 18 décembre 2017
Star Wars VIII - Les Derniers Jedi
Deux ans après le très respectueux Réveil de la Force, la plus célèbre saga du cinéma revient avec un titre ronflant et évidemment trompeur. Aux manettes se trouve un nouveau réalisateur, Rian Johnson, qui s'est fait connaître il y a quelques années avec l'excellent Looper. Dès la première séquence (une baston dans l'espace), on nous en met plein la vue, avec, au premier rang, le personnage de Poe, mélange de Han Solo et de Luke Skywalker jeune. Du déjà vu donc, avec un élément particulièrement irritant : une tendance lourdingue à recourir au "juste-à-temps". On sait évidemment ce qu'il va advenir de la télécommande en équilibre au-dessus de la soute à bombes... et le sacrifice qui suit est mis en scène de manière particulièrement appuyée.
Heureusement surviennent les scènes de l'île, avec Skywalker âgé et la jeune Rey (Daisy Ridley, toujours excellente, incontestablement la révélation de cette nouvelle trilogie ; c'est fou ce que cette actrice arrive à faire passer à travers son personnage). En alternance avec le calvaire des résistants traqués dans l'espace, on assiste à la formation de la nouvelle apprentie, qu'une étrange communion relie à distance à Kylo Ren. Celui-ci est toujours incarné par Adam Driver, un très bon acteur que je ne trouve hélas pas vraiment à sa place ici. Il faut dire qu'il est très difficile d'incarner un successeur au charismatique Dark Vador, peut-être le meilleur vilain que le cinéma ait jamais inventé.
D'autres moments sont réussis, comme la séquence sur la planète-casino, avec en particulier l'évasion à dos de fathiers, sortes de gigantesques chevaux de l'espace. C'est l'occasion de signaler la qualité de la représentation des personnages animaliers, très expressifs, comme les fathiers, mais aussi les adorables porgs de l'île-refuge (qui vont s'attacher à Chewbacca) et les superbes renards de cristal, dont l'apport est déterminant en toute fin d'histoire.
Au chapitre des bonnes retrouvailles, il y a BB 8, R2-D2 (fugacement)... et Yoda (hélas trop peu présent). Je suis cependant beaucoup plus mitigé concernant Carrie Fisher, à qui on a confié essentiellement un rôle de potiche. Mon Dieu qu'elle est statique ! J'ai par contre apprécié une (fausse) nouveauté : le personnage de trafiquant interprété par Benicio Del Toro, évidemment calqué sur Lando Calrissian.
Au chapitre des déceptions, je mettrais aussi le duel avorté entre Kylo Ren et son ancien mentor (ce qui n'est pas sans rappeler une scène du tout premier film sorti dans les salles). J'ai même été parfois désagréablement surpris par un aspect technique. (J'ai vu le film en 2D.) Au cours de certaines scènes, un changement de mise au point intervient (entre le premier plan et l'arrière-plan), rendant subitement net ce qui était auparavant flou et vice versa. Au moment du changement, on a l'impression que les dimensions de l'image sont déformées. Je pense que c'est dû à une mauvaise intégration de gros fichiers numériques, les plans regorgeant d'effets spéciaux. Il est dommage que cela survienne dans ce genre de grosses productions.
Mais il reste la séquence de la planète de sel, vraiment très bien mise en scène, avec une bonne intensité dramatique. Elle rattrape ce qui précède et permet au film de se conclure sur une bonne note. Ce n'est pas un chef-d’œuvre, mais il relance la trilogie de manière intéressante, avec, toujours au centre, l'étrange relation entre les deux héros antagonistes.
23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 16 décembre 2017
Les Gardiennes
Xavier Beauvois (Des Hommes et des Dieux) s'est décidé à adapter, à sa manière, le roman éponyme d'Ernest Pérochon (paru en 1924). Il a le mérite de mettre au premier plan ce que, pendant la Première guerre mondiale, on appelait "l'arrière". Cette histoire est donc celle des femmes qui, dans les campagnes, ont fait "tourner la boutique" pendant que les hommes étaient au front, ne pouvant s'appuyer que sur les vieillards, les enfants et les soldats en permission.
Ces femmes de tout âge (de la gamine en chaussettes à la veuve vêtue de noir) sont incarnées par une pléiade d'actrices talentueuses. On a, avec raison, souligné la performance de Nathalie Baye (formidable). On a un peu moins parlé de la révélation de ce film, Iris Bry, totalement inconnue, mais qui irradie aussi bien dans les scènes d'intérieur que dans les prises de vue extérieures. Cette orpheline, placée chez des patrons successifs, va se révéler une excellente fermière... et elle possède un joli filet de voix !
Je suis par contre moins convaincu par Laura Smet, qui n'a vraiment pas la tête d'une paysanne... non pas qu'elle doive être laide ou grossière, mais on sent trop la citadine. Même si je comprends le choix de la distribution (réunir la mère et la fille dans une histoire familiale), je trouve que cela n'apporte rien au film.
Celui-ci revêt souvent un aspect documentaire. On suit les travaux et les jours, dans cette grosse exploitation où les femmes triment du matin au soir. Ainsi, à l'époque, il faut avoir les bras solides pour tenir la charrue tirée par les boeufs. L'essentiel des travaux se fait à la main, y compris la moisson, le seul outil étant à la faucille (et le fléau, pour le battage). L'intrigue s'étendant sur plusieurs années (de 1915 à 1920), on voit débarquer les premières machines : la moissonneuse-lieuse McCormick (tirée par les boeufs) et un tracteur (rudimentaire) Ford (sous la marque Fordson). Heureusement, à cette époque, dans les campagnes, on se serrait un peu les coudes. Mais le film est assez subtil pour nous faire entrevoir les jalousies.
L'amour va se greffer sur cette histoire pleine de deuils. L'un des hommes de la maison est l'objet de convoitises... tout comme, à partir de la fin de 1917, les jeunes et vigoureux soldats américains venus au secours des Français. Cela donne un tour sensuel à certaines scènes.
Le principal défaut du film est son rythme, très lent. A trop vouloir restituer le mode de vie rural, Beauvois peine parfois à se débarrasser de l'accessoire. Il s'attarde aussi un peu trop sur certains plans. Cela n'enlève rien aux qualités mentionnées plus haut, mais cela creuse un fossé entre ce qui reste un bon film et ce qui aurait pu être un chef-d'oeuvre.
21:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 15 décembre 2017
Santa & Cie
Alain Chabat s'est lancé dans la comédie de Noël. Au départ, je n'étais pas trop partant (peut-être à cause du souvenir très mitigé que je garde de Bad Santa). Mais, comme le bouche-à-oreille est bon, je me suis laissé tenter.
Le début m'a mis dans de bonnes dispositions. La première séquence dans le monde du Père Noël est éblouissante, avec une profusion de trucages numériques au service du merveilleux : il est question de la fabrication des cadeaux de Noël. La suite est vraiment drôle, avec le premier séjour de Santa au commissariat. Signalons que Chabat a recruté une pelletée de seconds rôles efficaces.
J'ai trouvé que la rencontre avec la "famille idéale" (les parents étant incarnés par Pio Marmai et la délicieuse Golshifteh Farahani) fonctionnait moins. C'est un peu surjoué. Les gamins s'en sortent bien, surtout au début. Ensuite, ils m'ont un peu cassé les pieds.
Mais, bon, le film regorge de clins d’œil à destination des adultes ; il y a des jeux de mots ; l'action est rythmée et les rennes sont mignons comme tout. Chabat a veillé à ne pas aller trop loin, afin que cela reste une comédie familiale, à la fin relativement prévisible. Elle contient néanmoins la superbe scène du "chargement" des cadeaux, très inspirée.
Cela ne va pas révolutionner le cinéma, mais cela permet de passer un très bon moment.
21:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 08 décembre 2017
Paddington 2
Trois ans après la sortie du premier volet de ses aventures, le plus vivant des ours en peluche revient sur les écrans, dans une comédie d'aventures à la fois très britannique et universelle par les thèmes qu'elle aborde.
On commence par retrouver le héros en famille, avec une scène de salle de bains cocasse même si elle fait un peu "déjà-vu". J'aime bien la caractérisation des personnages : le père ancien rebelle devenu cadre sup' frustré, la mère dynamique qui a rogné ses ambitions, la fille qui cherche à se démarquer (et qui va finir par y arriver) et le frangin en pleine crise d'identité, qui tente de se faire passer pour un djeunse.
La mise en scène est très soignée, avec notamment une scène étourdissante autour du livre animé (appelé ici livre pop-up), le dialogue débutant dans le monde réel (avec Paddington !) pour se poursuivre "dans" le livre, devenu la scène. C'est bluffant. (A l'origine, cela devait figurer dans le premier volet, selon Allociné.) Notons que le personnage de l'ourson est toujours aussi bien inséré à l'écran, interagissant parfaitement avec les personnages en chair et en os.
L'humour revient rapidement à l'assaut, avec les déboires de Paddington dans le monde du travail. C'est d'abord chez un coiffeur qu'il va faire des dégâts, avant d'officier en tant que laveur de carreaux, une activité pour laquelle il se révèle "anatomiquement" doué...
Les scènes les plus attendues étaient sans doute celles se déroulant en prison. Victime d'une injustice, le héros se retrouve entouré de criminels... dont il va se finir par se faire des alliés, voire des amis ! La manière dont le retournement de situation se produit est bien amenée, d'autant plus que, dans la maison d'arrêt, l'ourson commence par commettre une énorme bourde... En tout cas, il y rencontre un cuistot pas comme les autres, gros dur au cœur tendre (Brendan Gleeson, très bien dans le rôle), et une brochette de "gueules" qui mérite le détour. Attention toutefois : le vrai méchant de l'histoire ne se trouve pas en ces lieux (en tout cas, pas au début) ; il habite tout près de la famille du héros. Il est incarné avec un plaisir évident par Hugh Grant.
Mais le plus étonnant pour moi a été de constater que les auteurs ont fait du héros une sorte de réincarnation de Charlot (le personnage de Chaplin). Paddington a un peu la même démarche que lui, il porte un chapeau minable, qu'il soulève quand il s'excuse d'avoir commis une gaffe... et il est assez souple et imaginatif pour se sortir des pires situations. Enfin (et surtout), à un moment (au début de la séquence d'évasion), il se retrouve piégé dans un engrenage, dans ce qui est une référence explicite aux Temps modernes.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour la subtilité du scénario que l'on va voir ce film. Le gros de l'intrigue est cousu de fil blanc. On comprend très vite tout ce qui va se passer, à l'exception du mystère lié au livre animé, qui donne un côté enquête mystérieuse à l'histoire. Celle-ci trouve son dénouement dans une excellente séquence de trains, pleine de rebondissements.
Ce n'est pas la comédie la plus hilarante à l'affiche, mais elle fait passer un très bon moment.
23:35 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 04 décembre 2017
L'Etoile de Noël
Cette animation de Sony Pictures suscite des réactions contrastées, notamment en raison du sujet sur lequel s'appuie l'intrigue : les mois qui auraient précédé la naissance de Jésus. Voilà pourquoi, dans un souci d'impartialité, je vais vous proposer non pas une, non pas deux, non pas trois mais quatre critiques différentes de ce film.
On commence par Jean-Hubert, un identitaire de droite qui a emmené ses sept enfants voir le film.
En cette approche du temps béni de Noël, il est bon qu'un film d'animation rappelle à notre saine jeunesse les fondements de notre Civilisation. Ainsi, loin du matérialisme putride dans lequel baignent tant de productions destinées au peuple, cette oeuvre spirituelle fait le pari d'élever l'âme des spectateurs. A plusieurs reprises, l'intervention divine est visible à l'écran, rappelant aux fourmis que nous sommes combien nous sommes dépendants du Très-Haut. Celui-ci ne fait pas de distinction entre les créatures vivantes pour indiquer Son dessein. Comment ne pas voir la marque divine dans l'ardeur à faire triompher le bien manifestée par un âne chatouilleux, une colombe bavarde, une brebis bondissante et des dromadaires mal coiffés ? En dépit de l'horrible menace qui pèse sur la Sainte Famille (curieusement représentée sous des traits "orientaux"), le destin de l'humanité était en marche !
On continue avec la critique de gauche insoumise, par Karl-Georges-Boris ("KGB" pour les intimes).
Fonctionnant à la marge du système capitaliste hollywoodien, Sony Pictures nous propose une lecture révolutionnaire des textes considérés par certains comme sacrés. Joseph et Marie sont deux prolétaires victimes de l'impérialisme romain, dans lequel tout le monde reconnaîtra son lointain avatar états-unien. Ils forment un couple égalitaire, se partageant les tâches du quotidien. Tous deux appartiennent aux "minorités visibles", ces Français issus de l'immigration africaine spoliés par l'histoire, auxquels un glorieux destin est promis. Pour cela, ils vont devoir s'unir et s'unir avec ceux qui, de prime abord, apparaissent très éloignés d'eux. Cette puissante métaphore appelle les réprouvés de toute origine, humains, dromadaires, colombes, moutons, chèvre, ânes, chevaux, boeufs et chiens, veaux, vaches, cochons, à se fédérer pour renverser l'ordre établi. Cette animation, en dépit de quelques désagréables aspects superstitieux, est un véritable appel à la révolte !
Je m'en voudrais de ne pas vous communiquer la critique islamo-fasciste, rédigée par Tariq-Alain.
Le complot américano-sionisto-croisé tente à nouveau de déverser sa propagande infâme dans la tête des enfants d'Allah. (Loué soit Son nom !) Ce film a sans nul doute été produit dans le but de faire croire qu'Issah, ce prophète de deuxième catégorie, était le véritable élu de Dieu, alors que tout le monde sait qu'il s'agit de Muhammad. (Bénie soit son action !) Mais nous avions prévu cette tentative. Nous avons infiltré des frères dans la grande machine hollywoodienne à fabriquer du mensonge. Voilà pourquoi cette oeuvre au départ impure s'est parée des couleurs de l'Islam. Ainsi, le couple de héros, Youssouf et Myriam, forme incontestablement une famille palestinienne qui suit la voie de l'obéissance à Allah. Ils n'élèvent pas de porc, cet animal impur. De plus, lorsqu'elle sort du domicile, Myriam se couvre comme toute bonne musulmane doit le faire (et non comme tant de pécheresses en Occident, ces vipères lubriques qui tentent d'échapper à la saine domination de l'homme). Ce couple est pourchassé par des militaires cruels armés jusqu'aux dents, au service d'un pouvoir oppresseur. Il s'agit bien évidemment de l'occupant sioniste. L'ingéniosité dont font preuve les personnages animaux n'est pas sans rappeler les efforts méritoires et souterrains menés par les combattants d'Allah pour faire triompher la Vraie Foi.
Je termine par la critique la plus objective, la plus érudite, la plus argumentée, celle de Jérémie, 8 ans (et demi) : "C'est trop rigolo !"
20:50 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 01 décembre 2017
A Beautiful Day
A première vue, le titre du film sonne comme une antiphrase. Le héros Joe (Joaquin Phoenix, transfiguré) semble ne vivre que des journées de merde. Il faut dire qu'il cumule les passifs : il a eu une enfance difficile et c'est un ancien soldat, miraculeusement rescapé d'une embuscade au Moyen-Orient. Son corps en porte encore les stigmates.
Le poids de cette culpabilité explique peut-être son comportement suicidaire : les risques qu'il prend à tuer et les semi-tentatives qu'on le voit exécuter. C'est d'ailleurs par l'une d'entre elles que commence l'histoire, avec un superbe gros plan sur une tête dans un sac plastique.
C'est la marque de la réalisatrice Lynne Ramsay, très attentive à la construction de ses plans. La première partie du film est riche en trouvailles, comme cet enchaînement entre la vision du héros prostré dans une penderie et une autre du même, perçu en contre-plongée par-delà les rails du quai d'une gare. Entre les deux plans, l'acteur n'a pas changé de posture ni de place.
Il est donc possible de (presque) complètement s'abstraire de l'intrigue (au demeurant guère inventive) pour goûter pleinement le savoir-faire de la réalisatrice... et la performance de l'acteur principal. De surcroît, le scénario a des aspects nauséabonds. Joe, qui vit avec sa mère (qui perd les pédales), s'est reconverti dans le meurtre sur commande, façon grands coups de marteau dans la gueule. Petite précision : il semble ne s'en prendre qu'à des crapules.
Le voilà bientôt mêlé à une affaire sordide, faite de corruption politique et de pédophilie. C'est bien dégueu... et la réalisatrice frôle le caniveau : il est évident qu'on ne peut qu'adhérer à la croisade que Joe va mener, sans subtilité, contre la bande de salopards. Signalons toutefois que L Ramsay a l'élégance d'introduire quelques ellipses, qui nous évitent de voir trop de sang gicler. (Grosse déception pour le spectateur en quête de catharsis après une journée de boulot irritante.)
Et puis, au détour d'une scène, elle ose, comme cette improbable (et fugace) communion entre deux tueurs de bords opposés, l'un aidant l'autre à adoucir ses derniers instants, sur le sol d'une cuisine. C'est totalement inattendu, gonflé... et réussi. (Je recommande aussi la scène des funérailles lacustres.)
Je m'en voudrais de ne pas signaler la composition d'Ekaterina Samsonov (futur petit canon hollywoodien), qui incarne la gamine que le tueur mutique va prendre sous son aile. Malheureusement, la réalisatrice peine à conclure son histoire. Elle tente même, par un artifice scénaristique, de suggérer deux fins possibles, mais c'est décevant, au regard de ce que le film a fait entrevoir auparavant.
PS
L'un des personnages secondaires possède un très joli matou auquel, fort heureusement, il n'arrive rien de désagréable, contrairement à nombre d'humains.
22:48 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 30 novembre 2017
Le Brio
J'ai un peu tardé à aller voir ce film, qui a bénéficié d'une promotion quasi-hollywoodienne. La vision de la bande-annonce m'avait donné l'impression de connaître déjà toute la trame de l'histoire, ce qui enlève quand même un peu l'envie. Mais, certains éléments laissaient présager une intrigue pas trop "politiquement correcte" et le bouche-à-oreille est très bon. Va donc pour Le Brio.
La première (agréable) surprise arrive dès le début, avec ces extraits d'émissions télévisées, avec Serge Gainsbourg, Claude Lévi-Strauss, Romain Gary et surtout Jacques Brel, qui parle de la bêtise et du bonheur.
Très vite, le principal argument de cette comédie sociétale surgit : la confrontation entre l'étudiante beurette banlieusarde pugnace et le prof de fac grand-bourgeois de droite. Les échanges entre les deux personnages sont souvent savoureux, notamment grâce au talent des interprètes, Daniel Auteuil (que je n'ai pas vu aussi bon depuis longtemps) et la révélation Camélia Jordana (qui n'était jusqu'à présent pour moi qu'une -jolie- voix, celle qui interprète la chanson accompagnant le dernier film de Cédric Klapisch, Ce qui nous lie). On peut aussi signaler la prestation de Yasin Houicha en Mounir, le petit ami de Neïla.
A ceux qui pensent que le pire (question propos stigmatisants) sort de la bouche de Pierre Mazard, je conseille de tendre l'oreille au début du concours de plaidoiries, lorsque le premier adversaire de l'héroïne Neïla soutient la thèse que "l'habit ne fait pas le moine". (C'est d'autant plus fort que le petit con en costume-cravate est très bien interprété.)
Il y a toutefois un aspect conte de fées dans l'histoire. L'héroïne habite une cité du Val-de-Marne où il n'y a ni trafic ni agression, où presque aucune femme n'est voilée. Quant aux deux principaux protagonistes qu'au départ tout oppose, ils vont petit à petit surmonter leurs aprioris et changer, intérieurement comme extérieurement. Fort heureusement, le scénario ménage quelques retournements. La vie n'est pas aussi simple et, parfois, on peut tirer grandement profit de situations désagréables.
Plusieurs scènes m'ont marqué. Il y a celles qui montrent le groupe de potes de banlieue, des jeunes (presque) comme les autres, qui se chambrent et jouent ensemble. J'ai aussi beaucoup aimé le repas de femmes, entre la grand-mère à peine francophone, la fille adolescente attardée et la petite-fille brillante mais habillée comme une souillon. Du point de vue de la mise en scène, c'est une plaidoirie de Neïla qui emporte le morceau, vers la fin. Elle ne survient pas dans le contexte auquel on s'attend, mais c'est quand même un bel hommage à l'enseignement qu'elle a reçu, puisqu'elle y exploite les petits trucs de son agaçant mentor.
Et puis il y a cet épilogue assez cocasse, qui donne foi en l'avenir.
00:22 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 28 novembre 2017
Les Conquérantes
Ce film suisse évoque le combat des femmes pour l'obtention du droit de vote... et de plus de respect au quotidien de la part des hommes. Le début des années 1970 est une époque de remise en cause, chez nos voisins alpins comme ailleurs. Les spectateurs qui ont un peu de kilomètres au compteur retrouveront dans cette Suisse rurale et patriarcale un peu de la France des années 1970-1980, à ceci près que, dans l'Hexagone, c'est depuis 1944 que les femmes peuvent voter.
Cela aurait pu donner un film pesant, militant, poussiéreux. Ce n'est heureusement rien de tout cela. C'est évidemment engagé, mais furieusement drôle, malgré la gravité des situations. Il y a d'abord le contraste entre ces femmes de la campagne, soumises bien qu'enragées de leur condition de bonnes à tout faire, et les jeunes qui ne veulent pas de la même vie de leur mère. Il y a aussi la beaufitude ridicule de certains hommes, vraiment pas subtils. Il y a enfin l'irruption de la révolution sexuelle, dans une scène hilarante au cours de laquelle des femmes revendiquent le mot "clitoris" et découvrent, pour certaines d'entre elles, qu'elles ont un tigre dans le moteur...
On suit plus particulièrement l'évolution de Nora, une timide femme au foyer qui doit se fader un beau-père acariâtre, deux fils égocentriques et un mari gentil mais très sensible au qu'en-dira-t-on. L'une des scènes du début la montre pédalant à vélo, dans l'un des rares moments de totale liberté dont elle jouit. Le déclic est la révolte de sa nièce, dont Nora ne supporte pas la répression. Dans le même temps, elle suit les débats sur le référendum portant sur le droit de vote... et elle se dit qu'elle pourrait reprendre un travail.
Cela fait beaucoup pour son mari Hans, un beau garçon maladroit qui ne l'a jamais fait jouir. Travailleur consciencieux, il est sur le point de bénéficier d'une promotion dans la scierie dirigée par une vieille bique ultraconservatrice. Son départ pour le service militaire va donner des ailes à Nora... et bouleverser le village.
L'héroïne va trouver des alliées : une retraitée à moitié sénile mais audacieuse, une restauratrice d'origine italienne de moeurs très libres et même sa belle-soeur, lassée d'un mari décevant.
Cela donne un ensemble instructif et très plaisant, toujours d'actualité à une époque où l'obscurantisme est loin d'avoir disparu.
dimanche, 26 novembre 2017
Thelma
Visible à Rodez en version française comme en version originale, ce film fantastique nous vient de Norvège. Il débute de manière assez classique, par une scène issue du passé : un père emmène sa fille à la chasse. Rien n'est dit, tout est suggéré, mais l'on comprend que, lorsqu'une biche surgit devant les personnages, la gamine aimerait bien que son père ne la tue pas. Je vous laisse deviner comment cette enfant "un peu spéciale" lui fait comprendre qu'il ne devrait pas tirer...
On retrouve Thelma des années plus tard. La petite fille de la campagne est devenue un joli brin de femme, étudiante dans une grande ville où elle a du mal à s'intégrer. Le réalisateur Joachim Trier part d'une vie quotidienne anodine pour suggérer que le feu couve sous la glace.
Thelma a été élevée par des parents très croyants. Elle a été surprotégée. Du coup, elle apparaît un peu coincée à ses camarades de fac : elle est timide, ne boit pas d'alcool, ne sort pratiquement pas le soir et, quand elle s'exprime, a des opinions qui tranchent par rapport à ses camarades. Chaque jour, elle a au moins l'un de ses parents au téléphone. Ce n'est que plus tard que l'on comprend que la jeune femme a un secret, que connaissent ses parents. Les dialogues entre eux sont donc à double sens, suffisamment bien écrits pour que la posture des parents chrétiens hyper-protecteurs tienne la route.
Cette deuxième partie un peu languissante voit Thelma se faire une amie, étudiante comme elle. Leur relation prend un tour inattendu, le tout filmé avec beaucoup de sensualité.
Evidemment, cela va finir par déraper. Le passé enfoui ressurgit, déteignant sur le présent. Le fantastique (ou le surnaturel) prend de plus en plus de place, sans que le réalisateur ait besoin de recourir à une tonne d'effets spéciaux. En gros, seules trois scènes (une dans une clinique, une chez l'amie de Thelma et une sur le lac) ont nécessité des retouches numériques. Les autres suscitent le trouble voire la crainte grâce au jeu des acteurs, à la mise en scène et au montage.
Le seul défaut du film est sa longueur. Je ne me suis jamais ennuyé, mais j'ai trouvé que, de temps en temps, on aurait pu accélérer le rythme. Notons toutefois qu'il se termine de manière surprenante, pas du tout "à l'américaine". Gageons qu'Hollywood va récupérer le scénario pour en produire une version plus conforme aux canons en vigueur outre-Atlantique.
11:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 25 novembre 2017
Detroit
Kathryn Bigelow (la réalisatrice très inspirée de Démineurs et Zero Dark Thirty) s'est penchée sur les émeutes de 1967, dans ce qui était alors la capitale de l'automobile américaine. Le film met principalement en scène les tensions entre (certains) Noirs et (certains) Blancs, alors que la ségrégation venait à peine d'être supprimée.
C'est une nouvelle fiction à caractère documentaire. La réalisatrice essaie de reconstituer ce qui s'est passé cette nuit-là, quasiment en temps réel, en suivant au plus près les principaux personnages, interprétés par des acteurs criants de vérité. Parmi ceux-ci, on reconnaît John Boyega (vu dans Le Réveil de la Force et The Circle) et Will Poulter (vu dans The Revenant).
On sent que le film est à la fois très écrit et nourri par une part d'improvisation. C'est vraiment très bien foutu. Bigelow filme Detroit comme une ville en guerre du Moyen-Orient. Et que dire de la montée de tension qu'elle instaure, au point de rendre étouffantes certaines scènes en apparence anodines.
Trois catégories de forces de l'ordre sont intervenues cette nuit-là : les militaires de la Garde nationale, des policiers de l'Etat de Michigan et ceux de la ville de Detroit, qui font plus penser à une milice désorganisée qu'à des défenseurs de la loi. C'est d'eux que vont surgir les dérapages.
En même temps, Bigelow ressuscite une époque, celle d'un furieux appétit de liberté de la part d'une partie de la jeunesse, sur fond de musique Black.
La limite du film est le décalage que j'ai ressenti par rapport à quasiment tous les personnages. Qu'ils soient des "bons", des "méchants" ou des "neutres", je n'ai pu m'identifier à aucun d'eux. Ils me sont apparus bouffis de préjugés ou lâches ou terriblement immatures. Alors que la mise en scène a pour but de nous immerger au coeur de l'intrigue, je suis resté un peu étranger à la représentation de cette flagrante injustice, pourtant très bien filmée.
00:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 22 novembre 2017
Justice League
DC Comics essaie de la jouer comme Marvel, en lançant une série de films de super-héros liés les uns aux autres. Voilà pourquoi celui-ci contient des allusions à Man of Steel et Batman vs Superman. Cependant, cela ne débute pas sous les meilleurs auspices. Je ne sais pas si c'est la version française qui pêche, mais, franchement, la plupart des dialogues sont à chier... et j'ai vraiment du mal avec la groooossse voix dont on a affublé Ben Affleck (décidément pas le meilleur Batman).
Heureusement, à intervalle régulier, des traits d'humour viennent égayer l'intrigue, sans toutefois que cela soit aussi désopilant que dans le récent Thor : Ragnarok. L'une de ces saillies figure d'ailleurs dans la bande-annonce, à l'intérieur d'un dialogue entre Batman et un petit nouveau :
- Et vous, c'est quoi votre super-pouvoir ?
- Je suis riche.
De manière générale, tout ce qui tourne autour de Flash (Ezra Miller, très bien) est réussi. J'ai beaucoup apprécié ce personnage de djeunse maladroit et blagueur, qui n'est pas sans rappeler le Vif-Argent des X-Men.
L'humour est aussi de sortie à l'occasion de la résurrection d'un autre super-héros, dans une scène où celui-ci dialogue avec sa petite amie :
- Ça fait quoi d'être entre quatre planches ?
- Ça gratte.
[...]
- Tu sens bon !
- C'était pas le cas avant ?
Enfin, plus loin, au cours d'une baston, deux des valeureux combattants de la liberté échangent des propos de la plus haute intensité :
- Mais t'es dingue !
- C'est pas moi qui suis venu avec une grosse fourchette.
On retrouve un peu l'ambiance de 300 - La Naissance d'un empire, scénarisé par Zack Snyder, qui est ici derrière la caméra. Voilà pourquoi celle-ci s'attarde autant sur ces corps masculins bodybuildés (sacré Zack !), les personnages féminins étant nettement moins bien mis en valeur... à l'exception peut-être de Wonder Woman, qui a le charme et l'énergie de Gal Gadot, pourtant pas gâtée par son costume.
Ses congénères amazones sont d'ailleurs au cœur de la première séquence emballante du film, lorsque leur île est attaquée par Steppenwolf, un méchant très très vilain (et costaud). Il faut reconnaître que Snyder sait y faire côté baston. Il est servi par de très beaux décors et des effets spéciaux qui en jettent.
Bref, au bout d'un moment, on se fiche un peu du pourquoi et du comment et l'on digère agréablement, confortablement installé dans une grande salle.
22:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 21 novembre 2017
Carbone
Olivier Marchal signe un nouveau polar, dont l'intrigue s'inspire de l'affaire la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. En août dernier, Le Monde a consacré une excellente série de papiers à cette arnaque tarabiscotée, qui a sombré dans le macabre.
Par précaution et peut-être aussi pour mieux gérer la tension dramatique, les scénaristes se sont parfois un peu éloignés de l'histoire. Ainsi, le personnage principal, incarné par Benoît Magimel (correct, mais pas transcendant), est un mélange d'Arnaud et de Fabrice (pour ceux qui connaissent l'affaire). On a de plus rendu son personnage plus sympathique que dans la réalité... sinon il n'y aurait pas eu de film : les spectateurs lambdas n'auraient pas pu s'identifier à des escrocs minables et des salauds sans scrupule.
Le début est un peu lourd, avec l'insistance mise sur ce courageux chef de PME que le fisc emmerde et qui, de surcroît, doit supporter la morgue de son richissime beau-père (Depardieu, potable). Les meilleures scènes surviennent quand il se retrouve avec ses potes, très bien interprétés. Parmi eux, je distingue Mickaël Youn et surtout Idir Chender, qui incarne le mec immature, qui ne va pas parvenir à gérer la pression et à qui le succès va faire perdre les pédales. Il est vraiment très convaincant. Signalons aussi la composition de Dany en matrone juive. Laura Smet n'est pas mal non plus en compagne du vainqueur du jour.
Le principe de l'arnaque est expliqué sans trop de détails. Le but n'est pas de créer une fiction à caractère documentaire. Marchal veut manier la pâte humaine, à l'américaine, et brosser le tableau de l'ascension et de la chute d'une bande de potes. Au passage, il se vautre un peu dans la représentation du luxe ostentatoire (musique assourdissante, filles affriolantes, sexe, drogue, alcool, grosses voitures et montres rutilantes). Mais, comme c'est filmé avec style, ça passe. La tension monte efficacement, notamment à partir du moment où des truands patentés vont vouloir prendre leur part du gâteau... voire celle des autres.
Le fait que cette arnaque ait été mise en oeuvre par des minorités (et que Marchal n'ait pas cherché à atténuer cet aspect communautaire) a gêné certains critiques (notamment celui du Monde). Oui les premiers arnaqueurs étaient presque tous des juifs du Sentier, oui leurs associés étaient des trafiquants maghrébins et oui les blanchisseurs de l'argent sale étaient d'origine chinoise. Et alors ?
On peut très bien s'émanciper du contexte et se contenter de savourer un film d'action efficace, comme le cinéma français en propose peu.
20:59 Publié dans Cinéma, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films