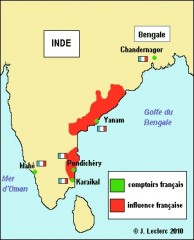jeudi, 14 février 2013
Lincoln
Steven Spielberg enchaîne les films à gros budget ; Lincoln succède aux Aventures de Tintin et au Cheval de guerre. Par contre, il change de genre. Il s'agit ici d'une tentative de reconstitution historique, minutieuse, sans guère de spectacle. Et pourtant, en toile de fond se trouve la Guerre de Sécession, dont la conclusion pèse sur l'aboutissement d'un projet cher au coeur du président des Etats-Unis : le vote du treizième amendement, abolissant l'esclavage.
Les interprètes sont souvent excellents, à commencer par Daniel Day-Lewis, auteur une nouvelle fois d'une prestation remarquable. (Il me manquait depuis There will be blood.) Il campe à la perfection ce grand idéaliste à la morale inflexible, qui va devoir se faire plus dur et plus manipulateur pour parvenir à ses fins. Il va être aidé par les "gauchistes" de l'époque (appelés "radicaux"), qui vont accepter de modérer leur attitude. Dans ce groupe se distingue Thaddeus Stevens, incarné avec talent par Tommy Lee Jones. Ce personnage nous réserve des surprises... jusqu'à la toute fin !
Trois autres groupes épaulent le président : les proches, les républicains conservateurs (qu'il faut toutefois convaincre... voire tromper) et un trio d'employés véreux, chargés de faire basculer certains votes (chez les démocrates, dont l'écrasante majorité est contre le projet de Lincoln). Leurs interventions sont savoureuses... et rappellent qu'il est difficile d'envisager de faire de la politique à un haut niveau sans parfois se salir les mains. Le film aborde ces questions délicates, sans aller toutefois au fond des choses.
La description du processus parlementaire alterne avec les moments familiaux. Spielberg a voulu montrer que ce président si populaire, qui a marqué son temps, n'a pas été heureux. Il a perdu un fils, a vu s'effilocher son mariage. (Sally Field, qui joue l'épouse, en fait un peu trop à mon goût.) Les relations avec son fils aîné ne sont pas très bonnes non plus. (Dans le rôle, Joseph Gordon-Levitt m'a paru moins convaincant que dans Looper.)
2h30, c'est toutefois un peu long et, si certains morceaux de bravoure parlementaire méritent le détour, on aurait pu (dû) pratiquer quelques coupes. Notons que si le matériau est historique, le film peut aussi se voir comme un polar politique. La réalisation en est soignée, Spielberg semblant avoir été particulièrement attentif au placement de la caméra. Il est néanmoins desservi par une musique trop présente, qui a tendance à surligner. On a l'impression d'avoir déjà entendu des dizaines de fois certains passages. (John Williams nous a habitués à mieux.)
Bref, c'est plutôt un bon film, mais avec quelques défauts notables.
20:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire
mercredi, 13 février 2013
Hiver nomade
Ce documentaire est consacré à une pratique qui ne cesse de décliner, la transhumance ovine (hivernale) en Suisse romande. On suit, sur une saison de quatre mois, deux bergers et leurs animaux de compagnie (ânes et chiens), dans leur périple professionnel.
Le berger en chef est un Français (corrézien de naissance), Pascal, la cinquantaine, autodidacte, débrouillard, paternaliste, charismatique, amoureux de la nature. Il dirige le troupeau de main de maître... et forme son assistante, Carole, une Bretonne pleine de courage, mais parfois un peu dépassée par les événements... et on la comprend.
Le film montre la dureté de la vie au quotidien face aux éléments : le froid, la neige (précoce cette année-là), la pluie. L'installation des bâches, le soir, est une étape-clé : elle va donner un peu de répit aux bergers, même si, en période de transhumance, on doit toujours rester sur le qui-vive. On apprécie d'autant plus certains petits plaisirs, comme ces huîtres dégustées au tournant de la nouvelle année.
Les humains sont très dépendants de l'aide que leur apportent les ânes et les chiens. Les premiers, pas toujours dociles, transportent leur "kit de survie". Ils sont fortement mis à contribution, au point que l'un d'entre eux doit être remplacé, en cours de transhumance.
Les chiens, eux, sont indispensables à la conduite et la surveillance du troupeau (qui atteint 800 têtes au plus haut)... mais certains canidés ont tendance à n'en faire qu'à leur tête. Le parcours est donc aussi l'occasion de parfaire leur dressage... et de commencer celui du dernier venu, qui a la chance de débuter le voyage dans la poche du vêtement ample de la bergère ! (Il est mignon tout plein.) On découvre certaines pratiques des bergers, comme le choix dans le troupeau de "poissons-pilotes", des moutons leaders, qui bénéficient d'une nourriture d'appoint et entraînent le reste du groupe là où les humains veulent les mener.
Entre les deux bergers, les relations sont parfois un peu tendues. Incontestablement, ils s'entendent bien, mais le "chef" voudrait bien que son assistante devance ses demandes. Elle aussi est un peu en formation. Ceux qui ont vu Entre les Bras ne seront pas étonnés que des proches soient parfois sans concession l'un pour l'autre dans le cadre de l'activité professionnelle.
La photographie est superbe. Il faut dire que le sujet s'y prête. On est dans les Alpes suisses, enneigées la majorité du temps. Avec les bergers, on goûte la quiétude des pâturages d'altitude. On apprécie le silence de la campagne. Les rencontres que l'on fait sont parfois enrichissantes, parfois sources de tension, comme celle de paysans locaux qui, sans le dire explicitement, font comprendre à nos héros qu'il faudrait qu'ils dégagent rapidement, sans empiéter sur leurs terres.
Notons que le périple est géré à distance par un patron (qui a constitué le troupeau). Il vient de temps à autre voir comment cela se passe sur le terrain... mais aussi pour récupérer des bêtes engraissées et les vendre après abattage.
Ce n'est pas long (1h25), c'est joli à regarder et on apprend des choses. Un film à découvrir, un peu comme Jon face aux vents, l'an dernier.
20:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 10 février 2013
Wadjda
Première surprise concernant ce film : il cartonne à l'Utopia de Toulouse. J'ai dû faire la queue pour acheter la place et, lorsque la séance a commencé, la salle 1 (la plus grande) était presque pleine... de femmes ! Des (très) jeunes (venues avec leur maman) et des très âgées, qui ont parfois réussi à entraîner leur compagnon. L'un d'entre eux a d'ailleurs roupillé à côté de moi pendant une bonne partie du film !
Le début m'a un peu inquiété. J'ai redouté un film illustrant le "féminisme de salon", dénonçant les méchants islamistes qui empêchent les femmes de se maquiller et de porter des hauts talons. La jeune Wadjda apparaît comme attirée par ce qui choque les conservateurs : elle ne peut pas se séparer de ses baskets Converse, écoute de la musique occidentale, porte des piercings (discrets) et rechigne à ajuster le voile (quasi) intégral dans lequel l'idéologie fondamentaliste veut enfermer les femmes. Au quotidien, elle se fait taquiner par l'un de ses voisins, pas très sympathique de prime abord... et ses parents (appartenant visiblement à la classe moyenne) ne semblent pas beaucoup s'occuper d'elle.
Mais, au fur et à mesure que l'on découvre les personnages, que nous est révélée la vie quotidienne de certaines femmes saoudiennes, cela devient passionnant. C'est d'abord dû à l'interprète du rôle-titre. Cette petite Waad Mohammed est pétrie de talents et sait magnifiquement faire passer à l'écran l'ironie frondeuse que la réalisatrice Haifa Al Mansour a distillée dans l'intrigue.
Pourtant, la vie n'est pas drôle pour les femmes dans ce pays. Si, à l'intérieur de leur logement, elles évoluent dans les habits de leur choix, dès qu'elles sortent, elles doivent se soumettre à l'un des plus rétrogrades codes vestimentaires qui soient. Mais ce n'est pas tout. On sent la domination des hommes au quotidien : les femmes sont dévolues aux tâches ménagères et à la procréation. (C'est d'ailleurs parce qu'elle ne peut pas donner de fils à son mari que la mère de l'héroïne va devoir accepter qu'il prenne une deuxième épouse. Ajoutons que l'arbre généalogique familial ne mentionne que les hommes.) Elles n'ont pas le droit de vote et rencontrent de grandes difficultés pour exercer une activité professionnelle.
Les scènes d'école sont très réussies. On y voit le contraste entre la bigoterie imposée aux filles et leur désir de vivre la vie de leur choix (du moins pour les plus rebelles). La petite Wadjda réussit à se faufiler entre les gouttes. Elle y mène ses petites affaires... et n'hésite pas à monnayer ses services ! Suprême habileté, elle va faire croire à son nouveau zèle religieux, pour tenter de remporter un concours portant sur la connaissance et la récitation du Coran ! Pour cela, elle achète un DVD-quiz et s'inscrit à des séances de psalmodie. Son véritable but est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir acheter le vélo de ses rêves.
Trois beaux personnages entourent celui de Wadjda : sa mère, son voisin et la directrice de l'école. La première est sans cesse sur la brèche, entre un mari qui la délaisse, un travail qui l'éloigne de sa fille et un transporteur indélicat. (Elle fait un geste magnifique, pour sa fille, à la fin du film.) Le deuxième est finalement plus sympathique qu'il n'y paraît. On comprend rapidement qu'il en pince pour cette voisine anticonformiste, un peu chieuse sur les bords, mais qui a tellement de charme. La troisième est le personnage le plus ambigu. A l'intérieur de l'école, l'apparence qu'elle se donne pourrait la faire passer pour une parfaite occidentale. Et pourtant, c'est la plus acharnée à faire respecter le règlement, dans ses aspects les plus stricts. On finit par apprendre qu'elle eut une jeunesse sans doute tapageuse et que sa vie privée n'est peut-être pas aussi conforme à la morale islamique qu'on pourrait le croire.
C'est donc un film riche de contenu, avec un aspect documentaire, mais souvent drôle. La réalisatrice sous-entend que, pour les femmes de 30-50 ans, la cause paraît perdue, mais que si celles-ci se battent, l'espoir est permis pour la génération suivante.
13:36 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film
samedi, 02 février 2013
Django unchained
Dans son nouveau film, Quentin Tarantino pratique l'hommage, le calque et le retournement. Django unchained est donc formaté comme un western spaghetti. C'est particulièrement sensible au niveau des incrustations à l'écran et de la musique. Sergio Leone n'est pas loin, notamment dans un plan sur les yeux de Django-Jamie Foxx qui, de surcroît, est là pour régler de vieux comptes.
Cependant, à la différence de ses illustres devanciers, Tarantino choisit de placer au centre de l'action un Noir. Il pousse le vice jusqu'à montrer celui-ci châtiant d'immondes Blancs racistes. Voilà le retournement. Comme dans Inglourious Basterds, il réécrit l'histoire au profit des victimes.
La première séquence est une véritable merveille. Il y a tout : une ambiance nocturne chiadée, un souci du détail, aussi bien dans les scènes de dialogue que dans la baston (assez brève... ce n'est que la mise en bouche, voyons !). Et parlons-en, des dialogues (en vo sous-titrée, c'est mieux : on savoure les passages en français, entendus dans la seconde partie) : Christopher Waltz (qui confirme tout le bien que je pensais de lui déjà dans Carnage) se pourlèche les babines des répliques que lui a concoctées Tarantino. Le plaisir continue dans la bourgade de péquenots, qui nous montre une seconde fois le "docteur" Schultz dans ses oeuvres.
En dépit du titre, c'est donc bien le personnage incarné par Christopher Waltz qui est le héros de la première partie. Il mène l'action, tel un deus ex machina sorti de sa roulotte de dentiste (excellente trouvaille). Les plus belles répliques sortent de sa bouche. Mais, petit à petit, Django, au départ timoré et interloqué (mais ravi de sa nouvelle liberté), va prendre de l'assurance. Si la qualité des dialogues s'en ressent, l'action gagne en intensité : la sauce tomate jaillit davantage des corps (jusqu'à tapisser les murs) et l'on voit encore plus de cadavres propulsés ou déformés par la balle qui les atteint. On aura compris qu'il ne faut pas chercher trop de vraisemblance dans les scènes de baston. On est juste là pour prendre son pied.
Les bons esprits regrettent l'abus de violence gratuite... mais on est chez Tarantino. (N'y emmenez donc pas vos gamins !) Il n'est pas moins ambigu que dans ses précédents films. C'est évidemment bourré d'humour. Les drogués de mise en scène apprécieront particulièrement certains moments, comme le service de la bière (dans la première partie) ou "le spectacle d'intérieur", qui voit nos héros rencontrer un gros enculé efficacement interprété par Leonardo DiCaprio. Toutefois, côté acteurs, dans la seconde partie, c'est Samuel L. Jackson qui casse la baraque. Il joue une sorte d' "Oncle Tom" odieusement servile... machiavélique au fond.
Son arrivée à l'écran coïncide avec le retour des dialogues percutants. La parole, comme toujours chez Tarantino, permet de faire basculer l'action. Elle va d'ailleurs sauver la mise à l'un des héros et faire rebondir une nouvelle fois l'action, histoire que le film se conclue sur un ultime massacre.
Et les femmes, là-dedans ? On les voit peu. C'est étonnant, parce que Quentin nous avait habitué à des personnages féminins plus étoffés. Ici, elles jouent les utilités (comme dans les westerns spaghetti dont il s'inspire). On se pose néanmoins des questions sur la "femme masquée", qui fait partie de la troupe de soudards employée par Candie-DiCaprio. On la voit à l'occasion de la capture d'un évadé, dans le transport qui suit vers la propriété du maître, ainsi qu'à la fin, dans une baraque où s'entassent les employés : elle y visionne des images touristiques de la Grèce. Tarantino avait visiblement prévu de consacrer quelques scènes à ce personnage... Va falloir se ruer sur les bonus du DVD !
15:39 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 31 janvier 2013
Zero Dark Thirty
Le titre évoque un moment de la nuit, celui durant lequel on imagine que les Navy Seals ont pris d'assaut le refuge d'Oussama ben Laden, au Pakistan, en mai 2011.
Le film était attendu pour ce qu'il était censé montrer. Il est d'abord intéressant par ce qu'il ne montre pas à l'écran. Cela commence par la référence aux attentats du 11 septembre 2001, présentés uniquement par voie sonore, avec un écran noir. N'oublions pas que la réalisatrice est américaine et que, pour son public national, ces événements constituent peut-être la plus terrible catastrophe humaine de l'histoire du pays. Il leur faudra encore un peu de temps pour réaliser que, dans d'autres pays du monde, des horreurs bien pires ont été perpétrées. Ce "noir" visuel nous pousse néanmoins à tendre l'oreille. L'un des coups de fils choisis est celui d'un jeune homme, qui tente de rassurer sa famille en précisant que, si un avion a bien percuté la tour n°1, lui se trouve dans la tour n°2... en sécurité.
Le film, bien que minutieusement construit, fourmillant de détails, reste très évasif sur son personnage principal , l'agent de la CIA Maya (incarnée par Jessica Chastain, une nouvelle valeur sûre de Hollywood, déjà remarquée pour ses prestations dans L'Affaire Rachel Singer et La Couleur des sentiments). Quand bien même ce personnage est la fusion de plusieurs personnes réelles, on aurait pu nous en dire plus sur son passé. On comprend qu'elle a été recrutée très jeune par la CIA, en 2000 ou 2001. Vu l'obstination dont elle fait preuve dans la traque de ben Laden (et sa réaction tout à la fin, après la découverte de son cadavre), on en déduit qu'elle a perdu un ou plusieurs proches le 11 septembre 2001. L'actrice donne de la vraisemblance à ce personnage de moine-soldat au féminin, mais le scénario la dessert un peu.
A ce propos, on notera que la caméra ne filme jamais entièrement le chef terroriste, et surtout pas en gros plan. Si l'on conçoit que ce n'est pas l'homme qui est le plus dangereux, mais les idées qu'il véhicule, c'est logique. On nous a aussi épargné la scène de largage du corps en pleine mer (si cela s'est réellement passé ainsi). De ce point de vue toutefois, le film se situe dans la lignée de la politique américaine, qui a voulu éviter de faire du terroriste une icône, mais qui est arrivée au résultat exactement opposé. La découverte de ben Laden dans le sac mortuaire m'a irrésistiblement fait penser à la mort d'Ernesto Guevara... joli paradoxe qui voit un révolutionnaire athée et un intégriste musulman devenir des figures christiques !
Il n'est pas non plus question des trois plus terribles attentats antioccidentaux qui ont succédé à ceux du 11 septembre 2001 : Bali (en octobre 2002), Madrid (en mars 2004) et Londres (en 2005). On pourrait justifier ces omissions en précisant que leurs auteurs avaient des motivations plus nationales qu'internationales. On pourrait aussi relier ces oublis à ce que déclare Maya (dans le film) à l'un des pontes de l'espionnage yankee : tuer ben Laden désorganiserait le réseau d'Al Qaïda et réorienterait sans doute l'action de certains groupes vers des objectifs nationaux. En gros, les Etats-Unis seraient un peu plus peinards, alors que leurs alliés auraient davantage de soucis à se faire...
Le film nous propose par contre de vivre du côté de la CIA deux attentats dont on a entendu parler, sans en saisir tous les enjeux à l'époque. Cela commence avec l'explosion d'un camion piégé à l'hôtel Marriott d'Islamabad, au Pakistan, en 2008. Présenté à l'époque comme une démonstration anti-occidentale de force, l'attentat semble avoir aussi eu des cibles très précises. Il en est de même avec celui de la base Chapman (en Afghanistan), en 2010. Dans le film, on le sent venir à des kilomètres. Ce manque de subtilité est contrebalancé par l'efficacité de la réalisation (Bigelow avait fait ses preuves avec Démineurs) et la qualité de l'interprétation.
C'est assez révélateur de l'ensemble du film : un produit bien fichu, documenté, mais très ambigu sur le fond. Le cas de la torture est exemplaire. On nous montre de longues scènes d'interrogatoire ou de mise sous pression. On peut à la fois féliciter la réalisatrice pour sa volonté de montrer la fange dans laquelle certains de ses personnages se vautrent. Mais un mauvais esprit pourrait objecter que la réussite de la traque de ben Laden reposerait, au moins en partie (selon le film), sur ces séances de torture...
Les amateurs de cinéma sont heureusement servis par plusieurs très bonnes séquences, comme la filature du messager de ben Laden, en pleine jungle urbaine pakistanaise (reconstituée en Inde !), détecteurs ultra-sophistiqués à l'appui. J'ai aussi particulièrement aimé la séquence de l'assaut du refuge pakistanais, filmé de nuit (avec une caméra spéciale) et dans un silence étouffant... à travers lequel, dans un premier temps, on ne perçoit que quelques bruits. Élément positif supplémentaire, le scénario se démarque ici de la version officielle de Washington, pour s'inspirer du récit d'un Navy Seal, ancien membre du commando, qui a révélé que ben Laden a été abattu alors qu'il ne représentait pas de menace directe pour les soldats. Cette expédition était donc bien une vengeance, pas du tout un acte de justice. C'est d'ailleurs l'impression qui se dégageait du titre originel de ce (très) long métrage, "For God and Country".
21:22 Publié dans Cinéma, Histoire, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire
samedi, 26 janvier 2013
Le Roi du curling
Quelque part entre les Deschiens et Groland, cette comédie provinciale norvégienne pratique l'humour à froid... ce qui n'est guère surprenant dans ce pays spécialiste des sports d'hiver. Le curling est l'un d'entre eux. Pour les Européens de l'Ouest et du Sud, c'est une curiosité ethnologique, un peu comme le cricket ou le base-ball. Très populaire dans certains pays, on pourrait rapprocher sa pratique de celle de la pétanque ou des quilles chez nous : l'élite goûte peu ces activités sportives, alors qu'elles réclament beaucoup de concentration et d'habileté.
Ici, le héros, Truls Paulsen, est un monomaniaque qui considère ce sport comme un art. La moindre contrariété peut le faire disjoncter. La première partie du film nous montre donc la déchéance du champion, qui entraîne avec lui les membres de son équipe. Les hommes ont tous (plus ou moins) du bide... et souvent des problèmes psychologiques. Truls est un obsédé du rangement, son numéro 2 n'arrive plus à dormir, un troisième ne pense qu'à observer des oiseaux et le quatrième membre de l'équipe, véritable érotomane, saute sur tout ce qui bouge.
La deuxième partie du film montre ces gaillards en train de vivoter. On s'attarde tout particulièrement sur Truls, persécuté par sa mégère de femme. (Les séquences de salon, face à la télévision, valent leur pesant de cacahuètes !) Par contre, au boulot, on le ménage. Bourré de cachets, il fréquente un club de parole, où il rencontre un tas de dingos sympathiques... notamment un pépé atteint du syndrome de Tourette et une sorte d'artiste, très mignonne, qui va s'amouracher de lui... on se demande bien pourquoi !
La troisième partie est celle de la renaissance. Afin d'y parvenir, Truls va devoir s'émanciper de la tutelle de sa femme, remédier au problème de sommeil de son second, récupérer l'ami des oiseaux et canaliser l'énergie sexuelle du dernier acolyte. Le nouveau championnat approche. L'équipe la plus dangereuse est menée par l'éternel rival de Truls, un gros vantard permanenté, qui se prend pour le roi du monde... et que l'acteur norvégien a visiblement pris un grand plaisir à incarner !
Si le comique de situation basique (et un brin puéril) ne vous rebute pas, si vous avez apprécié un film comme Norway of life, ne ratez pas cette petite comédie, qui réussit à rendre passionnante une partie de curling !
22:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, cinema
dimanche, 20 janvier 2013
Jean de la Lune
Je suis un peu comme certains personnages adultes de ce dessin animé : j'avais oublié Jean de la Lune, alors que c'est une figure dont on m'avait parlé dans l'enfance. Mi-extraterrestre mi-humain, il se retrouve sur Terre, pour son bonheur comme pour son plus grand malheur.
L'unique habitant de la Lune s'ennuie. Voilà pourquoi il quitte notre satellite pour gagner notre planète, où il va faire la connaissance d'enfants (qui ne peuvent s'endormir sans sa présence rassurante), d'un savant fantasque et génial (Ekla des Ombres) et d'un dictateur mégalomane, qui se fait passer pour son ami.
Cette animation en apparence anodine brasse donc des thèmes importants : l'amitié, la nature, l'ambition, la servilité. Le fil rouge est une voiture américaine, que l'on voit partir d'un cinéma en plein air au début du film (et qui y retourne tout à la fin, je vous laisse découvrir pourquoi).
On sent que Tomi Ungerer, marqué par les totalitarismes du XXe siècle, a voulu les dénoncer. Il croise le portrait sans concession du dictateur avec un rapide tableau de la société de cour qui l'entoure, l'accent étant mis sur son bras droit, un crétin servile. Une touche d'humour vient à chaque fois ridiculiser la grandiloquence de ces importants : un ours, utilisé comme trophée, statue ou carpette... mais toujours vivant, ce qu'il cherche évidemment à cacher !
La fantaisie est de mise chaque fois que le scientifique Ekla est à l'écran. Un peu trop naïf, il se fait dans un premier temps manipuler, avant de contribuer au sauvetage du héros.
L'animation est assez perfectionnée. De prime abord, cela ressemble à certaines productions françaises, avec un côté art-déco. Mais, dès que l'on s'intéresse aux mouvements des personnages, on se rend compte de la méticulosité du travail effectué. La musique d'accompagnement, très variée, est vraiment chouette.
Petit bémol à mon enthousiasme : le rythme est un peu lent. On aurait pu pratiquer quelques coupes, pour aboutir à un film d'1h20 - 1h25, au lieu d'1h35.
PS
Sur le site dédié, on peut télécharger divers documents, notamment un dossier d'images à colorier, pour les enfants.
13:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
vendredi, 18 janvier 2013
Argo
Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors que le film de Ben Affleck vient de recevoir deux Golden Globes ("meilleur film dramatique" et "meilleur réalisateur") et qu'il est sept fois nominé aux Oscar, certains cinémas ont eu la bonne idée de le reprogrammer... ce qui m'a permis de le voir, enfin.
Même si l'essentiel de l'histoire se déroule à Téhéran, en Iran (les scènes correspondantes ayant été tournées en Turquie), un nombre non négligeable de séquences ont pour cadre soit Washington (et la Virginie), coeur du pouvoir politique états-unien, soit la Californie et Hollywood, coeur du pouvoir culturel yankee. On nous présente deux milieux très contrastés, l'un peuplé de types cassants et engagés dans des luttes d'influence, l'autre de branquignols plus ou moins doués, capables du meilleur comme du pire. Je vous laisse imaginer dans quelle catégorie il faut ranger la CIA... Cela nous vaut quelques moments savoureux, avec de vieux routiers comme John Goodman.
Le coeur du sujet est la crise des otages. Les scènes de foule iranienne sont particulièrement réussies. Les précieuses anecdotes de tournage du site Allociné nous apprennent que des techniciens ont été mêlés aux figurants. L'impression de réalisme est grande... et, si l'on a déjà vu certaines images d'époque (notamment l'assaut contre l'ambassade américaine), on est frappé par la ressemblance.
Viennent ensuite les moments plus intimistes, centrés sur les six réfugiés logés chez l'ambassadeur du Canada. C'est le prétexte à un beau portrait de groupe, avec des acteurs très bons, choisis aussi sans doute pour leur ressemblance avec les personnages qu'ils incarnent. (Je conseille de rester à la fin : on nous propose une intéressante comparaison entre les images réelles et certaines, issues du film.) On ne nous cache pas leurs faiblesses, leurs dissensions. Les spectateurs peuvent facilement s'identifier à ces individus qui ne semblent pas sortir de l'ordinaire. L'un d'entre eux, Marek Lijek, a récemment livré son témoignage.
La dernière partie du film est construite sur le mode du suspens. Ben Affleck y abuse du just in time, que ce soit à propos d'un coup de fil à Hollywood, de la réservation des billets d'avion comme du décollage final, dans une scène dont on sait aujourd'hui qu'elle est complètement inventée. (On pourrait aussi reprocher au scénario d'éviter de dire clairement que l'ambassadeur du Canada, qui a sauvé la mise des six rescapés, était devenu un agent de la CIA.)
Cela reste un bon divertissement, bien joué, qui manie de manière sensible la pâte humaine. Même s'il glorifie l'Amérique débrouillarde, il a l'honnêteté de ne pas cacher les sujets de mécontement des Iraniens, qui avaient des raisons d'en vouloir à Oncle Sam... et qui (exception faite de l'employée de maison de l'ambassadeur) sont dépeints de manière assez unilatérale dans ce film.
23:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire
mardi, 15 janvier 2013
Tabou
Depuis plusieurs semaines, il est beaucoup question du film (en noir et blanc) de Miguel Gomes, porté par le bouche-à-oreille des cinéphiles. Il est divisé en deux parties, placées dans l'ordre chronologique inverse.
On commence donc par suivre la fin de vie d'une vieille dame qui a dû être belle, jadis. Elle perd un peu la tête, mais ne manque pas de caractère... ce qui ne simplifie pas le travail de son auxiliaire de vie cap-verdienne. Une voisine esseulée va se rapprocher d'elle. Il faut s'accrocher un peu pour s'intéresser à cette histoire de petits riens du quotidien. Ce long prologue, pas très bien joué (à l'exception de Laura Soveral, qui incarne l'héroïne), est pourtant nécessaire pour comprendre la suite.
La seconde partie nous plonge plus de 40 ans en arrière, dans le monde colonial portugais, au Mozambique. A proximité du mont Tabou se sont installés des Blancs, servis par une pléiade de Noirs. Ah, le bon temps des colonies... Ne comptez pas sur ce film pour étudier les rouages de la domination européenne. Il est question de convenances sociales et d'amour (ce qui n'est pas sans rapprocher Tabou d'Anna Karenine, pourtant très différent sur la forme).
La grande réussite de cette deuxième partie est d'avoir juxtaposé les images, muettes, les sons de l'Afrique, la musique dansante des années 1950-1970 et la narration d'un vieil homme qui fut un jeune amant fougueux. Bien que ne bénéficiant pas des dialogues, on comprend sans problème le déroulement de l'action. Les acteurs sont très expressifs et l'image d'une grande beauté. La musique, qui s'apparente à du twist américano-portugais, est entraînante.
Le fond est un peu triste, mais c'est une belle histoire.
22:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 13 janvier 2013
Anna Karenine
C'est une nouvelle adaptation du roman de Léon Tolstoï, cette fois-ci par Joe Wright, un Britannique qui a aussi une formation théâtrale. C'est la principale originalité de ce film : il se déroule sur plusieurs plans, certains d'entre eux étant symbolisés par des décors de théâtre.
C'est ce qui m'a longtemps fait hésiter. Finalement, c'est très réussi. Je redoutais un procédé trop conceptuel, associé à une esthétique cheap. C'est en fait brillamment mis en scène et les décords sont somptueux. Evidemment, le numérique est passé par là, qui facilite la transition entre scène de plateau et scène (supposée) d'extérieur.
Du coup, on passe un très bon moment, au plaisir des yeux s'ajoutant la qualité du jeu des acteurs. On sent que Keira Knightley s'est beaucoup investie dans le rôle-titre. Je ne peux toutefois m'empêcher d'être irrité par ses moues d'enfant gâtée (et comme les gros plans sont légion...). On note qu'elle est souvent vêtue de noir ou de couleurs proches du rouge, alors que les femmes de la "bonne société" sont habillées de blanc ou de beige.
D'autres interprètes féminines sont tout aussi remarquables : Emily Watson (appelée désormais à jouer les rombières), Kelly McDonald (à suivre), Ruth Wilson... et surtout Alicia Vikander, qui confirme tout le bien que l'on pensait d'elle depuis A Royal Affair.
Je n'ai par contre guère apprécié l'interprétation du comte Vronski par Aaron Johnson. Certes, le personnage est censé être un peu falot par rapport à l'impétueuse Anna, mais je trouve sa composition trop convenue. Il était meilleur dans Albert Nobbs. Du côté masculin, c'est Jude Law qui impressionne. Il casse son image, incarnant un cocu magnifique, dévot à l'extrême.
L'ensemble est très agréable. On peut se laisser porter par cette histoire d'amour tragique. On peut aussi s'intéresser au tableau de la société russe de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les femmes y sont soumises à une étiquette rétrograde et les pauvres subissent la domination de l'aristocratie. Le tourbillon révolutionnaire ne s'est pas encore formé, mais on en distingue les prémices.
De surcroît, l'intrigue croise habilement l'histoire de trois couples : Anna et Vronski, celui constitué par le frère d'Anna (un libertin impénitent) et son épouse (allègrement trompée) et celui, porteur d'espoir, que finissent par former Kostya et Kitty).
14:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 06 janvier 2013
Les Bêtes du Sud sauvage
Ce film surprenant mêle deux registres : la chronique sociale (réaliste) et le conte (fantastique). L'histoire se déroule dans le Sud de la Louisiane, qui n'a pas totalement pansé les plaies de l'ouragan Katrina. Les héros évoluent dans le bayou, entre La Nouvelle-Orléans et le Golfe du Mexique. La pêche et l'élevage de poules sont les principales source d'alimentation.
L'accent est mis sur les relations compliquées entre un père débrouillard et autoritaire et sa jeune fille, Hushpuppy, dont le tempérament cache une grande détresse : le manque d'affection, le père n'étant pas démonstratif et la mère n'étant plus là, pour on ne sait quelles raisons. Ces deux personnages sont incarnés (avec talent) par des acteurs non professionnels : l'homme était boulanger et la gamine a été sélectionnée parmi 4 000 candidates !
Le quotidien est fait de crasse et de tensions. On se croirait dans le Tiers Monde. Les adultes picolent sec, mais ils n'ont pas l'alcool mauvais. Ils vivent leur petite vie, à l'écart de la grande Amérique. L'arrivée d'un ouragan bouleverse cette routine. On suit ceux qui sont restés, notamment le père et la fille, en plein conflit (le père a de plus en plus de mal à dissimuler sa maladie). On constate l'étendue des dégâts.
Les scènes hyper-réalistes alternent avec des moments oniriques. Il semble que ce soit la petite fille qui imagine l'arrivée d'aurochs (plutôt des porcs sauvages, en fait). On se demande alors si les bêtes du titre sont ces animaux-là ou si ce n'est pas la métaphore des rapports humains (ou la vision que les autres habitants ont de la petite troupe qui vit dans son coin).
Le monde réel rattrape nos héros. On veut faire leur bien malgré eux : les enlever de la zone dangereuse et les intégrer à la "civilisation". Le réalisateur prend clairement parti contre cette politique. Je l'ai trouvé un peu naïf dans sa présentation de la vie solidaire de ces nouveaux Robinsons.
Les images n'en sont pas moins belles, que ce soient les vues du bayou que les scènes d'intérieur, avec les gros plans de la nourriture. La séquence la plus réussie est pour moi celle qui est liée à l'île-cabaret, où les enfants finissent par se rendre. Ils y découvrent une ambiance plus tendre, filmée dans des tons plus chauds.
C'est donc globalement bien fichu mais, sur le fond, complaisant avec cette vie de pauvreté farouche qui offre peu de perspectives d'avenir aux enfants.
15:50 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 03 janvier 2013
Cogan
... Killing them softly, en version originale ("Les tuer gentiment"). Brad Pitt incarne un tueur expérimenté, qui sert d'intermédiaire, d'entremetteur quand des situations compliquées se présentent. L'intrigue est limpide : un duo de jeunes cons veut se faire de la thune facilement. Il est engagé par un commerçant malin. Ils commettent l'erreur de braquer un tripot : les truands qu'ils ont dévalisés vont vouloir se venger.
On suit donc la pente inexorable qui mène à l'exécution des trois voleurs. L'originalité du film est de nous montrer la genèse des contrats qui vont porter sur leurs têtes. On suit les négociations, puis les discussions entre acteurs de la vengeance. On aboutit enfin à quelques scènes violentes, mises en scène avec une grande minutie (marque de fabrique du réalisateur), de manière presque clinique. Il n'y a rien de trop dans ces moments sanglants, mais il ne manque rien non plus.
On sent qu'Andrew Dominik (injustement encensé pour L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford) a vu et apprécié les films de Quentin Tarantino. Mais il n'en a pas la verve, le souffle, même s'il ne manque pas d'habileté. Du coup, par moments, on se désintéresse de cette histoire de truands pour se pencher sur les rapprochements effectués avec le fonctionnement de l'économie américaine. (Des extraits de journaux télévisés sont régulièrement insérés dans le cours de l'action, ou simplement diffusés en fond sonore.)
De manière assez attendue, le déclenchement de la crise financière (l'action se déroule pendant la campagne présidentielle d'octobre-novembre 2008) est montré comme le résultat de l'action de financiers voyous. Plus intéressant est le parallèle tracé dans l'autre sens. En effet, à cause du braquage des deux jeunes cons, c'est toute l'économie (clandestine) des tripots qui est menacée. Il faut d'urgence restaurer la confiance, quitte à s'en prendre à celui qui, bien que n'étant pas coupable, passe pour l'être aux yeux de la majorité.
Vu que les dialogues occupent une part importante de "l'action", je conseille de voir le film en version originale. Les acteurs sont très bons. On retrouve une brochette d'habitués des seconds rôles (James Gandolfini, Richard Jenkins, Ray Liotta...). Le mélange du polar et de l'analyse politico-économique ne fonctionne toutefois qu'à moitié. C'est un peu trop verbeux.
13:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
mardi, 01 janvier 2013
Les "Riton" 2012
Pour la septième fois consécutive, je me suis efforcé de construire mon palmarès annuel. Il a fallu faire des choix parfois difficiles, tant le nombre de films qui m'ont plu est grand. J'ai gardé ceux qui m'ont laissé la plus forte impression, ou qui ont fait preuve d'originalité. Cela donne un florilège d'une cinquantaine de longs-métrages, que j'ai classés de la manière suivante.
Dans la catégorie "film d'animation" :
- Riton du meilleur film pour adultes : Le Magasin des suicides
- Riton de la meilleure fantaisie historique : Zarafa
- Riton du meilleur conte : Le Jour des corneilles ex æquo avec Rebelle
- Riton du meilleur film transculturel : Couleur de peau : miel
- Riton de l'animation japonaise : Les Enfants Loups ex æquo avec La Colline aux coquelicots
- Riton du meilleur Burton : Frankenweenie
- Riton de la meilleure poursuite de série : L'Age de glace IV
- Riton de la pâte à modeler : Les Pirates, bons à rien, mauvais en tout
Dans la catégorie "comédie" :
- Riton de la meilleure satire politique : The Dictator
- Riton du meilleur film antiaméricain : God Bless America
- Riton de la comédie la plus malsaine : Touristes
- Riton de la comédie sans complexes : 2 days in New York
- Riton de la comédie décalée : Adieu Berthe, ou l'enterrement de mémé
- Riton de la comédie farfelue : Camille redouble
- Riton de la comédie qui ne paie pas de mine : Radiostars
- Riton de la comédie nostalgique : Stars 80
Dans la catégorie "film d'époque" :
- Riton du film de rebelles du peuple : Les Chants de Mandrin
- Riton du film de rebelles de l'élite : A Royal Affair
- Riton du film d'amour contrarié : Les Hauts de Hurlevent
- Riton du film "de qualité française" : Augustine
- Riton du film favorable au "mariage pour tous" : Albert Nobbs
- Riton du film clitoridien : Oh my God !
Dans la catégorie "conflits contemporains" :
- Riton du film évoquant la guerre d'Espagne : Insensibles
- Riton du film évoquant la Seconde guerre mondiale : Aloïs Nebel
- Riton du film mettant à jour un aspect méconnu de la Shoah : Sous la ville
- Riton du film évoquant la Guerre Froide : La Dette
- Riton du film radioactif : La Terre outragée
- Riton du film eastwoodien : J Edgar
Dans la catégorie "Proche et Moyen Orient"
- Riton du film choc : Incendies
- Riton de la comédie sociale drôlatique : La Vierge, les Coptes et moi
- Riton du film féministe : Les Femmes du bus 678
- Riton du polar islamique : Une Famille respectable
Dans la catégorie "société actuelle" :
- Riton du film sur la crise financière : Margin Call
- Riton du film sur le troisième âge : Robot and Frank
- Riton du film sur l'émigration africaine : La Pirogue
- Riton du film sur les défis de l'intégration : La Désintégration
- Riton du meilleur biopic : Cloclo
Dans la catégorie "documentaire" :
- Riton du film qui donne envie d'aller à l'opéra : Traviata et nous
- Riton du film qui a donné le goût du théâtre : César doit mourir
- Riton du film qui donne faim : Entre les Bras
- Riton du film qui donne envie de visiter la Scandinavie : Jon face aux vents
- Riton du film qui donne envie d'adopter un chat : Félins
- Riton du film qui donne envie de meugler : Bovines
Dans la catégorie "polar - film d'action" :
- Riton du film sur la lâcheté : 38 témoins
- Riton du film sur les trafiquants de drogue : Miss Bala
- Riton du film de baston : Avengers
- Riton du film d'espionnage : Skyfall
- Riton du film d'anticipation : Looper
- FILM DE L'ANNEE : Bullhead
Pour les amateurs de drogue dure :
- les Riton 2011
- les Riton 2010
- les Riton 2009
- les Riton 2008
- les Riton 2007
- les Riton 2006
17:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
lundi, 31 décembre 2012
Ernest et Célestine
Après Le Magasin des suicides (macabre à souhaits) et Le Jour des corneilles (enlevé et mystérieux), voici une troisième production (au moins en partie) française dans le domaine de l'animation.
On découvre d'abord une partie du monde de Célestine, la souris, dans un dortoir à l'ancienne, où ce qui ressemble à une bonne sœur terrifie les pensionnaires avec l'histoire du "grand méchant ours". Évidemment, Célestine ne croit pas à ces fadaises... et elle dessine ce qu'elle pense. Comme, en plus, elle ne rapporte que peu de dents d'ours, elle n'est guère utile à sa société souterraine. (A tous les parents qui se plaignent de voir leurs enfants manger trop de sucreries, je recommande vivement d'emmener leur progéniture voir ce film, ne serait-ce que pour la première séquence chez le dentiste !)
On nous présente ensuite Ernest, qui vit seul au fond des bois, dans sa cabane brinquebalante, où s'entassent divers objets et instruments de musique. Il n'a pas de travail et il a faim. Il se rend donc en ville, où nous découvrons une famille de commerçants : le père vend des sucreries, la mère des dents ! Le fils préfèrerait manger des douceurs plutôt que de penser à succéder à ses parents, mais on ne lui laisse pas trop le choix. Le premier commerce devient la proie d'Ernest, guidé par Célestine.
Au-delà de la confrontation de ces deux univers (a priori si différents mais finalement si ressemblants), le film traite d'une rencontre improbable, celle d'une souris et d'un ours qui ont en commun le tempérament artistique et un certain décalage vis-à-vis du monde dans lequel ils vivent. Ces individus à la marge vont faire l'objet de poursuites acharnées de la part des forces de l'ordre des deux univers, tout ça à cause du vol de centaines de dents et de l'introduction de l'ours dans le monde des souris.
C'est drôle, sans doute un peu compliqué pour les tout petits, avec des clins d’œil pour les adultes. Le tracé des personnages est vraiment original. L'animation des souris est gracieuse, subtile, sans que cela se voie. C'est à la fois joli et expressif, le tout sur une musique légère. Pour les ours, il m'a semblé néanmoins percevoir l'influence des mangas japonais. Le mélange des genres est réussi et l'on passe un bon moment, avec une histoire pas idiote sur le fond.
P.S.
Le site internet dédié est sympa.
20:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
samedi, 29 décembre 2012
Touristes
Ben Wheatley est un réalisateur qui explore le "côté obscur" de l'âme humaine. De lui, on a déjà pu voir cette année l'étonnant Kill List, à la limite du polar social et du thriller. Avec Touristes, on passe à l'humour noir, sarcastique, dérangeant, dans un style qui n'est pas sans rappeler l'excellent God Bless America, même si ce dernier film a une portée morale plus grande.
Les deux héros, qui forment rapidement un couple, sont deux "petits blancs", à la marge de la société de consommation. Lui, plutôt charismatique, n'est pas très beau. Elle est d'un physique quelconque... et surtout elle est d'une assez grande immaturité affective. Cet improbable duo devient une redoutable équipe de tueurs en série... un peu par hasard, lors d'un périple touristique dans le nord de l'Angleterre.
C'est là que l'on voit que le réalisateur nous a tendu un piège. Leur première victime (un enculé de première... si, si, je vous assure) nous est volontairement, caricaturalement, présentée comme antipathique. On est censé croire que son décès résulte d'un malencontreux accident, mais on a tout fait pour que les spectateurs accueillent sa mort avec joie.
Cela se complique avec les victimes suivantes, dont le meurtre est à chaque fois prémédité par l'un des membres du duo. Ils ne sont pas franchement odieux, ont visiblement tous fait des études supérieures (l'un d'entre eux reconnaît même être passé par une école privée), ne veulent faire de mal à personne... Certains sont écolos sur les bords. Bref, ce sont des bobos ! Malaise dans la salle de l'Utopia de Toulouse (où j'ai vu le film) : une bonne partie du public pourrait se retrouver à la place des trucidés !
Plus qu'une revanche morale, ces meurtres (sanglants... et montrés comme tels... super !) sont une revanche sociale. Les assassins sont des ratés : lui est au chômage et ne parvient pas à écrire son livre ; elle, à plus de 30 ans, vit encore chez sa mère. Leurs victimes sont bien insérées dans la société, elles sont du "bon côté" : elles ont une plus belle caravane, pratiquent la randonnée, le vélo ou le jogging, ont des "valeurs"... Le réalisateur met en scène la révolte de petits bourgeois en voie de prolétarisation contre la moyenne bourgeoisie.
Le film est aussi intéressant sur le plan psychologique : on voit évoluer la relation trouble (et intense !) qui lie les meurtriers. Au départ, il est clair que Tina tombe sous la coupe de Chris (qui tue les deux premières fois). Le rapport de domination semble s'inverser au fur et à mesure que la jeune femme coupe les ponts avec la "civilisation".
On peut néanmoins se contenter de voir ce film comme une bonne comédie sardonique. Il n'en reste pas moins très troublant sur le fond.
22:49 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
vendredi, 28 décembre 2012
Violeta
Ce biopic atypique est consacré à une chanteuse célèbre en Amérique latine, Violeta Parra, qui s'est illustrée dans le Chili d'avant Augusto Pinochet. Le film fonctionne par alternance de moments puisés dans l'enfance et l'âge adulte de l'artiste. C'est une sorte de puzzle, ou de kaléidoscope.
On découvre l'enfance de cette métis (à moitié mapuche), fascinée par ce père à la fois instituteur et musicien (et même comique), qui lui a transmis le goût du chant accompagné à la guitare... et une indéniable tendance à l'autodestruction. On se rend compte de la misère dans laquelle était plongé le peuple des campagnes chiliennes autour de la Seconde guerre mondiale.
On suit la jeune femme dans ses débuts, d'abord avec une petite troupe. Elle fait passer sa vie de famille après ses aspirations artistiques. On la voit donner une représentation en Pologne puis s'installer à Paris, proposer ses toiles au Louvre (véridique). On prend conscience de ses engagements politiques. On peut la qualifier de "compagnon de route" du Parti communiste. (Voilà qui explique l'engouement ressenti par les intellos de gauche pour ce film...)
De retour au Chili, elle se lance dans l'incroyable entreprise de collecte du patrimoine chanté populaire des campagnes, auquel elle tente de redonner vie. On la suit dans certaines de ses pérégrinations... La dame n'avait visiblement pas froid aux yeux !
Ses amours ont été passionnelles et finalement malheureuses. Elle les retranscrit dans ses chansons, qui ont parfois aussi un aspect social. La force du film réside en grande partie dans la qualité du jeu de Francisca Gavilan, qui, à l'image de Cécile de France dans Soeur Sourire, interprète les chansons de l'artiste qu'elle incarne, dont Gracias a la vida, qui sert de générique de fin.
La caméra filme la fille comme la femme de très près, pointant la saleté, les imperfections du visage comme le feu qui anime son regard et la beauté de son sourire. Je reprocherais toutefois au film sa longueur : 1h50, surtout qu'une demi-heure avant la fin, on sent très nettement quel tour prend la vie de l'artiste. Cela devient inutilement languissant.
P.S.
RFI a consacré une émission au film, l'invité étant le fils aîné de Violeta, Angel.
00:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
mercredi, 26 décembre 2012
Les Hauts de Hurlevent
C'est une nouvelle adaptation du roman d'Emily Brontë. Dans mon esprit, le titre faisait allusion à une chanson de Kate Bush et à un film, ancien (très noir), avec Laurence Olivier, que ma mère avait adoré.
La première heure nous plonge dans cette lande brumeuse du nord de l'Angleterre, très peu peuplée, où les prés sont séparés par de petits murs de pierre, où souffle un vent à écorner les bœufs (même si, là-bas, on voit surtout des moutons et des chevaux)... un Aveyronnais peut y retrouver un peu d'Aubrac (en plus humide et moins enneigé). On y est attentif aux plantes, aux animaux ; on n'est pas rebuté par la boue.
La réalisatrice, Andrea Arnold, économise les dialogues. Elle veut nous faire sentir le paysage et les sentiments qui traversent les protagonistes. C'est à mon avis parfaitement réussi : qu'y a-t-il de plus sensuel qu'un bas dévoilé par inadvertance, une épaule dénudée ou une mèche de cheveux échappée d'une coiffure (trop) ordonnée ? La caméra est près des corps : on voit bien les cicatrices du jeune homme, on suit la main de Catherine s'enfoncer dans ses cheveux crépus.
Cette première heure est épatante parce qu'elle nous fait comprendre les frustrations et les aspirations des différents personnages : celles du jeune Africain Heathcliff (ramené à la ferme par le père à la fois autoritaire et chrétien convaincu), celles de Hindley, le fils limite abruti et celles de Catherine, la jeune fille au départ hostile, puis intriguée par l'étrange individu, un peu initiatrice, enfin amoureuse.
Le film est tourné de manière objective, mais, de temps à autre, la vision qui nous est donnée subit l'influence de l'un des personnages, principalement Heathcliff et Catherine.
La deuxième heure voit le retour d'Heathcliff, enrichi, et la décadence de la ferme familiale, reprise par Hindley, de plus en plus dépendant de son ancien souffre-douleur. Catherine en a épousé un autre, ce dont Heathcliff ne se remet pas. Le film ne suit pas exactement le roman et ne met pas en scène une implacable vengeance. On a plutôt l'impression que la fatalité est à l'œuvre. L'histoire s'arrête de plus au niveau de la première génération, alors que l'œuvre de Brontë poursuit avec les enfants (la fille de Catherine et son mari, le fils qu'Heathcliff va avoir avec la sœur de l'époux de Catherine... et le fils de Hindley, que l'on voit dans ce film).
L'interprétation est de qualité. J'ai préféré les acteurs incarnant les amoureux jeunes (Solomon Glave et surtout Shannon Beer, plus convaincante de Kaya Scodelario, qui joue la Catherine adulte). Mais James Howson est aussi très bien. Parmi les seconds rôles, j'ai particulièrement apprécié les employés de la ferme et le père.
Un film fort, sur la naissance d'un amour et la noirceur de la vie.
19:07 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 23 décembre 2012
Héritage
Ce film israélien, mêlant comédiens parlant arabe, hébreu et/ou anglais, est l'œuvre de Hiam Abbas (présente dans la distribution), une comédienne remarquée dans de multiples rôles, dans des films comme La Fiancée syrienne, Paradise now ou encore Amerrika.
L'histoire se noue autour d'un mariage, celui de la fille d'un entrepreneur palestinien au bord de la faillite, en Galilée. Au sens strict, les protagonistes sont donc plutôt des Arabes israéliens, même si l'on sent que l'histoire pourrait s'appliquer plutôt à des Palestiniens de Cisjordanie occupée.
L'entrepreneur est lui-même le fils d'un notable local, très malade. L'un des frères a des ambitions politiques (à concilier avec l'occupant israélien...), un autre, marié à une chrétienne, n'est toujours pas père et l'une des sœurs, la petite dernière, a décidé de mener se vie de femme à sa guise.
On voit que la réalisatrice a eu l'habileté d'entremêler la politique avec des considérations économiques et la dénonciation du patriarcat. Et pourtant... aucune des nombreuses (et ravissantes) femmes que l'on voit à l'écran n'est voilée. Nous sommes dans la bourgeoisie proche du Fatah. Ce n'est donc pas un portrait fidèle de la société palestinienne que l'on nous propose, mais une tranche de vie des catégories aisées, elles aussi confrontées à des choix douloureux.
Le contexte de la domination israélienne n'est que sous-jacent. On voit (et entend) régulièrement les avions de Tsahal parcourir le ciel. On voit parfois le résultat de bombardements. Les personnages tentent de vivre malgré tout. Au quotidien, ils sont amenés à croiser des Israéliens. S'ils veulent faire de la politique, ils vont être mis sous surveillance par la police.
Mais le cœur de l'histoire est constitué de ces vies de femmes. Il n'y a pas de matriarche, l'épouse du chef de famille étant décédée, sans doute en mettant au monde la petite dernière. Du coup, ce sont les deux grandes sœurs qui incarnent les figures dominantes. Bien que modernes d'apparence et traitées d'égal à égal par leurs époux, elles poussent au maintien des traditions. Le film tente d'explorer ce paradoxe. Une seule des jeunes femmes adhère à ce schéma, la future mariée. Sa sœur est plus coquine, plus libertaire... un peu comme sa (jeune) tante, qui suit des études et s'est entichée d'un Anglais.
C'est (très) bien joué, correctement filmé. Il ne faut pas s'attendre toutefois à un grand film à thèse sur le conflit proche-oriental. Mais cette fiction mérite le détour.
23:49 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
samedi, 22 décembre 2012
Le Voyage de Monsieur Crulic
Ce voyage est (entre autres) celui réalisé par le corps du héros, ramené dans son pays d'origine (la Roumanie) par deux membres de sa famille. Dès le début, donc, on sait que cela finit mal. C'est une histoire (malheureusement) vraie, celle d'une erreur judiciaire. Mais elle est racontée sous forme animée, l'auteure (Anca Damian) mêlant les styles.
Ce Roumain n'a pas eu la vie facile. Il a arrêté tôt l'école, n'a pratiquement pas connu sa mère (à cause de la séparation précoce de ses parents) et a perdu son seul enfant à la naissance de celui-ci. Comme beaucoup de Roumains arrivés à l'âge adulte dans les années 1990-2000, il a tenté sa chance à l'étranger. Une partie de sa famille a migré en Italie, lui s'est tourné vers la Pologne. C'est là qu'il va être accusé à tort, deux fois. Désespérant de faire valoir ses droits, il se lance dans une grève de la faim. J'ai retrouvé un peu de l'ambiance de l'excellent Présumé coupable. (Certains ont vu une parenté avec Hunger.)
Ce film est aussi l'occasion de tracer un portrait sans complaisance de deux anciennes "démocraties populaires", à l'heure post-communiste. C'est particulièrement accablant pour les services publics : police, justice, hôpitaux, ambassade...
Ah, oui, j'oubliais : l'histoire nous est contée à deux voix. La plupart du temps, on entend celle du narrateur, le héros (du moins l'acteur qui l'incarne). Le ton est rocailleux (à la slave), mélancolique. C'est de manière presque neutre que sont racontés des drames. L'autre voix est féminine ; elle donne un peu de perspective à l'histoire de Crulic.
De prime abord, l'animation peut paraître rudimentaire, voire bâclée : cela ressemble à de la gouache. Mais l'auteure a mélangé les styles et les plans. Elle a inséré des photographies (surtout dans la première partie) et des effets numériques élaborés (comme cette soeur qui pleure, résumée à un oeil sur jupe qui finit par disparaître, sous l'effet de la douleur).
La dernière séquence est un montage d'extraits de journaux télévisés traitant de l'affaire. On replonge dans le réel mais, finalement, c'est la fiction animée qui m'a paru la plus cruelle.
23:18 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
vendredi, 21 décembre 2012
Le Hobbit : un voyage inattendu
On prend (presque) les mêmes et l'on recommence ! Peter Jackson remet le couvert pour ce qui semble être le premier épisode d'une nouvelle trilogie, dont l'action est antérieure à celle du Seigneur des anneaux. On retrouve donc Bilbon, Frodon (brièvement), Gandalf et certains elfes. Les véritables héros sont une troupe de nains (plus grands que les hobbits mais plus petits que les humains et les elfes) : je vous garantis qu'on a soigné les trognes !
Mais 2h45, c'est long... d'autant plus que l'histoire peine à démarrer. (Il paraît qu'il existe une version longue d'environ 3h30...) C'est qu'il faut concilier plusieurs types de public : les fans des romans, qui connaissent déjà l'histoire, ceux qui, comme moi, n'ont pas lu les livres mais apprécié la première trilogie et le nouveau public, qui n'a peut-être même pas vu ces films à la télévision ou en DVD.
Cela commence sur le registre comique. L'interprète de Bilbon jeune, Martin Freeman (remarqué dans le rôle du docteur Watson dans la mini-série Sherlock), adopte avec une aisance déconcertante la posture de la victime consentante, bonne pâte qui se fait manger la laine sur le dos... la laine, et le reste, puisqu'il doit accueillir une belle bande de pique-assiettes ! Merci, Gandalf ! Dit comme cela, cela donne l'impression que la séquence est hilarante, mais, franchement, c'est très convenu.
L'intrigue suit le même schéma que celle de la précédente trilogie. Ce premier volet pourrait être appelé "La Communauté des nains". La petite troupe se constitue, se chamaille, se bagarre et marche dans la campagne néo-zélandaise, à l'image de ce que l'on a vu naguère.
Visuellement, c'est réussi, mais je ne vois pas ce que la 3D apporte. De plus, par moments, l'image m'est apparue surchargée d'éléments. On ne distingue pas tout nettement, d'autant plus que les scènes d'action sont menées tambour-battant. On est à la limite du jeu vidéo (ce n'est pas un compliment).
Sur le fond, on sent que Tolkien avait puisé dans l'Ancien Testament. Ce peuple autrefois puissant, avide de richesses, qui a été vaincu et qui est désormais condamné à l'errance n'est pas sans rappeler les Hébreux. (Les références sont plus nauséabondes dans la trilogie déjà adaptée au cinéma.)
L'histoire est malgré tout prenante. J'ai aimé la présentation de la puissance puis du déclin du royaume des nains. J'ai surtout apprécié de retrouver Gollum, que Bilbon rencontre et auquel il va dérober son "précieux". Les scènes confrontant les deux hommes font partie des meilleures du film. Petit plaisir perso : l'introduction (parcimonieuse, hélas) de Cate Blanchett, sur laquelle le temps ne semble pas avoir de prise.
22:53 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 20 décembre 2012
L'Odyssée de Pi
Ce nouvel Ulysse est un adolescent indien, dont le prénom a été choisi en référence à la piscine Molitor, à Paris. La première demi-heure est longuette, pas super bien jouée (ni doublée). Elle nous permet néanmoins de découvrir comment le garçon de l'ancien comptoir français de Pondichéry (où l'on enseigne encore la langue de Molière) a réussi à faire triompher le diminutif mathématique (Pi) sur les quolibets du genre "Pisseux".
Marquante est l'une des premières séquences à le mettre en contact avec le tigre. C'est l'occasion pour le père de donner une "leçon de vie" à ses fils. C'est aussi l'occasion pour le spectateur un brin attentif de se rendre compte que la réalisation manque parfois de rigueur : il est évident que le tigre n'a pas pu faire passer entre les barreaux le cadavre de sa proie, qu'il n'a pas encore dépecé.
On retrouve cette négligence dans la séquence du naufrage. Il est vrai que, depuis le Titanic de James Cameron, la barre a été mise haut. Mais on se fout un peu de nous quand on laisse de côté la grande majorité des occupants du navire qui sombre et quand on évite de donner la cause de la catastrophe, quitte à ce que des enquêteurs japonais tentent de la découvrir plus tard. (C'est un procédé scénaristique - le lampshade hanging - récemment décrit dans une petite vidéo bien fichue mise en ligne sur le site du Monde.)
La séquence nous met en contact avec un drôle de cuistot, sorte de beauf raciste incarné avec conviction par Gérard Depardieu. Dans la scène du repas, j'ai eu l'impression qu'il ne s'adressait pas au père du héros, mais à Jean-Marc Ayrault. Et pourtant, le cargo n'était pas en partance pour la Belgique...
Arrive donc le naufrage. Moyen. Parfois invraisemblable, comme ce moment durant lequel le garçon est en suspension sous l'eau, face au navire qui coule, les lumières encore allumées.
A partir du moment où il se retrouve dans le canot, en compagnie du tigre, le film devient presque bon. La relation ambiguë qui se noue entre le félin arrogant (très joli matou numérique) et l'ado maladroit est fouillée, intéressante. (J'ai bien ri quand il a été question de la délimitation du territoire de chacun. Le tigre - ici sans doute une tigresse - lui joue un petit tour façon Zarafa...) Les péripéties s'enchaînent, notamment en raison de la présence d'autres animaux. On sent la volonté de glorifier la nature, à travers ces scènes montrant l'océan, vu du dessus ou par en-dessous, de jour ou de nuit. Cependant, cela sent trop le montage numérique. J'ai pourtant vu le film en 2D, mais c'était parfois vraiment artificiel. Dommage.
Bien que totalement invraisemblable, la séquence sur l'île végétale, peuplée de suricates, m'a beaucoup plu. Elle est formellement magnifique et riche de sens, sur le fond.
Il reste que l'ensemble donne l'impression d'être un collage mal assemblé. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que des producteurs en panne d'inspiration ont voulu réaliser un coup en puisant dans différents films à succès (Seul au monde, Slumdog Millionaire, Madagascar, Deux Frères, entre autres). Le résultat n'est pas très convaincant. Le mélange des civilisations et des mondes est un peu trop appuyé.
Il n'aurait pourtant pas fallu grand chose pour que ce soit un grand film. Une demi-heure avant la fin, le héros adulte, qui raconte l'histoire, reprend son récit et en donne une autre version. Du coup, on se demande si tout ce que l'on a vu depuis le naufrage n'était pas mensonge ou fantasme. Malheureusement, ce filon n'est que trop peu exploité.
23:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 02 décembre 2012
Les Lignes de Wellington
La compagne et collaboratrice de feu Raoul Ruiz (elle a procédé au montage des Mystères de Lisbonne) a repris son dernier projet de film. Cela donne une ambitieuse coproduction franco-portugaise, dont l'intrigue se situe pendant l'invasion du Portugal par les troupes napoléoniennes, déjà présentes à l'époque en Espagne.
Le fil rouge de l'histoire est la migration des civils portugais, qui fuient l'avancée des troupes françaises et les destructions opérées par les armées portugaises et britanniques, qui ont choisi de pratiquer la politique de terre brûlée, pour affaiblir l'envahisseur. L'objectif est de l'attirer au pied de fortifications réputées imprenables, construites dans le plus grand secret, au sud du pays, à l'initiative du général Wellington.
On suit donc ces improbables colonnes de fuyards, mêlant aristocrates, bourgeois et gens du peuple, Portugais et Britanniques. Il y a ce mari épris de culture, qui recherche son épouse disparue. Il y a cette veuve anglaise, à laquelle un sous-officier portugais va s'attacher. Il y a les hommes de troupe (les personnages les mieux campés, à mon avis), qui entrent parfois en relation avec les infirmières (l'une d'entre elles interprétée -avec talent- par Elsa Zylberstein). Il y a cette jeune Anglaise volage. On n'a pas oublié les prostituées, ni les marchands. Certains saynètes sont croquignolesques, mais, globalement, l'accumulation lasse.
Du coup, de temps à autre, on se réjouit de suivre un peu les Français. Hélas ! Ils sont systématiquement présentés sous un jour négatif. Et quand on se retrouve face à un trio d'acteurs bien de chez nous (Isabelle Huppert, Catherine Deneuve et Michel Piccoli), on apprend qu'ils incarnent des Suisses !
Cete séquence est d'ailleurs à l'image du film : riche en promesses, s'appuyant sur une distribution prestigieuse, mal employée, et au final décevante. Le film pêche par la faiblesse de la direction d'acteurs. On a l'impression que la réalisatrice n'a pas osé se montrer trop directive avec ses comédiens... Le "métier" ne fait pas tout ! Et puis il y a ces scènes qui sont jouées comme du vieux théâtre filmé...
Bref, en dépit de la présence de plusieurs moments savoureux, c'est dans l'ensemble assez maladroit et ennuyeux.
11:56 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinema, cinéma, film, histoire
dimanche, 25 novembre 2012
Royal Affair
Le titre aurait pu être traduit par "Liaison royale", mais cela aurait sans doute trop souvent évoqué le film d'Adrian Lyne (avec Michael Douglas et Glenn Close), pour le public francophone. L'intrigue s'inspire de l'histoire, méconnue, du médecin roturier allemand Struensee, qui devint le favori du roi du Danemark Christian VII (au XVIIIe siècle)... et l'amant de la reine Caroline. Le médecin n'était pas qu'un jouisseur : il tenta de moderniser le royaume.
Ce film réussit l'exploit de tout aborder sans jamais paraître pesant. On a donc droit à une belle reconstitution historique, les messieurs bien cintrés dans leurs costumes et les dames à la poitrine impeccablement mise en valeur par leurs robes. On nous fait toucher du doigt les grandes inégalités sociales dont souffre le royaume. On sent le poids du puritanisme protestant.
Les spectateurs français découvriront peut-être l'aura dont jouissaient les philosophes des Lumières jusqu'en Europe du Nord... chez les esprits éclairés. C'est un livre de Jean-Jacques Rousseau qui va enclencher la liaison entre la reine et le médecin... et celui-ci, devenu régent du royaume, recevra une lettre de Voltaire, ravi de la nouvelle politique suivie par le gouvernement.
Mais c'est d'abord une histoire d'amour. La jeune Anglaise, encore adolescente, cultivée, croit que son royal époux sera le prince charmant qu'elle attend depuis toujours. Très dur est le retour sur terre, avec un époux à moitié dingue, jaloux de l'envergure intellectuelle de sa nouvelle jeune femme (qu'il va finir par appeler "maman" !), qui doit se soumettre aux aspects les moins reluisants de l'étiquette royale. Une fois la transmission de la couronne assurée, le souverain va d'ailleurs rapidement retourner dans les bras des prostituées (un monde dont le film trace hélas un portrait quasi enchanteur...).
Le deuxième choc dans la vie de Caroline d'Angleterre est la rencontre de Struensee, qui la fascine de plus en plus. De son côté, le libertin contestataire, auteur de pamphlets contre la monarchie absolue et les privilèges, opposé au mariage, se rend compte qu'un sentiment inconnu est en train de naître en lui.
Les acteurs sont excellents. La jeune Alicia Vikander est à la fois délicieuse et touchante en femme amoureuse et attachée au progrès. Mads Mikkelsen, que j'avais découvert dans Les Bouchers verts, a fait du chemin depuis. Il faut aussi signaler la performance de Mikkel Boe Folsgaard, dans le rôle du roi fantoche. Les autres acteurs sont tout aussi épatants.
On regrettera toutefois que le réalisateur ne se concentre que sur les "élites" (et leur rivalité), le peuple étant montré comme une masse informe, manipulable, dont on sent néanmoins la réprobation à travers le silence qui accueille une exécution.
22:21 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film
samedi, 24 novembre 2012
Beautiful Valley
Ce film israélien (connu aussi sous le titre Le Jardin d'Hanna) fait se percuter deux mondes : celui dans lequel ont grandi des personnes âgées, des pionniers de l'Etat juif, et celui dans lequel la population vit aujourd'hui, furieusement néo-libéral, consumériste et hyperindividualiste.
On l'a peut-être oublié, mais parmi les fondateurs de l'Etat d'Israël, nombre de personnes avaient des convictions marxistes. Les kibboutzim ont été la traduction agricole de l'utopie sioniste de gauche. On en perçoit seulement l'écho dans le restaurant communautaire et les témoignages filmés que visionne l'héroïne, Hanna.
Celle-ci, très âgée (80 ans environ), est veuve. Elle vit seule, même si sa fille habite le même kibboutz, qu'elle dirige d'ailleurs. Bien qu'à la retraite, Hanna ne peut s'empêcher de travailler. Comme on essaie de l'en dissuader, c'est de nuit qu'elle retourne sur l'exploitation agricole. Elle persiste aussi à s'investir dans les oeuvres collectives, qui n'intéressent plus grand monde. Du coup, sa vie tourne en rond ; elle ne fréquente pratiquement plus que d'autres vieillards. Seule une jeune femme, en passe d'effectuer son (rude) service militaire, semble trouver grâce aux yeux d'Hanna. La patriarche lui offre l'expérience, la douceur et le réconfort que la société moderne ne lui apporte pas.
Attention toutefois avant de vous décider à aller voir ce film. Si les paysages sont magnifiques, c'est souvent montré en plan fixe et le rythme est à l'image du déplacement de la majorité des personnages : très lent. Si l'on supporte cela, on appréciera.
21:54 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
vendredi, 23 novembre 2012
Augustine
Même si la (talentueuse) réalisatrice, Alice Winocour, cite plutôt Lynch et Cronenberg comme références, après avoir vu le film, il est évident que son œuvre est apparentée à L'Enfant sauvage (de Truffaut) et à Vénus noire (de Kechiche).
Tirée de faits réels, l'histoire met en scène une lutte des classes (des femmes pauvres exploitées par la grande bourgeoisie française de la fin du XIXe siècle) et une lutte des sexes (des femmes malades traitées comme des objets par des médecins hommes).
Il faut voir comment, dans la première partie du film, la servante est considérée par les participants au repas : c'est un être qu'on ne regarde (quasiment) pas, tant qu'il exerce ses fonctions. On est bien obligé de le regarder, de le considérer quand la crise d'hystérie se déclenche... mais l'on sent que les convives ont l'impression de se trouver au zoo.
Les médecins de La Salpétrière sont un peu plus respectueux, mais Augustine est d'abord un sujet d'étude parmi tant d'autres. Dans le rôle titre, Stéphanie Sokolinski (alias Soko) est formidable. Les autres femmes (certaines de réelles malades de notre époque) sont aussi très bien campées. Face à elles se trouvent deux principaux médecins, incarnés avec talent par Olivier Rabourdin et Vincent Lindon (pourtant pas le premier choix pour le rôle de Jean-Martin Charcot).
C'est ce dernier qui remarque Augustine. Se noue alors une drôle de relation, marquée par l'ambiguïté. Augustine considère Charcot comme son sauveur et transfère sur lui son énergie sexuelle inemployée. Charcot se montre plus humain que d'autres, mais reste globalement distant. Il veut se servir de cette patiente peu ordinaire pour faire progresser ses recherches... et sa carrière. Petit à petit, il se rend compte que les choses sont plus compliquées que prévu.
Le film restitue les arcanes du monde médical et rend palpable la tension sexuelle refoulée. Soko est impressionnante lors des scènes de crise. La réalisatrice a su choisir les moments où le gros plan s'imposait (dans l'examen du corps) et ceux où il fallait élargir le regard. Certains mouvements de caméra (comme au début, lors de l'entrée d'Augustine en cuisine, peu avant la première crise) témoignent d'une habileté déjà grande. Voilà une réalisatrice à suivre.
19:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 22 novembre 2012
Stars 80
J'ai longtemps hésité avant d'aller voir ce film. Je m'étais dit que cela devait être une nouvelle comédie lourdingue à la française, jouant outrageusement sur le voyeurisme ("Regarde comme ils ont vieilli !" ou "Elle a raté son lifting, celle-là !"). Ou bien, cela risquait de se limiter à une suite de reprises de vieux tubes...
... Eh bien j'avais tort !
C'est d'abord un vrai film, qui commence par une séquence très réussie, en prison, avec un générique plutôt malin. On se demande vraiment ce que viennent faire ces deux gueules cassées là-dedans. Ces deux quinquas blancs, mal rasés, grands cernes sous les yeux, sont accueillis par un gardien Black (joli retournement de cliché). On finit par s'apercevoir qu'ils sont là pour une tout autre raison... et on finit par comprendre qu'ils n'auraient même jamais dû venir !
Le duo Anconina-Timsit fonctionne très bien. Le premier en fait peut-être un peu trop. Il est à l'image des chanteurs qu'il tente de faire remonter sur scène : c'est une sorte de has been, un ancien jeune, qui a connu son heure de gloire, mais dont le talent a brûlé comme une chandelle.
La séquence chez le producteur, qui les éconduit ironiquement, est aussi un petit bijou. Vient donc le moment de constituer l'équipe qui va tourner dans toute la France. Il faut retrouver les anciennes vedettes. Certaines ont totalement disparu de la circulation. D'autres vivotent, sans plus. Quelques-unes ont gardé un peu de leur aura passée... mais rien qu'un peu. Ces chanteurs font souvent preuve d'auto-dérision. J'ai adoré la séquence "mafieuse", dans le club de Jean-Luc Lahaye (en excellente forme physique, pour le plus grand bonheur de ces dames).
Le tournant du film est le repas qui suit le premier concert, raté. Loin du strass et des paillettes, la chanson populaire française revit autour d'une table où des amitiés se nouent. C'est touchant et on prend plaisir à réentendre certains refrains.
La suite est une sorte de success story. Dans le groupe de départ, on trouve Jean-Pierre Mader, qui assure, avec simplicité, le groupe Images et les Début de Soirée, que le duo de producteurs est allé chercher au fin fond d'un sordide kébab. Mais voilà que les deux producteurs se fâchent, alors que le triomphe est à portée de mains.
Pendant ce temps-là, les artistes redécouvrent la grande vie. Le public afflue. Les salles sont plus grandes, les hôtels plus luxueux... et les cachets plus élevés. Une nuit, la libido de ces quinquas et sexagénaires se réveille. Et voilà le chanteur de Cookie Dingler qui nous la joue Kim Basinger (dans 9 semaines et demi)... un moment d'anthologie. Dans le même temps, Peter et Sloane, que la vie avait séparés, se rabibochent. Jean-Luc Lahaye, qui a fini par rejoindre le groupe, s'adonne à de drôles de jeux avec ses groupies... Mais la question qui taraude les insomniaques pas occupés à copuler est la suivante : qui peut faire jouir aussi bruyamment la pulpeuse Sabrina (toujours aussi bien gaulée, mamma miaaa !) ?
L'apothéose se produit au Stade de France, avec le retour de Jeanne Mas, aussi fragile qu'auparavant... et d'un Gilbert Montagné débarqué des États-Unis, où Anconina et Timsit l'avaient retrouvé des mois auparavant, pianiste expressif dans un temple protestant, dans une séquence digne des Blues Brothers !
Bref, c'est drôle, entraînant et fort agréable à suivre, en dépit d'effets un peu trop appuyés.
23:56 Publié dans Cinéma, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
mercredi, 21 novembre 2012
Looper
Ce polar de science-fiction louche sur Terminator et surtout L'Armée des douze singes (et donc aussi La Jetée, de Chris Marker). Le scénario en est clairement inspiré (parfois un peu trop). Bruce Willis fait le lien au niveau de la distribution et certaines scènes contiennent comme des clins d'oeil.
Dans un futur proche, aux Etats-Unis (évidemment !), de jeunes tueurs à gages liquident les types qu'on leur envoie d'un futur encore plus éloigné (dans lequel il n'est plus possible de se débarrasser discrètement des gêneurs). Ils se paient en récupérant les lingots d'argent fixés au dos des victimes. Ils savent que leur contrat est terminé quand ils découvrent un max de lingots en or au dos de la dernière victime, leur alter ego du futur. Voilà qui boucle la boucle (loop). Ils peuvent profiter de la vie pendant 30 ans, sachant qu'on viendra un jour les chercher pour éliminer toute trace des exécutions.
Comme Joe, le héros (du futur lointain), est incarné par Bruce Willis, on se dit qu'il ne risque pas de se faire zigouiller dans le premier quart d'heure... et l'on a raison ! Mais cela perturbe toute l'organisation, celle de 2044 et celle de 2074. L'espace-temps se tord, les souvenirs se modifient. On peut s'amuser à réfléchir aux changements qu'implique chaque acte nouveau de l'un des personnages principaux.
On peut aussi se laisser aller à apprécier un bon film d'action, où les tueurs à gages manient le tromblon et les hommes de main du chef de gang des révolvers dotés d'un canon imposant... La réalisation est nerveuse, très au point au niveau des poursuites et des combats. Certaines scènes sont même impressionnantes, comme celle qui voit un échappé du futur subir les conséquences immédiates des tortures infligées à son alter ego plus jeune de 30 ans. D'un point de vue technique, c'est du niveau d'un bon Photoshop... mais c'est puissant cinématographiquement parlant !
Les femmes jouent un rôle secondaire dans l'histoire... jusqu'à ce que le jeune Joe rencontre cette mère de famille, seule avec son fils (mais s'agit-il de son fils ?) au fin fond de la campagne. Emily Blunt (entrevue dans La Guerre selon Charlie Wilson) est épatante dans ce rôle ambigu de fausse femme forte et mère-courage, qui semble connaître beaucoup de choses pour une paysanne du Kansas... (Elle a un petit quelque chose d'Uma Thurman.) Notons aussi la performance du gamin, Pierce Gagnon, un acteur (en herbe) à suivre.
Le rythme s'accélère à nouveau dans la dernière partie du film... et cela se termine par une boucle dans la boucle, une astuce scénaristique qui a perturbé beaucoup de monde. Si les élucubrations de fans plus ou moins inspirés vous intéressent, vous pouvez vous rendre sur un site spécialisé. (Cela part vraiment dans tous les sens !) De manière plus rationnelle, le réalisateur Rian Johnson a donné quelques clés pour mieux comprendre le film... A ne lire qu'après l'avoir vu !
P.S.
En France, certains critiques ont glosé au sujet d'un détail : dans la version originale, le héros apprend le français, alors que les "vieux" lui recommandent de se mettre au mandarin et de se rendre à Shanghaï, plutôt que dans la "vieille Europe". Dans la version doublée en français, le jeune Joe apprend... l'italien et envisage de se rendre à Florence (ville dont le nom a l'immense avantage de faire bouger les lèvres d'une manière assez proche de celles qui prononcent "France")...
18:25 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film
lundi, 19 novembre 2012
Une Famille respectable
Un prof entre deux âges, parti jadis faire ses études à l'étranger, revient donner des cours dans une fac iranienne, celle de Chiraz, située assez loin de Téhéran :
On sent qu'il n'est pas un chaud partisan du régime des mollahs... mais il doit prendre des précautions. Son père, qui a jadis répudié sa mère pour se mettre en ménage avec une autre femme, dont il a eu un autre fils, cherche à le voir.
Le héros évolue entre son demi-frère (avec lequel il était fâché), son neveu (si serviable, et dont la mère... est l'ancienne amoureuse du héros !), ses étudiants et sa mère. Celle-ci, recluse mais apaisée, ne veut plus entendre parler du passé, et surtout pas toucher le moindre argent du mari indélicat, même par héritage interposé. Et pourtant... une véritable fortune est en jeu. Du coup, dans ce régime hyper-moralisateur, l'art de la dissimulation est poussé à un haut degré.
Des retours en arrière sont chargés de nous rappeler les contentieux du passé. Mais, comme le pays, les gens ont changé depuis. Le héros ne le comprend pas... et réalise trop tard qu'il est tombé dans un traquenard.
Faites très attention à la séquence du début, tournée en partie en caméra subjective. Elle est située dans le troisième quart de l'histoire. La suite est en fait l'explication des circonstances qui ont abouti à un enlèvement. On savoure la complexité de l'intrigue, digne d'un polar occidental.
La réalisation est sobre. C'est au niveau du montage qu'un gros travail a été fait. On sent qu'il a fallu déployer beaucoup d'habileté pour contourner la censure iranienne. Le spectateur attentif y lira une critique acerbe du régime des mollahs, à travers notamment le cas des jeunes hommes envoyés à une mort certaine lors de la guerre contre l'Irak. On pourrait dire aussi beaucoup de choses de cette gamine ravissante devenue une mère complexée, obsédée par la pureté.
Si vous avez aimé Une Séparation ou encore Les Chats persans (réalisés par d'autres talentueux cinéastes), vous pouvez vous laisser tenter par ce film au titre en forme d'antiphrase.
20:16 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinema, cinéma, film
samedi, 17 novembre 2012
Le Jour des corneilles
C'est un (superbe) dessin animé français, qui puise à la fois dans la tradition du conte à l'européenne et dans l'imaginaire de créateurs comme Hayao Miyazaki. L'animation est le résultat du travail d'une équipe franco-belbo-luxembourgo-canadienne.
L'histoire commence un soir d'orage. Un géant porte un enfant, qu'il se dépêche de cacher dans la forêt. (Cela nous vaut une première scène virtuose, dans un terrier, avec le bébé qui tente de téter une sorte de grosse belette ou de femelle castor.) L'enfant est ensuite récupéré par le géant, qui va l'élever à la dure... lui interdisant de sortir de la forêt, sous peine de disparaître pour toujours.
Mais... le gamin est curieux... et son père va avoir un accident. A partir de là, l'histoire s'emballe.
Le titre n'est peut-être pas très bien choisi : les corneilles n'interviennent que dans la deuxième partie du film. Mais elles vont jouer un rôle dans la relation entre le garçon et Manon, la fille du médecin (à qui Claude Chabrol a prêté sa voix, peu de temps avant de mourir).
Pour moi, ce sont les deux morceaux du film qui se déroulent dans la forêt qui sont les plus réussis. Un grand soin a été apporté au paysage végétal, ainsi qu'aux mouvements des personnages, notamment des animaux. Il y a donc le début, avec la vie autarcique du géant et du garçon. La scène de chasse est brillante. Moins clinquantes, mais magnifiques visuellement, sont les scènes qui voient le garçon dialoguer avec d'étranges personnages, à corps humain tête d'animal. Il rencontre un chat forestier, une biche, un crapaud... Le mystère ne sera expliqué que dans le dernier quart du film.
Le passage par le village est l'occasion de stigmatiser la bêtise d'une partie des habitants. On en apprend un peu plus sur le passé du géant. C'est surtout le lieu de la rencontre entre le garçon et Manon. Tout ce petit monde va se retrouver dans la maison du médecin, l'hôpital n'étant pas adapté au séjour d'un géant récalcitrant !
Le retour dans la forêt va donner la clé de l'énigme aux spectateurs qui n'auraient pas encore deviné. On aboutit à une séquence magnifique, dans un recoin secret, avec ce superbe personnage muet de la femme-biche. Mais l'orage approche. Une dernière transformation va faire rebondir l'histoire...
P.S.
Le site internet mérite vraiment le détour.
11:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, cinema
jeudi, 08 novembre 2012
Skyfall
Il faut attendre un petit moment avant de comprendre ce que désigne le titre : le manoir familial des Bond, censé se trouver en Ecosse (petit clin d'œil à Sean Connery). On en a une prévision dans le générique de début, un bon clip vidéo (sur la chanson d'Adele) qui brasse fantasmes du héros, événements passés et projections dans le futur de l'histoire.
Et c'est parti pour 2h25 d'action et de glamour, avec quelques pincées d'humour. La première séquence, tournée en Turquie (notamment à Istanbul) est un pur moment de bonheur. J'ai trouvé la poursuite en moto encore meilleure que celle mise en scène par Spielberg dans Tintin et le secret de la Licorne. Plus loin dans le film lui répondent les péripéties dans les sous-sols de Londres. Entre les deux, j'ai été marqué par l'assassinat du notable chinois (et les retrouvailles de Bond et du tueur à gages), dans cet immeuble aux parois vitrées. C'est moins spectaculaire que les deux séquences dont je viens de parler, mais on sent qu'il y a eu un gros travail de mise en scène et de gestion des reflets.
Au niveau du casting, c'est tip-top. Daniel Craig est une version moderne de Sean Connery très convaincante. Face à lui, Javier Bardem est épatant en méchant blond à la sexualité interlope... ce qui interroge d'ailleurs celle de son adversaire ! Maiiiiiiiiiiiiiiiiis noooooooooon, James est un hétéro sévèrement burné, inconsolable de la perte de son aimée dans Casino Royale (incarnée il est vrai par la superbe Eva Green).
Que les fans tradis se rassurent : les scénaristes ont mis dans les pattes de James une brochette de dames bien gaulées et pas farouches, de la compagne cachée du héros dans sa retraite asiatique à sa collègue du MI6 (incarnée par Naomie Harris, la nouvelle Halle Berry ?) en passant par la sulfureuse Frenchie Bérénice Marlohe, qui, lors de la séquence se déroulant dans un casino de Macao, porte une robe de chez robe :
Côté gonzesses, Judi Dench ("M") est aussi épatante, même si elle a plus de rides.
Les autres personnages masculins sont un peu étouffés par le duo Craig-Bardem. Signalons toutefois l'apparition d'un nouveau "Q", un geek un peu trop sûr de lui (Ben Whishaw) et l'introduction d'un parlementaire (incarné par Ralph Fiennes) destiné à un grand avenir.
L'accumulation des qualités rend le spectateur indulgent pour les quelques défauts. On nous ment quand on nous fait croire que le bateau emporte Bond et sa nouvelle conquête de Macao vers une île chinoise : en réalité, la séquence suivante a été (en partie) tournée au Japon, à proximité de Nagasaki, sur l'île d'Hashima :
De plus, le méchant est un peu trop machiavélique, il a tout prévu et organisé des mois à l'avance. Comme lorsque Bond évite (presque) toutes les balles, on est au bord de la vraisemblance. Mais ne boudons pas notre plaisir et, calé dans un bon fauteuil, dans une grande salle, profitons du spectacle.
14:01 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film