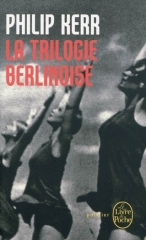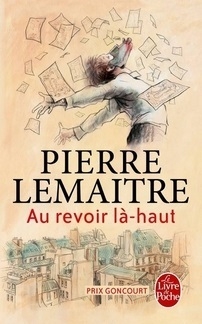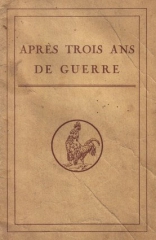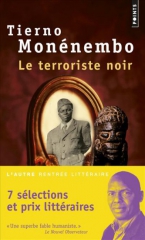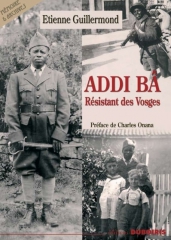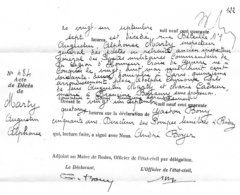dimanche, 08 avril 2018
L'Eté de cristal
Il y a environ deux semaines est décédé Philip Kerr, écrivain britannique connu pour ses polars. Il a situé l'intrigue de certains de ses romans dans le monde du football. Mais ce sont les aventures de Bernhard "Bernie" Gunther, détective dans l'Allemagne nazie, qui lui ont valu la reconnaissance internationale. Il y a quelques années, les premiers romans faisant intervenir ce personnage ont été retraduits et publiés en un volume, en collection de poche :
L'Eté de cristal constitue la première partie du volume. L'action démarre peu de temps avant les Jeux Olympiques de Berlin, en 1936. L'ancien policier, viré parce qu'il n'était pas un nazi militant, est devenu détective privé, mais évite d'enquêter sur les histoires d'adultère, qu'il juge trop dangereuses. Il parvient néanmoins à gagner sa vie avec les affaires de disparition, très nombreuses en Allemagne depuis 1933...
Cette fois-ci, il va être recruté par un riche industriel, dont la fille et le gendre ont été retrouvés morts dans une maison incendiée... avec chacun une balle dans le corps. De surcroît, un collier de diamants et de mystérieux papiers ont disparu.
Voilà Bernie embarqué dans une enquête périlleuse. Il doit veiller à ne pas marcher sur les plates-bandes de la Kripo (police criminelle), tout en se méfiant de la Gestapo : certains de ses membres s'immiscent dans l'affaire, à la demande d'Hermann Goering, qui connaît le riche industriel. S'ajoutent à cela les SS, qui s'inquiètent que l'un des leurs (le gendre) ait pu être assassiné. N'oublions pas non plus les voleurs et les assassins, qui n'ont pas intérêt à être retrouvés.
Il faut donc un peu s'y connaître en histoire allemande (au besoin en révisant ici) pour savourer tout le sel de ce roman. L'auteur s'est visiblement beaucoup documenté et, même s'il prend parfois des libertés avec l'Histoire, le tableau qu'il brosse de la société urbaine allemande sous le IIIe Reich m'a l'air tout à fait fidèle. On y découvre notamment des aspects de la vie quotidienne, parfois méconnus.
J'ajoute que c'est bien écrit (et traduit). L'histoire est racontée du point de vue du détective, un peu cynique, souvent sarcastique. Il n'hésite pas à tourner en ridicule tel personnage important ou tel élément de la propagande. Du point de vue des autorités, même s'il n'est pas nazi, il est relativement fiable car pas suspect de "philocommunisme". Il passe pour un conservateur modéré... mais Bernie finit par reconnaître qu'il lui est arrivé de voter SPD (socialiste) !
Comme l'auteur s'inspire des romanciers américains du milieu du XXe siècle, il fait rencontrer quelques femmes fatales à son héros. Les deux plus marquantes sont l'actrice, seconde épouse du vieil industriel, et la journaliste intrépide, qu'il associe à son enquête, mais dont on finit par perdre la trace...
Pour en savoir plus, il faut lire les aventures suivantes (La Pâle Figure et Un Requiem allemand), qui se déroulent en 1938 et 1947. A l'origine, je pense que le romancier n'avait pas prévu de s'attarder davantage sur son héros. Mais, comme ses livres ont rencontré le succès, il a, par la suite, écrit d'autres romans, dont l'action s'intercale entre ces trois oeuvres, ou les prolonge. En voici la chronologie (incomplète, toute l'oeuvre n'ayant pas encore été publiée en français) :
00:29 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, histoire, livres, roman
mercredi, 28 février 2018
La Juste Route
Ce film en noir et blanc a pour cadre la Hongrie de l'immédiat après-guerre. En 1945, un bourg est en fête : l'épicier local marie enfin son fils, avec une fille de paysans (auparavant entichée d'un gars parti rejoindre la résistance communiste). Au village, tout le monde (ou presque) s'y prépare. Dans le même temps, à la gare ferroviaire voisine, descendent deux rescapés de la Shoah, qui transportent avec eux deux mystérieuses caisses, qui contiendraient des parfums ou des articles d'hygiène.
Très vite, la nouvelle se répand dans le village. L'intrigue se déploie alors sur deux plans : on suit le parcours des juifs (à pieds) et des deux caisses (sur un chariot), de la gare jusqu'au centre du village. On ne sait pas trop où ils vont exactement ni ce qu'ils viennent faire ici... d'autant que les deux hommes (un âgé, l'autre jeune adulte) sont quasiment mutiques.
Au sein de la population du village, trois familles semblent en savoir plus. La venue de ces juifs ne les arrange pas du tout et réveille des souvenirs que l'on voudrait bien voir rester enfouis. C'est un peu comme si un battement d'ailes de papillon était sur le point de provoquer la naissance d'un cyclone dans ce village.
Le plus gratiné est l'épicier, qui est aussi secrétaire de mairie. Dans l'arrière-boutique, il conserve un étrange album de famille. Quant au coffre de la mairie, il renferme quelques documents compromettants. Plusieurs des adultes du village sont prêts à en découdre avec les arrivants, bien que ceux-ci ne formulent a priori aucune revendication ni menace. D'un autre côté, certains habitants ne supportent plus cette ambiance délétère, ni le poids de la culpabilité.
C'est tout l'intérêt de ce film que de montrer les différentes attitudes des habitants et les conséquences de leur choix sur leur vie de tous les jours. Il convient aussi d'éclaircir le mystère de la présence de ces voyageurs, qui ne sont pas du village, mais sont peut-être apparentés à certains des habitants.
C'est un petit film bien ficelé, bien filmé, qui joue beaucoup sur le non-dit. Dans sa conclusion, il est assez ambigu, mais à nous, Français, dont le pays a aussi connu une période d'occupation allemande (et un gouvernement collaborateur), il évoque bien des choses.
22:07 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 24 février 2018
Pentagon Papers
Le titre "français" du dernier film de Steven Spielberg est une nouvelle illustration du snobisme de certains distributeurs, qui remplacent le titre d'origine (en anglais), non pas par un équivalent en français, mais par... un autre titre anglais ! (On a récemment vu le même procédé à l'œuvre pour The Passenger et 24H Limit.)
The Post (dans la version originale, dont nous avons d'ailleurs pu bénéficier au CGR de Rodez... un mois après la sortie du film) raconte comment un rapport secret, faisant le bilan de la politique américaine au Vietnam, a fini par être publié, au début des années 1970, d'abord par le The New York Times (pas très content de la manière dont cette histoire est contée par Spielberg), puis par The Washington Post.
Ce film est donc une ode à la liberté de la presse (démocrate), une dénonciation de l'unilatéralisme du pouvoir présidentiel (incarné ici par Richard Nixon, dont les coups de fil du soir sont sans doute une allusion aux tweets nocturnes de son lointain épigone) et l'histoire de l'affirmation professionnelle d'une femme, Katharine Graham (magistralement interprétée par Meryl Streep).
C'est tourné comme un film d'espionnage, avec ses rendez-vous secrets, ses documents ultra-confidentiels, ses coups fourrés et ses (petites et grandes) trahisons. Fidèle à son style, Spielberg a aussi voulu rendre hommage et faire œuvre d'historien. Certaines scènes ont donc un but strictement documentaire, comme celles qui montrent la machinerie d'une entreprise de presse, de la conception à l'impression et la distribution des journaux.
Les comédiens ont dû se fondre dans leur rôle, d'autant plus que nombre d'acteurs de l'époque sont encore vivants, ou du moins très présents dans les mémoires, outre-Atlantique. Voilà donc Meryl Streep et Tom Hanks (excellent en rédac' chef roublard) dotés de coiffures aussi originales que démodées :
Deux personnages se trouvent au centre de l'intrigue. Il y a tout d'abord le (premier) lanceur d'alerte, Daniel Ellsberg, qui va être la source primaire du Times puis du Post. A travers lui, Spielberg veut rendre hommage à ses lointains successeurs, comme Bradley Manning et Edward Snowden (qui, lui, a déjà eu les honneurs d'un documentaire et d'une fiction signée Oliver Stone)... persécutés sous une administration démocrate (celle d'Obama).
Il y a surtout cette "Kay" Graham, l'héritière du Washington Post, qui a dû succéder en catastrophe à son mari infidèle (et suicidaire). C'était il y a plus de quarante ans. A l'époque, la presse était dirigée et rédigée par des hommes, qui ne concevaient pas qu'un esprit en jupon puisse rivaliser avec eux. De surcroît, bien que connaissant parfaitement ce milieu, Kay Graham passait au départ pour une simple rentière. La mise en scène de Spielberg (bien aidée par l'interprétation de M. Streep) se charge de nous faire comprendre quelle était la pression qui pesait sur les épaules de cette femme. Au début, elle tâtonne, intimidée malgré sa connaissance des dossiers. Le film montre sa progressive montée en puissance, jusqu'à cette très belle scène, un soir de réception, dans un salon où, face à une troupe de vieux mecs en costume, Kay va tenir bon. C'est le grand talent de Spielberg que d'avoir réussi à créer quelques-uns de ces moments jubilatoires qui font passionnément aimer le cinéma.
21:46 Publié dans Cinéma, Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, presse, médias, journalisme, histoire
mardi, 13 février 2018
La Douleur
Je me suis décidé à aller voir l'adaptation du livre autobiographique de Marguerite Duras, appelée ici Marguerite Antelme, puisqu'elle est l'épouse du résistant Robert Antelme, que la Gestapo parisienne (française...) vient d'arrêter. Quand j'étais plus jeune, c'est de l'époux dont j'avais entendu parler : son témoignage (L'Espèce humaine) est considéré un peu comme l'équivalent de Si c'était un homme (de Primo Levi), pour les camps de concentration. Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé qu'il avait été marié à la célèbre (et atypique) écrivaine.
La première partie est très prenante. Elle prend la forme d'un jeu du chat et de la souris entre la frêle et tenace Marguerite (Mélanie Thierry, éblouissante) et l'inquiétant Pierre Rabier (Benoît Magimel, très bon), un gestapiste qui se pique de littérature. (Derrière ce personnage se cache quelqu'un de bien réel, Charles Delval.) Le trouble de l'héroïne est restitué par la mise en scène, qui joue sur la netteté des images et les reflets. Un bon point pour le réalisateur Emmanuel Finkiel (auteur, entre autres, de Voyages et de Je ne suis pas un salaud). A un moment, j'ai même cru reconnaître le visage de Duras âgée dans le reflet d'un reflet de Mélanie Thierry.
Hélas, la seconde partie (qui dure quand même plus d'une heure...) plombe le film. Rabier a disparu, laissant Marguerite face à ses doutes et à son angoisse. Celle-ci prend la forme de pesants monologues, en voix off. Dans ce magma de lourdeur pédante, je distingue toutefois une étincelle (outre la prestation de M. Thierry) : Shulamit Adar, qui incarne Mme Katz, une mère juive persuadée de bientôt retrouver sa fille, qui a été déportée en Europe de l'Est...
Par dessus le marché, c'est le moment où le personnage de Dionys (interprété par Benjamin Biolay, dont le visage semble ne pouvoir prendre qu'une seule expression) devient très présent... trop présent. Du coup, quand on n'a pas succombé à l'envie de piquer un somme, on attend la fin avec impatience.
Dommage.
19:14 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 02 février 2018
L'Echange des princesses
Par un curieux détour du destin, ce film, adapté d'un roman français, coproduit par France 3, réalisé par un Français, dans lequel ont tourné nombre d'acteurs français et où (conformément à la réalité historique) on parle français, même à la cour d'Espagne, est nommé aux César 2018 dans la catégorie... "meilleur film étranger".
Il est réalisé de manière très classique, à tel point qu'on peut dire à son sujet qu'il s'agit d'une nouvelle illustration de la "qualité française". Certains trouvent cela ennuyeux. Moi, j'ai aimé cette mise en scène académique, parfois quasi picturale, à l'image du plan du début, décalque d'un tableau filmé en zoom arrière.
Je suis aussi "client" des films en costumes, avec ces robes invraisemblables et ces tuniques amidonnées et boutonnées. J'en profite pour rendre hommage au travail des bruiteurs, qui ont parfaitement restitué les frottements des tissus, très agréables aux oreilles.
Mais cette histoire de mariages (arrangés) croisés entre les familles royales de France et d'Espagne vaut surtout pour le jeu des acteurs... et des actrices. On a parlé d'Olivier Gourmet (qui incarne le Régent) et de Lambert Wilson (qui interprète un Philippe V tonitruant). On n'a pas assez souligné la performance d'une brochette de comédiennes épatantes.
A tout seigneur tout honneur. Voici donc Andréa Ferréol, qui incarne la princesse Palatine, la belle-sœur de feu Louis XIV, dont la verve est redoutée à la Cour, mais qui va s'attacher à la toute jeune princesse espagnole que l'on destine à Louis XV encore mineur.
C'est une autre figure tutélaire, de plus modeste extraction, que l'on voit assez souvent dans le film, Mme de Ventadour, gouvernante du futur roi de France puis de sa promise d'outre-Pyrénées. Dans le rôle, Catherine Mouchet (inoubliable jadis dans Thérèse) est impeccable de rigueur et de tendresse contenue.
De son côté, la piquante Ananamaria Vartolomei incarne la fille rebelle du duc d'Orléans, promise au très falot prince des Asturies. Sa beauté a visiblement conquis celui-ci à distance, puisque l'on suggère qu'il a rapidement pris l'habitude de se pogner devant le portrait de Louise Elisabeth...
Mais la véritable révélation de ce film est une adorable poussinette, j'ai nommé Juliane Lepoureau, qui a la lourde tâche de rendre vraisemblable le personnage de la gamine espagnole donnée en pâture au futur roi de France. Elle est vraiment adorable, avec un regard où pétille l'intelligence :
Je me suis laissé prendre à cette étonnante intrigue, portée par la qualité de l'interprétation et la beauté de certains plans. L'information historique est ponctuellement mêlée à la fiction, à travers certains détails de la vie quotidienne ainsi que de petites incrustations évoquant le contexte ou le devenir des principaux personnages.
20:24 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 26 janvier 2018
Les Heures sombres
Décidément, ces dernières années, nos amis anglo-saxons ne cessent de se passionner pour les deux dirigeants britanniques qui ont joué un rôle majeur au début des années 1940, à savoir Winston Churchill et George VI. Celui-ci tint le premier rôle dans Le Discours d'un roi, quand celui-là fut à l'affiche de Churchill. Même si Gary Oldman et Ben Mendelsohn ne font pas oublier ceux qui les ont précédés, ils "assurent" très correctement.
Le premier problème est l'impression de déjà-vu qui se dégage de nombreuses scènes. Que ce soit le Churchill intime, sa relation avec sa secrétaire ou le bégaiement de George VI, à de nombreuses occasions, ce ne sont pas les images de ce film qui s'imposent à l'esprit, mais celles d'autres oeuvres.
Pourtant, je dois reconnaître qu'il y a des efforts de mise en scène. Du (presque) Premier ministre allumant son cigare dans le noir au ballet des doigts de sa secrétaire répondant aux ébauches de discours du même, on est agréablement surpris, et à plusieurs reprises, par certains effets. J'ai aussi en mémoire le moment où la porte de l'une des salles du bunker souterrain se referme sur Churchill, ne laissant voir que son visage dans la petite lucarne, comme s'il était prisonnier.
Ce film a au moins le mérite d'apprendre au public non spécialiste (et de rappeler à ceux qui l'auraient oublié) que le courant pacifiste (celui de l'apaisement) fut très influent au Royaume-Uni et que même Churchill douta parfois de la marche à suivre. Cependant, c'est mis en en scène de manière excessivement mélodramatique : le personnage de Churchill, presque seul contre tous est plongé dans le doute, à un point où il semble prêt de basculer, avant de repartir à la conquête de l'opinion. De la même manière, on ne comprend pas bien comment le roi a changé d'avis, ni comment Churchill a retourné une partie de la Chambre des Communes.
Cela ressemble trop souvent à une enluminure, avec des longueurs et, paradoxalement, des raccourcis historiques malvenus. (La vision des Français est caricaturale et je laisse les spectateurs de Dunkerque juger de l'évocation de l'opération Dynamo...). C'est de surcroît trop complaisant vis-à-vis de l'élite aristocratique britannique. Et que dire de ces acteurs qui prennent la pose ! La caméra s'attarde trop souvent de manière emphatique. Ah, pour sûr, on a remarqué qu'untel a soudainement levé le sourcil ou que tel autre a fermé les yeux quand il a senti venue sa défaite politique. Quant à la séquence dans le métro, si elle commence de manière tonique, elle s'enlise assez vite dans une sorte de politiquement correct meringué.
Bref, en dépit de quelques qualités perceptibles à l'écran, c'est une déception.
21:53 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 12 janvier 2018
La Promesse de l'aube
C'est l'adaptation de l’œuvre autobiographique de Romain Gary, pseudonyme de Romain Kacew, né dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Vilnius, emmené par sa mère en France dans l'Entre-deux-guerres. Le film balance entre ses deux personnages principaux, la mère occupant le devant de la scène dans la première partie, la seconde étant davantage centrée sur le fils. Mais c'est la relation œdipienne entre les deux qui est au cœur de l'intrigue.
Charlotte Gainsbourg incarne avec talent cette mère juive (qui prie dans une église orthodoxe !), à la fois possessive et ambitieuse pour son fils. L'actrice a acquis une démarche et un accent qui contribuent à renforcer l'authenticité de son personnage, d'autant plus qu'elle s'est révélée crédible lorsqu'elle parle polonais. Aux spectateurs juifs comme aux non-juifs, elle rappellera bien des mamans, parfois excessives dans la manifestation de leur amour.
Le début, en Lituanie polonaise (ou en Pologne lituanienne, c'est selon), est réussi parce qu'il ressuscite une ambiance et une époque aujourd'hui révolues. On perçoit bien les tensions intercommunautaires, tout comme la rage de réussir de Nina (la mère), qui ne recule pas devant l'escroquerie pour s'en sortir. Du côté des enfants, je n'ai pas été très convaincu par celui qui incarne Gary jeune. Par contre, les petits Polonais catholiques sont très bien campés. Du côté des guests, on peut signaler Didier Bourdon (partie 1) et Jean-Pierre Darroussin (partie 2), dans des rôles toutefois un peu stéréotypés.
L'histoire prend de l'ampleur quand le garçon grandit (à Nice, puis à Paris), qu'il commence à s'émanciper (un peu) de sa mère... et à regarder sous les jupes des filles. Son passage par l'armée lui apprend que les préjugés antisémites ne sont pas le privilège des seuls Polonais. La Seconde guerre mondiale constitue évidemment un tournant, le jeune homme devenant enfin un écrivain... mais aussi un héros de l'aviation. Cela nous vaut quelques scènes bien troussées, comme celles qui se déroulent dans le ciel... mais aussi celles qui ont pour cadre l'Afrique.
Même si la mise en scène recourt à quelques facilités c'est un spectacle de qualité, assez prenant.
23:15 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 26 décembre 2017
Qui était Fernand Forestier ?
Ceux qui l'ignoraient ont pu l'apprendre récemment en lisant la presse aveyronnaise, tout d'abord La Dépêche du Midi, avec un article publié il y a une dizaine de jours, article repris presque mot pour mot avant-hier dans Centre Presse :
Originaire du Bassin (plus précisément d'Auzits, ce qui explique la diligence de La Dépêche), il est devenu gendarme. On remarque qu'il a officié en Tunisie avant d'être nommé dans le Lot, à Figeac. Ce n'est d'ailleurs pas très loin de là qu'il a été fusillé le 8 juin 1944 : à Gramat, selon la fiche (hélas entachée d'une faute) disponible sur le site "mémoire des hommes" :
C'est dans La Dépêche que l'on peut trouver la plus grande précision quant aux auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à Fernand Forestier : ce sont des membres de la tristement célèbre division SS "Das Reich", qui, le lendemain, frappait à Tulle, avant de se déchaîner à Oradour-sur-Glane.
Pour les habitants d'Auzits, ce gendarme résistant n'est pas un inconnu, puisque son nom figure sur le monument aux morts de la commune :
Pour la petite histoire, signalons que ledit monument a été conçu par un architecte qui avait pignon sur rue à l'époque : André Boyer. On lui doit aussi les monuments de Bertholène, Buzeins et Recoules-Prévinquières. A Rodez, il est connu pour avoir donné sa physionomie actuelle au Broussy... et pour avoir projeté de transformer la zone du Foirail, entre la place d'Armes et la gare de Paraire.
18:43 Publié dans Histoire, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, actualité, presse, médias, journalisme
samedi, 23 décembre 2017
Le Dalaï-lama bientôt en Chine ?
C'est la question que se pose (entre autres) le correspondant du Monde en Chine, Brice Pedroletti, dans un article paru il y a deux jours. Le guide spirituel des Tibétains aurait manifesté le désir de revenir en Chine... et Pékin ne s'y serait pas montré hostile. Etonnant, non ?
Le Dalaï-lama souhaiterait se rendre sur une montagne sacrée pour les bouddhistes, qu'ils soient tibétains, chinois ou mongols : le Wutaishan. Or, cette montagne se trouve dans la province du Shanxi, dans l'est de la Chine, en dehors donc de la zone de peuplement tibétain (et donc, a fortiori, à l'extérieur de la région autonome du Tibet). Voilà qui pourrait expliquer l'accueil non défavorable des autorités chinoises.
Sur la carte ci-dessus, j'ai placé un losange jaune approximativement à l'emplacement du Wutaishan, dans le Shanxi. Un autre losange se trouve, dans le sud, dans la province du Yunnan, à Kunming, où l'envoyé du Dalaï-lama aurait été autorisé à se rendre. Là encore, c'est en dehors de la région autonome du Tibet et au-delà des limites du Tibet historique revendiqué par certains indépendantistes tibétains.
Une troisième zone est coloriée en jaune : le nord-ouest de la province du Yunnan, où l'envoyé du Dalaï-lama (selon l'article) aurait aussi été autorisé à se rendre. Ici, on est toujours en dehors de la région autonome, mais à l'intérieur du "Tibet historique", dans un de ces fragments que les autorités chinoises ont disjoints du noyau tibétain pour perturber le combat politique de leurs adversaires. C'est incontestablement une faveur faite à l'envoyé du Dalaï-lama, qui est originaire de cette région. (Pour la petite histoire : on y trouve un district qui a été rebaptisé Shangri-la pour attirer les touristes...)
Précisons que, vis-à-vis des touristes étrangers, les organismes du "pays du milieu" (comme celui-ci) continuent à présenter la région autonome comme le seul et unique territoire tibétain :
Pékin surveille comme le lait sur le feu ces régions tibétaines "de l'extérieur", où se sont déclenchés, en 2008, la plupart des mouvements de contestation de la domination chinoise, comme en témoigne une carte publiée naguère dans Courrier International :
2018 sonnera le dixième anniversaire de ces événements. Il est possible que les ouvertures faites au Dalaï-lama soient une manière de désamorcer d'éventuelles velléités de "célébration" des mouvements de protestation. Du côté du guide bouddhiste, le choix du lieu de pèlerinage pourrait être interprété comme une preuve de sa volonté de conciliation.
22:41 Publié dans Chine, Politique, Politique étrangère, Presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, histoire, presse, médias, journalisme
samedi, 16 décembre 2017
Les Gardiennes
Xavier Beauvois (Des Hommes et des Dieux) s'est décidé à adapter, à sa manière, le roman éponyme d'Ernest Pérochon (paru en 1924). Il a le mérite de mettre au premier plan ce que, pendant la Première guerre mondiale, on appelait "l'arrière". Cette histoire est donc celle des femmes qui, dans les campagnes, ont fait "tourner la boutique" pendant que les hommes étaient au front, ne pouvant s'appuyer que sur les vieillards, les enfants et les soldats en permission.
Ces femmes de tout âge (de la gamine en chaussettes à la veuve vêtue de noir) sont incarnées par une pléiade d'actrices talentueuses. On a, avec raison, souligné la performance de Nathalie Baye (formidable). On a un peu moins parlé de la révélation de ce film, Iris Bry, totalement inconnue, mais qui irradie aussi bien dans les scènes d'intérieur que dans les prises de vue extérieures. Cette orpheline, placée chez des patrons successifs, va se révéler une excellente fermière... et elle possède un joli filet de voix !
Je suis par contre moins convaincu par Laura Smet, qui n'a vraiment pas la tête d'une paysanne... non pas qu'elle doive être laide ou grossière, mais on sent trop la citadine. Même si je comprends le choix de la distribution (réunir la mère et la fille dans une histoire familiale), je trouve que cela n'apporte rien au film.
Celui-ci revêt souvent un aspect documentaire. On suit les travaux et les jours, dans cette grosse exploitation où les femmes triment du matin au soir. Ainsi, à l'époque, il faut avoir les bras solides pour tenir la charrue tirée par les boeufs. L'essentiel des travaux se fait à la main, y compris la moisson, le seul outil étant à la faucille (et le fléau, pour le battage). L'intrigue s'étendant sur plusieurs années (de 1915 à 1920), on voit débarquer les premières machines : la moissonneuse-lieuse McCormick (tirée par les boeufs) et un tracteur (rudimentaire) Ford (sous la marque Fordson). Heureusement, à cette époque, dans les campagnes, on se serrait un peu les coudes. Mais le film est assez subtil pour nous faire entrevoir les jalousies.
L'amour va se greffer sur cette histoire pleine de deuils. L'un des hommes de la maison est l'objet de convoitises... tout comme, à partir de la fin de 1917, les jeunes et vigoureux soldats américains venus au secours des Français. Cela donne un tour sensuel à certaines scènes.
Le principal défaut du film est son rythme, très lent. A trop vouloir restituer le mode de vie rural, Beauvois peine parfois à se débarrasser de l'accessoire. Il s'attarde aussi un peu trop sur certains plans. Cela n'enlève rien aux qualités mentionnées plus haut, mais cela creuse un fossé entre ce qui reste un bon film et ce qui aurait pu être un chef-d'oeuvre.
21:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 10 novembre 2017
Dans un recoin de ce monde
Ce film d'animation japonais est l'oeuvre de Sunao Katabushi, qui a auparavant travaillé pour des studios prestigieux. Ici, il adapte le manga éponyme, créé par une dessinatrice née à Hiroshima, Fumiyo Kono. La particularité de cette histoire est que l'héroïne est une jeune femme d'Hiroshima, douée pour le dessin et dont nous allons suivre la vie dans les années 1930-1940.
Au départ, j'ai trouvé le dessin un peu naïf et pas particulièrement brillant. C'était trompeur. Certaines scènes voient le brio de l'auteur éclater, comme quand il montre l'héroïne en train de dessiner. Sous nos yeux, l'animation prend forme, avec une précision déconcertante. Superbes aussi sont les scènes décrivant la manière dont l'observation de la nature inspire la jeune dessinatrice.
L'intrigue nous conduit à suivre l'histoire japonaise à travers le regard de l'adolescente qui devient femme. Elle est bientôt mariée (sans qu'on lui demande trop son avis) au fils d'une famille de Kure, une grande ville proche d'Hiroshima et qui constitue la principale base navale de la mer Intérieure.
La militarisation du Japon et son entrée en guerre (d'abord contre la Chine, puis contre les Etats-Unis) nous sont montrées par les yeux d'une épouse soumise et travailleuse... qui ne renonce pas toutefois à son passe-temps artistique, d'autant plus que l'époux qu'on lui a choisi se révèle un type attentionné. Délicates sont les scènes qui évoquent l'intimité du couple.
Avec le reste de la belle-famille, les relations ne sont pas toujours faciles, d'autant qu'avec la guerre, la population souffre de pénuries grandissantes. La jeune Suzu va faire son apprentissage de femme au foyer, de belle-fille, de belle-soeur et de voisine. Touchante aussi est sa découverte de la grande ville, au cours d'une sortie qui la voit se perdre dans le quartier des prostituées.
C'est donc moins "engagé" que le Gen d'Hiroshima de Keiji Nakazawa. On n'en perçoit pas moins les échos de la politique japonaise (avec l'intrusion de la redoutable Kempetai) et de la guerre, avec notamment les bombardements de la base navale de Kure, la voisine (et industrielle) Hiroshima semblant curieusement préservée.
Vous vous doutez bien que, petit à petit, le film mène les personnages vers le 6 août 1945. L'explosion est filmée de manière indirecte, mais les conséquences elles sont clairement montrées à l'écran. Cela donne certaines des scènes les plus fortes de ce film, qui n'est pas sans rappeler le récent Lumières d'été.
18:51 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 29 octobre 2017
Au revoir là-haut
Quatre ans après la sortie de 9 mois ferme, j'attendais avec impatience la nouvelle œuvre d'Albert Dupontel. L'an dernier, on l'a vu jouer dans Les Premiers, les Derniers, mais, là, il a adapté l'excellent roman de Pierre Lemaitre (disponible en collection de poche).
Faut-il avoir lu le roman avant d'aller voir le film ? Non, d'autant plus que Dupontel a opéré plusieurs modifications dans l'intrigue et qu'il en a changé la fin. Ne pas avoir lu le roman laisse le plaisir total de la découverte... mais l'avoir lu avant permet d'en savourer mieux l'originalité.
La première est ce grand retour en arrière, sur lequel est bâtie l'histoire. Il n'existe pas dans le roman, dont la trame suit une chronologie classique des événements. L'arrestation d'Albert Dupontel/Maillard est elle aussi une invention scénaristique. L'intrigue (bien que simplifiée par rapport au roman) étant foisonnante, l'ajout du commentaire de l'un des personnages principaux est apparue nécessaire pour faciliter la compréhension des péripéties par le grand public.
Comme l'action débute pendant la Première guerre mondiale, Dupontel se savait attendu au tournant à propos des scènes de tranchées. Il ne déçoit pas, même si cet épisode fondateur est considérablement allégé : le romancier avait beaucoup développé la psychologie des personnages, un aspect que Dupontel n'a conservé que pour celui qu'il incarne !
Ceci dit, les autres personnages principaux sont servis par des interprètes haut de gamme, certains correspondant parfaitement à l'image que je me faisais d'eux en lisant le roman. C'est le cas pour Niels Arestrup (Marcel Péricourt, le père du défiguré), Albert Dupontel, Héloïse Balster (la Gavroche à laquelle l'artiste ancien combattant va s'attacher) et surtout Laurent Lafitte (le rôle du lieutenant -puis capitaine- Pradelle semblant avoir été écrit pour lui). Nahuel Perez Biscayart est une révélation pour moi, dans le rôle de la "gueule cassée". On peut signaler aussi les excellentes compositions de Mélanie Thierry, de Michel Vuillermoz, de Philippe Uchan et d'Emilie Dequenne. Comme les dialogues sont très bien écrits (un peu moins truculents que dans le roman, toutefois), cela nous vaut d'excellents moments de comédie et quelques morceaux de bravoure, en matière de confrontation d'acteurs.
Quand j'y réfléchis, dans presque toutes les scènes majeures intervient Laurent Lafitte. Il y a sa manière de persécuter les poilus, sa rivalité avec Péricourt/Arestrup et sa relation ambiguë avec la fille de celui-ci, qui débouche sur une scène magistrale, dans la chambre à coucher, se concluant par un plan filmé de derrière le lit, la caméra saisissant l'expression de Pradelle à travers les barreaux.
C'est dire si la réalisation est soignée. Dupontel n'abuse pas des effets de caméra, mais c'est souvent brillant, les plans étant visiblement construits avec une extrême minutie, notamment au niveau des déplacements des personnages. Ajoutez à cela une photographie vraiment superbe et vous obtenez une œuvre ambitieuse sur le plan graphique.
Sur le fond, Dupontel reprend la petite musique antimilitariste du roman, ainsi que la dénonciation des puissants. Il y ajoute une dose d'anticléricalisme, particulièrement sensible lors du séjour d'Edouard à l'hôpital militaire. Albert doit se jouer des religieuses pour parvenir à soulager son camarade de combat.
Ensemble, les deux hommes vont monter une arnaque "héneaurme", autour de la fabrication (fictive) de monuments aux morts, pendant que le désormais capitaine Pradelle s'enrichit de son côté grâce à un autre type de fraude, lié à la création des cimetières militaires. (Historiquement, la première est fausse, alors que la seconde s'inspire de faits réels.)
Pour faire tenir son film en deux heures, Dupontel a dû pratiquer quelques coupes (la plupart judicieuses... j'aurais néanmoins aimé qu'il en laisse davantage sur l'affrontement Pradelle-Péricourt). Les changements qu'il a opérés dans la dernière partie de l'histoire sont sans doute liés aux messages qu'il veut faire passer. Dupontel est un moraliste, ce qui permet de comprendre ce qui arrive à l'un des "méchants"... et pourquoi l'arrestation d'Albert prend un tour très inattendu, à la toute fin.
C'est incontestablement l'un des meilleurs films de l'année.
23:47 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mardi, 24 octobre 2017
Les Oubliés
J'avais raté ce film à sa sortie. Il n'était resté qu'une semaine au programme à Rodez, en version française, à des horaires peu compatibles avec mon emploi du temps. Actuellement, il continue à tourner dans quelques cinémas et il est sorti en DVD.
Il raconte l'histoire vraie de soldats allemands (ici des adolescents mobilisés à la fin de la Seconde guerre mondiale), faits prisonniers et envoyés déminer les plages danoises, en 1945. C'est un type de sujet qu'on a évité d'aborder pendant des années : l'armée allemande ayant commis tant de crimes horribles, on n'a pas jugé utile de dénoncer le sort de ces jeunes soldats. Rappelons tout de même que ces mines avaient été posées par l'occupant allemand. Les gamins eux-mêmes avaient subi l'endoctrinement des Jeunesses hitlériennes... et il n'est pas impossible que certains d'entre eux fussent des fils de SS.
Le film pose la question de la responsabilité collective. Alors que les Danois, à l'image de tant de peuples européens, ont souffert à cause des Allemands pendant la guerre, devaient-ils le faire payer aux enfants de ces soldats ?
On leur a confié une tâche délicate et ultra-dangereuse. Ils n'ont reçu qu'une formation express, suffisante toutefois pour effectuer un travail basique, insuffisante quand ils se trouvent face à un dispositif plus élaboré... voire vicieux (une mine en cachant une autre).
Au départ, le sous-officier danois (Roland Møller, vu dans Hijacking, excellent) qui s'occupe d'eux se montre extrêmement dur, déversant sur eux sa haine des Allemands. Mais, petit à petit, il réalise que ce ne sont que des gamins et qu'on fait peser sur leurs épaules une charge qui n'est pas de leur âge. Au fur et à mesure que le temps passe, la petite troupe s'amenuise, amputée de ceux qui périssent dans une explosion. Notons que, si la mise en scène joue avec nos nerfs, elle ne tombe pas dans la facilité. Le réalisateur a voulu éviter que certains événements ne soient trop prévisibles. De la même manière, l'amélioration des relations entre le tuteur danois et la troupe de jeunes démineurs ne suit pas une courbe régulière. Il y a des hauts et des bas.
Je trouve que tous les acteurs sont bons, qu'ils incarnent les Allemands ou les Danois, les civils ou les militaires. Sur un sujet casse-gueule, le réalisateur a construit un film subtil, qui se conclut par un acte d'une grande humanité.
21:40 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
lundi, 09 octobre 2017
Le Jeune Karl Marx
Méfiez-vous des programmes de présentation : ce film n'est diffusé que dans une seule version, multilingue, puisqu'on y parle (principalement) allemand, (sinon) français et (occasionnellement) anglais. C'est lié à la distribution (internationale) et aux péripéties de la vie du jeune Karl Marx, qui a vadrouillé entre Prusse (rhénane), France, Belgique et Royaume-Uni.
Il est incarné par un très bon acteur allemand, August Diehl, qu'on a récemment pu voir dans En mai, fais ce qu'il te plaît et Diamant noir. Je suis moins convaincu par Stefan Konarske en Friedrich Engels, un rôle certes difficile, puisque c'est un fils à papa qui va se révéler très sensible à la cause ouvrière.
Le film mérite aussi le détour pour les interprètes féminines, en particulier Vicky Krieps (vue dans Colonia) en Jenny Marx et Hannah Steele en Mary Burns, la compagne d'Engels. Subrepticement, le film montre que nos esprits (masculins) rebelles ont encore du chemin à faire, puisque, dans leurs rapports aux femmes, ils se révèlent des mecs comme les autres... et encore, le film n'ose suggérer que Marx a engrossé la bonne de la famille, comme n'importe quel bourgeois phallocrate !
La fin des années 1840, sur laquelle se concentre le film, est celle des révélations pour le duo Marx-Engels, qui va se constituer et, au contact l'un de l'autre, affiner sa pensée. Ils vont notamment se démarquer de Proudhon (Olivier Gourmet, excellent) et de Bakounine, tout en récupérant le mouvement socialiste prophétique anglais. Pour que le tableau soit complet, il nous manque les "socialistes utopiques" (sans doute caricaturés par la catégorie précédente), qui ont hélas été oubliés dans l'histoire de la gauche contestataire, alors que les doctrinaires souvent sectaires tiennent encore aujourd'hui le haut du pavé.
Quant à la classe ouvrière, elle fait l'objet d'assez peu d'attention dans le film. Le début est chargé de nous montrer la difficile condition des employées du textile, mais, à l'image du personnage d'Engels, le réalisateur et le scénariste n'en ont qu'une connaissance externe, limite intellectualisée. Du coup, le film perd beaucoup en force, d'autant plus qu'il manque de rythme. Cela m'a un peu fait l'impression d'une collection de vignettes, plutôt destinée à des intellos. Le capitalisme sans foi ni loi a encore de beaux jours devant lui, vu la maladresse de ceux qui le critiquent...
21:36 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 08 octobre 2017
L'affaire Fualdès, le sang et la rumeur
Jusqu'au 31 décembre 2017, le musée Fenaille de Rodez propose une passionnante exposition consacrée à un fait divers qui a défrayé la chronique il y a 200 ans, en Aveyron bien sûr, mais aussi au plan national et même international.
Dès le vestibule, on est accueilli par la reproduction d'une gravure datant sans doute de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. On y découvre une vue d'un Rodez exigu (peuplé à l'époque de seulement 6 500 habitants), entouré d'espace rural, en particulier sur les pentes aujourd'hui presque intégralement bâties.
De là, on pénètre dans la première salle, consacrée au crime en lui-même. On nous présente Antoine-Bernardin Fualdès, ancien révolutionnaire ardent devenu bonapartiste et procureur impérial au criminel. C'est dire qu'il a dû se faire des ennemis dans le passé, d'autant plus qu'il est franc-maçon (de tendance antimonarchique), une étiquette délicate à porter en 1817, au début de la Restauration, juste après la Terreur blanche.
Le mystère plane toujours sur ce qui s'est passé le soir de ce 19 mars 1817. Vers 20 heures, Fualdès a quitté son domicile ( 1 aujourd'hui situé au début de la rue de Bonald, où l'on peut encore voir la porte d'origine, qui a été légèrement reculée par rapport à la rue, sans doute pour ménager un abri). Il faisait sombre à Rodez, mais le cafetier voisin (2) a reconnu l'ancien procureur parti se promener, une serviette de documents sous le bras, semble-t-il. Au bout de la place de la cité, il a tourné à droite, rue Terral (3). A partir de là, les versions divergent.
L'enquête (bâclée) et la rumeur publique ont très tôt désigné la maison Bancal (4) comme étant le lieu du crime. N'a-t-on pas retrouvé à proximité de celle-ci, rue des Hebdomadiers (aujourd'hui rue Séguy) un mouchoir qui ne peut qu'avoir servi de bâillon ? N'a-t-on pas retrouvé la canne de Fualdès à peine plus loin, rue Terral ? Dans la salle du musée sont proposés plusieurs plans d'époque, ainsi qu'une carte postale du tout début du XXe siècle, permettant de localiser les principaux endroits liés (de manière réelle ou supposée) au crime. Notons que la mairie de Rodez avait fait imprimer l'un de ces plans, dont la vente devait servir à soulager les nécessiteux de la commune.
Le corps de Fualdès ayant été retrouvé en contrebas de la ville, sur les berges de l'Aveyron, à Layoule, aux confins de Rodez et du Monastère, les imaginations se sont déchaînées sur la manière dont le corps y avait été transporté. Contrairement à ce qu'un esprit contemporain pourrait croire, ce n'est pas le chemin le plus court qui a été emprunté. Celui-ci traversait une partie de la cité (la partie Nord), où, le soir, le moindre bruit est susceptible d'éveiller l'attention.
Les assassins (car ils étaient sans doute plusieurs) ont sans doute transporté Fualdès (vivant ou mort) en longeant les remparts de la cité. Ils seraient sortis par la porte Saint-Martial qui, à l'époque, faisait le lien entre l'évêché et la cathédrale. Une fois à l 'extérieur, il y avait peu de chances qu'ils soient dérangés, la zone étant quasi inhabitée... et peu fréquentée le soir.
(gravure présentant une vue de la place d'Armes à la fin du XVIIIe siècle)
La deuxième partie de la première salle propose divers objets en lien avec l'affaire : une reconstitution des vêtements que portait Fualdès ce soir-là, la mise en scène du crime, telle que la version officielle l'a transmise, une vielle comme celle dont devaient jouer les musiciens présents en cette période de foire... et une maquette de la désormais fameuse maison Bancal, réalisée en 1820 par David Niépce. Ce nom ne vous est peut-être pas inconnu : il s'agit du cousin de Nicéphore, l'inventeur de la photographie. Officier des dragons, il s'ennuyait un peu dans le chef-lieu aveyronnais. Et puis cette maison suscitait une telle curiosité... à tel point que les gens y venaient en nombre, prêts à payer pour la visiter. Curiosité supplémentaire : la maquette a été conçue de manière à ce qu'une partie soit amovible, dévoilant l'espace intérieur, minutieusement reconstitué.
L'engouement pour ce fait divers fait l'objet de la deuxième salle, consacrée aux productions de l'époque, particulièrement des années 1817-1818. Aujourd'hui, on dirait que l'affaire "a fait le buzz"... sauf qu'alors n'existent ni internet, ni la télévision, ni la radio, ni le téléphone... C'est donc par les illustrations et les écrits que les informations (les fausses comme les vraies) ont été véhiculées. C'est l'âge d'or de la lithographie, de nombreuses étant exposées dans le musée. Des peintres se sont même déplacés pour faire le portrait des principaux protagonistes, pour la plupart des gens du peuple, dont la renommée va désormais égaler (temporairement) celle des puissants. L'histoire de ce meurtre a donné lieu à des productions théâtrales... et même à la création d'un "cabinet de cire", où a été reconstitué la scène du crime, telle que la rumeur l'a propagée.
Au niveau des écrits,il y a profusion d'édition de feuilles volantes. Pour les plus fortunés, on publie les actes des procès. L'essentiel est publié par la presse, locale comme nationale, puisque des journalistes parisiens ont fait le déplacement. L'un d'entre eux, Hyacinthe Thabaud, a visiblement été traumatisé par Rodez, une ville sombre, peuplée de chauve-souris et de porcs en liberté...
L'une des publications les plus célèbres est les Mémoires de Clarisse Manzon, la fille d'un juge ruthénois, une mythomane qui va précipiter la chute de certains des accusés. Ce livre a été réédité à de nombreuses reprises et même traduit (en anglais, danois...). On a ainsi entendu parler de l'affaire Fualdès dans toute l'Europe, jusqu'aux États-Unis !
La troisième salle fait le point sur les suites judiciaires, ainsi que sur les zones d'ombre. Plusieurs hypothèses sont évoquées quant aux véritables causes de la mort de Fualdès. Rappelons tout d'abord qu'il y eut trois procès, le premier (celui de Rodez), ayant été cassé pour un vice de forme. Les deux suivants ont eu lieu à Albi, le troisième étant en quelque sorte la queue de comète du deuxième. Voilà pourquoi les trois condamnés à mort ont été exécutés en terre albigeoise, le 3 juin 1818. D'autres accusés ont été condamnés à la prison à perpétuité, d'autres à des peines plus légères. Quelques-uns ont été acquittés.
Dans cette salle, il est question des mensonges et omissions dans lesquels l'affaire a été engluée. Aucun meurtre n'a été commis dans la maison Bancal, dont les enfants ont pu imaginer un récit fantasmagorique, sans cesse renouvelé, sans susciter le scepticisme des enquêteurs. C'est à l'image de la majorité des témoins (plus de 300 lors des deux premiers procès), comme ce meunier qui, sur son lit de mort, a fini par reconnaître qu'il avait tout inventé pour pouvoir voir du pays ! Le summum est peut-être atteint avec ces lettres anonymes de menace, reçues par Clarisse Manzon... qui se les était envoyées elle-même !
Et encore, l'exposition ne dit pas tout. La lecture de l'excellent catalogue (issu notamment d'un gros travail de fond de Jacques Miquel) nous en apprend d'autres. Je pense à ces témoins à décharge qu'on a tenté de faire revenir sur leurs déclarations, où ceux dont on a totalement négligé les paroles. Parmi eux, il y a ce réfugié espagnol, ancien juge, qui logeait juste au-dessus des Bancal (et donc du lieu présumé du crime)... et qui n'a rien entendu d'inhabituel ce soir-là, tout comme le voisin des Bancal, qui était un ami de Fualdès ! On a aussi "perdu" ces pierres tachées de sang, découvertes à Layoule, ce qui tendait à prouver que c'est là que le meurtre avait été perpétré, et non dans la maison Bancal.
Et puis, il y a ces "liaisons coupables", ces attaches familiales qui unissent les notables royalistes de Rodez et de ses alentours à de prestigieuses familles françaises (comme celle de Decazes). Une hypothèse tient la corde (sans être la seule envisageable), celle d'une vengeance des Chevaliers de la Foi, cette conjuration qui a tenté de remettre Louis XVIII sur le trône, en 1814, et qui a échoué notamment à cause du procureur impérial Fualdès. La bande de royalistes a commis bien des méfaits, qui n'ont jamais été sanctionnés par une condamnation en justice. Quant au procureur et à l'officier de gendarmerie chargés de l'affaire en 1817, il ont été ensuite rapidement décorés de la légion d'honneur... Ils avaient sans doute bien mérité de la Patrie !
PS
Sur le site du musée Fenaille, on peut accéder à un très bon web-documentaire.
PS II
On peut aussi, sur la Toile (ré)écouter des émissions radiophoniques (de RTL et France Inter) qui ont été consacrées à l'affaire.
PS III
Enfin, ne partez pas du musée sans réclamer la reproduction du plan d'époque de la cité de Rodez. (C'est gratuit.) Il est annoté de manière à faciliter la déambulation dans les rues de la ville, tout en suivant l'affaire Fualdès.
17:06 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, occitanie, société, actualité, culture
mercredi, 04 octobre 2017
Confident Royal
Opération My taylor is rich aujourd'hui, avec le nouveau film de Stephen Frears, en version originale sous-titrée à Rodez ! Ces derniers temps, le cinéma britannique aime à revisiter les moments marquants du passé national (antérieurs à l'adhésion à la CEE...). En juin dernier, on a pu voir un Churchill compatissant au sort des soldats participant au débarquement de Normandie. En juillet, c'est le stoïcisme et le sens du devoir des tommies en 1940 qui fut à l'honneur dans Dunkerque. On a aussi eu droit à l'abnégation du couple Mountbatten dans Le Dernier Vice-Roi des Indes.
Le récent auteur de Florence Foster Jenkins s'est attaqué à un autre monument national, la reine Victoria (vieillissante), remarquablement interprétée par Judi Dench, qui retrouve ainsi le réalisateur de Philomena. Dans le rôle principal, l'actrice assume ses rides et ses dents manquantes, pour composer un formidable portrait de la souveraine, à la fois protégée et corsetée par l'étiquette de la cour. C'est l'occasion de découvrir une brochette de seconds rôles bien campés, entre vieilles badernes et culs pincés, le tout sur fond d'ambitions personnelles.
L'arrivée de serviteurs indiens musulmans va mettre le feu aux poudres. On a un peu rapidement présenté cette histoire comme une totale révélation, issue de la découverte des carnets de l'ancien favori de la reine, en 2010. En réalité, des historiens spécialisés avaient déjà évoqué la chose (certes sans y consacrer un livre entier). En français, une biographie de Victoria datant de l'an 2000 (et signée Roland Marx) consacrait un peu moins d'une demi-page à la petite révolution de cour qui agita le microcosme à l'extrême fin du XIXe siècle.
C'est donc un film orienté (à l'image des récentes productions historiques britanniques), tout à la gloire de la reine, très dur pour "Bertie" (le futur Édouard VII) qui pourtant, une fois devenu roi, engagea le rapprochement avec la France, qui mena à la signature de l'Entente Cordiale. Un autre personnage subit un traitement (à mon avis) injuste : Lady Churchill (la maman de Winston, une Américaine qui a des ancêtres... français), présentée comme une intrigante revêche... sans qu'on ose préciser qu'elle fut (entre autres) l'une des (nombreuses) maîtresses du futur Édouard VII.
Le début est assez drôle, avec la découverte d'une reine gourmande, pas très propre à table et dont le médecin s'enquiert de la qualité des selles... La rencontre avec l'Indien Abdul est aussi assez comique, avec, au centre de l'attention, un de ces horribles desserts à la gelée dans lequel je n'ai pas pu m'empêcher de voir des allusions sexuelles.
La suite est hélas plus plan-plan, manquant de rythme, malgré la qualité de l'interprétation. (Je recommande tout particulièrement la déclaration que Judi/Victoria assène, en gros plan, à un trio d'emmerdeurs masculins dans son bureau.) A voir si l'on se pique d'anglomanie, ou si l'on peut se contenter de suivre les évolutions de Judi Dench à l'écran.
PS
C'est la deuxième fois que Stephen Frears gâche un splendide matériau. Il y a une dizaine d'années, la performance d'Helen Mirren (Elizabeth II dans The Queen) n'avait été que médiocrement servie par un film décevant.
22:55 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 24 août 2017
Lumières d'été
Jean-Gabriel Périot (auquel on doit le médiocre Une Jeunesse allemande) mêle ici fiction et documentaire pour parler d'Hiroshima et de ses conséquences.
Dans la salle où j'ai vu le film, il était précédé d'un court-métrage du même auteur, 200 000 fantômes, constitué d'un diaporama construit à partir de la superposition de vues du Dôme de Genbaku, le seul bâtiment resté debout au niveau de l'épicentre de l'explosion atomique. En fond sonore, on entend un poème dit en anglais (et non traduit). Le concept de base est intéressant, mais le résultat manque de lisibilité. Les images défilent trop vite et pas dans un ordre strictement chronologique. On comprend quand même que les vues présentent le Dôme avant l'explosion, juste après et dans les phases de reconstruction de la ville.
Le film en lui-même démarre ensuite, par une séquence dont tout le monde a parlé : le témoignage d'une hibakusha, une rescapée de l'explosion atomique. J'ai beau avoir beaucoup lu et vu sur le sujet, j'ai été saisi par les paroles de cette vieille femme digne. J'ai repensé au formidable manga Gen d'Hiroshima, dont l'auteur Keiji Nakazawa était (il est mort en 2012) un autre rescapé du bombardement. Cette séquence est d'autant plus réussie que le témoin est... une actrice.
Le réalisateur du documentaire, un Japonais qui vit à Paris, sort quelque peu bouleversé de cet entretien. Il se trouve dans le parc de la Paix lorsqu'il fait une curieuse rencontre : Michiko, une jeune femme en kimono, délicieusement désuète, qui semble en savoir beaucoup sur la ville d'Hiroshima et les conséquences de l'explosion atomique. Voilà qu'on nous embarque dans une déambulation romantique, à pieds, en train, en ville, au bord de la mer. On assiste à une partie de pêche, un repas entre amis, une cérémonie en l'honneur des ancêtres et un concours de lueurs. Même si on comprend assez vite qui est la jeune femme, c'est assez inattendu, plein de délicatesse et de poésie, culminant dans une scène de chant indescriptible.
Certains critiques ont beau faire la fine bouche, j'ai été très touché par cette histoire, portée par deux actrices formidables : Mamako Yoneyama et Akane Tatsukawa.
23:12 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 30 juillet 2017
Après trois ans de guerre
C'est le titre d'un fascicule édité en 1917, et que je me suis procuré (pour un euro) dans une brocante aujourd'hui :
Il sort d'une imprimerie parisienne (aujourd'hui disparue). C'est un document gouvernemental (français), dont la préface est signée Théodore Steeg. Elle nous indique que le texte est destiné aux écoliers. Quoi de plus normal, puisque l'auteur de la préface est à l'époque ministre de l'Instruction publique (ente mars et septembre 1917) ?
C'est évidemment un plaidoyer en faveur de l'action du gouvernement français et une charge anti-allemande. Indirectement, ce texte est révélateur des mentalités de l'époque... et il contient plusieurs informations intéressantes.
Il évoque l'ambiance qui était celle du pays avant la déclaration de guerre. D'après lui, la longue crise créée par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo n'a, dans un premier temps, pas suscité trop d'inquiétude dans la population. Celle-ci pensait que la diplomatie viendrait à bout des tensions, comme ce fut le cas quelques années auparavant lors de la crise marocaine (franco-allemande). Ensuite est venu le temps de la résignation et de la détermination à faire son devoir... pas de "fleur au fusil" donc, même si l'on dit que les wagons transportant les troupes avaient été abondamment décorés.
L'auteur passe ensuite aux nombreux torts de l'Allemagne, les premiers étant d'avoir préparé et provoqué cette guerre. Au passage, le sort du caporal Peugeot (remis en lumière en 2014) est évoqué.
Les combats du front ouest sont racontés sobrement, mais avec un tropisme français très marqué. Les échecs allemands sont exagérés, au besoin en recourant à des anecdotes symboliques, comme celle évoquant les suites de la bataille de la Marne : "Nos soldats goûtent la joie enivrante de courir sur les talons ferrés de l'envahisseur et de le reconduire par des routes où des milliers de bouteilles vidées attestent son amour des vins de France." (Ce fut aussi le cas en 1940, mais dans le cadre d'une victoire allemande cette fois-ci.)
L'auteur en appelle au patriotisme et à la justice. Pour le premier, les figures mises en avant vont de Roland de Roncevaux au chevalier Bayard en passant par Du Guesclin et Jeanne d'Arc. On trouve aussi une référence aux combattants de 1792. Du point de vue de la justice, l'auteur défend l'idée que cet affrontement est, du point de vue français, la "guerre du droit". Pour accréditer son opinion, il énonce les ralliements de pays, le dernier à avoir rejoint l'Entente étant les Etats-Unis. On compte sur eux pour renforcer le poids des adversaires de l'Allemagne, qui a disposé, dans un premier temps, d'une supériorité mécanique liée à sa puissance industrielle.
L'ouvrage s'achève sur des considérations concernant la paix future, nécessairement victorieuse. L'auteur craint que l'on soit trop magnanime avec l'Allemagne, provoquant l'incompréhension des peuples agressés par celle-ci.
22:14 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, livres, france
jeudi, 27 juillet 2017
Simone Veil (bis)
Comme j'ai été emballé par la lecture d'Une Jeunesse au temps de la Shoah, je me suis procuré l'édition intégrale des mémoires de Simone Veil, en collection de poche.
La jeune magistrate qu'elle fut a peu travaillé dans les tribunaux. Très vite, elle a été repérée et utilisée comme technicienne du droit, notamment au ministère de la Justice. On la sent préoccupée par le mauvais état du système judiciaire et soucieuse d'améliorer la situation dans les prisons.
Sa carrière politique a suivi des chemins détournés. Elle écrit avoir voté tantôt à droite, tantôt à gauche (mais pas pour les communistes). Elle n'avait pas la fibre gaulliste et a même voté NON au référendum de 1969 (celui qui a abouti à la démission de Charles de Gaulle). Elle qui fut "embauchée" par Valéry Giscard d'Estaing avait voté pour Chaban-Delmas au premier tour de la présidentielle de 1974. On sent qu'elle a apprécié Georges Pompidou et que, si elle reconnaissait l'intelligence de VGE, elle se sentait plus proche de Jacques Chirac, l'euroscepticisme en moins.
Le grand moment de son passage au gouvernement fut évidemment le vote de la loi autorisant l'IVG. Le discours qu'elle prononça à cette occasion à l'Assemblée nationale est d'ailleurs intégralement reproduit en annexe. Alors qu'à d'autres occasions elle a parfois la dent dure pour les personnes qu'elle a côtoyées, elle ne se montre pas revancharde en narrant cet épisode, alors qu'elle a été traînée dans la boue.
Elle préfère remercier ceux qui l'ont aidée, comme ce sénateur du Cantal nommé Mézard... Cela ne vous dit rien ? Avant d'entrer dans le gouvernement Philippe (au titre de ministre de l'Agriculture puis de ministre de la Cohésion des territoires), l'avocat Jacques Mézard a été sénateur du Cantal pendant presque neuf ans... tout comme son père (qui était médecin) : Jean Mézard a été sénateur de 1971 à 1980. Bien que membre du CNIP (réputé très conservateur), il a soutenu le projet de Simone Veil.
L'ancienne ministre est beaucoup moins amène envers deux autres de ses anciens collègues : Raymond Barre et Maurice Papon (celui-ci pas tant pour ce qu'il avait fait que pour son absence de regrets).
L'autre grande aventure politique de sa vie est la construction européenne. Le grand public a souvent retenu sa présidence du Parlement européen (pendant deux ans et demi), mais elle y a siégé au total 14 ans. Elle pointe le manque d'investissement des députés français, plus occupés à leurs calculs politiciens hexagonaux qu'aux grands enjeux continentaux. Là aussi elle décerne quelques bons points... et éreinte copieusement une autre figure du centrisme : François Bayrou. A deux reprises, elle en dresse un portrait peu flatteur, le peignant en arriviste hypocrite.
On n'apprend pas grand chose quand elle évoque son retour en politique, dans le gouvernement Balladur (celui de la deuxième cohabitation). Elle n'est pas non plus très loquace sur son passage au Conseil constitutionnel (de 1998 à 2007). Par contre, certains lecteurs seront peut-être un peu surpris par ses opinions sur la vie politique française du début du XXIe siècle. Une Vie a été publié dans le dernier tiers de l'année 2007. Il a sans doute été rédigé durant les mois qui ont précédé. Simone Veil s'y montre séduite par Nicolas Sarkozy (ce qui n'est pas une surprise pour qui a suivi l'actualité de l'époque)... et par Rachida Dati, à propos de laquelle elle écrit : "Rachida Dati, dont la lucidité et le courage font mon admiration" ! Pour le coup, c'est Mme Veil qui semble avoir manqué de lucidité. De surcroît, elle ne dit rien de la création d'un ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale, confié au très progressiste Brice Hortefeux.
Elle a au moins le mérite de la franchise et le courage de ses opinions. Ses mémoires sont d'une lecture facile et riches d'enseignements. Ils permettent de nuancer le portrait statufié que les médias ont eu tendance à dresser de l'ancienne ministre.
00:21 Publié dans Histoire, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, livres, société, france, histoire, femme
samedi, 22 juillet 2017
Dunkerque
Trois ans après Interstellar, Christopher Nolan revient avec un film de guerre, un genre dans lequel jusqu'à présent il ne s'était pas illustré, même si certaines de ses précédents oeuvres (notamment The Dark Knight Rises) ne sont pas sans parenté avec ce type de film.
Il y appose sa marque : c'est un thriller guerrier dans lequel, paradoxalement, on voit très peu le sang couler (même s'il y a des morts). Je pense que ce n'est pas un hasard si la scène la plus sanglante (au sens strict) est celle d'un accident (dans un bateau).
C'est surtout la terreur qui est mise en scène. Elle est à l'oeuvre dès le début, avec ces soldats qui fuient un ennemi invisible, mais qui les asperge de balles. Un gros travail a été effectué sur le son : les bruits sont l'un des personnages principaux de l'histoire. Outre ceux des balles, il y a ceux des bombes, des torpilles, des avions en piqué, de la tôle des navires qui plie voire se fracture. Associés à la musique de Hans Zimmer, ces sons constituent un habillage auditif très marquant.
Nolan a aussi déconstruit son récit. On nous annonce très vite que l'on va suivre différentes catégories de personnages : les soldats qui attendent pour embarquer, les aviateurs qui sont chargés de les protéger et les marins qui vont quitter les côtes anglaises pour se porter à leur secours. A partir de là, l'éventail se déplie : on va suivre différentes catégories de soldats et les parcours de deux aviateurs vont diverger. Cela forme un puzzle qu'il faut faire l'effort d'assembler, les scènes n'étant pas présentées dans un ordre strictement chronologique. Certains épisodes vont nous êtres montrés plusieurs fois, de points de vue différents.
Cela crée un effet dramatique supplémentaire : on ne sait pas toujours à quel moment de la journée on se trouve exactement. Derrière cela, je pense qu'il y a aussi un objectif : insister sur le courage dont plusieurs catégories de personnes ont fait preuve... sans cacher les faiblesses et les lâchetés.
La réalisation est impeccable. Nolan est aussi bon dans les scènes d'intérieur (dans les bateaux) que dans celles d'extérieur, avec notamment des plans assez originaux pris des avions.
A côté de cela, les acteurs sont des pions, qui s'en sortent plus ou moins bien. Les jeunes sont très crédibles, sauf peut-être Cillian Murphy (qui incarne un soldat victime d'un stress post-traumatique), au jeu maladroit (ou alors il a été mal doublé). Les "anciens" sont sous-exploités, en particulier Kenneth Brannagh (le commandant), dont Nolan fait une simple statue. Son personnage n'en est pas moins important pour la compréhension de l'intrigue : ses répliques donnent des informations précieuses sur le contexte historique. (Pour en savoir plus, on peut se reporter au livre de Jacques Duquesne, récemment publié... et moins anglo-centré.) Mark Rylance s'en sort un peu mieux, mais dans un rôle monolithique.
Malgré ces quelques réserves, c'est vraiment un bon film, tout en tensions, du début jusqu'à la fin... mais Dieu que ça manque de femmes !
13:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
jeudi, 20 juillet 2017
Dunkerque 1940 - Une tragédie française
C'est le titre du livre écrit par Jacques Duquesne, un vétéran du journalisme, originaire du Nord-Pas-de-Calais (Hauts-de-France), connu aussi pour ses ouvrages historiques, principalement consacrés au christianisme et à la Seconde guerre mondiale.
Ici, le témoin se mêle à l'historien, puisque Jacques Duquesne, âgé de dix ans à l'époque, a vécu l'opération Dynamo, qui a permis le rembarquement d'environ 350 000 soldats alliés (majoritairement britanniques) entre la fin fin du mois de mai et le début du mois de juin 1940.
Le livre vaut donc d'abord pour les anecdotes qui ponctuent l'histoire. On y découvre les chansons anti-allemandes entonnées par les gamins de la ville, les débuts de la guerre maritime (avec l'emploi des mines) et le désordre dans lequel vivait la population locale.
S'ajoute à cela le contexte historique. Jacques Duquesne a voulu raconter, vue du Nord, cette "étrange défaite" qui a tant marqué les esprits à l'époque. Il commence par la "drôle de guerre" et insiste sur le manque de préparation des armées alliées, françaises comme britanniques. L'exemple le plus flagrant est l'emploi généralisé de la radio... par les troupes allemandes, alors que leurs adversaires en sont encore aux pigeons voyageurs (même si les moyens modernes de communication se développent). La maîtrise des transmissions a été un élément-clé de la bataille de France.
Il est bien entendu question des avions et des chars. C'est de leur utilisation combinée et intelligente qu'est née la victoire allemande alors que, sur le papier, les Alliés disposaient d'un matériel équivalent en quantité, les chars français soutenant même la comparaison avec les panzers. Mais ils ont été en général mal utilisés, sauf par un colonel (bientôt général) à l'époque peu connu, un certain Charles de Gaulle, dont Duquesne évoque l'action du côté de Montcornet et d'Abbeville, en Picardie.
L'auteur ne cache pas les aspects négatifs de l'histoire, notamment les désaccords entre Français et Britanniques. Au niveau local, c'est la débandade, avec son cortège de lâchetés et d'actes d'héroïsme. A petites touches, Duquesne fait l'éloge de son défunt père, policier non mobilisé qui a pris des risques insensés pour tenter de maintenir un semblant d'ordre en ville.
C'est passionnant, parce que le livre fourmille d'anecdotes et qu'il est très bien écrit. J'avais commencé à le lire après le dîner et je n'ai pas pu m'arrêter, achevant la lecture tard dans la nuit !
Quelques bémols, histoire de ne pas tomber dans le dithyrambe. J'ai relevé une erreur, à propos de la date de l'Anschluss (page 84) : il est présenté comme réalisé en 1937, alors qu'il a eu lieu en 1938. Je ne suis de plus pas tout à fait d'accord avec la manière lapidaire de présenter la politique étrangère des Etats-Unis après la Première guerre mondiale (page 44). Enfin, j'aurais aimé que l'auteur s'étende davantage sur la rumeur de la grève des cheminots belges.
Je termine par un avertissement aux futurs lecteurs : n'attendez pas la description minutieuse du processus de rembarquement des troupes. L'opération nous est présentée dans sa globalité, avec des détails certes, mais c'est surtout à la résurrection de l'atmosphère de l'époque que Jacques Duquesne s'est consacré... avec talent.
PS
Sur la cause du soudain arrêt des troupes allemandes, le 24 mai, Jacques Duquesne développe une hypothèse intéressante, qui ne fait toutefois pas l'unanimité parmi les historiens. Voir par exemple les explications de François Delpla, un des meilleurs spécialistes français de cette époque.
12:47 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, france, médias, journalisme, presse, livres, seconde guerre mondiale
mardi, 18 juillet 2017
Le Dernier Vice-Roi des Indes
Il s'agit de Lord Mountbatten, un membre de la famille royale, qui a suivi une carrière militaire et administrative. Au début de 1947, il est envoyé en Inde pour gérer le plus rapidement (et pacifiquement) possible la passation de pouvoir entre les autorités britanniques et le gouvernement indépendant de la future ancienne colonie. Celle-ci, qu'on devrait plutôt appeler les Indes, s'étendait sur un territoire occupant les actuels Pakistan, Inde et Bangladesh. (Elle a même inclus, à une époque, la Birmanie et la Sri Lanka.) Elle abritait une population bigarrée, multiculturelle. Mais l'époque n'était pas à l'entente, plutôt à l'affrontement.
La réalisatrice d'origine indienne Gurinder Chadha (à laquelle on doit, entre autre, Joue-la comme Beckham) met bien en scène les tensions principalement entre hindous et musulmans. Elle montre aussi les divergences qui existent entre les principaux dirigeants politiques. Mais elle ne se hasarde pas à tenter d'expliquer la cause des premiers massacres intercommunautaires, qui vont bientôt dégénérer.
Elle a préféré mettre au premier plan une histoire d'amour impossible comme Bollywood les aime tant, ici entre un hindou ouvert d'esprit et une musulmane promise à un autre homme. Il est d'ailleurs intéressant de noter à quel point ce film britannique emprunte aux codes du cinéma grand public indien. C'est très coloré, avec un souci de reconstitution louable... mais c'est horriblement mélo. Les amoureux ont un côté "nunuche" parfois insupportable... et qu'est-ce qu'ils peuvent se répéter ! Le pire arrive à la fin (que je me garderai de raconter) : c'était tellement convenu que je me suis attendu à ce que la foule se mette à applaudir puis à danser...
G. Chadha ne s'embarrasse donc pas de subtilité : le jeune hindou (bien de sa personne) est le nouveau valet du vice-roi, alors que sa dulcinée est la nouvelle dame de compagnie de la fille de celui-ci. Quelle coïncidence ! Lui qui, quelques mois auparavant, était un policier affecté à la prison où le père de sa future chérie était incarcéré ! Ce scénario abracadabrantesque sert le propos de la réalisatrice : le palais du vice-roi (et la petite ville qui l'entoure) est un résumé de l'Inde.
Les acteurs européens s'en sortent un peu mieux. Certes, j'ai tiqué devant Hugh Bonneville, un peu trop vieux et empâté pour le rôle, mais il tient la route, faisant ressortir la volonté de négocier de Mountbatten. Surtout, le couple qu'il forme avec Gillian Anderson (excellente) fonctionne à merveille. J'ai aussi apprécié la brochette de seconds rôles britanniques, très bien campés. Je suis plus partagé sur les grandes figures indiennes. Si l'acteur qui incarne Nehru lui ressemble physiquement, je n'ai pas trouvé son jeu très convaincant. Cela marche mieux avec Ali Jinnah. Quant à Gandhi, je l'ai déjà vu tellement de fois à l'écran (soit dans des films d'archives soit dans des fictions) que j'ai éprouvé un sentiment d'étrangeté face à l'interprétation qui nous est proposée.
Concernant le contexte historique, le film montre bien que le pouvoir change de mains. Assez vite, le couple Mountbatten réalise qu'en dépit du respect qu'on lui manifeste, les décisions se prennent à Londres et que la force est désormais du côté des Indiens.
Toutefois, un élément de l'intrigue aurait mérité d'être expliqué aux spectateurs. Le couple est resté en Inde après l'indépendance. A la fin, on voit les Mountbatten participer à une action humanitaire, l'ancien vice-roi portant un uniforme (beaucoup moins prestigieux que le précédent). A quel titre se trouve-t-il là ? Eh bien, il était devenu gouverneur général de l'Inde, le pays ayant, dans un premier temps, conservé le roi d'Angleterre comme souverain (Nehru étant Premier ministre), avant de devenir une république en 1950.
C'est donc un film aux qualités assez limitées. Sur le plan dramaturgique, on est proche de la soupe bollywoodienne. Sur le plan historique, c'est intéressant pour quelqu'un qui ne connaît pas grand chose au contexte de l'indépendance de l'Inde... mais il faut savoir que les scénaristes ont introduit un gros mensonge dans l'intrigue : l'existence d'un plan (secret) de partition de la colonie, élaboré alors que Churchill dirigeait le gouvernement (avant juillet 1945 donc). C'est une invention. Il faut y voir la volonté de régler quelques comptes avec l'ancien Premier ministre britannique. C'était un homme plein de qualités... et de défauts. Parmi ceux-ci, il y avait le refus obstiné de l'indépendance des colonies. Ceci explique peut-être cela.
16:48 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 15 juillet 2017
Une Jeunesse au temps de la Shoah
Pour moi, Simone Veil était d'abord une féministe et une défenseure de la construction européenne. Je n'avais guère attaché d'importance à sa jeunesse et à sa déportation (qui a pourtant marqué jusqu'à son épée d'académicienne). Son décès a été l'occasion de m'y plonger. Au départ, je voulais lire son autobiographie (Une Vie), mais je n'ai pas trouvé le livre à Rodez. A sa place, j'ai acheté celui qui a été édité à partir de ses quatre premiers chapitres :
Ce n'est pas qu'une édition écourtée. Elle a été enrichie d'une préface, d'annexes et, surtout, d'un appareil critique (des notes) destiné à permettre aux adolescents de bien comprendre le contexte de l'époque et les allusions présentes dans le texte de Simone Veil. Autant le dire tout de suite : ces notes sont aussi d'un grand intérêt pour les lecteurs adultes !
Sous la plume de l'ancienne ministre, on découvre une jeune fille puis une adolescente au caractère déjà bien trempé. Visiblement, elle idolâtrait sa mère et s'est promise de ne pas commettre la même erreur qu'elle, à savoir abandonner toute ambition professionnelle pour se cantonner au rôle de femme au foyer.
Sa jeunesse s'est passée à Nice (où se réfugia, un peu plus tard, la famille Joffo, dont le destin nous est conté par Un Sac de billes), la ville où le couple Jacob (parisien) décida de s'installer dans les années 1930. Comme pour la famille Joffo, on remarque que l'occupation italienne (pendant la guerre) a été perçue comme bien plus douce que celle des Allemands.
L'autobiographie de Simone Veil contient plusieurs moments émouvants, à commencer bien sûr par l'éclatement de la famille à cause de la déportation. Le pire est que la jeune Simone a peut-être involontairement aidé la Gestapo à arrêter certains de ses proches. Un peu plus tard, il est question de la mort de sa mère et de la maladie d'une de ses sœurs.
Simone doit sa survie à un concours de circonstances, à sa bonne constitution physique, à sa volonté et à quelques "bonnes fées" qui lui ont sauvé la vie. Il y a ce prisonnier français qui, à son arrivée à Auschwitz, lui dit de mentir sur son âge. Il y a cette kapo qui la protège et il y a eu ces autres déportées, avec lesquelles elle s'est serré les coudes. (Rappelons que moins de 5 % des juifs déportés à partir de la France sont revenus des camps.)
A la fin de la guerre, la vie ne redevient pas rose immédiatement. Les déportés sont en quelque sorte mis en quarantaine avant d'être rapatriés en France. Ils n'y sont pas forcément bien accueillis. A l'époque, le génocide juif ne préoccupe guère les médias. Simone Jacob va reprendre goût à la vie grâce aux membres survivants de sa famille... et à l'amour, rencontré en la personne d'Antoine Veil. La grande affection qui a uni ce couple n'a pas évité les tensions, en particulier quand Simone a décidé d'embrasser une carrière juridique. Les époux ont négocié... et Simone est devenue magistrate. A l'époque où s'arrête le livre, la politique ne lui tend pas encore les bras.
C'est vraiment bien écrit et les notes explicatives sont très claires. On peut compléter cette lecture par celle des annexes, notamment des discours de Simone Veil, mais aussi l'entretien accordé par l'une de ses petites-filles au magazine Elle. Signalons que l'édition de poche contient un cahier d'illustrations et une chronologie détaillée.
PS
A lire aussi, dans le Bulletin d'Espalion de cette semaine, une pleine page consacrée à la venue en Aveyron de celle qui était alors ministre de la Santé, en décembre 1976.
PS II
D'autres journaux ont ressorti les images d'archives. La plupart du temps, en province, il s'agit de l'inauguration d'un hôpital ou d'un centre de soins. La plus étonnante de ces archives a été publiée par Le Berry républicain : à Saint-Amand, dans le Cher, la ministre avait été accueillie par le maire de l'époque, un certain Maurice Papon !
dimanche, 09 juillet 2017
Lettres de la guerre
C'est à partir d'un matériau réel (les lettres écrites par un écrivain portugais, alors médecin militaire en Angola) qu'Ivo Ferreira brosse un tableau d'une guerre coloniale. Elle rappellera aux spectateurs soit notre guerre d'Algérie soit le conflit américano-vietnamien. Apocalypse now est d'ailleurs l'un des modèles du réalisateur, tout comme le film Tabou, autre superbe noir et blanc portugais.
A la fiction se déroulant au début des années 1970 sont juxtaposés des extraits de lettres, lus soit par leur auteur (le personnage principal, que l'on voit parfois en train d'écrire), soit par leur destinataire, sa jeune épouse enceinte. Le mélange de ces deux voix, s'il introduit une salutaire diversité, n'en est pas moins perturbant. De surcroît, la première partie comporte trop de passages lus. Je n'ai pas été ému par la transcription littéraire de cet amour enflammé et contrarié.
J'ai été beaucoup plus intéressé par ce qui nous était montré à l'écran. C'est souvent d'une grande beauté plastique, avec des jeux d'ombre et de lumière, mais aussi des reflets parfaitement maîtrisés. Je pense notamment à cette projection de film, dont on finit par voir une image détournée, en extérieur, sur des objets. Je pense aussi à la réverbération, à la surface d'un cours d'eau, de l'image de soldats tentant de réparer un pont saboté par les rebelles angolais. De manière générale, les paysages (ah la savane africaine !) sont bien filmés. Les ambiances nocturnes sont aussi très belles.
Ceux qui attendent de l'action trépidante peuvent passer leur chemin. On suit la troupe au quotidien, la caméra se détournant d'elle de temps à autre, pour s'attarder sur les Africains. Certains spectateurs seront peut-être choqués par la condition des femmes, soumises au bon vouloir des messieurs, à l'exception peut-être des deux chanteuses portugaises, aguicheuses mais inaccessibles. Notons que les scènes d'intérieur ont été réalisées avec un grand souci du détail, en particulier au niveau du décor et des objets du quotidien.
Même si ce n'est pas une totale réussite, ce film mérite le détour pour sa beauté visuelle.
00:00 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
dimanche, 02 juillet 2017
Nos Patriotes
Il y a une dizaine d'années, Gabriel Le Bonin s'est fait remarquer avec Les Fragments d'Antonin, un étonnant film ayant pour cadre les conséquences de la Première guerre mondiale. Ici, c'est de la seconde qu'il s'agit, avec d'abord un massacre de tirailleurs sénégalais (parmi d'autres) commis par l'armée allemande. Même si cette anecdote ne fait pas partie de la vie du héros Addi Bâ, elle a été intégrée à l'intrigue, pour contribuer à rendre hommage à ces combattants africains de l'armée française, dont certains se sont illustrés dans la résistance.
C'est parfois un peu scolaire, voire démonstratif. Certains dialogues ont pour objectif d'informer les spectateurs, comme lorsqu'on fait dire à l'un des personnages féminins (interprété par Alexandra Lamy, par ailleurs très bonne) qu'elle est d'origine alsacienne.
Je trouve qu'il y a de grands écarts dans la qualité de l'interprétation. Se dégagent nettement Alexandra Lamy et Marc Zinga, qu'on a vu l'an dernier dans Bienvenue à Marly-Gaumont. Beaucoup d'autres ont un jeu correct, mais qui m'est apparu un peu stéréotypé.
Au niveau de la mise en scène, les scènes d'extérieur m'ont paru moins réussies que celles d'intérieur, qui suscitent davantage le trouble ou l'inquiétude. Le travail sur les lumières est très bon.
J'ai aussi apprécié la volonté de ne pas brosser un tableau idéalisé de la résistance et des rapports humains. On ne cache pas l'existence de préjugés racistes, y compris chez les rebelles. Du côté du héros, on voit qu'on n'a pas affaire à un saint. Il est certes courageux, mais impulsif, pas suffisamment réfléchi au départ. Qui plus est, il s'est attiré quelques inimitiés en raison de ses succès féminins...
Le film a aussi le grand mérite de montrer l'ébauche de la formation d'un maquis, avec ses difficultés, et l'importance qu'a eue le S.T.O. dans le recrutement de jeunes hommes. Entre thriller historique et chronique de province, l'auteur ne choisit pas et réussit un assez bel assemblage. Notons qu'il a fallu attendre 60 ans pour que les mérites de Mamadou Addi Bâ soient reconnus.
PS
Deux ouvrages ont inspiré le film. J'ai lu l'un d'entre eux, Le Terroriste noir, de Tierno Monénembo, un auteur africain qui aborde le sujet sous la forme d'un roman, dans lequel le narrateur est l'une de ces jeunes Vosgiennes qui ont côtoyé le tirailleur.
L'intrigue du film s'éloigne quelque peu de celle du roman. Les auteurs ont dû puiser à des sources plus strictement historiques, comme le site internet consacré au tirailleur par un journaliste local, qui a écrit une biographie du soldat-résistant :
23:59 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
mercredi, 28 juin 2017
L'affaire Fualdès à la Une
2017 marque le bicentenaire de l'assassinat de l'ancien procureur impérial Antoine-Bernardin Fualdès, qui fut à l'origine d'une sorte de bourrasque médiatique d'ampleur nationale, la première en France pour un fait divers. Depuis trente ans, à intervalle régulier, des publications évoquent le sujet. Plus rarement, la radio s'est penchée sur l'affaire. Récemment, à deux reprises, c'est Jacques Pradel, sur RTL, qui a donné un coup de projecteur sur l'un des plus retentissants meurtres du XIXe siècle, tout d'abord en mars 2015, puis, de nouveau, le 15 juin dernier, avec pour invité l'historien Jacques Miquel.
Celui-ci a contribué à la création de l'exposition actuellement visible au musée Fenaille jusqu'au 31 décembre 2017 (et dont je parlerai bientôt). Aujourd'hui mercredi, il était cette fois-ci l'invité de La Marche de l'histoire, sur France Inter.
Dans un format aussi court, il était impossible de tout dire. Ceux qui connaissent déjà l'affaire resteront sans doute un peu sur leur faim... mais je pense que c'est le but : susciter la curiosité, pour donner envie de se rendre au musée Fenaille, pour en savoir plus. L'émission aura au moins été l'occasion de faire entendre (partiellement) une version de la Complainte de Fualdès.
22:31 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Politique aveyronnaise, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, actualité, histoire, culture, médias, occitanie, musique, chanson
samedi, 24 juin 2017
Churchill
On peut commencer par dire ce que ce long-métrage n'est pas : ni un biopic, ni un film d'histoire. On va voir qu'il en donne une version très biaisée, tout à l'honneur (ou presque) du personnage principal, le Premier ministre britannique.
Qu'est-ce donc alors ? Une sorte de pièce de théâtre, filmée en partie en décors extérieurs. Elle nous présente les atermoiements du grrrand homme Churchill dans les jours et les heures qui ont précédé le débarquement du 6 juin 1944.
Le film mérite le détour en raison de la prestation des acteurs, au premier rang desquels Brian Cox, très crédible en vieux bouledogue anglais, colérique, alcoolique et amateur de cigares. Il contribue à dresser la statue du grand homme, avec ses forces et ses faiblesses : il n'est plus aussi vaillant qu'autrefois, sa vie de couple part en sucette... et (quand on connaît la suite de l'histoire) il manque un peu de lucidité.
Aux côtés de Cox se distinguent John Slattery (qui excelle à incarner l'Américain Eisenhower, en contraste complet avec le Britannique) et Julian Wadham, très bon en général Montgomery, quintessence de l'officier britannique... qui n'hésite pas à dire son fait à l'arrogant Premier ministre. Cela donne quelques scènes savoureuses... et une autre, empreinte d'émotion, entre le chef du gouvernement et le monarque bègue, James Purefoy ne parvenant toutefois pas à faire oublier le Colin Firth du Discours d'un roi.
En dépit des quelques critiques formulées, cela reste globalement complaisant avec Churchill. De plus, la trame des événements qui se sont déroulés au début du mois de juin 1944 est tronquée, voire déformée. Si Churchill a émis des doutes sur le Débarquement, ce ne fut pas de manière aussi virulente. De surcroît, il manque un personnage dans la galerie des interlocuteurs du Premier ministre à l'époque : Charles de Gaulle. Celui-ci l'a rencontré à plusieurs reprises... mais il n'apparaît à aucun moment dans le film. Il aurait notamment dû figurer dans la scène où Eisenhower expose ses plans à ses alliés. (Même si ce n'est pas un monument d'objectivité, la lecture du deuxième tome des Mémoires de guerre s'impose, en particulier celle du chapitre VI "Diplomatie".)
Le film se garde aussi d'expliquer que, si Churchill tient autant à la progression des troupes en Italie, c'est parce qu'il a un œil sur l'Europe centrale et les Balkans, où il redoute l'arrivée prochaine des Soviétiques. Il voudrait que les Anglo-américains y pénètrent le plus vite possible, quitte à délaisser un peu la France. Et puis le scénario n'aborde pas du tout l'enfumage réussi par les services secrets britanniques, qui sont parvenus, à l'aide (entre autres) d'agents retournés, à convaincre les nazis que le véritable débarquement devait avoir lieu dans le Pas-de-Calais, les opérations de juin 1944 ne constituant qu'un leurre. Le temps gagné grâce à ces manœuvres a contribué à la réussite d'Overlord.
De tout cela il n'est pas question dans ce film partial et incomplet, pourtant servi par une bonne distribution.
01:10 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 23 juin 2017
Le griffon automobile
On connaît le griffon, animal mythologique, généralement représenté sous la forme mi-aigle mi-lion. Il est devenu le symbole d'une marque automobile britannique, Vauxhall. Les spectateurs attentifs de France 2 ont pu noter sa présence lundi dernier, quand a été diffusé l'épisode 6 de la sixième saison de la série Meurtres au paradis (la deuxième partie de "Un homme à la mer") :
Exceptionnellement, cet épisode double a été tourné en partie au Royaume-Uni, où s'est poursuivie l'enquête débutée dans les Caraïbes (tournée en Guadeloupe). Il faut y voir comme un symbole de l'alchimie franco-britannique qui fait le succès de cette série.
En effet, le nom de la marque (Vauxhall) a une origine française. Foulques de Bréauté était un chevalier normand des XIIe-XIIIe siècles, installé à la cour d'Angleterre. Le domaine qu'il occupait, à proximité de Londres, prit son nom : Falkes' (Fawkes') Hall. Les armoiries normandes devaient être présentes en ces lieux. Il n'est donc pas étonnant qu'elles aient inspiré l'emblème de l'entreprise automobile qui se développa des siècles plus tard, dans ce qui était devenu un quartier londonien.
L'histoire industrielle de l'Europe nous a récemment fait un petit clin d'oeil. En raison de l'achat d'Opel par le groupe PSA, la marque Vauxhall se retrouve désormais sous pavillon français !
17:09 Publié dans Economie, Histoire, Presse, Télévision | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, presse, économie, histoire, médias
dimanche, 18 juin 2017
HHhH
Derrière ce titre énigmatique se cache un acronyme, celui (en allemand) de la phrase "Le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich". C'est la reconnaissance du rôle de ce personnage méconnu, Reinhard Heydrich, une des pires ordures du IIIe Reich, dont la renommée n'a pas atteint, dans le grand public, celle de types comme Hitler, Himmler, Goebbels ou Göring. C'est en partie en raison de son assassinat par la résistance tchécoslovaque, en mai 1942. Le film propose à la fois une biographie du chef nazi et une analyse des tenants et aboutissants de son assassinat.
La première partie est assez originale parce qu'elle nous montre l'ascension d'Heydrich, vue de l'intérieur. Le réalisateur Cédric Jimenez (auquel on doit La French) réussit à suivre de près le "héros" sans tomber dans la complaisance. L'excellente interprétation de Jason Clarke (vu récemment dans Enfant 44, Terminator Genisys et La Planète des singes : l'affrontement) aide aussi beaucoup. Bien qu'il ne ressemble guère au véritable Heydrich, il rend totalement crédible son personnage d'implacable nazi, "au cœur d'acier". Cependant, ceux qui (comme moi) verront le film en version française, pourront être gênés par le fait que Clarke ait la voix... d'Anthony DiNozzo (de NCIS), puisqu'il est doublé par Xavier Fagnon.
L'intérêt de cette première partie est de montrer que rien n'est écrit d'avance. Heydrich est un de ces fils de bonne famille engagés dans l'armée (ici la marine), que la situation de l'Allemagne dans les années 1920 laisse sans grand espoir de carrière... surtout que le monsieur a beaucoup de mal à gérer ses pulsions. C'est un peu plus tard que l'on comprend l'insertion d'une scène un peu racoleuse, au début, mais qui finit par prendre tout son sens. La rencontre d'Heydrich avec sa future épouse fait basculer l'intrigue. Elle est remarquablement interprétée par Rosamund Pike (qui était fantastique dans Gone Girl). Elle nous permet de comprendre l'attitude d'une partie des élites allemandes, qui ont vu dans Hitler un sauveur, un homme capable de rendre au pays sa grandeur passée. Mais cette nazie convaincue est un peu trop séduisante à mon goût.
Néanmoins, ce personnage est un bon exemple du rôle que les femmes ont pu jouer. Lui correspond, côté résistance tchécoslovaque, Anna Novak, qui a les traits de la talentueuse Mia Wasikowska (Albert Nobbs, Maps to the stars, Alice - De l'autre côté du miroir). A ses côtés, on peut souligner la présence de Céline Sallette, excellente en mère courage tchèque. Les autres acteurs masculins sont bien, mais ils m'ont moins marqué (allez savoir pourquoi).
Ces personnages de résistants sont au cœur de la seconde partie du film, qui montre l'organisation et le déroulement de l'attentat, ainsi que ses conséquences (la répression et la traque menées par les nazis). Cela contribue à rééquilibrer l'histoire qui, sinon, aurait pu paraître un peu trop en empathie avec le couple nazi. A ce sujet, Jimenez a l'habileté de montrer l'évolution du rapport de force entre Heydrich et son épouse. Lors de leur rencontre et au début de leur mariage, c'est elle qui "porte la culotte". On pourrait même dire que c'est elle qui a "façonné" le futur dirigeant SS. A partir de la guerre, il est devenu le dominant et, si l'on suit le réalisateur, il s'est déshumanisé, complètement bouffé par l'idéologie nazie.
Même si ce film comporte des facilités et, sur la fin, recourt un peu trop au mélodrame, il est une tentative originale de montrer ce que fut le nazisme. Une partie du public y découvrira les prémices de l'extermination des juifs et un très bel hommage à la résistance tchécoslovaque, dont on a peu parlé en Europe de l'Ouest.
15:18 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
samedi, 17 juin 2017
Augustin Alphonse Marty, illustre inconnu
Hier vendredi, au Centre européen de Conques, a démarré un nouveau cycle de conférences, la première (la précédente ayant été annulée en raison d'un problème de transport) étant consacrée à un Aveyronnais qui a joué un rôle important dans l'organisation de la Poste pendant la Première guerre mondiale, Augustin Alphonse Marty. Elle a été prononcée par Sébastien Richez qui, fait exceptionnel, est resté debout pendant toute son allocution, qu'il a su rendre vivante par sa connaissance du sujet et le choix des illustrations qu'il a projetées sur le grand écran de la salle.
On peut qualifier cet Aveyronnais de méconnu parce que, même si son rôle au sein de ce qu'on appelait à l'époque les PTT ne faisait l'objet d'aucun mystère, son identité même a été source d'approximations. Le conférencier a d'ailleurs eu l'humilité de reconnaître que, jusqu'à il y a récemment, il se trompait à propos du prénom de Marty. Comme, dans la plupart des documents officiels le mentionnant, son nom n'était précédé que de l'initiale A, les chercheurs en avaient conclu (un peu rapidement) qu'il se prénommait Alfred. On en a la preuve dans un appel à témoins lancé il y a quelques années sur le site du musée de La Poste :
Cette erreur se retrouve dans des ouvrages dits historiques, mais qui n'ont pas été rédigés par des spécialistes de la question... comme celui-ci :
Précisons que, dans ses articles plus récents (comme ici), Sébastien Richez a corrigé l'erreur et donne désormais la véritable identité du postier aveyronnais. Pour arriver à ce résultat, il a dû fouiller dans les archives de l'entreprise, qui contiennent plus de 300 dossiers au nom de Marty !
Comme le précise son acte de décès (que j'ai trouvé sur la page créée sur un site de généalogie par Michel Roussel, qui, me semble-t-il, était présent à la conférence), Augustin Alphonse Marty est né à Conques le 28 mai 1862. (Un doute subsiste sur le lieu exact : était-ce dans la "maison des sources" ou à Cambelong ? Mystère.)
Son père était... facteur ! En réalité, c'était un ancien soldat (né en 1818), gravement blessé au bras en Algérie, à qui l'on avait attribué cette fonction en compensation du préjudice subi. Mais ce n'était pas une sinécure pour autant. A l'époque, les tournées s'effectuent à pieds, sur plusieurs dizaines de kilomètres... La tournée du père était scindée en deux, s'effectuant sur deux jours.
De son mariage avec Marie Hortense Cadrieu (à Saint-Parthem, pas très loin de Conques) sont issus 8 enfants, Augustin Alphonse étant le sixième. Notons que la lignée n'est pas éteinte. Des descendants (indirects, semble-t-il) se trouvaient hier dans la salle. Un descendant direct habiterait en Loire-Atlantique, mais, d'après le conférencier, il ne s'est pas montré très intéressé par l'histoire familiale...
Sébastien Richez nous a ensuite présenté la carrière d'Augustin Alphonse Marty. Celui qui a fini inspecteur général des PTT a commencé comme simple "surnuméraire" à Blois en 1880 (à 18 ans, donc). On ne sait rien de sa formation ni de ses études. En tout cas, à ses débuts, il a beaucoup bougé, passant à Beauvais (en 1881), Bordeaux (en 1884) et Rouen (en 1886), avant d'intégrer (par concours interne, sans doute) l'Ecole Nationale Supérieure des PTT (ENSPTT), en 1888. C'est le premier tournant de sa carrière. Il en sort trois ans plus tard, deuxième de sa promotion, ce qui lui permet d'accéder à des postes administratifs hauts placés, jusqu'à l'inspection générale, décrochée en 1906, année où il devient chevalier de la légion d'honneur (la décoration est visible sur la photographie qui figure au début de ce billet). Entre 1906 et 1914, il a été chargé de missions spéciales, comme de réfléchir à l'avancement des fonctionnaires ou de traiter de l'abus de bien social commis par le directeur des Postes de la Seine.
Il occupe des fonctions importantes aux PTT à l'époque où la distribution du courrier connaît de profonds changements. A la fin du XIXe siècle les facteurs sont passés à la tournée unique, quotidienne, à vélo. Leur administration prend d'ailleurs en charge l'impôt qui pèse à l'époque sur ce véhicule. Le XXe siècle voit l'arrivée des automobiles (à moteur thermique... ou électrique). Au départ, les PTT ne possèdent pas les voitures, qui sont louées à des compagnies privées. Cette nouveauté permet d'accélérer la levée du courrier dans les boîtes postales dans les grandes villes. Les commerçants sont même incités à en acheter, pour en faire profiter leurs clients.
L'année 1914 est le second tournant dans la carrière d'Augustin. Il est nommé patron des Postes à Paris. Il constate la grande inefficacité du traitement du courrier (par les militaires) depuis la déclaration de guerre. En moyenne, la correspondance entre les soldats et leur famille met 10 à 12 jours à leur parvenir... dans le meilleur des cas. Cela peut prendre parfois plus de deux semaines. Voilà qui lui semble inadmissible, à une époque où, grâce au train, les PTT réussissent à transmettre le courrier classique en deux jours maximum. Marty va être nommé inspecteur général technique de la Poste militaire. En un peu plus d'un mois, il met en place un nouveau système qui permet de diviser par trois le temps d'acheminement du courrier. Huit gares "régulatrices" (reliées par un "train de rocade") sont désignées, entre Paris et le front, divisé en secteurs postaux. Chaque jour, par télégraphe, la position des unités était transmise à ces gares, ce qui permettait de ventiler le courrier trié auparavant par des bataillons de femmes, à l'Hôtel des Postes, rue du Louvre (à Paris) :
Sébastien Richez a émis l'hypothèse que le personnage que j'ai encadré en rouge ci-dessus soit Augustin Marty lui-même, venu poser pour cette photographie de propagande. Il reste que les femmes ont joué un rôle important dans le tri et l'acheminement du courrier (comme factrices). Le conférencier a même trouvé un document extrêmement rare, présentant une femme... au volant d'une automobile des PTT, sans doute sur le quai d'une gare parisienne :
Le traitement du courrier est devenu plus efficace aussi grâce à la modification de l'adresse postale, simplifiée : on a supprimé certaines lignes, la dernière servant au premier tri. Elle comportait le secteur postal. (Il en existait 154 au total, en comptant les fixes et les mobiles.) La cadence a considérablement augmenté : de 500 lettres par personne et par heure, on est passé à 3 000 !
Une autre disposition a rationalisé le traitement du courrier : la séparation des types d'envoi. Les lettres ordinaires et cartes postales étaient traitées rue du Louvre, alors que les recommandés et les paquets postaux (à distinguer des colis, qui n'étaient pas des envois labellisés PTT) partaient à Paris-Conservatoire.
Il est difficile d'établir des chiffres précis sur les volumes totaux traités à Paris, les quantités étant souvent estimées par sac. Pour 1915, on parle de 20 millions d'envois par jour, plus de la moitié consistant en du courrier émis ou destiné aux soldats. Cette prouesse aurait même fait l'admiration de l'ennemi. Peut-être ne s'agit-il là que de propagande (des articles allemands traduits ayant été publiés dans la presse française), mais il semblerait que la mécanique bien huilée mise en place par Augustin Marty ait fait des jaloux outre-Rhin.
Tant de talent et de dévouement méritait bien récompense. Celui qui était chevalier de la légion d'honneur depuis 1906, officier depuis 1913, a été élevé au grade de commandeur en 1920. Un an auparavant, il avait été décoré de la croix de guerre par le maréchal Pétain en personne. Sa dernière grande mission fut de réorganiser les services postaux de l'Alsace-Lorraine tout juste réintégrée, sous les ordres d'Alexandre Millerand, qui allait bientôt devenir président de la République.
De son oeuvre, il a laissé un témoignage dans un livre (aujourd'hui quasiment introuvable), La Poste militaire en France, campagne de 1914-1919, publié en 1922. Il y évoque notamment l'essor du mandat (créé en 1817) pendant le conflit. Ce moyen sécurisé d'envoyer de l'argent (désormais rapidement) a permis aux poilus de transmettre leur solde à l'arrière et aux familles de leur faire parvenir de petites sommes pour améliorer leur quotidien. On attribue aussi à Augustin Marty la création de la Poste automobile rurale (si précieuse dans les campagnes), même si son développement, à partir de 1927, est postérieur à son départ en retraite, survenu en 1924.
Il est décédé le 21 septembre 1940... à Rodez, où il ne résidait sans doute pas en permanence (bien qu'il y eût de la famille). Soit il y était en villégiature, soit il venait rendre visite à son ancien adjoint et ami Lacroix, qui lui habitait le chef-lieu aveyronnais.
P.S.
A ceux qui désireraient en savoir plus, je conseille de patienter jusqu'à l'automne prochain. A cette époque sera publiée la biographie d'Augustin Marty, rédigée par Sébastien Richez. Cette sortie est prévue en même temps que l'édition d'un timbre commémoratif.
12:29 Publié dans Aveyron, mon amour, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, histoire, france, société, culture