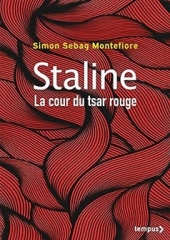mercredi, 27 septembre 2023
Nouveaux meurtres à Sandhamn
La série policière suédoise est de retour sur Arte, avec six épisodes inédits, ceux des saisons 8 et 9. Il y a un peu plus de quatre ans, j'avais signalé la diffusion de la saison 4, l'une des plus réussies. J'ai continué à suivre la série jusqu'à la saison 6. Malheureusement, à l'issue de celle-ci, la distribution a changé, du côté policier : Jacob Cedergren et ses acolytes ont cédé la place à de nouveaux enquêteurs, des personnages beaucoup moins intéressants, plus caricaturaux, qui m'ont fait lâcher le programme.
Je n'en aurais pas reparlé si je n'avais pas vu Esther, le deuxième épisode de la saison 9 et le cinquième des six nouveaux proposés par la chaîne franco-allemande.
J'ai retrouvé avec plaisir ce faux rythme lent, qui suit en fait une ligne scénaristique habilement sinueuse. (Ce n'est hélas pas le cas de tous les épisodes.) Tout commence quand un groupe d'adolescents chrétiens (qui cherchent à épicer leur retraite spirituelle), fait une macabre découverte, sur une île appartenant à une communauté religieuse. Cette découverte impose la réouverture d'une enquête vieille de trente ans, sur la disparition de trois ados, deux garçons et une fille, dans des circonstances jamais élucidées, les cadavres n'ayant pas été retrouvés.
J'ai aimé l'alternance entre les scènes du XXIe siècle et celles, plus anciennes, montrant certains personnages alors beaucoup plus jeunes. Parmi eux se trouvent l'héroïne de la série, la procureure Nora Linden (Alexandra Rapaport), et son ex-mari Henrik, qui vient de devenir, à l'époque, son petit ami. C'est touchant, parce qu'on suit alternativement un couple naissant, charmant, et un duo d'ex, qui ne s'entendent plus aussi bien. Les acteurs sont convaincants... en tout cas plus que ceux qui incarnent les policiers. Que ce soit en V.O. ou en V.F., j'ai du mal avec ces enquêteurs peu charismatiques au possible.
En revanche, l'intrigue policière est palpitante, faisant intervenir un pasteur, son ex-femme devenue prof de yoga, un religieux défroqué, une ancienne gamine jalouse, le tout entre le sud de la Suède (paysages superbes) et... l'Estonie (qui est très proche de la Finlande, voisine de la Suède).
Cet épisode, déjà disponible en ligne, va être diffusé sur Arte vendredi 29 septembre... en même temps que Nouvelle-Zélande - Italie. Les All Blacks ont beau proposer un jeu spectaculaire, je conseille de choisir le polar !
22:43 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
dimanche, 24 septembre 2023
France 3 soutient ouvertement l'immigration illégale...
... avec des fonds publics ! J'ai failli tomber de mon fauteuil, ce soir, en regardant Meurtres à Font-Romeu, énième épisode d'une collection qui alterne l'acceptable et le moins bon. Mais, ça, c'est sur le plan technique : des comédiens approximatifs, des dialogues écrits avec les pieds, des rebondissements abracadabrantesques... mais de beaux paysages et, parfois, un scénario bien troussé.
L'épisode inédit de ce soir respecte le cahier des charges de la série : un duo d'enquêteurs qui, au départ, ne s'entend pas, va unir ses forces pour résoudre une ténébreuse affaire, sur fond de paysages superbes, dans une province où les langues ne se délient pas facilement. Cette fois-ci, hélas, on n'a pas de légende locale (ni d'anecdote historique marquante) à se mettre sous la dent.
La distribution comprend du lourd (sur le plan télévisuel... le budget n'est tout de même pas illimité) : Béatrice de La Boulaye (remarquée dans Tropiques criminels) côtoie Stéphane Henon, issu lui d'un programme iconique de la chaîne publique : Plus belle la vie. C'est dire l'importance que la direction des programmes accorde à ce téléfilm. (La titulaire du poste, Anne Holmes, s'est fait la main en supprimant des séries parmi les plus populaires des chaînes publiques -Mongeville et Commissaire Magellan- sans doute jugées pas assez dans le coup de la "modernitude"...)
Déjà, le côté enquête policière n'est pas des plus réussis. On nous ressert le coup de la Parisienne -forcément dynamique- qui débarque dans une rugueuse province et qui se retrouve avec un collègue plutôt taiseux. Il faut plaindre B. de La Boulaye, pas uniquement en raison de l'horrible coupe de cheveux dont est affublé son personnage :
En effet, la comédienne, qui pouvait légitimement penser qu'on lui réservait le rôle phare, se retrouve à jouer les faire-valoir du principal interprète masculin, incarnant un officier de gendarmerie qui... aide les migrants clandestins !
Les promoteurs de l'épisode se sont bien gardés d'informer le public de la teneur de cette intrigue secondaire, qui prend de plus en plus de place au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Seule une courte bande-annonce a été diffusée, en avant-première, dans laquelle il est impossible de deviner ce qu'on s'apprête à nous servir.
L'enquête gendarmesque prend un tour pas du tout crédible, certains personnages secondaires étant mal campés. Même l'enquêtrice est mise dans des situations qui prêtent à sourire : par une soirée glaciale, elle épie son collègue pendant plusieurs heures, sans s'être emmitouflée, ses vêtements restant ouverts au niveau du col !
Ce soir-là comme la nuit suivante (quand elle prend son collègue en filature), elle est d'une absence de discrétion consternante pour un officier supposé chevronné.
En revanche, les scénaristes semblent s'être appliqués à rendre les migrants les plus sympathiques possibles. Tous sont calmes, gentils, craintifs. Au besoin, on tente d'attendrir les spectateurs avec les enfants, de manière limite putassière (le coup du gamin qui fait tomber son jouet au moment de fuir une intervention de la gendarmerie...). Que tout cela est lourd, appuyé !
Ah, j'allais oublier : on finit par apprendre que le capitaine de gendarmerie a entretenu une liaison avec une sans-papier... Par-dessus le marché, le commandant qui a le capitaine dans le viseur et qui mène la chasse aux migrants s'appelle... Hicham Naouri ! N'en jetez plus, la coupe de la bien-pensance est déjà pleine !
P.S.
Sans surprise, la personne qui a commis les meurtres est blanche, de culture catholique.
00:41 Publié dans Société, Télévision | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : société, télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
dimanche, 17 septembre 2023
Les (nouveaux) carnets de Max Liebermann
Cette série autrichienne, tournée en anglais, est de retour sur France 3, où elle a le grand avantage de remplacer l'insipide commissaire Dupin. J'avais découvert ce programme il y a deux ans et demi mais, déçu par le tour pris par certains épisodes, je n'avais pas suivi la saison 2. J'avais tort. Celle-ci est actuellement rediffusée en deuxième partie de soirée, après les épisodes inédits de la saison 3. Le tout est visible en replay de longue durée sur le site de France Télévisions.
Commençons par la saison 2. La semaine dernière a été diffusé La Comtesse mélancolique (disponible pendant encore trois semaines environ).
L'apparent suicide d'une riche comtesse cache un meurtre que l'exploration du cerveau humain va permettre aux enquêteurs de résoudre. Le jeune psychanalyste Max Liebermann n'a pas eu le temps de découvrir la source du traumatisme subi jadis par sa patiente, désormais décédée. Mais, avec l'inspecteur Oskar Rheinhardt, il va apprendre qu'un traumatisme peut en cacher un autre. L'intrigue est excellemment construite, superbement mise en images et interprétée avec talent.
Ce soir, c'est au tour du deuxième épisode de la saison 2 d'être rediffusé... et il est sensationnel. Le Baiser du diable (visible pendant un mois) nous entraîne dans les méandres de la géopolitique d'Europe centrale, au début du XXe siècle, juste avant le déclenchement des Guerres Balkaniques (annonciatrices de la Première Guerre mondiale).
Tout commence par la découverte, en apparence fortuite, du cadavre d'un homme disparu une vingtaine d'années auparavant. Très vite, l'inspecteur Rheinhardt est prié de se détacher de l'enquête, qui a des implications qui le dépassent. Mais il semble disposer d'un informateur privilégié. Dans cette histoire, (presque) rien ni personne ne semble conforme aux apparences. Dans l'ombre agit la Main noire (serbe), tandis que Liebermann essaie de faire parler une petite fille traumatisée. Le dénouement est stupéfiant. (Je me dois toutefois de signaler un petit anachronisme : la Main noire n'a été créée officiellement qu'en 1911, alors qu'ici l'action se déroule en 1908.)
Passons aux inédits. La semaine dernière a été diffusé le premier épisode de la saison 3 : Étreinte mortelle (qui restera accessible en ligne pendant plus de deux ans).
On y retrouve Max Liebermann, désormais confortablement installé dans son cabinet privé. Il s'est un peu éloigné des enquêtes policières. Mais une affaire particulière va le rapprocher de l'inspecteur Rheinhardt. De jeunes femmes sont victimes de meurtres machiavéliques, assassinées au cours d'un rapport sexuel consenti... La psyché du criminel fascine le psychiatre, qui devient aussi l'objet de l'attention du tueur. Notons que l'intrigue a pour cadre principal le milieu de la mode, au début du XXe siècle.
Ce soir est diffusé l'épisode 2, Le Dieu des ombres. Deux affaires s'entrecroisent : de mystérieux vols commis chez de riches propriétaires de mobilier chinois et le cas d'un malade particulier, ancien soldat du corps expéditionnaire européen à Pékin, traumatisé par la Révolte des Boxeurs, quelques années plus tôt.
Ce n'est pas le meilleur du lot, mais il est fidèle au style et aux qualités de la série, réalisée avec soin et s'appuyant sur un sympathique duo d'acteurs principaux : Matthew Beard (le psy) en intellectuel raffiné et Jürgen Maurer (l'inspecteur) en ours mal léché. L'ambiance se situe quelque part entre Les Enquêtes de Murdoch et Les Brigades du Tigre.
18:02 Publié dans Histoire, Télévision | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : télévision, télé, actu, actualite, actualites, actualité, actualités
samedi, 16 septembre 2023
Le Château solitaire dans le miroir
Bien placée dans la course du film au titre le plus long sorti en France cette année, cette animation japonaise est assez étonnante, en raison du croisement des genres qu'elle opère. Sur le fond, il s'agit d'une œuvre sociétale, qui traite de la phobie scolaire et du harcèlement, entre autres. Mais le traitement s'effectue par le prisme d'une intrigue fantastique.
Les héros sont sept adolescents, tous collégiens (même si certains ont plutôt un physique de lycéens), tous japonais, tous (sauf un) réfugiés au domicile de leurs parents. Par le biais de miroirs magiques, ils vont se retrouver, à intervalle régulier, pendant un an, dans un mystérieux château, perché sur une île-rocher perdue au milieu de nulle part, avec pour hôtesse une mystérieuse reine-louve, apparemment une enfant portant un masque, mais qui semble diablement mûre (et forte) pour son âge. Elle assigne une mission au groupe : trouver une clé dissimulée dans le château. Elle permettra à l'un(e) d'entre eux de réaliser son vœu le plus cher.
Des sept nous suivons surtout le parcours de Kokoro, fille unique d'un couple de cadres urbains, scolarisée dans un collège public où elle est devenue le souffre-douleur d'une bande de pétasses. Au fil de ses séjours dans le château, elle découvre qu'elle a d'autres points communs avec ses six compagnons, qui vont devenir des amis. Mais pourquoi ont-ils été réunis là ? Et comment trouver la clé ?
Le mystère semble dans un premier temps s'épaissir (l'existence d'univers parallèles ne tenant pas la route). Sans me vanter, j'ai assez vite deviné le twist... ainsi que l'identité réelle de la reine-louve. Cela n'a nullement entamé mon plaisir, puisque le scénario (adapté d'un roman) est foisonnant, ouvrant de multiples perspectives.
La réalisation est cependant inégale. La majeure partie des scènes est assez plan-plan. Toutefois, dès qu'il est question d'une surface réfléchissante (miroir, glace, vitre...), on remarque un incontestable brio.
C'est visible par les petits et les grands. Je pense que le film est conçu pour susciter des discussions dans les familles... et c'est aussi une histoire particulièrement énigmatique, pour qui aime se triturer les méninges.
PS
Du réalisateur, Keiichi Hara, on a déjà pu voir dans les salles : Wonderland, le royaume sans pluie, Miss Hokusai et Colorful.
23:08 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
vendredi, 15 septembre 2023
Mystère à Venise
Jamais deux sans trois... Un an et demi après Mort sur le Nil (qui succédait au médiocre Crime de l'Orient-Express), Kenneth Branagh revient en Hercule Poirot, adaptant (très très librement) cette fois-ci Le Crime d'Halloween, l'intrigue étant déplacée à Venise, ce qui nous vaut quelques jolis plans (surtout à la fin).
Comme dans les précédents films, le casting secondaire est impeccable. Du côté féminin, j'ai été marqué par Kelly Reilly et Camille Cottin (qui confirme la qualité de son basculement à l'international, déjà perçu dans Stillwater). Du côté masculin, on peut signaler les prestations de Jamie Dornan et de Jude Hill, stupéfiant en gamin à la maturité précoce.
Je suis moins enthousiasmé par le duo d'enquêteurs, incarné par K. Branagh et Tina Frey, celle-ci tenant le rôle d'Ariadne Oliver, le double littéraire d'Agatha Christie.
Leurs interactions sont parfois savoureuses (l'écrivaine s'étant autoparodiée et profitant aussi de l'occasion pour se moquer de son célébrissime détective, qui avait peut-être pris trop d'importance à ses yeux)... mais, clairement, les comédiens, aussi talentueux soient-ils, n'ont pas le charisme de Zoë Wanamaker et David Suchet, qui tenaient ces rôles dans la série d'ITV.
Fort heureusement, la photographie est soignée et l'intrigue fouillée, croisant l'univers d'Agatha Christie avec le surnaturel. C'est suffisamment bien écrit pour que chaque type de spectateur s'y retrouve : les rationalistes estimeront que toutes les réponses ont été données à la fin de l'enquête (principalement par Poirot), tandis que les adeptes de paranormal affirmeront qu'il y a bien eu intervention surnaturelle.
Je crois que les puristes n'ont pas trop apprécié ce mélange des genres. J'ai trouvé cela plutôt réussi, même si je pense que le film aurait pu avoir plus de force sans cet attirail tape-à-l'oeil. De surcroît, Branagh aurait pu se dispenser de certains effets de caméra, en particulier quand il se filme sans doute équipé d'un harnais et d'une sorte de caméra GoPro (en plus évoluée).
Comme cela dure moins d'1h45 et que le suspens est assez prenant, j'ai tendance à recommander ce film, en dépit de ses imperfections.
16:23 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 09 septembre 2023
Equalizer 3
Cinq ans après le volume 2, revoilà Robert McCall dans ses œuvres... à ceci près que, dorénavant, l'ancien employé de magasin de bricolage, ancien chauffeur VTC... et surtout ancien tueur à la solde d'Oncle Sam est à la retraite. Il coule des jours paisibles dans un coin de l'Italie... qu'il découvre pas si bien fréquenté que cela.
Cette fois-ci, ce sont des mafieux (d'abord siciliens, puis napolitains... faites la queue, les gars, y en aura pour tout le monde) qui vont tâter des méthodes expéditives de l'ange exterminateur américain.
Mais le réalisateur Antoine Fuqua prend son temps avant de nous montrer le héros en action. Il surprend agréablement avec la séquence inaugurale, durant laquelle, dans un premier temps, on ne découvre que les conséquences du passage de la tornade exterminatrice (avec un joli plan-séquence à la clé). C'est tout aussi parlant qu'une scène d'action chorégraphiée. Autre atout de cette introduction (annonciateur du ton du film) : le mystère qui plane autour de l'identité ou des motivations de certains personnages. Ici, c'est à propos d'un père et de son fils que l'on se pose des questions. Entre le début et la fin de la séquence, ils auront totalement changé de statut à nos yeux.
Denzel Washington se faisant vieux, Fuqua ne pouvait plus le faire passer pour un as du corps-à-corps... mais il lui a laissé la maniaquerie et une incontestable dextérité dans le maniement des armes, qu'elles le soient par nature ou par destination. Les quelques scènes de combat sont impeccablement réalisées.
Il m'a aussi semblé que la bobine du héros avait été volontairement un peu "retravaillée". Parfois, le visage de Denzel est presque difficile à reconnaître. Il devient une sorte de colonel Kurtz de la lutte contre le crime organisé. Cet aspect est une nouveauté et je trouve qu'il donne une saveur supplémentaire au film.
S'ajoute à cela un scénario assez bien troussé (émaillé d'humour), qui ménage quelques surprises. A noter que la version originale marie l'anglo-américain et l'italien. C'est un plaisir pour les oreilles.
J'ai passé un excellent moment.
22:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 02 septembre 2023
Joseph Staline et sa Cour
Arte a récemment rediffusé le film La Mort de Staline (que j'avais chroniqué à sa sortie, en 2018). Il est visible sur le site internet de la chaîne pendant encore quelques jours.
A celles et ceux qui n'auraient jamais vu cette coproduction franco-britannique, je conseille vivement de remédier à cette lacune, de préférence en version originale (anglaise) sous-titrée. Cela permet de mieux profiter du talent des interprètes, qui ont su parfaitement rendre compte de l'ambiance tragi-comique des derniers jours du tyran communiste et de la "course à l'échalote" qui a suivi son décès.
Je profite de l'occasion pour signaler la réédition d'un ouvrage historique remarquable, Staline, La Cour du tsar rouge, de Simon Sebag Montefiore. Sorti au début du XXIe siècle, ce pavé de plus de mille pages avait rencontré un grand succès. En français, on en connaissait une édition de poche, en deux tomes. Pour les soixante-dix ans de la mort de Staline (décédé en mars 1953), les éditions Perrin ont ressorti le bouquin, dans une version "semi-poche" de luxe (sur un papier de qualité) :
La lecture est vraiment aisée. C'est bien écrit (bien traduit ?), divisé en chapitres assez courts, disposés grosso modo de manière chronologique, de 1928-1929 à 1953. Une conclusion prolonge jusqu'au XXIe siècle, les descendants des dirigeants staliniens (du moins, ceux qui ont survécu) s'étant très bien intégrés à la Russie poutinienne. Les notes érudites sont repoussées en fin de volume. Si l'on veut en savoir plus, il est utile de les lire, mais le bouquin se savoure très bien sans.
Attention : ce n'est ni une biographie, ni une histoire de l'URSS, ni une analyse stricte des mécanismes de la dictature stalinienne... mais tout cela figure dans le livre. L'originalité de l'auteur est d'avoir choisi l'angle des relations entre les familles des dirigeants bolcheviks (certains connus, d'autres moins). C'est à la fois instructif et riche en anecdotes.
Je pense que les scénaristes de La Mort de Staline et de la bande dessinée d'origine se sont inspirés du livre de Montefiore, même s'ils s'en écartent un peu de temps à autre (pour mieux servir leurs effets comiques ou dramatiques).
J'ai longtemps rechigné à me plonger dans le bouquin (à cause de son volume). Ce fut mon "pavé de l'été" (coucou dasola)... et je me suis régalé.
14:32 Publié dans Cinéma, Histoire, Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire, television, télévision, télé
lundi, 28 août 2023
La Coupe du monde mise en pièces
Dans un peu plus d'une semaine, de grands malabars musclés originaires de tous les continents vont commencer à se rentrer dedans, en short, sur gazon vert. Le début de la Coupe du monde de rugby (à XV) approche... et c'est en faisant mes courses que je m'en suis rendu compte :
J'ai récupéré une pièce de deux euros, dont, curieusement, la Monnaie de Paris ne signale la disponibilité qu'à partir du... 8 septembre !
Au centre est dessiné un joueur sur le point de réaliser une passe (à la main). On note la présence des deux doubles poteaux, alors que le terrain a été remplacé par le globe terrestre, sans qu'il soit possible de distinguer de quel hémisphère il s'agit. (Dans le ciel semble être présente la planète Saturne, qui est visible des deux hémisphères. La faible hauteur -par rapport à la surface terrestre- pourrait indiquer que nous sommes dans l'hémisphère Nord.)
Le texte principal est gravé deux fois : en arc de cercle au-dessus de la scène et, en petits caractères, en bas à gauche. On repère aussi, en bas à droite, les majuscules RF (symboles de la France), ainsi que, semble-t-il, une corne d'abondance (à gauche)... et peut-être le poinçon du graveur ou de l'imprimerie, à droite.
18:20 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sport, sports, rugby, actu, actualite, actualites, actualité, actualités, france
Hypnotic
L'intrigue de ce thriller fantastique ne repose pas tant sur l'hypnose (au sens strict) que sur la faculté de tromper, de mystifier voire d'annihiler la volonté d'autrui que possèdent certains individus. Cette capacité semble être à l’œuvre lors de l'intervention à laquelle participe un officier de police, qui sort de chez sa psy. Le traumatisme qu'il a naguère subi (la disparition de sa fille) joue un rôle clé dans l'intrigue, mais l'on met un bon bout de temps à comprendre les dessous de l'affaire...
... parce qu'on nous mystifie nous aussi, spectateurs ! Il faut se méfier de ce que l'on nous montre à l'écran, y compris quand un personnage dénonce une manipulation. Il peut y avoir mystification dans la mystification, avec, cerise sur le gâteau, l'effacement de certains souvenirs et l'implantation d'autres, fictifs.
Cela ne vous rappelle rien ? Inception, bien sûr. Certes, Robert Rodriguez n'est pas aussi talentueux que Christopher Nolan (et Ben Affleck est plus convaincant dans la première partie de l'histoire que dans la seconde, où son personnage change de statut), mais j'ai trouvé les critiques bien sévères pour ce très honnête film de genre. Entre le brio de Nolan et le navet intersidéral (qui se porte bien dans les salles françaises), il y a de la place pour des films de qualité, divertissants. Celui-ci entre dans cette catégorie... mais il nécessite un peu de gymnastique intellectuelle, dans sa seconde partie.
P.S.
A la fin de la séance, ne quittez pas la salle trop vite...
13:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 24 août 2023
Retribution
Et c'est reparti pour un tour avec ce bon vieux Liam Neeson, que je n'avais pas vu en salles depuis un bail février dernier, dans Marlowe.
Avis à celles et ceux qui attendent un énième film de baston, dans lequel un héros vieillissant va flanquer une raclée à quelques dizaines centaines de sales types : ce n'est pas le cas ici. (Pour cela, il va falloir patienter jusqu'à la sortie d'Equalizer III.) Les scénaristes ont enfin pris en compte les effets de l'âge sur Liam. Ici, tout (ou presque) se passe dans des voitures, l'essentiel se concentrant dans le SUV de luxe du héros Matt Turner (dont on ne cesse de voir la marque à l'écran) et dans les téléphones qu'il utilise.
Ce n'en est pas moins spectaculaire pour autant. Il y a évidemment des poursuites automobiles (dans les rues de Berlin)... l'une d'entre elles montrant le héros échapper, un peu par miracle, à toutes les polices locales. Mais l'essentiel de la tension dramatique réside ailleurs : dans le jeu macabre avec un mystérieux maître-chanteur, qui a piégé le véhicule de Matt (ainsi que d'autres... mais combien ?).
Au niveau de l'intrigue, il est question de détournement de fonds. L'acteur-vedette incarne un type qui se veut droit, mais qui, pour gagner sa vie, doit mettre en confiance ses potentiels clients... voire leur mentir. Bien entendu, un complot est à l’œuvre. On peut s'amuser à essayer de deviner qui est derrière. (Ce n'est pas très compliqué.)
Un Liam Neeson convaincant (parfois même émouvant) et un montage nerveux rendent le film tout à fait visible. Il n'y a rien de bien nouveau dans cette histoire et certaines péripéties sont un peu téléphonées (!) mais, comme le boulot est bien fait, les 90 minutes passent vite, assez agréablement, sans plus.
10:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 23 août 2023
Les Avantages de voyager en train
Mes pérégrinations estivales (et la perspective de passer un moment agréable en zone climatisée) m'ont conduit à voir ce film, sorti il y a deux semaines, de manière confidentielle. C'est l'adaptation d'un roman espagnol, réputé foutraque.
La première partie fonctionne sur la base d'un emboîtement de récits. Un narrateur évoque une rencontre dans un train, celle d'une éditrice et d'un médecin. Celui-ci, pour passer le temps, propose de lui parler d'un de ses anciens patients, signalé par sa sœur. Ce soldat avait été déployé au Kosovo, pendant la guerre, à la toute fin du XXe siècle. Il a été traumatisé par les événements racontés par une travailleuse humanitaire, elle-même informée par un homme d'affaires, qui a été témoins d'horreurs.
Sur le plan formel, c'est assez brillant, mis en scène avec plus de subtilité que ce que je viens d'écrire suggère. Mais, sur le fond, c'est assez putassier et très pessimiste sur la nature humaine. Toutefois, au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on est amené à remettre en cause une partie des histoires. C'est assez savoureux, pour peu qu'on ait été attentif au début.
Je suis beaucoup moins enthousiaste envers la deuxième partie, qui raconte un asservissement progressif, celui d'une femme, mais mis en scène de manière dégradante (je trouve) pour le personnage et la comédienne (Pilar Castro, vue notamment dans Compétition officielle et Julieta). Cette séquence permet toutefois de mettre en perspective une partie de ce qui a été dit par le personnage d'Helga au début du film.
La troisième partie commence comme une belle histoire, celle de deux handicapés qui se rapprochent progressivement... mais je n'ai pas vu l'intérêt de son insertion dans l'intrigue.
La quatrième partie est celle qui remet le plus de choses en questions. Elle fait singulièrement remonter l'intérêt. Le film se conclut sur un ultime clin d’œil.
17:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
lundi, 21 août 2023
Ninja Turtles - Teenage Years
Un peu moins de dix ans après le reboot (tourné en prises de vues réelles, avec des comédiens en chair et en os et beaucoup de trucages numériques), voilà que Nickelodeon tente de relancer la machine à cash, avec un nouveau film, mais d'animation cette fois. Celui-ci navigue entre références au passé et style urbain contemporain, la parenté avec le dernier Spider-Man (across the spider-verse) étant frappante.
Au niveau des voix de doublage (dans la version originale), on a pris du lourd, puisqu'on entend Ice Cube, John Cena, Rose Byrne... et Jackie Chan, qui donne vie à Splinter, un rat maître en arts martiaux. Les séquences qui font intervenir ce personnage sont d'ailleurs très réussies, dynamiques et drôles... mais, visuellement, je préfère quand même la version du reboot de 2014.
Le début nous conte le genèse des mutants, les tortues, le rat... mais aussi les autres, leurs futurs adversaires/potes : une mouche-tueuse et quantité d'animaux plus ou moins dégoûtants... mais c'est cool à regarder !
Historiquement, les tortues-ninjas sont un décalque de population mise à l'écart, un statut dans lequel les minorités ethniques peuvent se reconnaître, aux États-Unis. Ici, quand les mutants tentent de se mêler aux humains, parmi les habitants de New York, ils sont victimes de racisme de la part d'une population fortement métissée. Le message sur la tolérance n'en prend que plus de force. Je regrette toutefois que la grande méchante de l'histoire soit une fois de plus une femme blanche qui, dans la VO, s'exbrime aveg un bedit agzent chermanique.
Visuellement, c'est bien foutu. L'intrigue est rythmée... un peu trop peut-être à mon goût : j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour savourer certaines scènes. La musique est globalement entraînante (exception faite de quelques morceaux de rap). Les héros aiment la good vibe et les pizzas. Ils ne sont pas vindicatifs, ni antipathiques, même si parfois ils se font passer pour de gros durs.
Voilà. Cela dure nettement moins longtemps que la plupart des grosses productions sorties cet été. On ne s'ennuie pas, mais on aura sans doute assez rapidement oublié.
18:56 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
dimanche, 20 août 2023
Les Ombres persanes
Il paraît que l'idée que nous ayons tous au moins un sosie sur la planète serait une légende urbaine... alors imaginez quand un couple iranien découvre que, dans la même ville (Téhéran), vit un autre couple, physiquement en tout point semblable !
J'ai enfin pu voir ce thriller sociétal iranien... dans une salle climatisée, ce qui m'a fait le plus grand bien, en ces temps caniculaires. Mais ce ne fut pas la seule source de contentement. Ce film est jubilatoire, d'une richesse et d'une finesse étonnantes.
Si les deux couples sont de quasi-copies sur le plan physique (les personnages étant interprétés par les mêmes acteurs, qui se livrent à un sacré numéro, soit dit en passant), sur le plan moral, les caractères des deux femmes comme des deux hommes diffèrent fortement. Sur le plan social, on a affaire à deux franges de la classe moyenne : le couple n°1 est composé d'un employé commercial et d'une monitrice d'auto-école, alors que le couple n°2 est composé d'une ancienne infirmière (devenue femme au foyer) et d'un cadre supérieur d'une grosse entreprise (à moins qu'il ne s'agisse d'un haut fonctionnaire). Mine de rien, le cinéaste Mani Haghighi pointe certaines inégalités sociales... et (indirectement) le statut des femmes, dans une société patriarcale. (Mais ce n'est pas le propos principal du film.)
La mise en scène est pleine de malice. Ainsi, lorsque Farzaneh, l'épouse du couple 1, voit son mari (infidèle ?) entrer (de nouveau, pense-t-elle) dans un immeuble où réside une autre femme, elle attend d'abord à l'extérieur, à côté de son véhicule. Une petite ellipse survient. On se retrouve dans les escaliers internes de l'immeuble, où l'époux n°1 est pris pour l'époux n°2... mais, surtout, un gros quiproquo surgit concernant l'identité d'une des femmes présentes.
Cette confusion de personnes nous est resservie en toute fin d'intrigue, dans un autre contexte. Je n'en dis pas plus, même si, dans ce cas, on voit venir la supercherie.
Évidemment, on se demande comment une telle double ressemblance est possible. Les deux épouses sont nées la même année, le même mois. Seraient-elles des jumelles ? Concernant les époux, c'est moins précis. Le seul parent survivant, le père de l'époux n°1, affirme aux grands dieux qu'il n'a jamais eu qu'un seul fils.
Fort heureusement, le film ne se limite pas à ce questionnement. La subtilité du jeu des acteurs nous fait comprendre que, petit à petit, quasi imperceptiblement, quelque chose semble naître, ouvrant le champ des possibles.
Dans un premier temps, la ressemblance entre les deux hommes est utilisée pour résoudre le gros problème rencontré par l'époux n°2. De chaque côté, on se rend compte que, si la supercherie est bien préparée, (presque) personne ne remarque quand il y a substitution d'époux. Cela débouche sur une deuxième partie assez inattendue, avant que ne survienne un petit coup de théâtre, à un gros quart d'heure de la fin.
J'ai été pris, du début à la fin. Ce sera à coup sûr un de mes films de l'année.
21:25 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
Rendez-vous à Tokyo
Ce film nous conte une histoire d'amour, dans le Japon urbain du début du XXIe siècle, en sept épisodes (à l'image des sept pas de danse qu'esquisse le couple, le soir de la rencontre)... sauf que ces sept chapitres nous sont montrés dans l'ordre chronologique inverse. Chacun se déroule le même jour, le 26 juillet (à chaque fois d'une année différente, bien sûr), qui est aussi le jour de naissance du héros.
On commence par l'année 2021, celle des Jeux Olympiques, alors que la pandémie de covid fait encore sentir ses effets. L'ancien danseur Teruo est désormais éclairagiste, dans une salle de spectacle. Il assiste à une représentation de danse, avec une nouvelle vedette féminine, qui ne le reconnaît pas. De son côté Yo est (toujours) chauffeuse de taxi, dans une compagnie assez prestigieuse. Ce soir-là, elle prend en charge un client qui lui rappelle quelque chose... Les deux anciens amoureux vont-ils se retrouver ?
Le deuxième chapitre se déroule sans doute un an auparavant, en pleine pandémie. Teruo est contraint au télétravail, tandis que Yo a mis en place des protocoles stricts pour pouvoir continuer à exercer son métier. Financièrement, c'est un peu difficile pour elle. Elle ne semble pas penser à son ancien amour (pas plus que Teruo, d'ailleurs).
Le troisième chapitre nous ramène un peu en arrière, à une époque où chacun tente de refaire sa vie de son côté. Yo est embarquée par des copines dans une soirée avec des mecs pas subtils, tandis que Teruo croise par hasard une ancienne élève de son école de danse, qui lui fait bien comprendre qu'elle est désormais majeure et qu'elle s'intéresse bigrement à lui...
La quatrième séquence est celle de la rupture entre Yo et Teruo. Elle est furieuse qu'il se replie sur lui depuis sa blessure au pied, tandis que lui se désespère de ne pas être compris. On sent qu'ils pourraient se rabibocher mais, comme on a déjà vu la suite, on comprend pourquoi cela ne va pas se faire. C'est d'ailleurs l'un des intérêts de ce film : analyser une séquence antérieure à partir de ce que l'on déjà de ce qui va suivre... et aussi, quand on a un peu de mémoire, mieux comprendre ce que l'on a vu auparavant (comme l'histoire de l'homme du parc ou le rôle de la mystérieuse borne funéraire, devant laquelle les personnages s'inclinent).
Le cinquième chapitre montre le couple bien installé, lui danseur prometteur, elle conductrice dans une petite compagnie de taxi. Ils habitent ensemble, dans cet appartement qui sert de point de départ à chaque historiette, avec ce chat qui n'arrête pas de rajeunir et l'affiche d'un film de Jim Jarmush (dont des extraits sont visibles dans plusieurs séquences). On n'est peut-être pas très loin du mariage. On commence à évoquer la possibilité d'avoir un enfant. Quand on connaît la suite, c'est assez poignant.
Le sixième chapitre tourne aussi autour du couple, qui ne s'est pas encore mis en ménage. Yo est jalouse, elle voit certaines apprenties danseuses tourner autour de Teruo. Celui-ci ne semble pas savoir s'il doit donner la priorité à la danse où à cette histoire d'amour qui commence à devenir sérieuse. On évoque la possibilité d'habiter ensemble.
Le septième chapitre relate la rencontre. On l'attendait avec impatience. C'est un peu à l'image d'une histoire d'amour que l'on a vécue intensément et qui s'est achevée. On aime à en retrouver les prémices. Cela se passe un soir, à l'issue d'un spectacle à moitié réussi et d'un cocktail plus ou moins ennuyeux. Mais cela se poursuit par une discussion enjouée dans un petit bar (géré par un patron philosophe, que l'on voit dans presque chaque séquence) et quelques pas de danse dans la rue...
Cela aurait pu s'arrêter là, le chapitre initial (qui est le dernier, dans l'ordre chronologique) laissant le champ des possibilités ouvert. Le cinéaste a peut-être voulu imposer sa conclusion (ou on lui a demandé de terminer de manière plus traditionnelle, pour ne pas trop perdre le public). En tout cas, l'histoire s'achève de manière touchante, délicate, à l'image du film.
00:26 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 18 août 2023
Blue Beetle
Je ne connaissais pas ce super-héros de comic books, mais je me suis laissé tenté par un film d'action nourri d'humour et d'effets spéciaux.
Cependant, le début est bourré de clichés, avec une famille de Latino-américains forcément haute en couleur... et limite cassos. On y est très croyant et les dialogues alternent l'anglais, l'espagnol voire un mélange des deux (le spanglish). Ça, c'est plutôt pas mal, mais les personnages sont caractérisés à la louche. La mère est assez autoritaire et protectrice, le père malade d'avoir travaillé comme un dingue toute sa vie, la grande-mère un peu zinzin va se révéler tenace... mais le pire vient du tonton blagueur et complotiste, agaçant et ridicule... et qui va prendre de plus en plus de place dans l'intrigue. J'ai finalement préféré les jeunes : le héros, Jaime, un garçon bien élevé, un chic type et sa sœur Milagros, un peu moins "politiquement correcte". Sans surprise, le héros va s'amouracher d'une bomba latina... qui, elle-même, n'est pas insensible à son charme. De ce point de vue-là, aucune surprise n'est à attendre.
Le meilleur vient quand le fameux scarabée (d'origine extraterrestre) se réveille et choisit son nouvel "hôte"... et quand je dis « choisit », cela signifie « pénètre »... pas par les oreilles, ni les narines, ni la bouche... eh, oui ! Blue Beetle nous présente un cas unique, où le principal personnage masculin devient un super-héros par... sodomie ! Je dois dire que j'ai été agréablement surpris par ce détail croquignolesque, même si, sur le plan de la vraisemblance, c'est nul. Après être entré dans le corps de son hôte, le scarabée remonte... le long de sa colonne vertébrale, et non du tube digestif... le tout, sans provoquer le moindre saignement (mais quelques douleurs chez ce pauvre Jaime, toutefois).
On rigole aussi franchement quand le scarabée se déconnecte de son hôte (tout en restant présent physiquement). Celui-ci, jusqu'alors recouvert d'une carapace protectrice, se retrouve tout nu, la première fois devant les membres de sa famille, qui ironisent sur une partie de son anatomie :
- Range-moi tes noisettes ! (dixit la grand-mère)
- On dirait qu'il a cinq ans ! (la sœur, je crois)
- C'est parce qu'il a très froid ! (le papa, compatissant)
Quelques détails scabreux supplémentaires ont été insérés dans la suite de l'histoire, comme un vaisseau péteur (redoutable) et le début d'une érection chez le jeune homme quand il flirte avec sa bomba latina. On a donc tenté de mélanger l'esprit de Spider-Man avec celui de Deadpool (ou des Gardiens de la galaxie), mais en plus sage : c'est un divertissement tout public.
Cet aspect est accentué par l'insistance mise sur la famille et ses supposées valeurs. On s'en prend des tartines, surtout quand l'un des membres décède. On assiste à un déluge de larmes, avec ralenti et gros plans. Je ne vous parle même pas des scènes d'au-delà, kitschissimes.
Supplice supplémentaire, il faut (surtout dans la première partie) se farcir de la musique latino de supermarché, ainsi que des reprises en espagnol de tubes anglo-saxons (dont un de Michael Jackson). Si j'ajoute que l'on voit le jeune héros déambuler en bermuda-chaussettes-claquettes, vous aurez compris que l'ambiance est des plus raffinées.
La film a quand même pour lui des effets spéciaux très corrects et des scènes d'action plutôt bien fichues. Le problème vient du fond. Même si les lieux sont fictifs, on comprend bien que les méchants sont les capitalistes nord-américains, incarnés par une femme blanche qui semble avoir tous les défauts. (Dans le rôle, on sent que Susan Sarandon est là pour toucher de quoi maintenir un train de vie dispendieux.) Déjà, dans Black Panther 2, on s'était rendu compte qu'Hollywood misait sur l'anti-occidentalisme et le dénigrement de personnages blancs (notamment féminins) pour vendre sa soupe au plus grand nombre. Warner-DC semble avoir pris le même virage que Disney-Marvel.
15:58 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
jeudi, 17 août 2023
Reality
Le titre de ce film est à double sens. C'est le prénom du personnage principal (une nouvelle occasion de constater que certains parents ont le cerveau dérangé), une quête (celle des agents du FBI)... et le projet de la réalisatrice. En effet, les dialogues du long-métrage sont issus du rapport du FBI, plus précisément de l'enregistrement de l'interpellation de Reality Winner, suivie de la perquisition de son domicile et du premier interrogatoire.
La mise en scène est un peu plus subtile que ce que laisse penser cette présentation. Elle alterne les séquences jouées (les plus nombreuses), les extraits de l'authentique enregistrement et la reconstitution de fragments du rapport écrit. S'y ajoutent quelques rapides retours en arrière (censés se passer dans la tête de l'héroïne). A signaler aussi une coquetterie visuelle (mais qui a du sens) : de petits effets spéciaux remplaçant les passages censurés du rapport, évoquant les détails les plus délicats de l'affaire. Toutefois, les spectateurs attentifs comprendront sans peine ce que l'on a voulu éviter d'ébruiter.
Je conseille d'aller voir ce court film (1h20 environ) en en sachant le moins possible. L'un de ses attraits est de deviner ce qu'il y a dans la tête de Reality (remarquablement interprétée par Sydney Sweeney). Pour quelle raison le FBI la considère-t-il comme une personne digne d'intérêt ? Cette membre des forces armées serait-elle une suprémaciste blanche (dont le domicile compte autant d'armes que celui d'un de ses interrogateurs) ? Au contraire, aurait-elle été contaminée par l'idéologie islamiste (un Coran de luxe, abondamment annoté, ayant été trouvé à son domicile) ? Ne serait-elle pas plutôt une lanceuse d'alerte... ou alors, est-elle tout simplement un peu cinglée ?
Le suspens dure grâce à l'ambiguïté du jeu de la comédienne, vraiment excellente (et très bien dirigée). La manière de procéder des enquêteurs ne nous aide pas non plus. Ils avancent pas à pas, précautionneusement, méticuleusement, tentant visiblement de d'abord mettre en confiance Reality, avant de dévoiler leurs cartes.
L'histoire se divise en trois parties : d'abord l'interpellation (dans le jardin du domicile de Reality), à laquelle succèdent un long interrogatoire puis la séquence finale, en extérieur. Le dialogue du début, plein de sous-entendus, crée une ambiance étrange, accentuée par la mise en scène, qui adopte des prises de vue anguleuses. Cela culmine dans la deuxième partie, un huis-clos impressionnant, avec un petit bout de femme confronté à deux grands costauds, dans une pièce quasiment sans décor. A certains moments, on n'est pas très loin de David Lynch, je trouve.
On finit par tout comprendre, par petites touches... même si, pour moi, la personnalité de Reality conserve une part de mystère. C'est passionnant. Un peu conceptuel certes, mais le film vaut vraiment le détour.
13:02 Publié dans Cinéma, Politique aveyronnaise | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 15 août 2023
La Voie royale
Il ne s'agit pas de l'adaptation d'un roman d'André Malraux, mais de la peinture de la "formation des élites". L'action ne se déroule pas au sein d'une de ces grandes écoles que le monde entier nous envie, mais, là où tout se joue en fait, dans une classe préparatoire scientifique, en province, dans l'un de ces lycées publics sélectifs qui ambitionnent de rivaliser avec certains établissements parisiens.
Derrière la caméra se trouve Frédéric Mermoud, auquel on doit l'excellent Moka et, plus récemment la mini-série L'Île aux 30 cercueils. Sa mise en scène varie les plans, montrant aussi bien les groupes (qui jouent un rôle important dans le milieu décrit) que les duos, certains comédiens étant régulièrement filmés en gros plan.
La brochette de jeunes acteurs constitue sans doute le principal atout de ce film. L'héroïne, Sophie, est incarnée par Suzanne Jouannet, qui confirme tout le bien que je pensais d'elle dans Des Choses humaines. C'est une fille de petits agriculteurs, douée en maths, sur le point de devenir "transfuge de classe". Boursière, elle se retrouve plongée dans un milieu (grand) bourgeois, celui de la classe prépa.
Une étrange amitié va se nouer avec la surdouée de la promo, Diane (assise à côté d'elle sur la seconde photographie d'illustration, ci-dessus), très bien interprétée par Marie Colomb. Du côté féminin, il faut aussi signaler la prestation de Maud Wyler (vue notamment Alice et le maire) en prof de physique pète-sec, dont l'apparente hyper-rigidité cache un humanisme que la comédienne parvient à faire passer, avec subtilité.
Du côté des messieurs, plusieurs figures se détachent. Alexandre Desrousseaux incarne avec une pointe de jubilation le gosse de riche doué et sans complexe (un brin macronien sur les bords), tandis que Lorenzo Lefebvre (aperçu dans Délicieux) joue l'étudiant de seconde année (qui "cube"), plus sympa (mûr ?) que les autres, et qui tente de se rapprocher de Sophie. Je pourrais signaler aussi Cyril Metzger, qui incarne le frère de l'héroïne.
La galerie de figurants est tout aussi convaincante. Cela, allié à une réelle qualité d'écriture, aide à camper une ambiance de prépa très réaliste, des séances de colle au travail en chambre, en passant par les discussions de couloir. Pour nuancer ce tableau très élogieux, je pourrais signaler quelques ajouts pas vraiment bien sentis, comme le coup des gilets jaunes (dont on comprend qu'il est mis là pour souligner le fossé qui sépare la vie de Sophie de celle de la plupart de ses camarades de promo).
Bref, c'est bien conçu, bien interprété, prenant à suivre, avec quelques rebondissements. C'est l'une de ces bonnes surprises de l'été... et un bon film français sociétal, ce qui n'est pas si fréquent.
13:23 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films, société
lundi, 14 août 2023
Yannick
En ce quarantième anniversaire de la victoire de Noah à Roland-Garros, certains pourraient penser que Quentin Dupieux s'est soudain intéressé au tennis. Que nenni. C'est au théâtre (et, par mise en abyme, au cinéma) et à la "comédie sociale" que le cinéaste a consacré son dernier moyen/long-métrage.
Alors que depuis Rubber (et jusqu'à Fumer fait tousser), je suis attentivement la carrière du réalisateur, j'ai un peu tardé à voir sa dernière œuvre, en raison notamment d'une bande-annonce pas du tout alléchante.
Le début aurait eu tendance à confirmer mes craintes... à ceci prêt qu'il s'agit de la représentation d'une (mauvaise) pièce de boulevard, de surcroît pas très bien jouée. On se retrouve un peu dans la situation des spectateurs de Coupez ! Il faut commencer par supporter la première fiction, volontairement de mauvaise qualité, pour apprécier pleinement la suite du film.
Ici, on ne revoit pas le début sous un autre angle... pour la bonne et simple raison que l'un des personnages (le spectateur intrusif) prend le contrôle de la salle et décide de réécrire la pièce ! Ce trublion est interprété (avec talent) par Raphaël Quenard, qui est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Ce prolétaire autodidacte (conscientisé) remet en question non seulement les cultureux qui s'échinent sur scène, mais aussi les spectateurs parisiens, de classe moyenne. Il est donc question de "mépris de classe" dans ce film pas aussi innocent qu'il en a l'air.
L'intrigue tient la route parce qu'en face, on a aussi de bons acteurs : Pio Marmaï et Blanche Gardin sont censés incarner des comédiens médiocres, mais l'on se rend compte, au fur et à mesure du film, que leur jeu est bien plus subtil que cela. Dupieux a particulièrement travaillé le personnage de l'acteur principal (P. Marmaï), ancien comédien prometteur, qui végète comme tant d'autres dans le "théâtre de consommation courante" parisien. Les seconds rôles (ceux des spectateurs de la salle) sont bien campés. Alors que le début nous met mal à l'aise avec les revendications du trublion armé, la suite renverse un peu la situation... avant que l'on nous montre la nouvelle pièce à l’œuvre. Elle serait finalement plus drôle que celle que le public était venu voir... et l'acteur principal y est plus convaincant qu'au début.
On s'amuse (un peu) ; on réfléchit aussi (un peu). On passe un agréable moment... mais sans plus. L'histoire s'arrête assez vite. Dommage.
15:02 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 11 août 2023
Un Coup de maître (France)
De Rémi Bezançon, j'ai gardé un bon souvenir du Mystère Henri Pick (en 2019). Ici, la comédie douce-amère n'est pas mariée avec le polar, mais une plongée dans le monde artistique -plus précisément pictural- contemporain. (C'est l'adaptation française d'un film argentin sorti en 2019.)
Presque toute l'histoire repose sur les épaules d'un duo d'acteurs : Bouli Lanners (en peintre doué, acariâtre et autodestructeur) et Vincent Macaigne (en galeriste cultivé, meilleur seul ami du peintre). La découverte progressive de l'intensité de leur relation amicale est l'un des plaisirs que réserve l'intrigue.
La première partie dresse un portrait gentiment ironique du monde des arts, entre galeristes plus ou moins intègres, agents artistiques plus ou moins avisés, critiques plus ou moins honnêtes... et clients plus ou moins casse-couilles. J'ai lu des choses un peu sévères sur ce début (peut-être sous la plume de critiques qui n'ont pas apprécié la satire -légère- d'un milieu dont ils sont familiers... et qui n'est pas sans ressembler, parfois, à celui du cinéma). Je le trouve pourtant bien mis en scène et bien interprété, notamment par un Vincent Macaigne qui sort un peu de sa zone de confort. Sans surprise, Bouli Lanners est formidable en peintre has been (mais teigneux), ravagé par le décès de sa compagne.
A partir du moment où commencent à se déployer les fils d'une arnaque, cela devient particulièrement savoureux... mais moins réaliste. Les péripéties s'enchaînent, montrant notamment le revirement des Importants, qui paraissent encore plus ridicules. On sent que les acteurs se sont pris au jeu. Les personnages secondaires sont eux aussi bien campés. Je craignais de m'ennuyer un peu. Ce ne fut pas le cas.
Ce n'est certes pas le film de l'année, mais une comédie sympathique, qui tranche avec certaines bouses françaises sorties ces dernières semaines.
13:06 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
samedi, 05 août 2023
En eaux très troubles
Cinq ans après la sortie du premier volet, Jason Statham et les mégalodons sont de retour (dans l'attente, sans doute, d'un troisième volet, qui ne manquera pas d'être intitulé "En eaux très très troubles"...).
L'acteur britannique laconique se fait presque voler la vedette par un comédien chinois (Jing Wu). Ce n'est pas que celui-ci fasse preuve d'un talent étourdissant... mais le film est une coproduction sino-américaine, qui vise clairement le public du "pays du milieu" (aucun des méchants n'est de type est-asiatique). A signaler que, dans la version française, on entend souvent parler le mandarin, le bilinguisme étant de mise dans ce long-métrage. (Il joue même un rôle important dans certaines scènes.)
Avant de plonger dans un feu d'artifice d'action et d'effets spéciaux, il convient toutefois de ranger son cerveau au vestiaire. C'est indispensable pour "avaler" l'histoire de la survie d'un mégalodon, hors du monde des humains, pendant plusieurs millions d'années... Je ne vous raconte pas quand il y en a plusieurs !
Je pense aussi que les spectateurs dotés d'un minimum de culture scientifique (notamment les océanographes) risquent d'être consternés par l'utilisation du terme "thermocline" (censée être une barrière infranchissable pour les habitants des profondeurs).
Le début est assez entraînant. On voit Statham dans ce qu'il sait faire, l'homme d'action défendant une cause, avec un poil d'humour. Je laisse à chacun(e) le plaisir de découvrir comment, surnageant seul en plein océan, il va être secouru, après avoir démasqué des trafiquants...
La suite emprunte à pas mal de films de genre, d'Abyss à Alien, en passant par Jurassic World et, bien sûr, Les Dents de la mer. (J'ai repéré des allusions aux numéros 2 et 3). Ayant vu le premier film (En eaux troubles, rediffusé ce dimanche sur TF1), je me demandais comment les scénaristes et le metteur en scène avaient pu construire une intrigue sur près de deux heures. A ma grande surprise, cela tient parfaitement la route.
Jonas/Jason va être confronté à des trafiquants, des conspirateurs, un ancien adversaire hargneux, des mégalodons (trois !!), une gigantesque pieuvre, des dinosaures amphibies (petits, mais teigneux)... et une adolescente peu obéissante (mais tellement attachante)...
J'ai vu cela sur un très grand écran, avec du bon son. C'est prenant, même si cela sera vite oublié. (Je pense qu'il faut s'attendre à une suite. Soyez attentifs dès qu'il est question du comportement des gros requins.)
18:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 04 août 2023
Détective Conan : le sous-marin noir
Un an (en gros) après La Fiancée de Shibuya, voici donc une nouvelle adaptation du manga qui débarque sur le grand écran. Même si l'intrigue se suit sans qu'il soit nécessaire de connaître l'ensemble des aventures précédentes (d'autant que des rappels sont effectués en début de film), il peut être utile de regarder The Scarlet Alibi, un montage d'extraits de la série, qui présente les principaux personnages. (C'est disponible gratuitement -avec coupures publicitaires- sur le site MyTF1.)
Cette enquête "multipolicière" fait intervenir les forces de l'ordre japonaises, mais aussi Interpol, le FBI, la CIA, le MI6... C'est donc presque davantage un film d'espionnage qu'un polar, comprenant de nombreux rebondissements.
Ces deux personnages sont Ai Haibara et Conan Edogawa, les héros au corps d'enfant mais à l'esprit d'adulte... ce que la majorité des autres ignore. Préserver leur secret est un enjeu important (ils sont censés être morts)... tout en luttant contre le crime organisé. Il est incarné par les redoutables "hommes en noir", qui semblent si puissants et qui portent tous un nom de code inspiré d'un alcool fort. L'identité de leur chef(fe) demeure un mystère...
Parmi eux sont infiltrés des agents gouvernementaux, qui doivent se comporter en délinquants tout en informant leurs alliés, pour tenter de faire échouer certaines manigances.
Les polices du monde entier pensent être sur le point d'inaugurer l'arme ultime dans la lutte contre les criminels : la "bouée du Pacifique", un gigantesque bâtiment semi-immergé, de forme circulaire, bourré de technologies, en particulier un tout nouveau programme de reconnaissance faciale, capable même de repérer un adulte à partir d'une photographie de lui enfant.
Bien évidemment, les "hommes en noir" (qui sont aussi des femmes, soit dit en passant) s'intéressent à la chose, pour la détruire... ou en prendre le contrôle. Dans leur manche, ils ont un atout majeur : un membre infiltré au cœur du système policier.
Nous voilà partis pour près de deux heures de tromperies, d'enlèvements, de poursuites, de surveillances, le tout entre communications cryptées, intelligence artificielle, smartphones, lunettes connectées, scooters sous-marins... et enfantillages. Cela convient au public enfantin (pas trop jeune toutefois : nos amis japonais n'édulcorent pas comme Disney) et les adultes, qu'ils soient (anciens) lecteurs du manga ou tout simplement amateurs de bons films d'animation. La qualité est au rendez-vous (elle a bien progressé depuis les premiers épisodes de la série télévisée) et la musique est sympa. Les personnages forment une distribution internationale (pratique pour les ventes à l'étranger) et les femmes ne sont pas confinées dans des rôles de pleureuse ou d'héroïne badass. Informaticienne, biologiste, policière côtoient des personnages plus traditionnels.
J'ai passé un très bon moment... et je conseille de rester jusqu'à la fin du générique.
P.S.
A signaler, de la part d'un film japonais, un bel éloge du monde aquatique, en particulier des baleines à bosse.
21:38 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 02 août 2023
Take Two : enquêtes en duo
France Télévisions vient de mettre en ligne (après diffusion nocturne) les trois premiers épisodes de l'unique saison d'une série dite de comédie policière. Ses créateurs (Andrew Marlowe et Terri Edda Miller) sont connus du monde du petit écran, puisqu'on leur doit aussi Castle et The Equalizer.
Sans surprise, le binôme d'enquêteurs est, au départ, un duo (qui semble) mal assorti. L'originalité ici est que le personnage farfelu est celui de la femme : Sam Swift (interprétée par Rachel Bilson). C'est elle qui occupe le rôle de la "consultante", une comédienne qui sort d'une cure de désintoxication et dont la carrière bat de l'aile. Elle est évidemment ravissante, fantasque, limite casse-couilles, mais très futée, avec l'envie de faire le bien.
A ses côtés se trouve un ancien flic, devenu détective privé. Par le passé, il avait la quête de justice chevillée au corps. Il est devenu un peu plus cynique, mais c'est un excellent enquêteur... et un sacré beau gosse : il est incarné par Eddie Cibrian, que les téléphages ont vu notamment dans New York 911, Les Experts Miami et Rosewood.
L'association de ces deux personnalités contrastées (qu'une attirance mutuelle inavouée pourrait rapprocher) n'est pas sans rappeler aussi la récente The Mallorca Files.
Dans le premier épisode (« La star et le privé »), on assiste à la rencontre entre les deux protagonistes et à leur première collaboration, dans une enquête complexe qui nous plonge dans la pègre californienne. C'est souvent drôle, piquant et la partie policière de l'intrigue n'est pas bâclée.
Le deuxième épisode (« La main dans le sac ») est pour moi le moins bon de cette première salve. L'intrigue est pourtant assez fouillée ; il ne faut pas se fier à l'apparente simplicité de l'histoire d'adultère du début. Mais, bon, on sent que les deux protagonistes cherchent leurs marques. L'intérêt est relevé par la présence de deux seconds rôles pittoresques, les assistants des membres du duo, issus tous deux des "minorités visibles" et dotés de personnalités bien affirmées. Cela n'a rien de nouveau, mais c'est plaisant à suivre.
Le troisième épisode (« Recherche DJ désespérément ») est très prenant, même si une partie des péripéties est peu vraisemblable. Les interactions entre les principaux personnages sont souvent savoureuses et le duo semble avoir trouvé son rythme.
La suite sera diffusée à partir de mardi prochain (8 août).
23:07 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, séries télévisées, médias, actu, actualite, actualité, actualiyés
dimanche, 30 juillet 2023
A bord de "La Suzanne"
Aujourd'hui, j'ai pris le train... mais pas n'importe lequel : un train à vapeur, restauré, sur une portion de la voie qu'il a jadis empruntée. La locomotive, toute verte, s'appelle La Suzanne. Construite en 1889-1890, propriété privée à vocation industrielle (au départ), elle a d'abord circulé en Meuse, autour du chef-lieu, Bar-le-Duc, avant d'être utilisée durant la Première Guerre mondiale, notamment pour ravitailler la place-forte de Verdun, située dans le même département (mais plus au nord).
Cet été, chaque dimanche, l'association dont les membres ont restauré la locomotive (et deux petites gares) propose (contre rémunération, bien entendu) de prendre ce train à vapeur, pour un court trajet à 15-20 km/h, agrémenté d'explications.
C'est un peu à l'écart du centre-ville qu'il faut se rendre (se renseigner avant auprès de l'Office de tourisme), au nord, au même endroit où l'on peut pratiquer le vélo-rail, en semaine. Quelques vieux wagons ont été aménagés en guise de comité d'accueil, avec une présentation historique.
De là, on s'approche du guichet de la petite gare (dite du Varinot) et l'on monte dans l'un des wagons ouverts aux quatre vents, s'asseyant sur un banc de bois. L'animatrice de la visite prend le public en mains, avec humour... et en route Simone Suzanne !
Le temps était idéal : une vingtaine de degrés, un poil nuageux, mais ni pluvieux ni caniculaire. A l'odeur, on a vite compris que la locomotive n'était ni électrique ni diésel. Elle carbure aux bûches, qu'un(e) cheminot(e) charge avant le départ.
Ensuite, Suzanne nous montre de quel bois elle se chauffe... quitte à projeter des poussières carbonées dans l'atmosphère. (Mieux vaut ne pas venir vêtu de blanc, ou alors ne pas se placer sur les côtés du wagon.) En route, on croise plusieurs chemins de randonnée, d'où le transport est pris en photographie par des personnes visiblement venues dans cet objectif.
En cas de problème, une locomotive plus récente suit le convoi, notamment pour pousser un peu dans les côtes ! Au bout de 20-25 minutes, on arrive à bon port, une halte aménagée en lieu d'exposition (la gare Saint-Christophe).
Le baraquement est une "cabane Adrian", un bâtiment conçu de manière à pouvoir être construit en série et monté en un temps record. Il a été créé par un ingénieur lorrain, Louis Auguste Adrian, auquel on doit aussi le fameux casque (qui porte son nom), reconnaissable à son arête centrale, longitudinale. Plusieurs panneaux explicatifs retracent la carrière du polytechnicien et les utilisations successives des baraquements qu'il a conçus.
Juste à côté, un mini-auditorium de campagne a été aménagé, où l'animatrice retrace devant son public l'histoire des chemins de fer meusiens (à voie métrique, plus étroite, moins coûteuse que celle des voies aménagées par les grandes compagnies). Son entrain et son érudition rendent cette séquence passionnante, pour les petits et les grands. Son propos ne s'arrête pas à la fin de l'exploitation commerciale de la ligne. Elle brosse aussi à grands traits l'histoire mouvementée de la restauration historique, qui vaut son pesant de scories.
Vient ensuite le moment du retour. La locomotive a été permutée avec l'arrière du train (manœuvre que seul l'arrêt en gare permet d'opérer).
En chemin, de brèves haltes sont l'occasion d'apporter des explications complémentaires sur l'environnement de la ligne, qui traverse une forêt domaniale (celle de Massonges) et touche une zone naturelle protégée, où les batraciens aiment à se reproduire. D'autres animaux sont visibles au cours de la balade, notamment des vaches (des Charolaises, je crois), qui ont paru très intéressées par le passage de ces étranges visiteurs.
J'ajoute que les bénévoles qui encadraient la visite étaient habillés en costume d'époque, une petite touche qui agrémente le tout. En début et fin de ligne se trouve une petite boutique, pour celles et ceux qui voudraient acquérir un souvenir.
« Le ch'min d'fer, c'est super ! »
19:26 Publié dans Histoire, Loisirs, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, lorraine, guerre, grande guerre, guerre 14-18, première guerre mondiale
Le Manoir hanté
Disney a sorti le chéquier (160 millions d'euros tout de même) pour vanter l'une des attractions de ses parcs, à travers une fiction qui se veut à la fois horrifique et amusante.
Une chose est sûre : on voit le pognon à l'écran, à travers les décors et les effets spéciaux, très tape-à-l’œil. On pense évidemment à La Nuit au musée (avec Ben Stiller), à ceci près que ce film-ci (et ses suites) sont beaucoup plus drôles.
Les cinquante premières minutes se traînent. La découverte du manoir par une mère et son enfant accumule les clichés. La maman (Rosario Dawson, qui a sans doute des impôts à payer) est dynamique, mais l'on nous fait rapidement sentir le poids de l'absence du père (sur les épaules du fiston en particulier). La découverte des habitants non officiels de la demeure n'est même pas drôle... et guère effrayante.
Le poids du deuil s'accentue avec l'autre personnage principal, un ancien physicien très doué devenu guide touristique. On comprend très vite quel drame a flingué sa vie... et risque de menacer celle de son entourage, au manoir. C'est vraiment surligné au feutre fluorescent.
La distribution comprend aussi une voyante à moitié compétente (interprétée par une actrice qui fait regretter l'absence de Whoopi Goldberg), un vrai-faux pasteur (Owen Wilson, qui cabotine un max) et un chercheur un peu casse-couilles (Dany DeVito, sorti de l'EHPAD pour l'occasion). La seule bonne surprise est l'apparition (au propre comme au figuré) de Jamie Lee Curtis en médium victime d'une malédiction... un peu fofolle sur les bords.
Le film ne décolle vraiment qu'au cours d'une séance de spiritisme, qui voit l'un des personnages "sortir" de son corps. Il évolue dans le château, dans un état second, et voit tout ce qui échappe aux humains normaux, au quotidien.
La suite est plus ou moins entraînante, correctement mise en scène, mais assez convenue, sur le fond. On a déjà vu mieux ailleurs... et l'on se demande si Disney n'aurait pas plutôt dû produire un film d'animation sur le sujet.
09:59 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
vendredi, 28 juillet 2023
Parle à ma main...
C'est le titre qu'aurait pu porter ce petit film d'épouvante australien, intitulé La Main dans la version française, mais Talk to me en version originale. Cette formule joue un rôle clé dans l'intrigue, puisque, pour entrer en contact avec un esprit, il faut serrer la fameuse main et lui demander de parler (puis d'entrer en soi).
Vous aurez remarqué qu'il s'agit d'une main gauche, la main déviante, pas celle de Dieu, plutôt celle des esprits malins... On n'en saura guère plus sur elle, ni sur la signification des inscriptions qui la recouvrent. (Peut-être dans un opus n°2 ?)
Mais, avant d'en arriver là, on est saisi par une fort belle ouverture, sous la forme d'un plan-séquence de deux-trois minutes, qui se conclut de manière doublement frappante...
Une ellipse nous transporte du côté d'une banlieue de classe moyenne, où des jeunes de 16-20 ans (un peu à l'image du public de la salle, moi excepté) se réunissent pour participer à des expériences "limites"... hors de portée du regard des parents, bien entendu. Ces derniers semblent peu présents dans la vie de leurs enfants. Ce sont globalement des emmerdeurs... et des pourvoyeurs d'argent, qui permettront à leur progéniture ingrate de se procurer smartphone, habits moches (et chers)... et de quoi se défoncer la gueule. Dans cette perspective, les expériences avec la main apparaissent comme un substitut à la consommation de drogue.
Sans surprise, une grande partie de ces ados est assez antipathique. Tous les personnages (sauf un) sont taillés la hache. On ressent rapidement l'envie qu'il leur arrive des choses tristes... ce qui ne va pas manquer, grâce à la main.
Du côté des effets spéciaux, c'est réussi, sans esbroufe. J'y vois un peu de numérique mais, assez traditionnellement, beaucoup de maquillage et de prothèses. Le résultat est convaincant, sans que cela soit réellement effrayant. C'est plutôt gore... de plus en plus même au fur et à mesure que l'histoire progresse (à mon grand plaisir). Les djeunses qui peuplaient la salle où je me trouvais ont été scotchés sur leur siège. (Le film étant interdit aux moins de seize ans, j'ai aussi pu échapper aux hordes de collégiens mal élevés.)
Une comédienne sort du lot : Sophie Wilde, qui incarne Mia. Ce n'est pas le personnage principal au départ, mais elle va le devenir. Quand on fait le bilan de tous les états par lesquels passe ce personnage, on ne peut que saluer la performance d'actrice.
L'intrigue allie l'hyper-classique et des efforts d'originalité (assez modestes toutefois). Du côté du classique, il y a la croyance en un au-delà dangereux, le conflit / l'incompréhension entre parents et enfants, le désir de transgression des jeunes. Ceux-ci vont bien évidemment faire de grosses bêtises et ne pas accomplir les gestes qu'il faut pour se sortir du pétrin.
Dans ce collier de perles de pacotille, l'attitude d'une mère tranche agréablement. Elle a tendance à parler vertement, signalant à sa fille aînée qu'elle voit d'un mauvais œil qu'elle sorte le soir avec ce Daniel qui, rappelle-t-elle, « possède une queue ». Plus tard, quand elle trouve celui-ci dans la chambre de sa fille, elle lui signifie que le vagin de celle-ci lui est formellement interdit... J'ai aussi bien aimé son expression, quand elle entre dans une pièce où se trouvent son fils cadet, le meilleur ami de celui-ci et la chienne de la famille, une femelle bouledogue à l'hygiène approximative... la maman se demandant à voix haute si l'odeur pestilentielle dans laquelle baigne la pièce n'émanerait pas plutôt du copain de son fils ! (Je crois que je fus le seul spectateur de la séance à rire à ces moments croustillants...)
Comme tout bon film d'épouvante, celui-ci contient un message moral. On peut y voir la condamnation d'une manière d'utiliser les réseaux sociaux et du manque d'empathie de certains jeunes envers les autres.
Les vingt dernières minutes sont les plus rythmées. Au cours de celles-ci, on réalise (plus ou moins tôt selon son degré d'attention) qu'une supercherie est à l’œuvre, depuis un petit moment déjà. L'un des personnages ne le comprend que trop tard, mais parvient tout de même à déjouer l'une des manigances. Le film s'achève sur une très bonne séquence, décalée, qui perturbe celles et ceux qui n'ont pas encore saisi le fond de l'histoire, le dernier plan (joliment fait), sous forme de pied de nez, donnant l'explication.
Cela ne dure qu'1h30 et c'est le genre de petit plaisir (à l'image de [Rec] ou d'Escape Game) qu'on peut s'offrir l'été.
14:24 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 25 juillet 2023
Oppenheimer
Il y a trois ans, en pleine pandémie de covid, Christopher Nolan et ses producteurs avaient fait le choix de sortir Tenet en salles. Le risque avait été (relativement) payant puisqu'avec un peu plus de 2,3 millions d'entrées, le film avait fini en tête du box-office français de l'année (certes un peu sinistré).
Tout cela pour dire que les œuvres de Nolan, aussi cérébrales soient-elles (parfois), sont faites pour être vues dans une salle obscure. Oppenheimer ne fait pas exception à la règle. C'est d'ailleurs l'une des grandes réussites du cinéaste que d'être parvenu à rendre passionnante une épopée au cœur de laquelle se trouvent les sciences physiques... et d'en avoir fait un polar de trois heures, qui tient amplement ses promesses. Bon d'accord, l'enjeu politique (la rivalité avec les nazis, eux aussi lancés dans la course à l'arme atomique) n'est pas sans pimenter l'intrigue. L'ambiance de pré-Guerre froide (les alliés bolcheviks étant déjà perçus comme les adversaires de demain) ajoute une touche d'espionnage pas déplaisante du tout.
Deux catégories de scènes nous sont proposées. C'est paradoxalement en noir et blanc que l'on voit les plus récentes (celles qui se déroulent dans les années 1950, en plein maccarthysme), alors que la couleur est réservée aux années 1930-1940... mais c'est la partie la plus vivante, le cœur de l'histoire, avec le plus de chair (et de neurones).
Les interprètes sont excellents. Cillian Murphy s'est parfaitement coulé dans le personnage, qu'il ne cherche pas à rendre plus sympathique qu'il n'était... et c'est tant mieux. Par moments (l'orientation sexuelle mise à part), j'ai pensé à Benedict Cumberbatch en Alan Turing, dans Imitation Game, film qui n'est pas sans rapport avec celui-ci. On pourrait aussi rapprocher Oppenheimer d'un autre héros américain, Neil Armstrong, tel qu'il est dépeint dans First Man : lui aussi a pu s'appuyer sur une épouse brillante, qui avait suivi des études universitaires et qui a sacrifié ses aspirations professionnelles pour soutenir la carrière de son mari.
Ici, c'est à Emily Blunt qu'échoit ce rôle ingrat, celui d'une intellectuelle libre dans sa jeunesse, qui finit par se cloîtrer à Los Alamos avec deux gosses dont elle a du mal à s'occuper. Dommage que le personnage ne soit pas plus creusé.
Les autres seconds rôles (le film étant tout à la gloire d'Oppenheimer) sont incarnés par une pléiade de talents, de Jason Clarke (excellent dans la peau d'une enflure) à Matt Damon (crédible en ours mal léché), en passant par Florence Pugh (la plus belle communiste que j'aie jamais vue...), Rami Malek (important sur la fin), Josh Hartnett (curieusement bon en scientifique conformiste) et Robert Downey Jr (qui ne pouvait qu'incarner un type un peu magouilleur sur les bords)...
La mise en scène s'est évertuée à représenter ce qui se passait (parfois) dans la tête du physicien... en liaison avec ce qui passe au niveau atomique, lors d'une réaction. Cela donne des plans très léchés, soutenus par une musique appropriée... mais je ne suis pas sûr que ce dispositif aura permis aux spectateurs lambdas de mieux comprendre le fonctionnement d'une bombe atomique.
Mis à part ces aspects scientifiques ardus, le film est relativement limpide. On a visiblement voulu éviter de tomber dans les excès de Tenet... mais, du coup, je suis un peu déçu. Nolan nous livre une brillante fresque historique, engagée (à gauche), mais il y perd un petit peu son art de nous transporter dans des univers inédits.
P.S.
Pour en savoir plus sur l'histoire de la bombe atomique, je recommande à nouveau la lecture du roman graphique La Bombe, que j'avais chroniqué en août 2020.
21:03 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film, films, histoire
vendredi, 21 juillet 2023
Barbie
C'est dans une salle copieusement garnie (malgré la V.O.) et composée presque exclusivement d'un public féminin (de tout âge) que j'ai vu cet étonnant film, mélange de comédie sirupeuse et de discours féministe.
Le début est engageant, avec la parodie d'une scène de 2001, L'Odyssée de l'espace. (Je me demande toutefois quel pourcentage des spectateurs a compris l'allusion.) Sur le fond, c'est contestable : présenter l'invention de la poupée Barbie comme une conquête féministe me rappelle le slogan d'une entreprise française d'électroménager, qui prétendait que ses produits libéraient la femme.
Après ce moment d'audace (limitée), on nous plonge dans le monde merveilleux (et rose, très rose) de Barbie Land, où tout est organisé pour faire de la vie des "poupées" (les jolies jeunes femmes) un rêve éternel. Au second degré, c'est assez savoureux, surtout quand on découvre le rôle attribué aux hommes. Voilà donc Ryan Gosling (après des heures passées sur le banc de muscu) relégué au rang d'objet sexuel (asexué) consentant.
C'est drôle... et malin. Cela peut aussi bien convenir à celles (et ceux ?) qui trouvent cet univers réjouissant (et regardent donc cela au premier degré) qu'à ceux qui y voient une critique ironique.
Hélas (ou plutôt heureusement), cette belle mécanique du bonheur factice va s'enrayer. Du coup, Barbie et Ken s'embarquent pour le monde réel, celui des propriétaires de poupées... et des concepteurs de Barbie.
Le trajet est trop rose et sucré à mon goût... sans parler des chansons. Il y en a bien une ou deux avec des paroles intéressantes (dont une qui détourne celles de la chanson du début) mais, globalement, cela m'a plutôt cassé les tympans.
L'intérêt remonte dans le monde réel, pour deux raisons. Tout d'abord, il y a la description du fonctionnement de la multinationale Mattel, évidemment exagéré (et laissant de côté certains aspects peu reluisants, ce qui permet à la firme de valider le film et de se donner, en passant, une bonne image)... et la découverte par Ken d'un monde dirigé par les mecs. Gosling excelle à nous faire ressentir à quel point le mâle frustré kiffe la life à ce moment-là. Il a la bonne mauvaise idée de rapporter les préceptes du patriarcat dans Barbie Land... avec des conséquences que je laisse à chacun(e) le plaisir l'horreur de découvrir.
Ce retournement est une excellente idée scénaristique, puisqu'il va donner lieu à la peinture d'un nouvel univers patriarcal (complémentaire du premier, en fait)... et à l'éclatement d'une véritable guerre civile... mais du genre flashy. La manière dont les "poupées", tombées en servitude, vont redresser la situation, vaut son pesant de paillettes.
Ce film contient aussi quelques beaux passages, un peu hors du temps, sans tout le tralala qui enrobe l'intrigue. L'un de ces moments voit l'héroïne discuter avec une dame âgée, à un arrêt de bus. Un autre voit l'intervention d'une autre mamie, qui a un lien avec l'univers de Barbie. Il y a aussi tout ce qui touche à la relation entre Barbie et sa véritable propriétaire, qui n'est pas celle que l'on croit. Mais le véritable morceau de bravoure est la diatribe féministe (propre à remobiliser les troupes), qui n'est pas déclamée par Barbie. (Margot Robbie laisse de l'espace à d'autres comédiennes dans ce film.)
Du coup, je suis sorti de là plutôt content. C'est une bonne comédie et, en dépit de ses limites, le fait que le film serve un discours féministe (les femmes doivent pouvoir être maîtresses de leur destin) au grand public est une bonne chose. De surcroît, à la fin, les personnages ont évolué. Si le patriarcat est définitivement rejeté (dans Barbie Land), il n'est pas remplacé par un matriarcat strict. Le film ne fait pas l'apologie d'un féminisme séparatiste ou exclusif, mais plutôt d'une nouvelle forme de "vivre ensemble" pour les femmes et les hommes.
23:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinema, film, films, cinéma
jeudi, 20 juillet 2023
Les Meutes
Récompensé cette année au Festival de Cannes, ce film marocain (coproduit par la France et le Qatar) est un nouveau prétendant au titre de « polar de l'été ». Il n'est d'ailleurs pas sans point commun avec son principal concurrent, Dernière nuit à Milan, dont l'action elle aussi est concentrée entre le crépuscule et l'aube.
Si le titre fait allusion à des chiens, que l'on voit brièvement impliqués dans des combats illégaux, c'est bien d'humains (et d'humanité) qu'il s'agit dans ce film. Les deux héros sont un père et son fils. Le premier est une petite frappe, récemment sortie de prison. A son visage et à son élocution difficile, on devine qu'il a dû consommer pas mal de substances bizarres dans sa vie. Son épouse semble l'avoir quitté et il vit chez sa mère. Le fils est déterminé à ne pas suivre les traces de son père. Il est honnête et droit, veut gagner sa vie légalement, même si le travail précaire qu'on lui propose est mal payé.
Un soir, le père embarque le fils pour un « boulot facile », une mission bien payée, censée durer moins d'une heure... mais qui va s'éterniser. Un peu comme la jeune mère iranienne de Juste une nuit, les deux compères vont accumuler les emmerdes et les déconvenues, et ce dès le début de leur mission, qu'il vont accomplir dans une vieille guimbarde rouge vif (une couleur qui porte malheur, nous dit-on), dont le fonctionnement devient de plus en plus aléatoire.
Nous voilà donc embarqués dans un véritable périple dans et autour de Casablanca... mais pas la ville de carte postale, celle prisée des touristes. Non. En suivant Hassan (le père) et Issam (le fils), on croise une ribambelle de personnages hauts en couleur : un chef de bande aux dents métalliques, un petit propriétaire terrien qui utilise un engrais particulier pour "soigner" ses figuiers, le mystérieux occupant d'une station-service désaffectée, un policier amateur de figues, un vieux pêcheur alcoolique... Toutes ces rencontres sont fort bien mises en scène. On ne sait jamais comment la séquence va se dérouler. C'est d'autant plus remarquable que la majorité des acteurs sont non-professionnels (à commencer par celui qui incarne le père).
L'intrigue a aussi l'intelligence de faire évoluer les deux personnages principaux, ceux du père et du fils. Au départ, le premier mène la danse et entraîne le second dans ses embrouilles. A partir d'un moment, quand tout part en sucette, le fils prend les choses en mains... et c'est le moment que son choisit le père pour exprimer des réserves. Voilà qu'il aurait des scrupules ! Même si le ton n'est pas à la comédie, certaines situations sont assez savoureuses.
L'atmosphère est très bien rendue, avec une belle photographie (pas aussi léchée par exemple que dans Limbo, mais elle convient parfaitement à l'intrigue). C'est filmé le plus souvent en plan serré et en gros plan, avec une caméra fixe ou à l'épaule (un peu à la façon des frères Dardenne, mais en moins "épileptique").
Cela dure 1h30 et j'ai été pris du début à la fin, même si la première scène, autour du combat de chiens, n'est pas la mieux jouée ni la mieux montée. On y découvre le chef de bande (pas totalement convaincant) et, surtout, son rival, interprété par un type qui parle peu mais qui dégage vraiment quelque chose. De surcroît, l'ambiance est déjà très tendue, sans effet sonore ou visuel particulier. On a là un réalisateur et scénariste de talent, Kamal Lazraq, qu'il faudra suivre.
11:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mercredi, 19 juillet 2023
Sisu - De l'or et du sang
Sorti il y a un mois, ce film américano-finlandais avait été signalé par une autre blogueuse cinéphile (Pascale). Il a mis du temps à arriver en Aveyron. J'ai pu accéder à une séance en version originale sous-titrée... pour constater que tous les personnages, allemands comme finlandais, parlent anglais (avec divers accents)... sauf à la fin.
Au départ, il s'agit d'un mélange de film de guerre et de western. Les paysages finlandais sont superbes, le chercheur d'or mutique, rugueux à souhait, entre son cheval et son chien docile.
Les Finlandais partagent avec les Polonais et les Baltes (Estoniens, Lettons et Lituaniens) le triste privilège d'avoir été successivement envahis par les Soviétiques et les Allemands. En 1944, le héros a perdu toute sa famille, massacrée par les troupes de Staline, mais leurs successeurs nazis n'ont rien à leur envier en matière de cruauté. Pas de bol pour eux, ces SS Totenkopf (ou ce qu'il en reste, vu la troupe débraillée qui sillonne le nord de la Finlande) croisent la route d'un ancien commando, sans peur, sans reproche... et sans pitié.
Quand on sait que le film va nous offrir de belles scènes d'explosion, d'éviscération et de démembrement, on se dit que cela commence doucement, dans ces terres de solitude, où le ciel semble si bas. Le héros a perdu femme et enfants, ne croit plus guère en la patrie... mais il trouve de l'or ! Un paquet d'or, qui va susciter bien des convoitises.
J'ai aimé ce démarrage en douceur et la progressive montée en tension, la première baston n'intervenant pas au moment que l'on pense... mais quand cela surgit, quel régal ! Il y a du Tarantino dans la manière dont ce guerrier dézingue une compagnie de SS : des fantassins, des motards, des aviateurs... jusqu'aux occupants d'un char.
Au passage, il contribue à libérer une brochette de femmes, butin de guerre des ordures nazies. Les meufs prouvent rapidement qu'elles ont les ovaires solidement arrimés : elles vont participer au massacre.
On se laisse gentiment porter par cette sauvagerie libératrice jusqu'à la séquence du lac, où, là, l'irrationnel commence à l'emporter. Le héros rebelle se mue en esprit vengeur quasi invulnérable, qui survit à toutes ses blessures et peut même se passer de respirer. La mise en scène est toujours aussi jouissive, mais le film perd en vraisemblance. C'est dommage.
Du coup, j'ai été un peu déçu par la dernière partie, la séquence en avion cumulant les impossibilités (au niveau du scénario comme de la mise en scène). Cela reste spectaculaire, mais la saveur particulière du début a disparu.
15:12 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film, films
mardi, 18 juillet 2023
Bron, saison 3
Depuis la fin du mois de juin, l'intégralité de la troisième saison de cette série suédo-danoise (à moins que ce ne soit dano-suédoise) est disponible sur le site d'Arte. J'avais découvert les deux premières saisons au cours du troisième confinement (dont ce fut sans doute l'un des rares aspects positifs, me concernant).
C'est toujours un duo binational d'enquêteurs qui mène la danse. On retrouve l'atypique (et ravissante) Suédoise Saga Noren, épaulée cette fois-ci successivement par deux Danois. Son précédent partenaire, Martin, est en prison (en partie à cause d'elle). Lui succèdent une femme au caractère bien trempé puis, dans des circonstances que je me garderai de révéler, un homme, Henrik, qui semble aussi tourmenté que sa collègue.
C'est l'un des intérêts de cette saison : confronter l'autiste de talent (qui a de plus en plus de mal à côtoyer les gens "normaux") à un autre policier désaxé (pour d'autres raisons). De tous ses partenaires, c'est sans doute celui dont elle va se sentir la plus proche... mais voilà que débarque sa mère, dont les intentions sont troubles...
La complicité (affective et professionnelle) de Saga et Henrik va être mise à rude épreuve, au cours d'une enquête à rebondissements. Un mystérieux assassin (ou plusieurs assassins ?) s'inspire de tableaux pour mettre en scène ses crimes. Il va falloir beaucoup de temps aux policiers pour trouver les liens qui unissent (presque) toutes les victimes. L'aspect enquête est toujours aussi passionnant.
Le scénario multiplie les arcs narratifs et brasse les sujets de société : famille d'accueil, abandon, guerre en Afghanistan, toxicomanie, réussite sociale, médias numériques, politique identitaire, PMA, GPA...
C'est prenant, très bien joué (à voir de préférence en VO, mais la VF est potable) et c'est plutôt bien filmé. Je recommande vivement... et j'espère qu'Arte aura bientôt la bonne idée de mettre en ligne la quatrième et dernière saison. (Les deux premières sont aussi accessibles en ligne.)
15:15 Publié dans Télévision, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : télévision, télé, médias, cinéma