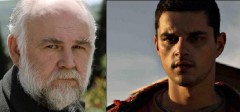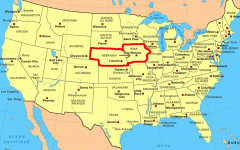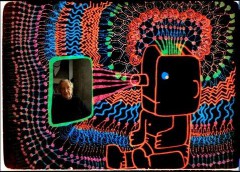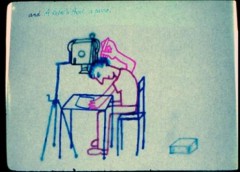mardi, 12 août 2014
Lucy
En moins d'1h30, Luc Besson (qu'il ne faut pas croire à chaque fois qu'il affirme avoir tourné son dernier film) tente de mêler un thriller de science-fiction, une réflexion philosophique et un poil de féminisme.
L'héroïne a été nommée ainsi en référence à l'australopithèque dont une partie du squelette a été découverte en Ethiopie, en 1974, par une équipe dans laquelle figurait le Français Yves Coppens. A l'époque, les paléontologues avaient été inspirés par une chanson des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds... les initiales des mots principaux formant l'acronyme LSD. Cela colle parfaitement avec l'intrigue du film, qui tourne autour d'une nouvelle drogue de synthèse, le CPH4 (dont le nom a été inventé, selon Besson).
Sur le papier, cela sonne bien, d'autant plus que la distribution est alléchante. Mais le début ne m'a pas emballé du tout. Est-ce parce que la version française est mauvaise ? Est-ce parce que je suis habitué à la véritable voix de Scarlett Johansson ? Cette dispute entre amoureux s'éternise inutilement. Par la suite, j'ai même eu mal pour l'actrice, qui n'est pas convaincante en étudiante pleureuse.
Cela devient intéressant quand Lucy se retrouve lestée du paquet de poudre bleue. Le thriller démarre vraiment et, en même temps, le compte à rebours qui la voit acquérir une maîtrise de son cerveau de plus en plus complète.
Ce début alterne avec des extraits d'une conférence scientifique, où l'on découvre Morgan Freeman, qui "fait le boulot". Les images sont entrecoupées d'extraits (fort jolis) de documentaires, pas tournés par Besson (les sources figurent dans la générique de fin). Science et philosophie se mêlent jusqu'à la fin, qui montre deux "Lucy" entrer en contact. Le scénario fait (intellectuellement) descendre l'espèce humaine de l'australopithèque, ce qui est faux.
De la part de Besson, le mélange des genres est assez culotté. Mais cela ne m'a guère intéressé. D'un point de vue cinématographique, on est content de retrouver Scarlett bonne actrice à partir du moment où les effets de la drogue se font sentir.
C'est drôle parce qu'on voit une fragile poupée mettre sa race à une brochette de voyous (et même à des policiers), parfois de manière spectaculaire. Les effets spéciaux sont réussis et les péripéties s'enchaînent. (On sait faire ça, chez Europa Corp.)
La tension monte jusqu'à un apogée qui m'a déçu. L'histoire se conclut trop vite. Je pense qu'on a dû pratiquer des coupes, pour faciliter l'exploitation en salles. Du coup, on laisse tomber la relation de l'héroïne avec sa mère, on ne développe pas l'ébauche de romance avec le policier français et l'on n'insiste pas sur le corps qui se rebelle (objet pourtant d'une belle scène d'avion).
Quant au féminisme, il est tout relatif. A part Lucy / Scarlett, aucun personnage féminin ne se détache. Sa meilleure amie, à peine entrevue, semble aussi superficielle que l'héroïne non droguée. Dans l'amphithéâtre où le professeur Norman s'exprime, on aperçoit bien de nombreuses étudiantes, mais tous les scientifiques de renom sont des hommes. Il en est de même des forces de police et des mafieux coréens, qui ne croisent qu'une femme de ménage et une tatoueuse. Si j'étais mauvais esprit, je dirais que le sous-texte du film est que les femmes sont globalement inférieures aux hommes, une seule se détachant du lot.
Mais chacun (féministe ou pas) peut y trouver son compte, tout comme à propos des drogues. La scène montrant Lucy faire la fête en boîte de nuit est clairement une apologie de la prise de ces substances (tout comme la trame générale, qui explique comment une femme très ordinaire devient surhumaine à l'aide d'une drogue). D'autres éléments en pointent les effets néfastes et dénoncent l'action des groupes criminels. Besson cherche à se concilier tous les publics, pensant ainsi rallier le grand nombre, au risque de ne pas faire le grand film qu'il est pourtant capable de réaliser.
17:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film
samedi, 09 août 2014
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?
J'arrive après la bataille, mais, bon, il n'est jamais trop tard. En fait, j'ai accompagné une personne qui ne se rend au cinéma que deux ou trois fois par an. Elle constitue l'une des cibles de ces longs-métrages familiaux, comédies balisées, dont le destin est d'être diffusées à 20h50 sur TF1 (qui, est-il besoin de le préciser, a produit le film).
Le prologue est réussi, avec cette succession de passages à la mairie. Pour paraphraser l'une des affiches (et un film célèbre), c'est un peu "Trois mariages et deux têtes d'enterrement" : au fil des unions, le couple bourgeois catholique, qui tentait de faire bonne figure au début, tire de plus en plus la tronche, pour finir par porter une tenue de deuil. Si l'on ajoute à cela le contraste des identités complètes des mariés, on obtient un bon démarrage.
Cela se gâte un peu quand on découvre les trois gendres. Les acteurs en font trop. Je les ai trouvés plutôt antipathiques (Chao un peu moins). Habilement, le scénario les présente avec un défaut principal, mais aussi une grande qualité. Rachid le musulman est un homme moderne, pas du tout intégriste, mais il a très mauvais caractère ; on le sent souvent sur le point de "péter les plombs". Dans sa profession d'avocat, on en fait un homme bon, mais très à cheval sur les principes.
David le juif est le plus agaçant, à la fois le plus communautariste (mais il n'a toutefois pas exigé que son épouse embrasse sa religion)... et le plus fort-en-gueule... sans compter qu'il mange comme un malpropre.
Chao est obséquieux à l'extrême, pas toujours de manière naturelle. Mais, au fond, c'est un chic type, qui a donné un coup de main bancaire à sa future épouse et qui est prêt à soutenir la nouvelle entreprise de l'un de ses beaufs.
Par contre j'ai bien aimé le passage qui voit chacun d'entre eux, pourtant victime de préjugés racistes, se révéler lui aussi pétri d'aprioris sur d'autres communautés : le Franco-Algérien déteste les Marocains et le juif séfarade méprise les Ashkénazes.
Le message est plus lourd quand il est question du père de famille, incarné par Christian Clavier. De sa bouche sortent la majorité des clichés racistes, qui ne sont pas toujours présentés comme tels dans le film. On a reproché aux auteurs de ne pas avoir clairement dénoncé certains de ces lieux communs. Quelques-uns sont certes battus en brèche (on voit un Arabe rejeter la drogue, un juif qui tire le diable par la queue et un Asiatique philanthrope), mais il est indéniable qu'à la fin du film, même si Verneuil père a accepté ses gendres, il n'en conserve pas moins nombre de ses préjugés.
Le second bouleversement vient de la quatrième fille, qui est sur le point d'épouser un Noir, d'origine ivoirienne. Cette fois-ci, on nous épargne la liste des clichés sur les Africains et on nous offre un superbe personnage : le père ivoirien, lui-même bouffi de préjugés, interprété avec talent par Pascal N'Zonzi. Sa réconciliation avec le gaulliste Verneuil est ma foi bien mise en scène.
La comédie manque toutefois de folie. On fait référence à Rabbi Jacob (dans un contexte assez cocasse), mais la comparaison ne joue pas en faveur du film le plus récent. (Et Clavier n'a pas le talent de Louis De Funès.) Seule Chantal Lauby, excellente en catho qui s'ouvre au monde, rompt un peu la mécanique prévisible de l'intrigue. (De manière générale, les personnages féminins sont plus sympathiques, plus mûrs.) Je regrette aussi que l'on n'ait pas davantage développé l'histoire du complot des gendres (contre le quatrième). Le quiproquo (à propos d'une photographie) était pourtant porteur.
Voilà. Ce n'est certainement pas la comédie du siècle (ni même de l'année). Tout en rassurant son public (et en évacuant le contexte social...), elle dit tout de même deux-trois choses pas idiotes.
21:20 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 07 août 2014
La Planète des singes : l'affrontement
Ce film est la suite de celui qui était sorti en 2011 (La Planète des singes : les origines). L'action se déroule dix ans après. Un prologue télévisuel nous apprend (ou nous rappelle) que l'épidémie qui s'était déclarée a presque exterminé le genre humain. A l'écran, une animation nous montre la propagation de la maladie, concomitante de la progressive disparition des lumières à la surface de la Terre.
Le sous-titre français est moins allusif que la version anglo-saxonne, qui évoque le début (l'aube) de la domination des singes. Le conflit principal est celui qui peut opposer les humains aux autres primates évolués. Mais, habilement, l'histoire met en scène les rivalités au sein de la communauté simiesque et (de manière moins développée) les dissensions entre les humains rescapés. Cela nous mène au message le plus intelligent du film : l'amitié et le respect peuvent naître entre des individus qu'au départ tout sépare, alors que les êtres en apparence semblables n'ont parfois pas grand chose en commun. Dans le rôle du chef charismatique et sage, Andy Serkis / César est excellent, meilleur en tout cas que Jason Clarke (remarqué dans Zero Dark Thirty), dont le jeu est un peu stéréotypé.
L'ambiance est post-apocalyptique. C'est devenu très convenu, le sujet ayant été déjà abordé par une floppée de films et de séries télévisées, dernièrement, Revolution, qui semble avoir inspiré une brochette de scénaristes hollywoodiens (ceux de Divergente et de Transcendance notamment). Notons que la musique est de Michael Giacchino, qui a aussi composé une partie de celle de la série Fringe et celle de plusieurs autres productions de JJ Abrams. D'ailleurs, les fans en reconnaîtront l'un des acteurs principaux, Kirk Acevedo, qui incarne ici un gros blaireau.
Je suis un peu déçu par le contexte post-apocalyptique. Les groupes, qu'ils soient humains ou simiesques, ont donné naissance à des organisations très hiérarchisées, dans lesquelles un chef domine la masse, en s'appuyant sur un groupe de fidèles. Cela nous mène à un autre message du film : la dénonciation de l'ambition dévorante et de la fascination pour les armes à feu. En poussant un peu loin, on pourrait voir en César un double de Barack Obama, qui dénonce la violence sanguinaire au début, avant que l'exercice du pouvoir et les nécessités du moment ne le poussent à s'adapter...
Lorsqu'il n'est pas question de politique, ce sont les relations familiales qui sont mises au premier plan. Sans surprise, la cellule de base de la société est présentée comme LE refuge face à la dureté de l'époque. Cela peut-être une famille classique (comme celle de César) ou une recomposée, comme celle de Malcolm, qui a perdu son épouse, alors que sa nouvelle compagne a vu mourir son époux et sa fille. Chacun a ses petits soucis : César doit gérer la crise d'adolescence de son fils aîné, alors que Malcolm doit faire accepter sa nouvelle compagne à son fils, lui aussi adolescent. L'un des publics cibles des producteurs peut donc s'identifier à un singe ou un humain de sa génération.
Par contre, les femmes sont globalement au second plan. Du côté des singes, on ne voit guère que la compagne de César, soumise et courageuse. Du côté des humains, seule Ellie émerge.
Sinon, on peut faire abstraction de tout cela pour se plonger dans un film d'action à rebondissements. C'est techniquement très au point. Les mouvements des singes sont criants de vérité. Plusieurs séquences sont particulièrement marquantes, comme l'incendie d'un village et l'assaut d'une cité fortifiée. Cela culmine dans le duel final, bien mis en scène mais au déroulement un peu convenu.
P.S.
Je ne pense pas trahir un secret en affirmant qu'il y aura une suite... et puis, tendez l'oreille pendant le générique de fin.
21:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 03 août 2014
Planes 2
Je n'ai pas vu le premier épisode (à l'époque, j'avais préféré me contenter du francophobe mais habile Turbo). Le début du film a failli me faire regretter de m'être laissé tenter pour le numéro 2. On y retrouve l'équipe d'amis qui entoure le héros (véhicules et avions), très très inspirée de Cars... mais sans la saveur qui avait fait la réussite de ces films.
L'histoire "décolle" lorsque le héros Dusty rejoint l'équipe de pompiers volants, composée de personnages hauts en couleur. Evidemment, des conflits surgissent, mais aussi des situations comiques, notamment avec le vieux camion de pompiers, qui veut vraiment montrer son pot d'échappement à ses camarades (qui n'en demandaient pas tant) et qui, lorsqu'il tente de prouver qu'il est à nouveau "bon pour le service", nous gratifie d'une sirène flatulesque...
Comme John Lasseter est le producteur exécutif, on peut se douter qu'il a veillé à la qualité de l'animation. Elle n'est pas toujours flagrante. Elle apparaît particulièrement au cours des séquences d'intervention. La première voit l'équipe de pompiers volants (des avions ou hélicoptères dont les pare-brise sont remplacés par des yeux) effectuer une mission de routine. Dusty y découvre ses limites, et le courage de ceux qui chaque jour risquent leur vie. On continue par son apprentissage, plutôt laborieux, mais parfois spectaculaire.
L'intrigue culmine dans une longue séquence d'incendie, qui s'inspire des films catastrophe et de ceux d'épouvante. C'est bien mené et souvent remarquable à l'écran. Les scènes où l'on voit, de nuit, les flammes progresser dans la forêt sont superbes. Le fond n'est pas idiot non plus. On dénonce la cupidité et l'arrivisme de l'homme d'affaires qui méprise l'environnement. Cela donne un film plaisant, mais en-dessous des chefs-d'oeuvre dont Pixar nous a gratifiés naguère.
20:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
mercredi, 30 juillet 2014
Boyhood
Pendant douze ans, chaque année, le réalisateur Richard Linklater (auteur notamment de l'excellent A Scanner Darkly) a filmé les mêmes acteurs... pendant une semaine seulement. Le projet était de montrer l'évolution d'une famille, en s'appuyant sur une équipe qui vieillissait avec les personnages. Au cœur de l'histoire se trouve le fils cadet, Mason, que l'on suit de l'enfance à l'entrée à l'université. (On pourrait traduire le titre par "Garçonnitude".)
Si la plupart des acteurs sont très peu connus voire inconnus, pour incarner les parents, le réalisateur a choisi deux pointures : Patricia Arquette et Ethan Hawke, deux bons professionnels, mais qui sont un peu à la marge du "star system".
L'un des intérêts du film est de voir l'évolution de ces acteurs connus. On redécouvre ainsi Patricia Arquette en ex-jeune première (très mince), puis on la voit ressembler à la mère de famille de Medium, avant qu'elle n'acquière le physique qu'on lui connaît actuellement. J'ai aussi ressenti un je-ne-sais-quoi de fascinant à regarder grandir ces enfants, devenus adolescents. On est même touché par les changements qui s'opèrent chez l'un des hommes de la vie de l'héroïne, ancien soldat en Irak (pour payer ses études), puis compagnon et époux qui se veut modèle, enfin alcoolique aigri, dépassé par l'évolution de la société américaine.
L'autre force du film est de montrer que, sans effets spéciaux, on peut mettre en scène une chronique familiale et la rendre aussi passionnante qu'un blockbuster. C'est évidemment dû au talent des acteurs et aussi au montage de chaque séquence annuelle. Il a fallu de plus tracer des liens d'une séquence à l'autre, tout en faisant évoluer les personnages. Le tour de force est réussi, avec quelques moments comiques savoureux.
Pour nous Frenchies, certaines scènes ont aussi valeur documentaire, sur nos amis d'outre-Atlantique. Rien n'est vraiment nouveau, mais l'histoire collecte un ensemble de faits (sur les relations parents-enfants, l'organisation de l'école, les distractions...) que l'on a déjà vus ailleurs, dans des séries ou des longs métrages.
Qu'en retire-t-on ? Eh bien qu'il est difficile d'être une mère américaine et de mener la carrière de ses rêves. Que les hommes sont quand même souvent des gros cons alcooliques. Que les adolescents peuvent être particulièrement casse-couilles... mais aussi sympathiques. Que l'argent détermine beaucoup de choses. Qu'une partie des Etats-Unis vit avec la Bible et les armes chevillées au corps. Là encore, rien de nouveau sous le soleil, mais le fait que l'on suive, année après année, ces personnages et ces acteurs a un charme inexplicable, celui de la vie.
09:47 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
lundi, 21 juillet 2014
A la recherche de Vivian Maier
Par le plus grand des hasards, un jeune Américain, John Maloof, met la main sur un paquet de négatifs puis de pellicules non développées. Il se rend rapidement compte que les photographies sont de grande qualité, très originales... mais que leur auteure est totalement inconnue. Ce documentaire est le récit de sa découverte, des recherches entreprises pour reconstituer la vie de Vivian Maier (1926 - 2009) puis de sa reconnaissance posthume.
On sait à quoi elle ressemble parce que, parmi les milliers de photographies qu'elle a prises, se trouvent des dizaines d'autoportraits, presque jamais classiques. Elle joue toujours sur les reflets ou les ombres :
Dans le lot, on trouve aussi beaucoup de vues d'enfants, noirs comme blancs, riches comme pauvres. Peut-être est-ce par déformation : Vivian Maier a vécu comme domestique, notamment "nounou". Les auteurs du film ont retrouvé certains des enfants qu'elle a gardés. Les témoignages sont très variés, pas toujours à l'avantage de la dame, qui a semble-t-il souvent changé d'employeur, soit qu'elle ait eu envie d'autre chose, soit qu'elle ait été renvoyée.
Elle a arpenté les rues des différents quartiers de New York et de Chicago, dont elle laisse un témoignage foisonnant. Elle était visiblement attirée par les "gueules", les physiques qui sortaient de l'ordinaire :
Elle a eu l'art de saisir l'essence des travaux et des jours de ce petit peuple de New York ou de Chicago, mais aussi des paillettes dont la ville se parait, à certaines occasions. Excellente cadreuse, elle savait montrer les inégalités d'un coup d'oeil :
A force de pratiquer, cette autodidacte de l'objectif a acquis un grand savoir-faire technique, apprivoisant la lumière et sachant capter les mouvements de la vie :
La très grande majorité de son oeuvre est constituée de clichés en noir et blanc, mais il en existe aussi en couleurs, ainsi que quelques films... et même des enregistrements audio. Vivian Maier garde toutefois une part de mystère.
Physiquement, c'était une femme impressionnante. Assez grande, elle était de surcroît dotée d'un gros caractère, tout en passant pour quelqu'un de farfelu. Il faut imaginer un équivalent féminin du M. Hulot de Jacques Tati, avec une pincée de Charles de Gaulle. Ces références à la France ne sont pas innocentes, puisque sa mère était française et qu'elle-même passa la majeure partie de son enfance dans notre pays, dans un coin perdu des Alpes où John Maloof finit par débarquer... et même par organiser une exposition !
Elle n'a jamais été mariée, ne semble pas avoir eu d'enfant. Elle rejetait les hommes à tel point que, lorsque l'un d'entre eux, croyant bien faire, voulu l'aider à se stabiliser sur une plate-forme où elle était montée pour pouvoir prendre des photos, elle le repoussa violemment. On pense qu'elle a dû connaître un traumatisme grave. S'est greffé là-dessus un tempérament solitaire et une activité (la photographie) qui l'a coupée du monde. Elle semble avoir voulu mettre un écran entre elle et la vraie vie, se contentant de la suivre en spectatrice.
Au cours de son enquête, John Maloof découvre qu'elle fut aussi une collectionneuse compulsive d'articles de journaux (entre autres), allant jusqu'à piquer une crise devant ses employeurs après qu'ils eurent donné une pile de vieux papiers à leur voisin. Il semble que, sur le tard, ses traits caractériels se soient accentués, au point qu'elle a dû arrêter de travailler. Elle a été temporairement sauvée de la misère par d'anciens enfants qu'elle avait gardés. Ils ont même loué un garde-meuble pour y stocker ses affaires. Elle est finalement morte pauvre, seule et oubliée.
Un autre mystère demeure : aurait-elle voulu être reconnue pour son oeuvre ? Il semble qu'au début, oui. Maloof a retrouvé une correspondance avec la France, dans laquelle il est question de l'édition de cartes postales à partir de certains de ses clichés. Puis, plus rien. L'événement traumatique est-il survenu à cette époque, après son retour à New York ? On ne le sait pas.
Il reste une oeuvre magnifique, tant sur la forme que sur le fond, preuve qu'une grande artiste peut venir d'un milieu modeste et mourir inconnue, à l'inverse de tant de pédants médiatiques sans talent.
P.S.
Toutes les illustrations de ce billet sont issues du site créé par John Maloof, qui est une véritable mine.
01:17 Publié dans Cinéma, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, photographie, photo
jeudi, 17 juillet 2014
Le Procès de Viviane Amsalem
Si le titre français fait allusion à l'ambiance kafkaïenne dans laquelle baigne l'intrigue, le titre israélien (Le Guet, c'est-à-dire l'acte de divorce) est plus explicite (pour le public local), puisque l'histoire tourne autour d'un couple qui se déchire, elle, Viviane (Ronit Elkabetz, formidable) voulant divorcer, lui, Elisha (Simon Abkarian, sobre mais pas toujours convaincant) ne voulant pas et s'appuyant sur la loi de son pays.
Il est donc question de la place de la femme juive dans la société israélienne. Alors que le débat devrait porter sur la pérennité du couple, on examine la personnalité de l'épouse sous toutes les coutures. L'habileté du film est de faire en sorte que les autres protagonistes finissent aussi par passer à la moulinette. Je recommande notamment le personnage de l'avocat d'Elisha (qui est aussi son frère), interprété par Sasson Gabai, excellent dans Le Cochon de Gaza. (Il avait joué aux côtés de Ronit Elkabetz dans La Visite de la fanfare.)
Cela ressemble un peu à du théâtre filmé, puisque tout se passe soit dans une petite salle de tribunal, soit dans les couloirs adjacents. On a varié les intervenants : outre les juges, les époux et leurs avocats, on fait défiler devant nous une belle brochette de témoins.
L'un des intérêts de leurs auditions réside dans le retournement possible du témoignage. C'est d'abord le frère de l'épouse qui n'apporte (involontairement) que de l'eau au moulin du mari. C'est ensuite un ami de l'époux, très louangeur sur celui-ci, qui finit par le trahir. Ce sont aussi quelques personnages hauts en couleur, comme la belle-sœur de l'épouse, qui nous livre un numéro de toute beauté ! L'un des moments-clés est le passage des voisins, d'abord l'homme, puis sa femme, qui va finir par parler franchement hors de sa présence.
Etant donné la sobriété de la mise en scène, le moindre détail est signifiant. On sera donc très attentif aux évolutions de la coiffure de Viviane, ainsi qu'à la grande diversité de ses tenues (et de ses chaussures), qui ne laissent pas indifférents certains des hommes présents dans la salle.
Les dialogues sont savoureux aussi par l'enchevêtrement des langues : l'hébreu, le français, l'arabe... Une partie de ce petit monde est originaire d'Afrique du Nord, où l'on a le sang chaud. Face aux plaignants, les juges religieux forment un trio incongru de barbus (censés être) respectables, scrupuleux au-delà du raisonnable et dont la patience va être mise à rude épreuve.
La procédure s'éternise, de reports en demandes supplémentaires. Je ne dirai pas comment cela se termine, mais sachez être attentif aux expressions du visage de Viviane... Qui a vraiment gagné ?
23:55 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
mercredi, 16 juillet 2014
Circles
Ces cercles concentriques sont les ondes de choc provoquées par un événement traumatique, à l'image de ce que l'on voit d'un plan d'eau où l'on a jeté une pierre. Comme le dit l'un des personnages du film, malheureusement, ce sont plutôt les mauvaises que les bonnes actions qui ont ce genre de répercussions.
Tout commence en Bosnie-Herzégovine, en 1993. Un soldat serbe revient chez son père, voir aussi sa fiancée. Dans le village multiconfessionnel, la cohabitation semble se passer assez bien. Mais un groupe de paramilitaires (serbes) fait des siennes :
Dans la première partie du film, on ne voit pas comment cette scène se termine. On fait un bond de 12 ans et l'on retrouve presque tous les protagonistes, désormais éparpillés. Certains sont restés en Bosnie, comme ce vieil homme qui s'acharne à reconstruire une église sur le point d'être engloutie à cause d'un barrage. Quand on finit par voir le bâtiment d'origine (et le lieu où il se trouve), on comprend mieux l'acharnement du vieil homme. Il est aidé par un jeune ouvrier... et bientôt l'un des amis de celui-ci, dont le vieillard ne veut pas, au début. On se demande pourquoi et l'on se dit qu'il y a sans doute un lien avec le père disparu du jeune homme. Une drôle de relation va se nouer entre les deux.
Ce saut dans le temps fonctionne très bien parce que les personnages ont réellement vieilli à l'écran, à tel point que certains d'entre eux sont méconnaissables. On a joué sur la chevelure, la barbe, la moustache, les vêtements, sans doute aussi le maquillage. Je pense qu'en réalité on a "rajeuni" les acteurs pour les faire rentrer dans les rôles de l'année 1993. (On a peut-être même demandé à quelques-uns de mincir un peu pour faire plus jeunes.) En tout cas, avec peu de moyens, on a fait du bon boulot.
Pas très loin de la première histoire s'en déroule une autre, à Belgrade, en Serbie. Un accidenté de la route est amené aux urgences de l'hôpital central. Le médecin chef finit par reconnaître son patient. Les souvenirs rejaillissent. Il se retrouve face à un dilemme.
Le troisième sommet de ce triangle narratif se trouve en Allemagne. L'un des protagonistes du départ (on a du mal au début à déterminer lequel) y a refait sa vie. Il a un boulot correct, une épouse, deux filles. L'arrivée d'une femme des Balkans va bouleverser son quotidien. Elle est accompagnée d'un jeune enfant et fuit le père de celui-ci, qui est aussi une vieille connaissance.
Les trois histoires s'entrecroisent avec habileté. C'est de surcroît très bien joué, même si, de temps à autre, on verse un peu trop dans le mélo. Mais le réalisateur compense cela par un réel savoir-faire. Que se passe-t-il dans la tête de ces hommes filmés de dos, gros plan sur la nuque ? Pourquoi ces personnages apparaissent-ils si écrasés par leur environnement, que ce soit un paysage de montagne ou un quartier urbain ? Je pense aussi à cette conversation téléphonique, coupée en deux. On en perçoit une partie, à un moment du film, dans le contexte bosnien et l'autre, plus tard, dans le contexte allemand.
Petit à petit, les fils se dénouent. C'est brillant parce que magistralement monté. Ajoutez à cela une musique excellente et vous obtenez l'une des découvertes de cet été, à ne pas rater si le film est programmé près de chez vous.
P.S.
Même si l'intrigue a été travaillée pour rentrer dans le cadre d'un long métrage, elle s'inspire d'une histoire vraie, ce qui donne encore plus de force au film.
12:25 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire
lundi, 14 juillet 2014
Gaudi, le mystère de la Sagrada Familia
Ce documentaire hispano-suisse (à moins qu'il ne soit helvético-espagnol) est consacré à la célèbre église barcelonaise, dont le nom complet est "Temple expiatoire de la Sainte Famille". En un peu moins d'1h30, il tente de nous exposer l'histoire du bâtiment et les controverses dont il est l'objet.
On associe la basilique à son plus ardent promoteur, l'architecte Antoni Gaudi, qui a consacré une grande partie de sa vie à sa construction. Il a vite compris qu'il n'en verrait pas la fin, mais il avait laissé des plans et surtout quantité de maquettes, pour permettre à ses successeurs de poursuivre son oeuvre.
Le film montre l'originalité du personnage, l'ampleur de ses talents, son engagement ainsi que sa modestie. Il a fini par vivre dans l'église en chantier, s'habillait de manière ordinaire, à tel point qu'à sa mort (il a été renversé par un tramway), ceux qui ont découvert son corps ont pensé qu'il s'agissait de celui d'un miséreux.
Après la mort de l'architecte, la guerre civile espagnole porta ce qu'on croyait être le coup de grâce à la construction. La basilique fut dégradée et la majeure partie des archives de Gaudi détruite. Par la suite, la question s'est posée de l'intérêt d'en reprendre la construction... puis de l'affectation du bâtiment : église ou musée ?
Le documentaire nous présente aussi deux des continuateurs de Gaudi, des contemporains au profil atypique. Le portail de la Nativité a été réellement achevé par le Japonais Etsuro Sotoo, qui a fini par se convertir au christianisme. Son parcours est particulièrement intéressant. Lui a cherché à se placer dans les pas de Gaudi. Plus indépendant est le sculpteur Josep Maria Subirachs (mort il y a quelques mois), qui se disait agnostique, mais de culture chrétienne. Il a été chargé du portail de la Passion, une grande réussite à mon avis, avec ces figures géométriques qui ne sont pas sans rappeler certaines toiles cubistes.
Aujourd'hui, on utilise les techniques les plus modernes, en particulier l'informatique (notamment des logiciels appliqués à l'aéronautique). Cela n'empêche pas l'architecte américain (Mark Burry, je crois) d'être lucide : ce sont les parties anciennes qui ont le plus d'âme et, si l'édifice ne manque pas d'allure, ce n'est qu'un monstre de béton. Le film s'achève sur les travaux en cours, sur la façade de la Gloire qui, même terminée, sera privée du grand parvis que Gaudi voyait déployé à ses pieds. La spéculation immobilière a eu raison des aspirations artistiques... Mais une autre menace pèse sur le bâtiment : la construction d'une voie ferrée (souterraine) à grande vitesse !
Au niveau de la réalisation, c'est très bon. A l'intérieur, l'église a été filmée à différents moments de la journée. On perçoit la variété des éclairages. Les jeux d'ombres et de lumière sont bien rendus. Les vitraux contribuent aussi à embellir l'édifice. On suit leur conception et leur réalisation.
A l'extérieur, on a filmé la basilique en hauteur, sous plusieurs angles et avec une grande précision. On distingue des détails que, même lors d'une visite approfondie, on ne verrait pas avec autant de précision.
La musique d'accompagnement, d'inspiration religieuse, se marie parfaitement avec les images. (On appréciera aussi la pertinence des interventions de Jordi Savall.) Le commentaire n'est pas dit sur un ton neutre... et c'est tant mieux. Autre atout de ce film : on a interrogé des non-spécialistes et des sans-grade. Au final, tous les témoignages ne se valent pas, mais c'est enrichissant.
00:13 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, art
jeudi, 10 juillet 2014
Big Bad Wolves
En dépit de certaines critiques négatives, je suis allé voir ce film israélien, incité par les louanges de Quentin Tarantino. On comprend assez vite pourquoi le meilleur réalisateur de sa génération a aimé : c'est un polar, parfois très complaisant avec la violence... et porté par une bonne bande son. On n'est pas très loin de Reservoir Dogs, même si le contexte est différent.
Cela commence par une séquence très réussie, muette. Trois enfants jouent à cache-cache. L'un d'entre eux ne sera pas retrouvé... du moins dans l'immédiat. Dans le même temps, la police locale enquête sur une série de meurtres pédophiles. Un suspect finit par être arrêté... et interrogé avec brutalité, sans que cela débouche sur quoi que ce soit. Un scandale éclate.
Vient ensuite la seconde partie du film, qui prend la forme d'une traque et d'une vengeance. Le père de l'un des enfants disparus joue un rôle déterminant. Mais son entreprise est régulièrement entravée ou perturbée par des éléments extérieurs : l'action maladroite d'un ancien flic, les coups de fil de sa maman, caricature de mère juive... et même la venue de son père, personnage qui se révèle plein de surprises !
L'humour réside dans ces effets inattendus et dans le décalage entre certains dialogues, quasi anodins, et l'horreur des situations. Franchement, j'ai bien aimé, même si je trouve que les auteurs abusent de la violence gratuite. (D'ailleurs, je ne place pas Reservoir Dogs très haut dans la filmographie tarantinienne.)
D'un point de vue formel, c'est très bon. J'ai déjà parlé de la musique, bien choisie, emballante. Les auteurs ont aussi construit méticuleusement leurs plans. Les focales comme les angles des prises de vue accentuent l'étrangeté ou le grotesque de certaines scènes.
On peut aussi s'amuser à tenter de deviner qui est le pédophile. C'est l'un des hommes montrés à l'écran. Mais est-ce le suspect ? Aucune preuve n'a été recueillie contre lui et, en face, certains des "justiciers" sont de sérieux clients. Il y aurait bien aussi cet Arabe à cheval mais, autant le dire tout de suite, c'est un personnage faussement menaçant.
C'est la grande habileté de ce film, la leçon qu'il donne, au second degré, qui n'a malheureusement pas été comprise par nombre de critiques. Le papa vengeur est un ancien de la guerre au Liban. Le grand-père a lui aussi combattu autrefois... et tous les policiers ont reçu une formation guerrière (sans parler du service militaire, qui, pour les garçons, dure trois ans).
Insidieusement, les auteurs montrent que la violence qui a été mise en oeuvre dans le conflit israélo-palestinien rejaillit sur la vie interne du pays. C'est par d'autres juifs que le suspect (juif aussi) est interrogé sans ménagement. C'est par d'autres juifs qu'il est enlevé et torturé... et c'est par un juif que les enfants ont été violés et assassinés.
00:42 Publié dans Cinéma, Proche-Orient | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
mardi, 08 juillet 2014
Le Conte de la princesse Kaguya
Cofondateur du studio Ghibli, Isao Takahata ne jouit pas en Occident de la même réputation qu'Hayao Miyazaki. Et pourtant... Dans sa jeunesse, il a créé la série Heidi (qui a fait beaucoup pleurer dans les chaumières). Plus tard, il est passé aux longs-métrages d'animation, avec Kié la petite sorcière et surtout Le Tombeau des lucioles, un véritable chef-d'oeuvre. Par la suite, il s'est aussi fait remarquer avec le superbe Pompoko et l'hilarant Mes Voisins les Yamada.
D'un point de vue formel, c'est moins flamboyant que les créations de Miyazaki. Les visages des personnages sont assez rudimentaires, à l'image de ce que l'on trouvait dans les productions japonaises des années 1980 :
Par contre, c'est du "fait main" (on dirait des peintures), avec un grand souci du détail et une véritable science du mouvement des personnages. Je pense à cette scène qui montre la princesse s'amuser avec un chat, d'une fluidité étonnante, ou ces moments où le bébé fait l'apprentissage de la marche (cul nu !), à coups de cabrioles plus vraies que nature.
L'atmosphère est celle d'un conte. Les amateurs des frères Grimm ou de Charles Perrault ne seront donc pas déboussolés, même si c'est ici tourné à la sauce japonaise, avec des références au bouddhisme et au shintoïsme. On notera aussi le grand soin apporté à la description des animaux (insectes, batraciens, poissons, oiseaux, mammifères...).
Le début de l'histoire baigne dans le merveilleux, avec la découverte de la princesse par un vieux couple de paysans, dans une bambouseraie. La gamine se révèle vite être un phénomène, grandissant à vue d'oeil. Cette enfance est aussi placée sous le signe de la joie, "Pousse-de-bambou" s'amusant avec les enfants du village et profitant des plaisirs simples de la vie, comme de déguster un succulent melon par une journée caniculaire :
Mais, au bout de 45 minutes environ, une rupture de ton intervient. La princesse a du mal à supporter le destin que des gens pourtant bien intentionnés lui ont tracé. Le dessin se fait moins lisse, révélateur des tourments internes de l'héroïne :
La jeune femme, dont la beauté est l'objet de spéculations dans tout l'empire, va apprendre à ruser avec l'étiquette très contraignante qui lui est imposée. Le dessin se fait plus traditionnel, s'inspirant visiblement des estampes qui ont fait la renommée du Japon :
Très drôles sont les séquences faisant intervenir les cinq prétendants, qui vont connaître des fortunes diverses... que je me garderai bien de révéler. Ici, on sent plutôt l'influence des Mille et une nuits dans la ruse dont la jeune femme fait preuve pour éviter d'avoir à se marier contre son gré. C'est ensuite au tour de l'empereur lui-même de s'intéresser à la princesse. Toute cette partie du film voit le personnage principal mûrir. Il a renoncé à certaines choses et appris à "vivre dans le système", tout en se ménageant des espaces de liberté. Ce conte est aussi une histoire d'apprentissage.
Une nouvelle rupture de ton annonce la dernière partie. On y apprend la véritable origine de la princesse, qui va tenter de connaître à nouveau le bonheur, qu'elle a touché du doigt dans l'enfance.
C'est une magnifique histoire, hélas desservie (à mon avis) par les chants (qu'ils soient en japonais ou doublés en français, dans la version que j'ai vue). Si les paroles sont porteuses de sens et la musique d'accompagnement en général agréable (je pense notamment aux morceaux joués sur un koto), les parties chantées m'ont semblé désespérément languissantes.
09:12 Publié dans Cinéma, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 06 juillet 2014
Palerme
La coupe du monde de football est une bonne incitation à fréquenter les salles obscures, d'autant plus que certains cinémas font des efforts de programmation... et que certains distributeurs choisissent judicieusement le moment de la sortie de leurs films. Le début de l'été 2014 ressemble un peu à celui de 2006, quand avait débarqué sur les écrans français Leçons d'amour à l'italienne.
La comédie transalpine est encore à l'honneur aujourd'hui, avec Palerme, dont l'action se déroule dans la capitale de la Sicile. Pour être plus précis, la majorité de l'action se déroule Via Castellana Bandiera (titre du film en italien), une ruelle à double sens de circulation... mais où deux voitures ne peuvent pas se croiser.
Avant d'en arriver à l'affrontement homérique qui constitue le coeur de l'histoire, on nous présente les protagonistes. A ma gauche se trouvent les Calafiore, famille modeste, où les hommes parlent fort, sont un peu truqueurs sur les bords, mais où les femmes peuvent arriver à leurs fins, à condition d'être malines et tenaces. A ma droite se trouve un couple en crise, composé de deux citadines pur sucre. La plus jeune, Clara, est illustratrice (on voit d'ailleurs plusieurs de ses croquis, censés être pris sur le vif... et très jolis). La plus âgée, Rosa, est une femme (mûre) de caractère, interprétée par la réalisatrice Emma Dante, qui est l'auteure du roman qui a inspiré le film. Notons qu'elle ne se donne pas le beau rôle, n'hésitant pas à se faire filmer sans chichis.
La film démarre par une magnifique séquence, presque muette, qui nous présente l'autre protagoniste du duel, Samira, une vieille femme d'origine albanaise. On ne la voit que de dos. On ne distingue donc pas son visage. Mais les mouvements de son corps et de sa chevelure suffisent. On la suit allant au cimetière, jusqu'au moment où, après avoir nourri une troupe de chiens errants, elle part au volant de sa voiture chercher le reste de la famille. (Notons que les deux groupes se déplacent en Fiat, l'une très ancienne -et petite, l'autre plus moderne... et très confortable. Le film est aussi une satire sociale.)
Quand on découvre celle-ci, on a comme une impression de déjà-vu. C'est qu'on agite les mains et qu'on a le verbe haut chez les Calafiore. On a le sang chaud, aussi. Ils vivent de la pêche et de menus travaux (plus ou moins légaux). Le père (gendre de Samira) est un petit tyran, fort en gueule. (Je recommande la tirade qu'il sort au premier automobiliste qui vient lui demander de déplacer sa voiture !) C'est d'abord lui qui refuse de céder le passage aux deux bourgeoises qui arrivent en face... surtout pas à la conductrice, qu'il surnomme "miss prout prout" !
Mais, très vite, on se rend compte que la belle-mère obéissante a décidé de n'en faire qu'à sa tête. En face, Rosa en a plein le dos de cette vie qui ne tourne pas comme elle l'aurait voulu. Cette fois-ci, elle compte bien ne pas se laisser marcher sur les pieds. La tension est à son comble. On est en plein western, où les rétroviseurs mettent en valeur les regards impitoyables des adversaires. Chacune est rivée à son volant mais, quand l'une décide de sortir, c'est pour mettre un "coup de pression" à l'autre... au besoin, en utilisant à l'urine !
Bien évidemment, les voisins vont s'en mêler, chacun ayant un avis autorisé sur la question. Certains conseillent aux deux femmes de reculer et de s'en aller. D'autres tentent de faire entendre raison au pater familias. Après un moment d'altercations vives, la rue va se calmer, laissant les deux conductrices seules dans leurs véhicules.
Pendant ce temps-là, les mecs vaquent à leurs petites affaires. Comme on est en Italie et même en Sicile, on ne s'étonnera pas que des paris soient faits sur l'issue du duel entre les deux femmes. On ne s'étonnera pas non plus qu'un groupe soit tenté de fausser le jeu...
Du côté des deux protagonistes, on commence à gamberger. Samira pense à un être cher, décédé, tandis que Rosa craint de perdre Clara, qui ne comprend pas son obstination. Le soir arrive, la nuit passe... et, au matin, la situation va se dénouer, de manière inattendue. Je vous laisse découvrir comment.
14:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
samedi, 05 juillet 2014
Zero Theorem
Cela faisait un petit moment que je n'avais pas regardé un film de Terry Gilliam (depuis 2005 et Les Frères Grimm). En dépit de critiques négatives, j'ai eu envie de voir ce que devenait l'ancien membre des Monty Python.
Dès le premier plan, on sent qu'on n'a pas affaire à un manchot. On est face à la vision d'un trou noir. On se croit dans l'espace... mais la caméra va effectuer un mouvement qui donnera tout son sens à la scène. Peu de temps après, on se retrouve dans la rue, en ville, dans un futur proche où les publicités numériques et ciblées agressent les passants. C'est très emballant.
S'ajoute à cela la prestation remarquable d'un acteur formidable, Christopher Waltz (excellent aussi bien dans Django unchained que dans Carnage), dont l'aspect physique n'est pas sans rappeler celui de Fétide dans La Famille Adams.
S'il est, comme son quasi-jumeau de la comédie macabre, introverti et agoraphobe, son personnage est moins clownesque. Gilliam en fait un type très intelligent, qui se pose des questions sur "le sens de la vie". Il travaille pour "le Management", une mystérieuse autorité supérieure qui finit par s'incarner en Matt Damon, remarquable dans le rôle.
La vie très réglée de Qohen Leth va être chamboulée par l'irruption d'une jeune femme excentrique, croisée au cours d'une fête un peu spéciale. Celle-ci est interprétée par Mélanie Laurent Thierry, véritable bombe sensuelle qui a pourtant bien du mal à briser la glace du héros (elle m'a tellement tourné les sens que je m'en suis trompé sur son nom) :
Il faut dire que, lorsqu'elle débarque dans l'église désaffectée qu'occupe le héros, vêtue d'une tenue d'infirmière hyper-moulante, malgré des godasses immondes, tous les mâles hétérosexuels de la salle ont les yeux qui sortent de leurs orbites et la langue qui pend jusqu'aux chaussettes. C'est évidemment un pur fantasme du réalisateur, auquel l'actrice s'est prêtée avec un incontestable talent. Plus loin dans le film, on la voit sous un autre jour, signe qu'elle sait jouer autre chose que les aguicheuses.
Je signale aussi la performance de Tilda Swinton, formidable en psychologue un peu déjantée, qui part même totalement en vrille dans une scène où elle finit par se muer en rappeuse ! (Je crois que, depuis que j'ai remarqué cette actrice au cinéma, dans Orlando en 1993, je n'ai jamais été déçu par ses prestations, que ce soit dans Michael Clayton, L'Etrange Histoire de Benjamin Button, Moonrise Kingdom, Snowpiercer ou The Grand Budapest Hotel.)
Toutefois, l'histoire subit quelques "coups de mou". La quête de sens du héros n'est guère palpitante. On est plutôt captivé par les péripéties et le talent des acteurs à incarner des personnages forts. Tout cela est un peu absurde... sauf si l'on se dit que Qohen Leth est le double d'un Terry Gilliam vieillissant, qui se pose des questions existentielles et voit dans la relation avec une jeune et belle femme un moyen de retrouver le génie créateur de ses débuts.
00:38 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 29 juin 2014
The Rover
Ce "vagabond" est Eric, un homme qui semble avoir (presque) tout perdu, dans une Australie devenue une jungle sans pitié. Au mitan de sa vie, il est seul, sans travail, avec peu d'argent... et on lui pique sa bagnole ! Il décide de tout faire pour la récupérer.
On se demande pourquoi cet acharnement. Après tout, il a mis la main sur le pick-up des voyous. Il pourrait s'en contenter, d'autant plus que sa caisse n'est pas une voiture de luxe. On se demande ce qu'elle peut bien avoir de si important pour lui (on ne le découvre vraiment qu'à la fin du film). Après tout, c'est peut-être la poursuite qui le motive. Elle donne un sens à sa vie, qui n'en a plus depuis de récents événements qui ne nous sont contés que plus tard.
C'est à la fois hyper-violent et drôle. L'humour ne réside toutefois pas dans les scènes d'affrontement armé, mais dans la confrontation des caractères. Les personnages (majoritairement des hommes) ont des "tronches" et, face à eux, le héros se révèle en général mutique, ce qui crée des situations embarrassantes.
Guy Pearce (un habitué des seconds rôles, vu dans Iron Man 3, Prometheus, Le Discours d'un roi et Démineurs) est excellent en homme mûr taiseux, violent et désespéré. Dans son périple, il s'attache un drôle de compagnon : le frère cadet de l'un des braqueurs (Robert Pattinson -récemment aperçu dans Maps to the stars- pas mal, bien qu'un peu caricatural), jeune homme immature, surtout en quête d'un protecteur, au fond.
En cours de route, le héros rencontre un nain trafiquant, de vieux commerçants âpres au gain, un médecin très méfiant, une hôtelière maladroite, une mère maquerelle et des militaires pointilleux mais imprudents. Cela contribue à créer une sorte de tableau impressionniste de la société de ce coin perdu de l'Australie méridionale, pas franchement joyeux.
C'est remarquablement réalisé. Un grand soin a été apporté à la construction des plans. On ne met pas n'importe quoi dans le cadre. C'est aussi parfois très joli à regarder : j'ai encore en mémoire deux très belles scènes, l'une qui voit le héros rouler dans une zone désertique, au crépuscule, l'autre qui montre le duo au réveil, à l'aube, dans un coin paumé. La photographie est très belle, avec des teintes ocres et bleutées.
Ce n'est pas le film du siècle, mais une découverte à faire. Je pense qu'on reparlera du réalisateur, David Michôd.
11:40 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
samedi, 28 juin 2014
Black Coal
Ce polar chinois a reçu l'Ours d'or cette année, au festival de Berlin. Plusieurs assassinats sont au coeur de l'intrigue. Ils ont eu lieu à cinq ans d'écart, en 1999 et 2004. A chaque fois, des morceaux du corps de la victime ont été retrouvés en plusieurs endroits (liés à l'exploitation du charbon).
La première partie du film présente le héros, policier sûr de lui en 1999, qui va perdre sa femme, plusieurs de ses collègues-amis... et son boulot. Cette enquête non résolue a provoqué sa déchéance, mais, cinq ans plus tard, il va tenter d'aller au bout, à l'aide d'anciens collègues, restés dans la police.
Sur son chemin, il retrouve la veuve de la première victime, dont il finit par découvrir qu'elle est liée à chaque personne assassinée. Le tout est de découvrir pourquoi.
L'intrigue est assez complexe... mais le public européen fan de séries policières ne sera pas dérouté. Il faut du temps pour en démêler tous les fils... et c'est assez surprenant. C'est aussi un polar social, qui brosse un portrait sans concession de la Chine du début du XXIe siècle. Si quelques liens d'amitié existent, au fond, quand les problèmes graves surgissent, c'est un peu chacun pour soi. On ne peut pas dire que les personnages fassent preuve de compassion envers plus faible qu'eux.
Au niveau de la réalisation, c'est maîtrisé. On s'en rend compte dès le passage d'une époque à l'autre, qui s'effectue au même endroit, où une saison succède à l'autre : la torpeur estivale du début est suivie d'un hiver très rigoureux. Cela nous vaut plusieurs scènes très réussies, notamment autour d'une patinoire, ou encore dans une nacelle de la grande roue.
Il reste quelques maladresses, notamment au niveau du jeu des acteurs. Certaines péripéties m'ont de plus paru un peu téléphonées (notamment l'un des meurtres). J'ai aussi l'impression que le réalisateur se complait dans la noirceur et le désespoir.
Cela reste un bon film, mais, à mon avis, A Touch of sin (de Jia Zhang Ke) était meilleur.
20:52 Publié dans Chine, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
Transcendance
D'après le Trésor de la langue française, la transcendance se définit par le "caractère de ce qui est transcendant, de ce qui se situe au-delà d'un domaine pris comme référence, de ce qui est au-dessus et d'une autre nature". Dans ce film, il est question d'une "sur-humanité", incarnée par un programme informatique sur lequel s'est greffée une personnalité humaine.
Depuis 2001, L'Odyssée de l'espace jusqu'au récent Her, on se demande si les ordinateurs ont une âme. Transcendance part du principe qu'il faut intégrer une pensée et un vécu humains à un programme pour y parvenir.
La première partie du film est une longue introduction, chargée de nous présenter les personnages principaux, le contexte (c'est un film d'anticipation) et de nous amener au choix décisif qui fait basculer l'histoire. Côté distribution, y a du lourd, avec bien entendu Johnny Depp (mal doublé en français, je trouve), Rebecca Hall (un clone approximatif de Scarlett Johansson... mais elle joue bien), Paul Bettany (qui en fait un peu trop, parfois), Cillian Murphy (dans un rôle assez stéréotypé ; il était mieux dans Time Out), Morgan Freeman (qu'on ne présente plus... du coup, il passe la moitié du film avec des lunettes de soleil sur le pif) et une vieille connaissance des séries américaines, Kate Mara (vue aussi dans Iron Man 2).
A l'écran, dans une grande salle, on prend son pied. Wally Pfister (le réalisateur) est directeur de la photographie de formation. Il a travaillé notamment sur Memento, Insomnia, Batman Begins, Inception et The Dark Knight Rises. Les décors sont vraiment superbes et les effets spéciaux très réussis.
L'intrigue est prenante. Le scénario nous laisse dans l'incertitude quant à l'opinion qu'il faut avoir du groupe de rebelles, à la fois militants avertis et adeptes des solutions radicales. Dans la deuxième partie du film, on suit la montée en puissance du "nouveau" Will Caster / Johnny Depp, ses inventions se matérialisant de manière parfois étonnante.
Mais l'histoire peine à se conclure. On s'est visiblement demandé qui il fallait garder en vie et comment terminer le film de manière "morale". Les vingt dernières minutes m'ont franchement déçu. On peut toutefois voir l'ensemble comme un bon divertissement.
10:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 26 juin 2014
Con la pata quebrada
Ce documentaire espagnol revient sur 80 ans de cinéma ibérique, sous l'angle de la place de la femme. Le titre, que l'on pourrait traduire par "avec la patte cassée" serait une référence au roman Don Quichotte (de Cervantès) et plus précisément à une formule qui évoque la place de la femme à la maison.
Les années 1930 furent très riches, avec la liberté acquise sous la République, avant que n'éclate la guerre civile. On y voit un reflet de la société, avec des femmes qui agissent, qui jouent même un rôle politique : elles avaient obtenu le droit de vote (bien avant les Françaises), celui de divorcer et, dans certaines régions, d'avorter (bien avant les Françaises).
Entre 1936 et 1939, le cinéma est le reflet de la division du pays, avec deux visions du rôle de la femme. Aux républicains s'opposent les franquistes, traditionalistes, qui vont triompher. En attendant cette funeste conclusion, on voit des enfants jouer une scène d'anthologie, avec des garçons qui défendent majoritairement l'inégalité des sexes, tandis qu'une charmante petite fille annonce vouloir être... la Pasionaria !
La suite est la partie la plus développée du film, qui court de la fin des années 1930 aux années 1970. Si l'on était en Allemagne, on parlerait des "trois K" : Kinder (les enfants), Küche (la cuisine) et Kirche (l'église). Paradoxalement, d'après ce qui est montré dans le documentaire, on exalte assez peu le rôle de mère. La propagande conservatrice insiste sur celui de femme au foyer et d'épouse docile. Son attitude doit de plus être conforme à la morale définie par la Sainte Eglise catholique. Réjouissante est par ailleurs la scène qui voit un vieil ecclésiastique dire le fond de sa pensée sur le deuxième sexe.
C'est l'une des qualités du film : son humour. Avec le recul, on s'amuse de cette scène qui voit de jeunes Espagnoles légèrement vêtues venir remercier leurs visiteurs d'outre-Atlantiques, fins gastronomes, en clamant : "Merci aux Américains qui aiment les moules espagnoles !" Un peu plus loin, on ricane en voyant la tête consternée du mari qui récupère sa belle chemise de soie... pas tout à fait bien repassée. Encore plus loin, c'est l'effarement d'une mère face à sa fille qui, de retour de vacances, lui avoue avoir eu des relations sexuelles. A l'époque de la Movida, cela devient plus "corsé", avec une scène qui montre une jeune actrice (destinée à une belle carrière) s'amuser dans son bain, avec un jouet animé, qui remonte entre ses jambes...
L'époque franquiste est suffisamment longue pour avoir été variée. On découvre donc l'ambiguïté des cinéastes de l'époque qui, tout en faisant l'éloge de l'épouse fidèle, irréprochable mère au foyer, aimaient parfois à filmer lascivement des femmes dévoyées. Les religieuses sont aussi bien mises en valeur. A l'inverse, les célibataires endurcies, les femmes indépendantes sont montrées de manière négative. Elles ne sont jamais heureuses, dans les fictions de l'époque.
On perçoit aussi les évolutions socio-culturelles. Les films mettent en scène l'essor du tourisme, avec des tenues plus légères et des comportements nouveaux. De son côté, l'irruption de l'électro-ménager dans les foyers est montrée comme une conquête féminine... (On n'est pas loin du "Moulinex libère la femme" que la France a connu à cette époque.)
A la mort de Franco succède une époque foisonnante, qui brûle parfois ce qui avait été adoré auparavant. On tourne en dérision la monarchie catholique (du Moyen Age ou de l'époque moderne, hein, attention) et les bonnes soeurs, dans des parodies pas toujours très fines. On présente aussi une vision plus moderne de la société. Les années 1930 ressurgissent, modifiées. L'érotisme est plus présent. On évoque aussi le thème des femmes battues avec, parmi les extraits servant d'illustration, celui d'un film mettant aux prises Carmen Maura et Sergi Lopez, bien plus jeunes qu'aujourd'hui !
Notons que l'auteur du documentaire n'est pas tombé dans la facilité qui aurait consisté (surtout pour la période récente) à collecter des extraits avec des vedettes ou futures vedettes. Il y en a, bien sûr, mais la grande majorité des films sur lesquels s'appuie la démonstration sont inconnus du public français.
Le début du XXIe siècle est marqué par de nouveaux questionnements, notamment sur la place des femmes aux postes de commandement.
Ce n'est pas très long (1h20 environ), c'est rythmé, fort instructif... et parfois très drôle !
23:47 Publié dans Cinéma, Histoire, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire
mardi, 24 juin 2014
Les Soeurs Quispe
Ce film chilien est très original. Il ressemble par moments à un documentaire rural, mais c'est une sorte de polar, dont l'arrière-plan est historique. On nous le précise dès le début : l'histoire s'inspire d'un fait divers qui s'est produit au Chili, en 1974. On ne nous dit bien évidemment pas lequel. Le contexte est celui des débuts de la dictature d'Augusto Pinochet.
Mais l'action se déroule très loin des villes et de leurs turbulences. On est sur l'Altiplano, dans un espace assez aride, balayé par les vents, pas très loin de la frontière argentine.
Les soeurs Quispe étaient quatre, mais ne sont plus que trois, l'aînée ayant disparu. (On comprend par la suite comment et pourquoi.) Justa, (la plus âgée de celles qui restent) joue le rôle de mère de substitution, la véritable étant déjà morte, tout comme le père. Au début, elle incarne la sagesse, mais, petit à petit, on réalise que, face aux nouveautés du moment, elle commence à perdre pied. Signalons qu'elle est incarnée par une petite cousine des vraies soeurs Quispe.
Lucia la cadette est un garçon manqué. Elle s'est parfaitement adaptée au milieu hostile. Elle sait très bien s'occuper des chèvres, au besoin en employant la force. Son passe-temps préféré est la recherche de fossiles, auxquels elle fait la conversation.
La benjamine est la plus jolie des trois, même si elle s'arrange mal. On sent qu'elle aspire à autre chose et qu'elle est fascinée par le monde urbain que pourtant elle redoute. Elle est magnifiquement interprétée par Francisca Gavilan, que l'on avait déjà remarquée il y a deux ans dans Violeta.
Le début du film nous fait découvrir "les travaux et les jours" de ces éleveuses de montagne. Elles doivent gérer un assez gros troupeau de chèvres laitières, auxquelles s'ajoutent quelques ovins. On les suit aux pâturages, pendant la traite et le soir, un moment délicat puisqu'il faut parvenir à récupérer tout le troupeau... sans oublier de séparer (pour la nuit) les petits des mères, pour pouvoir pratiquer la traite le lendemain matin. Des racines et des branches séchées sont utilisées pour élaborer une sorte d'enclos.
On voit aussi les femmes fabriquer (de manière très artisanale) leur fromage, qu'elles consomment et qu'elles vendent, à l'occasion. Elles mangent aussi de la viande de lama. Leur mode de vie est plutôt l'autoconsommation. Si l'on ajoute les vents violents et l'isolement montagnard, on se dit que (l'humidité en moins) l'Aubrac devait un peu ressembler à cela il y a quelques dizaines centaines d'années.
Ce quotidien monotone est perturbé par un mystère, celui de la disparition progressive des "voisins" (qui habitent à des dizaines de kilomètres !) et de leurs troupeaux. Un marchand ambulant assez roublard apporte un élément de réponse : le nouveau gouvernement a imposé une loi anti-érosion, qui vise à l'éradication des troupeaux de montagne, accusés de provoquer la disparition des terres. Derrière, il y a aussi la volonté de contrôler une population en marge... et de "sécuriser" la frontière avec l'Argentine, par où transitent parfois de drôles de citoyens.
Dans la dernière partie, les soeurs sont amenées à prendre une décision capitale. On sent bien qu'au départ, vu leurs tempéraments, elles ne sont pas d'accord, parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes aspirations. La fin est assez surprenante... et très forte.
20:51 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
lundi, 23 juin 2014
Jersey Boys
Ces garçons du New Jersey sont majoritairement des Italo-américains, qui ont passé leur enfance en osmose avec la mafia locale. A priori, leur horizon professionnel paraissait bouché : l'un était apprenti-coiffeur, deux autres commençaient à tâter de la prison et le quatrième ne parvenait pas à placer ses chansons. La formation du groupe, autour du chanteur Frankie Valli, va les porter au pinacle puis les plonger dans le désespoir. Grandeur et décadence du show business, vues par un Clint Eastwood très très académique.
La réalisation est certes correcte, mais je n'ai pas retrouvé la "patte" de ce bon vieux Clint. Et, même si les acteurs font le boulot, je trouve que le film souffre de nombreux défauts.
Le premier d'entre eux est le personnage principal, que l'on entend à longueur de film couiner avec sa voix de châtré nasillard. Il est de plus incarné par un clone raté de Tom Cruise, John Lloyd Young, à qui on a régulièrement envie de filer des tartes.
Et que dire des chansons ! Imaginez que Didier Barbelivien ait composé, il y a 20-30 ans, une série de bluettes pour midinettes à l'intention de Patrick Bruel. Bon, dans le tas, il y a deux-trois trucs à sauver (comme le célèbre Sherry ou encore Can't take my eyes off you... même si je préfère la version de Gloria Gaynor), mais, globalement, je trouve que c'est de la variétoche bas-de-gamme.
Au passage, à deux reprises, on entend un air familier aux oreilles françaises. Il s'agit de December 1963, dont Claude François a interprété une adaptation devenue célèbre sous le titre Cette Année-là.
La suite ? Ben, Clint nous raconte comment le succès a tourné la tête des jeunes hommes. Argent, alcool et filles à volonté... même pour le bon père de famille. Des tensions finissent par naître au sein du groupe, principalement pour des questions d'argent. Bref, rien de nouveau sous le soleil.
Un film dispensable... Rendez-nous le vrai Clint Eastwood !
23:22 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 22 juin 2014
Edge of tomorrow
Sorti (en France) la semaine du 70e anniversaire du débarquement de Normandie (tout comme le documentaire D-Day), ce film met en scène une autre tentative de libération de l'Europe, presque entièrement contrôlée par des extra-terrestres dont les formes empruntent à la fois aux arachnoïdes et aux céphalopodes.
A cause d'un accident, le héros, censé être mort, revit la même journée, en essayant de la modifier. Au départ, l'antipathique personnage incarné par Tom Cruise ne pense qu'à sa pomme (sauver sa vie). Puis il se dit que ce serait sympa de sauver celle de ceux qu'il croise (le soldat obèse qui se bat cul nu... et surtout la superbe combattante incarnée par Emily Blunt, déjà très bonne dans Looper). Finalement, il va tenter de sauver le monde. C'est un peu caricatural mais, grosso modo, cela traduit assez bien le simplisme du scénario, qui n'est pas sans rappeler celui d'Un Jour sans fin.
La première partie est une très bonne comédie. Cruise s'est bien glissé dans le rôle du communicant lâche et égoïste, à qui il arrive un tas de bricoles désagréables. Les seconds rôles sont efficaces, avec notamment un Bill Paxton épatant en sergent sermonneur. Comme les deux acteurs principaux "assurent" et que les effets spéciaux déchirent, on passe un très bon moment.
Dans la deuxième partie de l'histoire, le personnage incarné par Cruise prend le dessus. A force de recommencer la même journée (des centaines de fois...), il devient un soldat aguerri, mais jamais le duo qu'il forme avec Rita n'arrive au bout de la mission. Par contre, petit à petit, des sentiments naissent entre eux... même si, à chaque fois, pour la jeune femme, c'est une nouveauté. (Le film reste toutefois très pudibond.)
La dernière partie se déroule à Paris, de nuit. C'est spectaculaire à souhait, très joli à regarder, même s'il faut faire preuve d'un peu d'indulgence quant au scénario, qui abuse du "juste à temps" (tout comme, très récemment, X-Men - Days of Future Past).
Notons que la France est très présente dans cette fiction états-unienne. Outre le fait qu'au coeur de l'histoire se trouve un débarquement dans notre pays, signalons que l'héroïne est surnommée "l'Ange de Verdun", en hommage à son apport décisif dans une bataille contre les envahisseurs. Il faut ajouter la séquence parisienne (certains monuments emblématiques "dégustent" grave... de manière virtuelle, fort heureusement !)... et un flash d'actualités, au cours duquel les spectateurs de la salle, parfois stupéfaits, ont reconnu... François Hollande ! (Il serait intéressant de savoir si, dans les versions du film distribuées en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, par exemple, le président français est remplacé par un dirigeant local.)
Même si la fin ultime m'a un peu déçu, je suis sorti de là très satisfait... et avec une forte envie d'uriner !
13:32 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, cinema
dimanche, 08 juin 2014
Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
On a comparé cette comédie historique suédoise à Forrest Gump, le héros étant un homme ordinaire, pas particulièrement futé, mais qui va se trouver mêlé à une série d'événements importants, sans l'avoir voulu. Par contre, ici, on ne nous propose aucun trucage numérique faisant croire que le héros a rencontré des personnages réels. Ceux-ci sont incarnés par des acteurs.
C'est un petit bijou pince-sans-rire, mais, attention, hein, pas aussi léger qu'une production anglaise. L'humour "à froid" est lesté de façon scandinave. Mais, quand on aime, c'est un régal !
Mine de rien, l'enfance du héros est l'occasion de rappeler quelques vérités sur un pays qui n'était pas encore le paradis de la social-démocratie. Paternalisme, puritanisme protestant et cupidité faisaient des ravages. Le jeune Allan le vit bien, même s'il perd successivement son père et sa mère. Il s'est découvert une passion pour les explosifs, ce qui va le conduire à se venger, involontairement, d'un commerçant malhonnête.
Sa vie sentimentale s'est arrêtée à peu près au moment où elle commençait, grâce à un médecin racialiste et eugéniste, comme la Suède et d'autres pays européens en ont connu dans l'Entre-deux-guerres.
Allan a à peine le temps de s'insérer sur le marché du travail et de se faire ses premiers amis qu'il se retrouve embarqué dans la Guerre d'Espagne, où ses talents d'artificier vont trouver à s'exercer. Cela ne l'empêche pas, à la fin du conflit, de se retrouver à la table de Franco, auquel il a sauvé la vie dans des circonstances que je vous laisse découvrir. Au cours du banquet, le dictateur en vient à porter un toast au meilleur ami disparu d'Allan... qui était un communiste !
Tous ces moments savoureux nous sont livrés par des retours en arrière. Le coeur de l'intrigue est l'époque contemporaine. Allan est centenaire, mais il n'a pas envie de célébrer ce siècle d'existence. Il met donc au point une spectaculaire évasion de la maison de retraite où il est parqué. Bruce Willis n'aurait pas fait mieux !
Et puis, une chose en entraînant une autre, une intrigue drôle et primesautière se développe, chaque scène rebondissant sur la précédente. C'est de voir et entendre un gamin jouer avec des pétards qui a incité le papy à se faire la belle. C'est la bêtise d'un crâne rasé victime d'une "courante" qui le pousse à lui dérober sa valise pour partir Dieu sait où.
Allan fait la rencontre d'un autre vieillard solitaire (beaucoup plus jeune que lui, ceci dit). Les deux pépés vont partir à l'aventure, lestés de cette valise qui semble susciter bien des convoitises. Le portrait du groupe de malfrats qui part à leur poursuite mérite à lui seul le détour.
La petite troupe va s'agrandir d'un étudiant professionnel, d'une femme isolée... et d'un éléphant, qui va se révéler très utile !
Entre temps, les retours en arrière nous auront montré le rôle capital joué par Allan dans la création de la bombe atomique, puis son action trouble pendant la Guerre froide. Etait-il un agent double, triple, quadruple ? Nul ne le sait... surtout pas lui ! Il a au moins profité de sa position pour sa saouler à volonté !
Je me garderai bien de dire comment tout cela se termine. En tout cas, c'est pour moi la comédie à voir en ce moment.
22:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
vendredi, 06 juin 2014
Maléfique
Disney revisite Charles Perrault (cité au tout début du générique de fin)... pour les beaux yeux d'Angelina Jolie, qui a visiblement pris beaucoup de plaisir à incarner une "méchante"... sur un fond vert. L'idée de départ est excellente : nous conter non pas l'histoire de la belle au bois dormant, mais celle de la sorcière... qui n'en a pas toujours été une.
Nous voilà embarqués dans le récit de la jeunesse d'une fée protectrice de sa contrée, menacée par les humains cupides et violents. A grand renfort d'effets spéciaux, on nous montre les impressionnants pouvoirs de la gamine puis de la jeune femme, le tout baignant dans une ambiance de merveilleux qui rappelle aussi bien certaines productions Disney que des classiques d'heroic fantasy.
Je mets toutefois un bémol à mon éloge de l'aspect technique. A trois reprises, au moins, on sent le côté artificiel (recomposé si vous préférez) de certaines scènes. On perçoit l'aspect surimposition, par exemple quand la jeune Maléfique rencontre l'humain dont elle va tomber amoureuse, ou encore à la fin, quand Aurore (une blondasse insipide) retrouve son prince charmant (tout droit sorti d'un boys' band).
Entre ces deux moments, l'histoire est tout à tour sombre et porteuse d'espoir. Elle est effroyable quand elle nous montre la "chute" de la fée. Elle est belle quand elle évoque le lent changement qui s'opère à l'intérieur de celle-ci, au fur et à mesure qu'elle s'attache à la jeune fille qu'elle a pourtant maudite.
Angelina Jolie est parfaite dans le rôle-titre, anguleuse à souhaits, très expressive. Face à elle, Sharlto Copley assure davantage en roi décadent qu'en jeune homme arriviste. (Il était meilleur dans Elysium et surtout dans District 9.) Au niveau des seconds rôles, je retiens Sam Riley et surtout les trois petites fées chargées de la gamine, parmi lesquelles se distingue particulièrement Imelda Staunton... oui, la Dolorès Ombrage d'Harry Potter !
La partie animation est vraiment de qualité (si on laisse de côté les deux-trois scènes dont j'ai parlé plus haut). Les décors sont superbes et les personnages qui peuplent le monde de Maléfique sont très réussis. J'ai particulièrement apprécié le corbeau, compagnon de vengeance de l'héroïne, auquel il ne manque vraiment que la parole !
21:08 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 05 juin 2014
The Homesman
Ce nouveau film de Tommy Lee Jones joue à la fois sur les mythes (celui de la frontière, des pionniers) et sur l'histoire intime (celle d'une femme indépendante et pieuse, celle de couples qui partent en vrille et celle d'un vieil égoïste alcoolique).
On peut tout de suite souligner la qualité de l'interprétation, en particulier celle d'Hilary Swank, qui porte littéralement le film sur les épaules. Habilement, Tommy Lee Jones se glisse dans le rôle du faire-valoir, accompagné par une brochette d'acteurs épatants, auxquels on peut ajouter, sur la fin, notre chère Meryl Streep, qui vient faire coucou en épouse de pasteur philanthrope.
Évidemment, les deux individus que tout sépare vont petit à petit se rapprocher. La pionnière autoritaire s'adoucit, montre ses failles et le voleur goguenard se surprend à faire preuve d'un peu d'humanisme. Le chemin parcouru ensemble (avec les trois épouses rendues dingues par les conditions de vie du trou perdu où on les avait envoyées) n'est pas que matériel.
Il faut dire que les héros ont intérêt à se serrer un peu les coudes. Le voyage relie le Nebraska (qui n'est à l'époque qu'un territoire) à l'Iowa (qui a obtenu le statut d’État quelques années auparavant) :
La région grouille de personnes sans foi ni loi et, parfois, les Indiens sont de la partie. Ce ne sont pas les moins dangereux.
Tout ce petit monde semble se diriger vers une destination prévisible... eh bien non. Vers les trois-quarts du film, un événement inattendu survient, qui change la trame de l'histoire. Elle n'en devient que plus poignante... et forte.
22:54 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
D-Day - Normandie 1944
Sorti fort à propos, ce moyen-métrage (de 45 minutes environ) en 3D mêle rigueur historique et technologie de pointe. Plusieurs types d'images sont représentés. On trouve des vues aériennes de la Normandie, des images d'époque (je pense notamment aux abords des plages du Débarquement, avec la présence des dirigeables... c'est très joli en 3D), des scènes jouées et de l'infographie comme ces cartes montrées en plongée et que l'on voit s'animer au fur et à mesure que l'entreprise des Alliés réussit.
C'est propre et bien fait. Le commentaire de François Cluzet s'insère parfaitement dans le film... mais, en dépit de ces qualités, je n'ai pas été emballé. D'abord, j'ai vraiment du mal avec ces lunettes 3D qui obscurcissent ce qui se trouve à l'écran. Ensuite, j'ai trouvé le contenu assez basique, voire banal. A ceux qui ont suivi jadis les cérémonies du cinquantième anniversaire, cela apparaîtra un peu fade. Mais c'est visiblement le (très) grand public que l'on a cherché à toucher.
00:35 Publié dans Cinéma, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire
dimanche, 01 juin 2014
L'Ile de Giovanni
Ce manga croise l'histoire japonaise avec une oeuvre de fiction, Train de nuit dans la voie lactée. C'était le livre préféré de la mère des héros (deux garçons, dont les prénoms sont inspirés de l'oeuvre). Il est devenu le leur et une source de rêveries (superbement matérialisées à l'écran).
Mais l'action du film démarre en 1945. Nous sommes sur l'île de Shikotan, située au nord du Japon, juste à côté d'Hokkaido. La guerre finit par arriver sous la forme d'un bombardement américain... puis des bateaux soviétiques.
L'animation (qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle au niveau des personnages... ça ressemble à du manga "de consommation courante") est suffisamment habile pour permettre aux spectateurs de comprendre l'étonnement des Japonais (encore plus des enfants) devant ces grands soldats blonds (ou bruns) qui débarquent et prennent possession de l'île.
La suite de l'histoire montre les sentiments ambivalents des enfants qui, à l'image du reste de la population, souffrent des pénuries diverses, mais qui nouent une drôle d'amitié avec la fille du commandant, une jolie blonde tout aussi fascinée qu'eux par les trains. Cela nous vaut une scène magnifique autour d'un petit train électrique, de nuit, entre les deux parties de la maison, brièvement réunies. (C'est évidemment une métaphore de la situation des îles Kouriles, que la Russie contrôle toujours aujourd'hui.)
J'apprécie aussi que, bien qu'ayant vu le film en version française, on ait pris soin de laisser les dialogues russes, qui sont donc sous-titrés. Je vous assure que cela n'a nullement gêné les bambins présents dans la salle. De la même manière, on a permis à nos oreilles occidentales de profiter aussi bien des chants japonais que des russes, entonnés à l'école primaire, dans deux classes voisines.
L'histoire prend un tour tragique quand l'expulsion des habitants est décidée. Ceux-ci ne sont pas directement envoyés au Japon. C'est le début d'un périple, qui voit les garçons partir à la recherche de leur père, plus ou moins aidés par leur oncle, un drôle de type, franchement magouilleur, qui rappellera bien des personnages comiques aux amateurs de mangas.
L'histoire ne s'arrête pas aux années 1940. Une séquence nous montre certains des protagonistes, au début du XXIe siècle. C'est à la fois mélancolique et porteur d'espoir.
12:22 Publié dans Cinéma, Histoire, Japon | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film, histoire
samedi, 31 mai 2014
Les Chèvres de ma mère
Cette mère est Marguerite Audier, éleveuse de chèvres dans le Var, sur le plateau de Saint-Maymes, dans une ancienne commanderie templière créée au XIIe siècle, où elle et son compagnon tiennent aussi un gîte :
La fille n'est pas Anne-Sophie, l'agricultrice qui veut reprendre la ferme, mais la réalisatrice, Sophie Audier. Dans le passionnant dossier de presse accessible sur le site Jour2Fête, elle explique son parcours et pourquoi elle a choisi de ne pas succéder à sa mère. Il n'en est quasiment pas question dans le film, qui se concentre sur les relations entre la future retraitée et la future exploitante, qui veut s'installer avec son conjoint, qui élève des ovins. (On le voit un petit peu, en fin de film.)
"Maguy" est une éleveuse atypique. Elle n'est pas issue du monde agricole et a débuté en 1973, à partir de rien. Elle et son compagnon sont sans doute d'anciens "babas cools", qui ont refusé le monde moderne et ses contraintes. La traite et la fabrication de fromages (réputés dans la région) se font donc à l'ancienne. L'un des intérêts du documentaire est de confronter les générations et les points de vue. A l'écran, on ne nous montre pas de conflit tranché, juste quelques divergences de point de vue. Les deux femmes semblent assez bien s'accorder.
J'ai été particulièrement sensible à la qualité de l'image. Les paysages de montagne sont magnifiques et les bêtes sont très bien filmées. Chèvres, bouc, chevreaux, âne "passent bien" à l'écran... y compris la chatte dont, à un moment, rien ne laisse deviner la présence, avant que l'on entende son ronronnement grave, puis que l'on voie la pointe de ses oreilles ! Cet aspect bucolique ne masque cependant pas les difficultés de la vie paysanne dans ce milieu : entre la conduite du troupeau, les mises bas et le retour des loups, il y a de quoi s'inquiéter.
Si les deux femmes sont calmes, c'est la plus ancienne, Maguy, qui s'affirme le plus dans le documentaire. On sent la femme de convictions, qui, patiemment, a su construire sa vie autour de son projet professionnel. La jeune Anne-Sophie a plus de mal à s'affirmer... d'autant qu'elle est filmée par la fille de l'agricultrice. Mais c'est dans la dernière partie du film qu'on la sent le plus en difficulté : les tracasseries administratives remettent en question son installation.
Et puis il y a ce moment d'émotion intense, quand Maguy se sépare de la majorité de ses bêtes (elle en garde quelques-unes : les chèvres les moins bien conformées et le magnifique âne). On est ému avec elle.
C'est vraiment un beau film.
12:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
vendredi, 30 mai 2014
Leçons d'harmonie
C'est un nouveau film coup-de-de-poing qui traite de la jeunesse et de la violence à laquelle elle est confrontée. Récemment, on a pu voir Le Grand Cahier et j'espère qu'un jour ou l'autre, à Rodez (ou pas trop loin), on pourra voir au moins l'un des deux films sud-coréens qui traitent d'un sujet similaire.
Ici, l'action se déroule au Kazakhstan, dans deux lieux différents : la ferme (où le jeune Aslan vit en compagnie de sa grand-mère, une paysanne pauvre) et le collège public, où sévit un racket sévère.
Le héros est un gamin maigrichon et mutique. C'est donc un souffre-douleur tout désigné pour les gros blaireaux du collège. A la suite d'une plaisanterie bien crade, il est mis à l'écart. D'un côté, ça le retranche dans sa solitude. De l'autre, ça le protège des brimades quotidiennes. Le gamin se jette à corps perdu dans le travail scolaire, y voyant l'occasion d'apprendre de quoi mettre au point sa vengeance.
Il se révèle doué en sciences... et habile de ses mains, lors des séances de travaux mécaniques. Il se fait même des amis... à leurs risques et périls.
Les jeunes acteurs sont en général étonnamment bons, notamment les divers harceleurs et racketteurs (parce qu'il y a plusieurs groupes de racket...). Par contre, les dialogues ne m'ont pas paru d'une incroyable richesse. Le réalisateur Emir Baigazin est toutefois habile à transmettre l'information par le biais de l'image, du cadrage, de la mise en scène.
Cela donne une oeuvre âpre, sur un monde cruel. Le gamin n'est pas tendre avec les animaux... en attendant mieux. Au collège, on se retrouve face à une hiérarchie parallèle, les adultes paraissant complètement à côté de la plaque. Et que dire des séances de cours... Est-ce vraiment ainsi que cela se passe ? Si tel est le cas, je plains les pauvres gamins !
Dans la seconde partie, l'auteur nous gratifie de deux ellipses, qui nous épargnent deux moments particulièrement sanglants, mais qui jouent un rôle crucial dans l'intrigue. Tout le travail des scènes suivantes est de nous faire comprendre ce qui s'est réellement passé un soir, après les cours, puis une autre nuit, dans une cellule.
C'est très fort... et pas du tout optimiste sur la nature humaine
22:31 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
jeudi, 29 mai 2014
X-Men - Days of Future Past
Bryan Singer a repris en main la franchise de super-héros, après quelques escapades plus ou moins réussies (son Walkyrie était correct, mais pas enthousiasmant).
L'intrigue croise le passé (le début des années 1970) et le futur (un monde dominé par les sentinelles, dans lequel les mutants sont pourchassés sans répit). A l'écran, cela donne un contraste saisissant entre les séquences sombres (marquées par le noir, le marron, mais aussi les teintes bleutées et rougeâtres), et les séquences lumineuses (celles des années 1970), pourtant souvent violentes elles aussi, mais porteuses d'espoir.
On retrouve donc à la fois certains vétérans de l'équipe (dans le futur), accompagnés de personnages inconnus de ceux qui ne lisent pas les comics (l'un étant incarné par Omar Sy)... et certains personnages des années 1970 (guidés par Wolverine), qui doivent s'allier à Magneto pour empêcher Raven/Mystique de commettre l'irréparable.
Au départ, on est dans le film de super-héros, efficace, sans plus. Mais il prend une autre épaisseur à partir de la séquence qui montre la délivrance de Magneto. Au niveau de la mise en scène, c'est éblouissant. L'introduction du personnage de Vif-Argent (incarné par Evan Peters) donne un coup de fouet à l'histoire, qui prend aussi parfois un tour comique fort bienvenu.
Par contre, les scènes de dialogue qui font intervenir Charles Xavier ne m'ont pas emballé du tout. Comme dans X-Men - Le Commencement, j'ai un problème avec l'acteur James McAvoy (ou celui qui le double en français). Si l'introduction de temps morts dans l'action se justifie, je trouve qu'ils sont trop nombreux (ou qu'on fait trop durer certains d'entre eux). La dynamique du film aurait gagné à ce qu'il soit un peu plus "resserré".
Au niveau de l'intrigue, on notera la grande place jouée par le personnage de Mystique, auquel Jennifer Lawrence prête sa plastique irréprochable... et peut-être sa souplesse, si elle n'a pas été doublée pour les scènes de bagarre (ce dont je doute).
Sur le fond, il est question de vengeance et de tolérance, un propos pas idiot, servi par une production à grand spectacle, qui culmine, en même temps, aux deux époques, pas deux séquences très réussies : l'utilisation d'un stade par Magneto et l'assaut mené par les sentinelles contre le dernier refuge des mutants. Même si le film abuse du "juste à temps", cela reste un très bon spectacle.
13:04 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
dimanche, 25 mai 2014
Maps to the stars
Le dernier film de David Cronenberg nous plonge dans le quotidien d'artisans plus ou moins prestigieux du rêve hollywoodien. Attention toutefois : ce n'est pas la satire cinglante que les frères Coen ou un Quentin Tarantino auraient pu réaliser. Ce portrait acrimonieux est nourri des obsessions de Cronenberg, ce qui fait du film une œuvre étrange, originale certes, mais pas franchement réjouissante.
Disons tout de suite qu'un double inceste est au cœur de l'intrigue. S'ajoutent à cela la schizophrénie de certains personnages et l'ambition de "faire son trou" à Hollywood. Saupoudrez le tout de sourires de façade, de jalousie féroce et de culte de l'apparence et vous aurez une idée de l'ambiance dans laquelle baigne l'intrigue. Ah, j'ai failli oublier le rôle de l'alcool et des drogues diverses...
Du côté de l'interprétation, il n'y a rien à dire : c'est impeccable. Julianne Moore vient de décrocher à Cannes un prix d'interprétation mérité. On la sent très "engagée" (y compris physiquement...) dans un rôle un peu ingrat, celui d'une ancienne vedette qui cherche à revenir sur le devant de la scène, malgré le poids des ans et ses angoisses existentielles.
Étant donné ce que l'on voit à l'écran et ce que Cronenberg a imposé à son actrice principale, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas une part personnelle dans son interprétation. Celle qui, ces dernières années, déplorait les ravages de la chirurgie esthétique chez ses collègues semble y avoir recouru au niveau des lèvres... La présence au générique de Carrie Fisher (qui fut la princesse Leia, dans Star Wars), dans son propre rôle, est aussi un clin d’œil au temps qui passe.
J'ai été encore plus emballé par l'interprétation de Mia Wasikowska, remarquée il y a peu dans Albert Nobbs. Elle incarne une jeune femme psychologiquement fragile, rescapée d'un incendie qui l'a partiellement défigurée et dont les séquelles sont présentes sur son corps. (On reconnaît bien là Cronenberg.) Du coup, elle ne montre qu'une partie de son visage et de son cou, le reste étant soigneusement dissimulé aux regards... mais enrobé de telle manière (collants, gants longs...) qu'elle en est extrêmement désirable. (C'est le moment de signaler que les "costumes" ont été très bien choisis.)
Sur le fond, l'histoire est assez ironique dans la première partie du film, avant que les aspects sombres ne prennent le dessus dans la seconde. Ni le coach personnel, ni les acteurs (jeunes comme vieux), ni les producteurs ne trouvent grâce aux yeux de Cronenberg.
12:16 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film
samedi, 24 mai 2014
Conversation animée avec Chomsky
C'est le genre de film qui réunit des publics aux motivations diverses. Il y a ceux qui viennent voir la nouvelle oeuvre de l'un des cinéastes les plus doués de sa génération (l'auteur de Eternel Sunshine of the spotless mind, de La Science des rêves et de Be kind rewind). Il y ceux (pas très nombreux, à mon avis) qui sont arrivés là portés par le souffle de la linguistique générative... et puis il y a tout une mouvance contestataire, qui a trouvé en lui un intellectuel indépendant, devenu une sorte d'icône de la gauche de la gauche. C'est sans doute la frange la plus importante de son public.
A l'Utopia de Toulouse où j'ai vu le film, la salle était pleine... et pleine de jeunes adultes à la coiffure approximative et aux vêtements colorés. De temps à autre, un keffieh apparaissait autour d'une gorge.
J'ai eu peur.
Heureusement, ceux qui étaient assis autour de moi étaient sages et assez propres. J'ai donc pu profiter pleinement du film. Et il faut dire qu'une certaine concentration est nécessaire pour suivre à la fois les méandres de la pensée chomskyenne et les délires graphiques de Michel Gondry. En général, l'image est constituée d'une scène réelle, qui est intégrée à une animation plus ou moins foisonnante.
Il y a bien sûr un lien entre les inventions de Gondry et ce que Chomsky est en train de raconter. J'ai en mémoire le moment où il parle de son enfance et de sa scolarité dans un établissement novateur (un peu du genre de ceux du système Freinet, je pense). Comme il s'est révélé être un élève doué, on lui a fait sauter une classe. A l'écran, cela donne un jeu de cubes comme les enfants en manipulent tant. Sur chacun d'entre eux est inscrit l'une des lettres du mot "school" (école, en anglais). On voit l'un des cubes passer au dessus de l'autre !
A un autre moment, il est question d'astronomie et même d'astrologie. Chomsky évoque divers scientifiques, notamment Isaac Newton. Gondry choisit de nous dessiner le visage du physicien, tel qu'on le connaît en Occident, avec sa perruque à rouleaux... et il fait se mouvoir des planètes tout autour... voire à l'intérieur des rouleaux !
Notons que le réalisateur s'adresse régulièrement à son public. Il exprime ses doutes, explique sa méthode et se lance parfois dans un petit cours d'animation :
Il est finalement peu question de la politique contemporaine dans ce film. C'est plutôt la vie personnelle de Chomsky que Gondry a choisi d'illustrer. L'homme révèle adorer ses enfants et petits-enfants qui, depuis le décès de son épouse, constituent sa meilleure raison de vivre. On sent par contre l'homme engagé déçu par l'évolution du monde contemporain.
L'une des gageures était de rendre intelligibles les recherches en linguistique de Chomsky. Franchement, je ne pense pas avoir tout compris. C'est parfois assez ardu et j'avoue que, de temps à autre, j'ai moins prêté l'oreille pour jouir du spectacle déployé à l'écran.
Je pense que Gondry atteint quand même son but quand il prend l'exemple de la phrase "The man who is tall is happy." et de sa transformation en interrogation "Is the man who is tall happy ?". L'illustration permet de comprendre pourquoi la phrase ne se structure pas en mots indépendants mais en groupes de mots. D'après Chomsky, l'enfant qui veut passer à la forme interrogative choisit naturellement de déplacer le second "is" de la phrase et pas le premier. Il a suivi une logique structurelle et pas de proximité.
Au final, cela donne une oeuvre ambitieuse et un peu foutraque, qui nécessite sans doute deux visions pour bien en comprendre tous les ressorts. (On surveillera la sortie en DVD.)
00:34 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, cinema, film